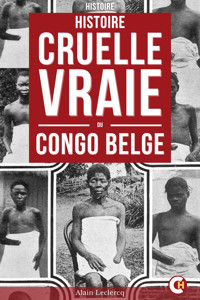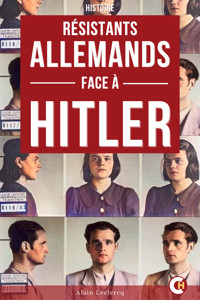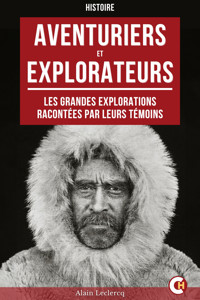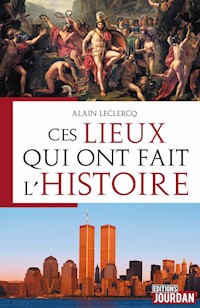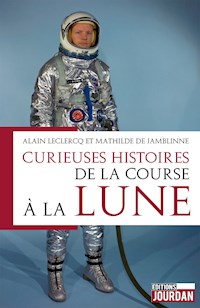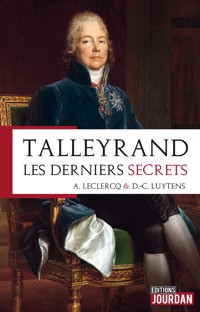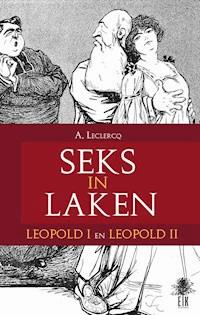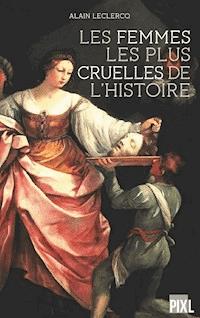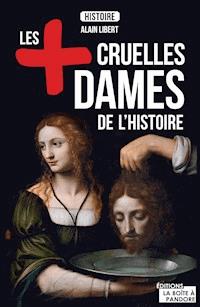Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Clandestins, espions, saboteurs; une véritable guerre dans la guerre ! Missions clandestines, services de sabotage, espionnage et contre-espionnage, renseignements et faits de résistance... Une véritable guerre secrète, méconnue, s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, tant dans les services secrets officiels que dans les organismes clandestins. Des destins exceptionnels, des hommes et des femmes tapis dans l'ombre, parmi lesquels : - Claire Philips, qui a ouvert aux Philippines un cabaret pour pouvoir soutirer au mieux des informations aux soldats japonais qui le fréquentaient. - Josefina, l'espionne lépreuse, qui effrayait par ses cicatrices les officiers de garde qui, dès lors, ne la fouillaient pas. - William Stephenson, qui a dirigé l'un des plus grands réseaux mondiaux de services secrets, sous la couverture d'un directeur du contrle des passeports britanniques. - le professeur Zapp, qui a mis au point un système de micropoints pour faire passer des messages invisibles à l'oeil nu. - Ernie Lehmitz, qui a été trahi par son écriture. ...et bien d'autres encore! Découvrez sans plus attendre l'histoire de ces espions qui ont mené une véritable guerre parallèle durant la Seconde Guerre Mondiale. EXTRAIT Octobre 1940, le gouvernement du général Franco demanda un visa pour les îles britanniques en faveur d'un phalangiste. Ce personnage s'occupait de mouvements de jeunesse en Espagne et souhaitait étudier le scoutisme britannique en temps de guerre. Le Foreign Office répondit favorablement et l'homme put entrer en Grande-Bretagne. Or, les services de contre-espionnage anglais savaient tout de lui, entre autres que ce qu'il verrait ou entendrait serait immédiatement transmis à Berlin. Il devint l'espion préféré des Anglais qui lui manifestèrent une affection débordante. Certains espions jouèrent le rle de dirigeants scouts. Ils allèrent l'accueillir à l'aéroport et l'accompagnèrent à l'htel Athenaeum Court o ils lui avaient réservé une suite. L'endroit était littéralement truffé de microphones invisibles et de fils reliés aux tables d'écoute: c'était un chef-d'œuvre du genre. En revanche, ils approvisionnèrent leur hte en boissons variées et, de façon générale, ils ne le laissèrent manquer de rien. À l'époque, il devait y avoir en tout et pour tout trois batteries lourdes anti-aériennes dans la région londonienne. L'une d'elles fut placée dans le jardin public qui fait face à l'htel Athenaeum Court. Elle reçut l'ordre de tirer sans interruption et à la cadence la plus rapide au cours de chaque alerte, qu'il y eût ou non des avions ennemis dans le ciel de la capitale. Ces pièces accomplirent au mieux leur mission. Comme il y avait alors au moins un raid aérien chaque nuit, l'espion passait des heures tapi dans un abri et persuadé par le tintamarre que Londres était hérissée de canons de D.C.A. Ses homologues s'arrangèrent pour lui faire visiter la batterie postée sous ses fenêtres - c'était un remarquable dispositif, équipé de pièces de quatre-vingt-dix millimètres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Éditions Jourdan
Paris
http://www.editionsjourdan.fr
Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-332-9 – EAN : 9782390093329
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Alain Leclercq
1939-1945
espionnage
et
guerre secrète
La Seconde Guerre mondiale a été le théâtre de nombreuses batailles, de nombreux sièges, de désastres et de drames, et ce, aux quatre coins du globe. À côté de ces grands faits d’armes, ou de ces grandes défaites, s’est menée une autre guerre, dans l’ombre des militaires.
Des milliers d’hommes et de femmes se sont ainsi battus, tant dans les services secrets officiels que dans les organismes clandestins nés de la guerre. Comme sur les champs de bataille, les risques qu’ils couraient étaient énormes et le courage en proportion. Ce livre, à travers les épisodes les plus caractéristiques de cette forme de guerre, raconte l’histoire de quelques uns de ces combattants de l’ombre.
Hans Petersen, le « plus dangereux cambrioleur » du Danemark
Le Danemark d’avant-guerre comptait beaucoup de voleurs de petite envergure, mais peu de vrais criminels : cela fait donc sensation quand on se met à parler de Hans Petersen comme du plus dangereux cambrioleur du pays. Bien que, sur les quarante années de sa vie, il en eût passé une vingtaine en prison, il n’était pas aussi effrayant que sa réputation le laissait entendre et l’honneur de sa profession lui interdisait de s’abaisser à commettre de vulgaires larcins ou à faire du mal à qui que ce soit.
Petersen s’était spécialisé dans les antiquités. Chaque fois qu’il dévalisait une maison, il avait coutume, dès le lendemain, d’envoyer un compte-rendu circonstancié à la presse et à la police, leur précisant très exactement quels objets il avait dérobés et quelle en était la valeur. S’il s’était introduit chez une personne de mauvais goût, il en faisait également état, et souvent il dénonçait comme faux certaines œuvres d’art très cotées.
Son exploit qui défraya le plus la chronique fut de passer un week-end au domicile du chef de la police pendant que ce dernier était à la campagne avec sa famille. Il raconte que c’était une fort jolie maison, mais que les sommiers s’affaissaient et que la vaisselle était ébréchée. Les Danois pardonnent presque tout, pourvu que cela les fasse rire et le pays tout entier se divertissait fort des aventures de ce cambrioleur que personne ne souhaitait voir derrière les barreaux. C’est pourtant ce qui finit par arriver.
Assurant lui-même sa propre défense, il dit aux juges que, lors d’un précédent séjour en prison, on lui avait promis de l’aider s’il rentrait dans le droit chemin, mais qu’à sa sortie du pénitencier, il n’avait reçu qu’un vieux pantalon. Sans aucun doute, l’homme était sincère et son amère déception l’avait fait se rebeller violemment contre la société. Il avoua qu’il avait emporté son butin à Londres, où il avait ouvert un magasin d’antiquités. Il en avait laissé la gérance à quelqu’un de confiance, sans l’informer de la manière dont le fonds avait été constitué.
L’écrivain et journaliste danoise Karin Michaelis prit la décision de lui offrir le soutien moral qui, de toute évidence, lui faisait si cruellement défaut, et lui promit qu’elle l’aiderait à repartir dans le droit chemin et à améliorer sa vie, de manière légale, quand il serait relâché. D’après ses lettres, il était manifeste qu’il rêvait de se ranger. Karin Michaelis alla trouver le roi pour solliciter sa grâce, ce à quoi il lui demanda si elle se rendait compte des dangers d’une telle mesure.
Elle lui répondit qu’elle n’avait aucune crainte et qu’elle hébergerait cet homme sous son propre toit jusqu’à ce qu’il ait montré au peuple danois qu’il comptait bien se conduire. Le monarque ne promit rien, mais, lorsque vint le jour de l’anniversaire royal, le cambrioleur fut gracié. Petersen écrivit qu’il ne serait pas chez Karin, dans l’île de Tura, avant une semaine : il avait quelques affaires à régler dans la ville voisine de Svendborg. Quand il arriva et que la mère de la journaliste le vit sortir de la voiture, bien mis, svelte, légèrement voûté, elle ne put croire que l’homme était un bandit, le prenant pour un universitaire.
Après le déjeuner, Karin emmena son hôte dans l’un des pavillons de son grand jardin, un lieu exigu, mais ensoleillé et plaisant. Il regarda autour de lui et sourit, content de l’accueil qui lui était si gentiment réservé. Il entreprit de défaire quelques élégantes valises tout en expliquant que ses malles arriveraient plus tard. En effet, il arriva plusieurs de ces malles cerclées de fer qui regorgeaient de précieux tapis d’Orient, de vases et de livres.
Un jour, Karin se rappela qu’il ne devait pas rester beaucoup de pétrole dans les lampes de son invité et en apporta une réserve. Quand elle frappa, il lui répondit, mais la fit attendre et, pendant tout ce temps, elle entendait un grand tintamarre de meubles qu’on déplace. Il finit tout de même par ouvrir. La pièce était métamorphosée par la présence d’objets d’art disposés avec beaucoup de goût.
Alors qu’elle l’interrogeait sur le temps d’attente et le bruit, il lui répondit d’une voix neutre qu’il avait barricadé la porte parce que ses anciens codétenus pouvaient, à tout moment, s’introduire chez lui et lui dérober ses œuvres d’art. Il avait, pour éviter ce souci, été à Svendborg pour souscrire une assurance contre le vol et ne serait tranquille qu’une fois celle-ci effective.
Hans Petersen savait plaire, et bientôt on l’invita partout dans l’île, même au presbytère, pour le café du dimanche après-midi. Il était parrain au baptême des enfants de la région et, lors des réceptions, il faisait le récit passionnant de ses cambriolages les plus audacieux. Il montrait comment crocheter les serrures avec une épingle à cheveux et comment se faufiler par une ouverture tout juste assez grande pour y passer la tête.
Durant la semaine, il restait généralement chez lui et travaillait à ses mémoires. Malheureusement, son style était si pompeux et son vocabulaire si pauvre que le manuscrit était d’une lecture fastidieuse. Au bout de quelques mois, il réalisa l’ambition qu’il nourrissait depuis longtemps : il ouvrit à Copenhague une sympathique librairie, spécialisée dans les éditions anciennes et rares. L’argent qu’il avait gagné en prison ne constituait pas un capital suffisant, mais des avocats, des membres de la police, des juges, et d’autres gens que son cas intéressait, firent une collecte.
Un jour, il rencontra une jeune et jolie femme qui travaillait dans un des plus gros cabinets juridiques de Copenhague et il en tomba amoureux. Son passé douteux ne lui nuisit apparemment en rien dans ses avances et leur mariage fut un événement important. Il fut célébré dans la demeure du président de la Cour suprême, qui invita ses collègues en grand nombre. Leur union fut une réussite et chaque année, pour l’anniversaire de sa grâce, Hans envoyait à Karin un petit cadeau accompagné d’un mot. Parfois, l’été, avec sa femme, il venait sur l’île passer un mois dans le pavillon. Il n’était pas seulement devenu un commerçant plein de zèle, mais aussi un mari attentionné et un homme tranquille et modeste. L’ex-voleur avait vraiment bien changé.
Puis les Allemands arrivèrent au Danemark. Ils savaient tout sur Hans, qui était sur la liste des gens qui pouvaient, à l’occasion, leur être utiles. Bientôt, on le vit partout en compagnie d’officiers allemands, allant même jusqu’à dîner et trinquer avec eux. Il portait un uniforme allemand magnifiquement coupé et affichait ses airs arrogants de jadis. Tous ses anciens amis étaient écœurés. Ils avaient rejoint la Résistance et gardaient en permanence le contact avec l’Angleterre, d’où ils recevaient directives et matériel pour les opérations de sabotage.
Sur l’île de Refshalö, les Allemands s’étaient emparés d’une grosse usine de pièces détachées d’avion, qu’ils faisaient tourner pour leur compte. La Résistance décida de la détruire. Des centaines de personnes travaillèrent sur le projet et beaucoup se firent embaucher à la fabrique ; d’autres organisèrent des accidents de voiture, des émeutes et de fausses alertes à l’incendie dans Copenhague, pour détourner l’attention de la police allemande au moment de l’opération. On décida qu’elle aurait lieu par une nuit sans lune. Des résistants devaient s’occuper des sentinelles allemandes chargées de surveiller l’usine. On y avait clandestinement introduit de la dynamite et elle était prête à servir. L’heure H approchait. C’est alors que ce plan, si bien élaboré, sembla sur le point d’échouer. Les saboteurs eurent beau faire, ils ne parvinrent pas à ouvrir les verrous spéciaux dont étaient équipées les immenses portes blindées à l’entrée de l’usine.
Deux jours avant la date convenue, l’un des chefs de la Résistance reçut un message. Il en avait déjà eu d’autres de la même écriture, qui donnaient des renseignements sur les plans allemands, mais personne ne connaissait leur auteur. Celui-ci, toutefois, était signé. Je me trouverai devant l’usine à minuit dans deux jours, disait-il. Je porterai un uniforme allemand. J’ouvrirai les verrous.H. P. Les saboteurs pouvaient-ils lui faire confiance ? En désespoir de cause, ils décidèrent de courir le risque et de l’attendre. À l’heure dite, il arriva, vêtu en nazi. Les sentinelles allemandes les plus proches avaient été on ne peut mieux réduites au silence. Le groupe des dynamiteurs, massé aux portes dans l’obscurité, avait, pour quelques instants, le champ libre.
Je suis ici pour tenir ma promesse, dit calmement H. P. Je ne vous demande qu’une chose : si jamais il m’arrivait malheur, veillez à ce que mon nom soit blanchi. Ma femme... Il s’interrompit et, se penchant sur le verrou, se mit à l’œuvre. En trois minutes, la porte s’ouvrit toute grande. Il aurait pu alors partir en toute tranquillité, mais il ne le voulut pas, insistant pour allumer lui-même une des mèches.
Tout était prêt. Au signal, les hommes se dispersèrent rapidement pour gagner leurs postes ; il y eut une attente pesante. Puis, un à un, les dynamiteurs sortirent en courant du bâtiment. Hors d’atteinte, ils regardèrent la formidable explosion qui entrouvrait la terre et embrasait le ciel à des kilomètres à la ronde. Il ne resta rien de l’usine que des machines informes et des gravats. Mais, si Hans Petersen avait su venir à bout rapidement de la serrure, il se montra trop lent comme dynamiteur. Il fut le seul à ne pas reparaître. Ce fut une fin grandiose. D’une certaine manière, on peut imaginer que c’est celle qu’il avait choisie...
William Stephenson et les agents de la B.S.C.
Lorsque Ernest W. Bavin téléphona chez lui, à Ottawa, un soir de mars 1941, sa femme, au cours de la conversation, l’informa que Eleanor Fleming, une amie de la famille, était venue d’Oshawa, dans l’Ontario, lui rendre visite et qu’elle cherchait un travail en rapport avec la guerre. Bavin répondit à cela qu’il avait justement quelque chose pour elle. Retiré depuis peu de la police montée canadienne, il se trouvait à New York, par suite d’une mystérieuse affectation, pour la durée des hostilités.
Quinze jours plus tard, miss Fleming, qui s’était rendue au Rockefeller Center de New York, 630, Cinquième Avenue, fut conduite au trente-sixième étage ; elle franchit une porte gardée par une sentinelle en armes et pénétra dans la British Security Coordination ou B.S.C. On lui fit signer un exemplaire de la loi régissant les secrets d’État en Grande-Bretagne et elle se mit au travail.
Officiellement, son bureau était une filiale de la commission d’achats britannique. Il s’agissait en fait de la section de la sûreté navale de la B.S.C. qui, dans les coulisses, assurait la protection des marchandises britanniques dans les docks de New York et le maintien des livraisons massives de matériel de guerre à la Grande-Bretagne. De la coïncidence de sa visite à Ottawa et du coup de téléphone de Bavin, il résultait qu’Eleanor Fleming se trouvait engagée dans la B.S.C., organisation qui dirigeait l’Intelligence Service dans tout l’hémisphère occidental et qui représentait une part importante de l’effort de guerre du Canada.
Elle avait été créée par le Canadien William Stephenson et son personnel était également en grande partie canadien : cadres supérieurs détachés de leurs entreprises et autres employés, parmi lesquels huit cents Canadiennes. Stephenson ne pouvait pas engager d’Américains pour les Renseignements britanniques et beaucoup de sujets britanniques n’étaient pas suffisamment familiarisés avec les habitudes américaines. Les Canadiens, eux, présentaient les qualifications requises : leur pays était en guerre, ils comprenaient les Américains aussi bien que les Britanniques et ils étaient nombreux dans la région de New York.
Certaines Canadiennes, comme Eleanor Fleming, entrèrent à la B.S.C. presque par hasard. D’autres — parmi lesquelles Grace Garner, rédactrice d’un magazine de Toronto, qui devint la principale secrétaire particulière de Stephenson — avaient répondu à une offre d’emploi. Elles ne s’aperçurent pas tout de suite qu’elles faisaient partie d’un service secret. Selon miss Fleming, la B.S.C. s’entourait de telles précautions que pendant longtemps, dira-t-elle, j’étais comme une ouvrière travaillant à une chaîne de montage, qui serre quelques boulons et quelques écrous sans savoir quel est le produit fini.
Elle ignorait même qui était à la tête de la B.S.C. : c’était quelqu’un qu’on appelait simplement le directeur. Elle posa un jour la question à Bavin qui lui répondit qu’ils n’en parlaient jamais, qu’ils n’abordaient jamais ce sujet. Quand elle le découvrit, ce nom ne signifia rien pour elle, pas plus d’ailleurs que pour les autres employées canadiennes de la B.S.C. qui travaillaient à New York et à Washington, Lima, Caracas, La Paz, Port of Spain et ailleurs. Elles devaient apprendre plus tard que William Samuel Stephenson était un maître de l’espionnage.
Qui était William Stephenson ? Cet homme de 45 ans, né à Winnipeg — un as de l’aviation alliée lors de la Première Guerre mondiale —, était l’inventeur d’une machine permettant de transmettre des photographies par radio et avait fait fortune avant d’atteindre la trentaine. Par la suite, il s’était fixé en Grande-Bretagne, avait beaucoup voyagé et fréquenté des personnalités éminentes par leur culture ou leurs fonctions.
Presque personne ne prêta d’intérêt à ce qu’il savait des préparatifs de l’Allemagne en vue du conflit qui se dessinait, à l’exception de Winston Churchill qui le considéra très vite comme principale source de documentation pour ses discours. Cela, dira-t-il plus tard, fut mon seul entraînement à l’espionnage. En dépit de son manque de formation théorique, Stephenson commanda une organisation chargée de repérer les taupes et les circuits de contrebande, de s’introduire dans les ambassades étrangères pour s’emparer des codes et des chiffres diplomatiques, de forger des agents pour le renseignement et les opérations subversives en territoires sous contrôle ennemi.
Il s’était rendu aux États-Unis au début de 1940 pour établir des relations au plus haut niveau entre le Secret Intelligence Service britannique (SIS) et le Federal Bureau of Investigation américaine (F.B.I.). Il rencontra J. Edgar Hoover, directeur du F.B.I., et sa proposition fut transmise au président Roosevelt qui accueillit favorablement l’idée d’un mariage le plus étroit possible entre eux. Étant donné le profond courant antibritannique existant aux États-Unis, encore neutre à cette époque, le Département d’État américain ne fut même pas informé de cette coopération.
Stephenson envisageait d’assigner à l’éventuelle organisation britannique aux États-Unis des responsabilités étendues : non seulement elle recueillerait des renseignements secrets, mais elle devrait aussi s’efforcer d’assurer une assistance suffisante à la Grande-Bretagne, de combattre la subversion allemande dans tout l’hémisphère occidental et d’amener les Américains à entrer en guerre. C’est exactement ce programme que le SIS lui demanda de réaliser. Sa couverture serait le poste de directeur du contrôle des passeports britanniques à New York. Il obtint un délai de réflexion et prit conseil chez Churchill, qui était devenu Premier ministre et lui dit d’accepter.
Stephenson partit donc vers le milieu de l’année 1940, alors que la France était au bord de la défaite et que le Commonwealth demeurait seul contre les nazis. Il était le représentant personnel de Churchill. Partout où il le pouvait, il ralliait des partisans à la Grande-Bretagne. Afin d’établir une ligne de contact direct avec le président Roosevelt, il s’acquit l’appui de William J. Donovan (dit Wild Bill, Bill le Sauvage), avocat new-yorkais qui entretenait d’importantes relations dans les cercles de l’Administration.
Donovan, écrivait Stephenson à Londres, exerce une influence prépondérante sur le secrétaire d’État à la Marine américaine, Frank Knox, une forte influence sur le secrétaire d’État à la Guerre, H. L. Stimson, et une influence de conseiller amical sur le président et sur le secrétaire d’État, Cordell Hull. Il ne fait aucun doute que nous pouvons obtenir par Donovan plus que par n’importe quel autre individu. Stephenson et Donovan devinrent les intermédiaires qui triaient et transmettaient les informations ultra-secrètes destinées à Roosevelt et à Churchill.
Les personnes qui furent à son service disent de Stephenson qu’il ignorait la peur et se consacrait entièrement à une tâche exigeant souvent de ne tenir aucun compte des règles admises. L’un de ses assistants précise : Il s’opposait avec énergie à l’emploi de toute violence contre les individus ou les organisations, mais il prenait sur lui de négliger les obligations ordinaires et de passer outre à la légalité sur le plan des droits civils et des privilèges diplomatiques. Il s’arrangea pour que soient publiées aux États-Unis des informations précises, démasquant les courants d’opinion isolationniste et antibritannique. Des agents de la B.S.C. s’infiltrèrent dans les ambassades et les administrations hostiles de Washington et d’autres villes et s’approprièrent leurs codes secrets.
Les agents de la B.S.C.
La pénétration des ambassades italienne et française de Washington fut réalisée grâce à une jeune femme nommée Cynthia, dont les charmes féminins — selon H. Montgomery Hyde, dans Un Canadien tranquille — furent l’instrument essentiel de sa réussite. Cynthia ne faisait pas partie des employées canadiennes de la B.S.C., mais on lui fournit une couverture en la faisant engager dans une administration gouvernementale canadienne de Washington. Son premier succès, au cours de l’hiver 1940-1941, fut d’obtenir d’un amiral, qui en moins de quinze jours succomba à ses charmes, les chiffres des services navals italiens. Peu après, un admirateur français, qui, d’ailleurs, devint son mari, lui fournit les codes de ceux de Vichy. En vingt-quatre heures, raconte Hyde, les photocopies en étaient parvenues à l’amirauté à Londres. En Afrique du Nord, quelques mois plus tard, l’élimination des résistances navales de Vichy fut en grande partie l’œuvre de Stephenson et de son adroite collaboratrice.
L’une des tâches les plus importantes de Stephenson fut de convaincre les Américains que la Grande-Bretagne avait la possibilité et la volonté de poursuivre le combat. Après l’effondrement de la France, dira-t-il après la guerre, au cours d’une interview à la radio canadienne, le président Roosevelt lui-même n’avait pas la certitude que l’aide accordée à la Grande-Bretagne ne serait pas du pur gaspillage. Les ambassadeurs américains à Londres et à Paris affirmaient que la position de la Grande-Bretagne était désespérée. La majorité des membres du cabinet de Roosevelt partageaient cette opinion. Donovan, en revanche, était persuadé que, si les États-Unis lui fournissaient un appui approprié, la Grande-Bretagne pouvait et devait survivre. Il m’incombait de lui faire connaître les besoins primordiaux de la Grande-Bretagne, afin qu’il en informe qui de droit, et de lui fournir des arguments concrets justifiant la thèse selon laquelle l’aide matérielle américaine constituerait non pas une charité à fonds perdu, mais un investissement rentable.
Stephenson joua un rôle capital dans les négociations qui, en 1940, aboutirent à la livraison de cinquante destroyers américains à la Grande-Bretagne. Cette transaction, précise-t-il, n’aurait pu s’effectuer sans l’intervention de Donovan... En outre, Donovan et moi contribuâmes pour une large part à obtenir cent Forteresses volantes pour la R.A.F. et plus d’un million de fusils pour l’armée territoriale britannique.
Donovan se rendit en Grande-Bretagne au début de 1941, puis en Bulgarie et en Yougoslavie, pays encore officiellement neutres, mais penchant en faveur de l’Allemagne. Le gouvernement yougoslave lui parut ardemment pro-allemand ; seuls le général Richard Simovic et quelques officiers nationalistes serbes étaient contre l’Allemagne. Simovic demanda à Donovan si la Grande-Bretagne pouvait résister et si les États-Unis entreraient en guerre. Après avoir averti Simovic qu’il n’exprimait là qu’une opinion personnelle, écrit H. Montgomery Hyde, Donovan répondit à ces deux questions par l’affirmative.
Fort de cette réponse, Simovic s’empara du pouvoir le 27 mars. Le 6 avril, Hitler envahissait la Yougoslavie. L’armée de Simovic fut écrasée, mais cette campagne devait retarder l’offensive allemande en Russie de cinq semaines — délai qui épargna sans doute à Moscou de tomber aux mains des nazis à l’automne 1941. Parmi les centaines de Canadiens de la B.S.C. se trouvait un génie des télécommunications, B. de F. Bayly, dit Pat, ingénieur électricien et professeur à l’université de Toronto, dont les réalisations pendant la guerre n’ont pas encore été totalement dévoilées de nos jours. H. Montgomery Hyde écrit que Bayly réussità adapter les machines cryptographiques télékrypton de la Western Union de telle sorte qu’elles puissent traiter la masse énorme des messages secrets échangés quotidiennement entre New York et les diverses organisations de Londres que Stephenson représentait. Un autre Canadien, Campbell L. Smart, de Montréal, dirigeait une section de la B. S. C. chargée de combattre la propagande ennemie.
Certains Canadiens avaient le statut d’Officiers Consulaires de Sûreté (C.S.O.). Ils inspectaient les usines qui fabriquaient les armes pour la Grande-Bretagne, prévenant tout sabotage de la part d’ouvriers américains antibritanniques. Ils veillaient également à la sécurité des navires britanniques dans les ports américains. Tout au début de la guerre, les C.S.O. se livrèrent à des fouilles systématiques des paniers-repas, des trousses à outils et des vêtements des ouvriers américains employés à la conversion de paquebots britanniques et français en transports de troupes. John Hart, appartenant antérieurement à la police montée canadienne, était chef adjoint des C.S.O.
Ernest W. Bavin, qui avait été officier de renseignements à l’état-major d’Ottawa, organisa les liaisons de la B.S.C. avec le F.B.I. : la police de New York et les autorités portuaires, la Marine, l’armée et la défense côtière des États-Unis, les services de l’immigration, des douanes et du Trésor travaillaient donc main dans la main avec leurs homologues canadiens. Bavin et ses collègues trouvèrent les hauts-fonctionnaires américains extrêmement coopératifs.
Le premier représentant officiel de Stephenson au Canada fut Charles Vining, président de la Newsprint Association of Canada et plus tard du Wartime Information Board. T.G. Drew-Brook, dit Tommy, agent de change de Toronto, qui avait fait la Première Guerre mondiale avec Stephenson, succéda à Vining en 1941 au poste de représentant de la B.S.C. au Canada. Vining plaçait Stephenson au même niveau que Churchill, Roosevelt, Alexander et Montgomery, ce petit groupe d’hommes sans lesquels les Alliés n’auraient pu gagner la guerre. Dans tous les domaines de l’activité si étendue de la B.S.C. au Canada, la contribution de Drew-Brook ne le cède, selon Vining, qu’à celle de Stephenson.
Vining et Drew-Brook ont refusé de donner des détails sur leur travail à la B.S.C., se considérant comme étant toujours liés par le serment exigé par la loi sur les secrets d’État. D’autres sources ont révélé que c’est Vining, grâce à l’amitié qu’il entretenait avec le ministre de la Défense canadien, James Ralston, qui servit d’intermédiaire entre la B.S.C. et le gouvernement. Ralston autorisa, de cette manière, des hauts-fonctionnaires d’Ottawa à accorder toutes les facilités aux opérations de la B.S.C. au Canada.
La station M et la production de faux
L’un des centres d’activité de la B.S.C. était la station M, créée à Toronto par Drew-Brook et spécialisée dans la fabrication de fausses lettres. Ses deux plus habiles contrefacteurs — deux anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui tenaient une boutique de réparations dans la basse ville à Toronto — ne furent jamais publiquement identifiés. On les disait capables de reproduire la frappe de n’importe quelle machine à écrire, quelle que soit son origine.
La station M, rapporte Hyde, ne produisit jamais un seul document qui ne fût pas une imitation parfaite dans les moindres détails d’une pièce authentique. Les techniques de fabrication incombaient à d’autres experts, dont les deux plus grands spécialistes canadiens de l’encre et du papier. L’un des coups de maître de la station M fut la suppression d’une ligne aérienne ennemie. Au début de la guerre, une importante ligne de communication entre l’Axe et l’Amérique du Sud était assurée par les Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.), qui avaient organisé, entre l’Europe et le Brésil, des vols réguliers transportant des valises et des courriers diplomatiques, ainsi que des agents allemands et italiens, des diamants, du platine, du mica, des produits chimiques, des films et des livres de propagande. Stephenson et ses conseillers imaginèrent un plan pour colmater cette fuite du blocus économique britannique.
Des espions basés au Brésil se procurèrent une lettre écrite à Rome par le président des L.A.T.I., le général Aurelio Liotta. Ce document allait permettre de fabriquer un faux adressé au directeur des L.A.T.I. du Brésil, le commandant Vincenzo Coppola. Une des plus grandes papeteries canadiennes mit au point, après des recherches de laboratoire, un feuillet spécial, à base de pâte de paille, de grammage européen. Les experts de la station M reproduisirent alors l’en-tête des L.A.T.I. et introduisirent dans une machine à écrire toutes les imperfections mécaniques caractérisant celle dont s’était servie la secrétaire de Liotta pour dactylographier la lettre authentique.
Le faux, daté du 30 octobre 1941, fut photographié et le microfilm expédié au principal agent de Stephenson à Rio de Janeiro. Le général Liotta était supposé avoir écrit : il ne fait aucun doute que le petit gros soit en train de tomber dans la poche des Américains et que seule une action violente de la part de nos amis verts puisse sauver le pays. Nos collaborateurs de Berlin ont décidé d’intervenir aussitôt que possible. Coppola devait observer la plus grande discrétion. Les Brésiliens, comme vous l’avez dit justement, peuvent bien être une nation de singes, mais il ne faut pas oublier que ce sont des singes disposés à servir quiconque tire les ficelles.
Le petit gros désignait indéniablement le président GetúlioVargas ; les amis verts étaient un parti d’opposition.Cette lettre insultait Vargas, outrageait son pays, tournait sa politique étrangère en dérision et impliquait une collusion avec ses ennemis. À Rio, un des hommes de Stephenson mit en scène le cambriolage du domicile de Coppola qui prévint immédiatement la police, déclenchant malgré lui l’effet de publicité souhaité par la B.S.C. L’un des sous-agents prit alors contact avec un journaliste américain de l’Associated Press et, lui faisant jurer le secret, lui avoua qu’il avait participé au cambriolage. Il montra au reporter une microphotographie que, disait-il, il avait trouvée dans les affaires personnelles de Coppola. C’était apparemment une reproduction d’une lettre émanant du président des L.A.T.I. L’envoyé de l’Associated Press en conclut que l’original avait dû être considéré comme étant trop compromettant pour être confié à la poste aérienne ordinaire et que ce microfilm avait sans doute été introduit secrètement dans le pays. Il porta le document à l’ambassadeur américain. Celui-ci, après en avoir étudié des agrandissements, estima la lettre authentique et la transmit au président Vargas.
Furieux, celui-ci réagit comme l’avait espéré Stephenson. Il annula tous les droits d’atterrissage des L.A.T.I. et ordonna l’arrestation de Coppola. Le commandant tenta de s’enfuir, après avoir retiré un million de dollars de la banque, mais il fut pris à la frontière argentine. On le condamna à sept ans de prison et à la confiscation de ses fonds ; une amende de 85 000 dollars fut imposée aux L.A.T.I. pour violation de la loi brésilienne ; ses appareils, ses terrains et ses ateliers d’entretien passèrent aux mains du Brésil ; les équipages et le personnel italien furent internés...
Quelques semaines plus tard, le Brésil rompait ses relations avec l’Italie et l’Allemagne. Renonçant à sa neutralité, il ouvrait l’accès de ses ports aux navires de guerre américains et autorisait les ingénieurs des États-Unis à construire des aérodromes indispensables à l’invasion prévisible de l’Afrique du Nord, en 1942. La lettre de la station M avait été d’un bon rapport.
Le camp X, un établissement secret
À peu près à l’époque où les spécialistes de Drew-Brook avaient élaboré ce célèbre faux, le chef de la B.S.C. au Canada créait, à l’est de Toronto, un établissement secret appelé le camp X. Stephenson, en effet, voulait être sûr que, lorsque les États-Unis entreraient en Guerre, ils aient immédiatement la possibilité de former des espions et des saboteurs américains. Londres accepta la proposition de fonder une école au Canada.
Par l’intermédiaire d’un prête-nom, afin de détourner les soupçons, Drew-Brook se rendit acquéreur, pour la somme de 12 000 dollars, d’un domaine de 90 hectares situé en bordure du lac Ontario, entre Oshawa et Whitby. Des ingénieurs du génie construisirent des baraquements, transformèrent granges et hangars et creusèrent des galeries de tir souterraines. Ce camp, enclos de barbelés et sévèrement gardé par des sentinelles, commença à fonctionner en août 1941.
Les élèves portaient l’uniforme canadien et recevaient la solde et les rations de l’armée canadienne. Le commandant était canadien, mais les cinq autres officiers et les dix instructeurs étaient britanniques. La plupart des cinq cents nouvelles recrues furent, en temps voulu, incorporées dans des unités britanniques, mais certaines appartenaient à la police montée canadienne ou au F.B.I. et apprenaient les méthodes utilisées par les ennemis au Canada et aux États-Unis. Après l’entrée en guerre des États-Unis, le camp X forma également des agents américains. À partir de ce noyau de techniciens, les États-Unis créèrent leur propre organisation militaire, l’Office des Services Stratégiques (O.S.S.), sous la direction du général Donovan, l’ancien agent de liaison entre Stephenson et Roosevelt. À New York, l’O.S.S. avait ses bureaux, comme la B.S.C., au Rockefeller Center, mais dans le hall.
Des Canadiens d’origines ethniques diverses suivirent l’entraînement du camp X : parmi les volontaires se trouvait un homme, Yougoslave de naissance, qui tint un petit bazar à Toronto après la guerre et ne voulut se faire connaître que sous le nom de Peter. Même maintenant, dit-il, si je donnais mon vrai nom, on viendrait me dire : « Écoute, ça va ! Tu n’es pas fou, non ? »
Peter était un cordonnier venu s’établir au Canada en 1927. Il fit son service militaire en 1942 et, après un entraînement de base à Sudbury dans l’Ontario, reçut l’ordre de se présenter à un bureau de Toronto. Là, il trouva un commandant qui lui parla dans sa langue natale, lui donna de l’argent et lui dit d’aller s’acheter des vêtements civils. Pendant quinze jours, il l’interrogea sur tous les événements de sa vie ; finalement, il lui demanda s’il était volontaire pour se rendre derrière les lignes ennemies. Peter acquiesça.