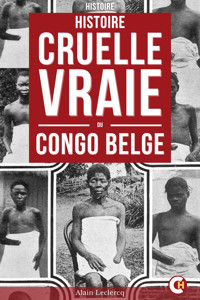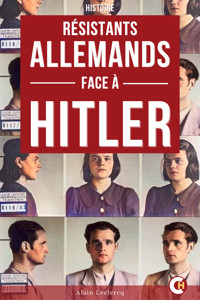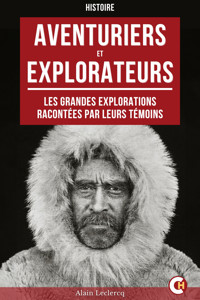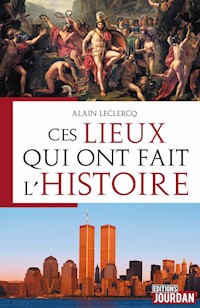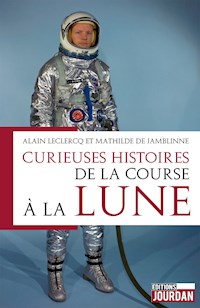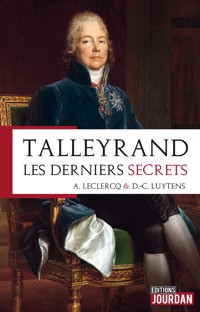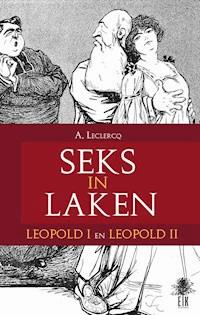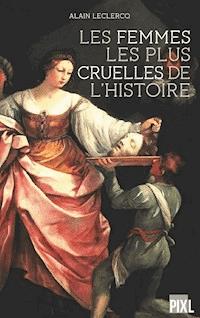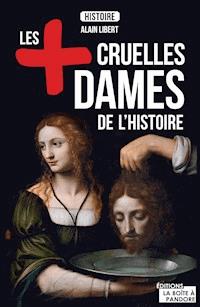Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CurioVox
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Jamais, dans le champ des conflits humains, tant d’hommes n’ont dû autant à si peu. » Winston Churchill
Ce livre réunit deux témoignages exceptionnels de pilotes de la Royal Air Force, deux récits authentiques d’hommes qui ont défié la mort à chaque mission. Dans le vacarme des moteurs et le fracas de la DCA, ils ont incarné le courage, l’abnégation et la fraternité des aviateurs alliés. De la Bataille d’Angleterre aux bombardements sur l’Allemagne, leurs voix racontent les nuits de feu, les camarades tombés, et cette rage de survivre qui faisait d’eux des légendes vivantes.
À travers ces deux parcours, Alain Leclercq fait revivre l’esprit héroïque de la RAF : celui des pilotes de chasse, des navigateurs, des bombardiers qui, jour après jour, affrontaient l’impossible. Un hommage bouleversant à ces hommes du ciel dont les exploits ont façonné la victoire et marqué à jamais la mémoire de la guerre.
Héros de la RAF : Pilotes et Légendes de Guerre est un récit historique haletant, vibrant d’émotion et de réalisme. Un livre pour tous les passionnés d’histoire militaire, d’aviation et de destins hors du commun.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Leclercq est historien, passionné par les récits du passé souvent négligés par l'historiographie traditionnelle. Spécialiste des histoires oubliées, il consacre ses recherches à la redécouverte d'archives méconnues et de témoignages perdus.
Son travail se distingue par sa volonté de rendre accessible au grand public des documents historiques précieux, mais habituellement ignorés. Grâce à ses investigations minutieuses dans les fonds d'archives, il exhume des récits authentiques qui éclairent d'un nouveau jour les grandes pages de l'Histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© CurioVox
Bruxelles - Paris
http://www.curieuseshistoires.net
Les éditions CurieusesHistoires vous invitent à découvrir des milliers d’histoires fascinantes sur https://www.curieuseshistoires.net et à nous rejoindre sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenus captivants ! Collection dirigée par Louis-Jourdan Leclercq.
ISBN : 9782390840121 – EAN : 9782390840121
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Alain Leclercq
Héros de la RAF pilotes et légendes de la guerre
Chasseur dans le soleil
J.E. Johnson
La réserve volontaire
Quand la guerre prit fin en Europe, je commandais un wing de Spitfire à Celle, la plus orientale de toutes nos bases aériennes en Allemagne. Depuis le passage du Rhin, six semaines auparavant, nos rencontres avec la Luftwaffe avaient été presque quotidiennes. Bien qu’elle fût dans une situation désespérée, à court de carburant et de pièces de rechange, ses aérodromes soumis à un bombardement continu, il faut lui rendre cette justice qu’elle se battit jusqu’au bout.
Durant ces dernières semaines, nous avions survolé les terrains allemands de l’aube au crépuscule, au cours de nos patrouilles de harcèlement et nous avions détruit plus d’une centaine d’avions. Notre tableau de chasse comprenait des appareils de toutes sortes depuis les bombardiers et les lourds avions de transport, les chasseurs Messerschmitt et Focke-Wulf, jusqu’aux avions à réaction dernier modèle. La Luftwaffe ne demandait pas de quartier, et jusqu’au Jour de la Victoire nous lui menâmes la vie dure.
Il faisait encore nuit noire quand nos Spitfire quittèrent la piste de décollage. Nous volions maintenant en direction de l’orient ; l’aurore commençait à illuminer le ciel et la terre. À basse altitude nous survolâmes Berlin, évitant prudemment de larges formations de chasseurs russes. La marée soviétique déferlait sur l’Europe Orientale.
Maintenant que tout était fini, les pilotes allemands refluaient de Norvège et du Danemark pour déposer les armes. Un jeune pilote plein d’arrogance posai son bombardier flambant neuf sur le terrain de Celle et me fit un salut impeccable en sautant de sa carlingue. Il était très heureux, nous dit-il, que la lutte entre la Luftwaffe et la R.A.F.1 fût terminée. Mais il restait un ennemi commun, et si nous pouvions lui offrir quelques bombes et peut-être une escorte de Spitfire... Il eut un regard peiné quand nous l’embarquâmes pour le camp de prisonniers le plus proche.
Les mois qui suivirent constituèrent une transition difficile entre la guerre et la paix. Mon rôle consistait désormais non pas tellement à voler qu’à m’assurer que les quelque mille aviateurs destinés à être démobilisés emporteraient un bon souvenir de leur vie militaire. Pour notre délassement en dehors du service, les rivières locales abondaient en truites et l’automne promettait du gibier. Il y avait de la grouse à débusquer et à tirer sur les landes couvertes de bruyères, et du chevreuil à chasser dans les forêts de pins, sans parler des battues de sangliers au clair de lune. Tout était à notre portée, et pour la première fois depuis six ans nous pouvions organiser nos loisirs.
Maintenant qu’une période de repos s’offrait à moi, je pouvais regarder en arrière et mesurer le chemin parcouru : mon entraînement comme volontaire de réserve, puis la bataille d’Angleterre, notre conquête progressive de l’espace aérien au-dessus de la Manche et de la France, Dieppe, mon premier wing canadien, la Normandie, Paris, Bruxelles, Arnheim et, finalement, le passage du Rhin et la campagne d’Allemagne.
Après des années de dur travail, j’eus la chance, en 1928, à vingt-deux ans, de décrocher mon diplôme d’ingénieur. Je trouvai une situation à Loughton, en bordure de la forêt d’Epping (Essex). Je devins membre du Chingford Rugby Club, où je fis la connaissance de jeunes gens pleins d’allant qui, pour la plupart, appartenaient déjà à diverses organisations de réservistes. Au cours d’une partie de rugby, je me fracturai l’omoplate droite. Je l’ignorais alors, mais la fracture fut mal ressoudée et les nerfs de l’avant-bras furent comprimés au-dessous de l’os. Plus tard, en 1940, cet incident faillit mettre un terme à ma carrière d’aviateur.
Je tentai de devenir pilote dans l’une des escadrilles de l’Armée aérienne auxiliaire. Au bout d’un certain temps je fus examiné par un officier qui, je l’appris par la suite, était passionné de chasse au renard. Il me posa les questions habituelles, école, profession, sports, et si j’avais ou non l’expérience du pilotage. Naturellement, j’insistai beaucoup sur le fait que j’avais déjà pris des leçons à mes frais. Toutefois, cela ne parut pas l’impressionner et j’étais convaincu que notre entrevue se terminerait par : « Nous vous ferons savoir s’il y a une place vacante ». Mais son enthousiasme languissant se ranima lorsqu’il apprit que mon pays natal était Melton Mowbray, dans le Leicestershire.
– Excellent, me dit-il. C’est une région que je connais très bien, car j’y chasse beaucoup. Dites-moi, à quel équipage appartenez-vous ?
Lorsque j’expliquai prudemment que le peu d’argent dont je disposais était consacré à l’aviation, et non à la chasse, il mit rapidement fin à notre entretien et ma candidature pour une escadrille auxiliaire ne fut retenue qu’une fois la guerre commencée.
Après la crise de Munich, il y eut une période intense de réarmement et d’expansion des unités auxiliaires et territoriales. Une fois de plus j’essayai d’entrer dans la Force aérienne auxiliaire. On me répondit qu’on disposait d’un nombre suffisant de pilotes, mais qu’il y avait des places vacantes dans les escadrilles de ballons, pour le cas où je m’intéresserais à cette branche vitale de la défense antiaérienne. Je répondis sèchement par la négative.
Deux de mes amis de rugby, qui s’étaient engagés dans la Réserve volontaire de la R.A.F., avaient appris à voler et étaient sur le point d’obtenir les ailes qui servaient d’insignes aux pilotes qualifiés. La Réserve volontaire avait été créée en 1936, son but étant de recruter et de former des pilotes. Au départ, tous avaient le rang de sous-officier et un certain nombre étaient promus officiers lorsqu’ils obtenaient leurs ailes de pilotes. La Réserve volontaire n’était pas un corps d’élite comme l’Armée auxiliaire de l’Air, dont le recrutement social était très supérieur. Je présentai ma demande au Ministère de l’Air et après une attente impatiente, je fus informé que pour le moment il y avait beaucoup plus de candidats que de places vacantes dans les écoles de la R.V., mais qu’on m’aviserait si de nouveaux centres d’entraînement étaient créés.
Mes espoirs étaient donc une fois de plus frustrés. Occupant un emploi civil spécialisé, j’avais comme perspective, en temps de guerre, de construire des abris antiaériens ou de superviser des équipes de décontamination. Désireux de faire tout de même autre chose, je demandai à être enrôlé dans la garde à cheval du Leicestershire. Bien que peu intéressé par la chasse à courre, j’avais appris dès mon jeune âge à monter à cheval.
Je me souviens avec plaisir du temps de service que je passai dans la garde montée et de nos manœuvres en campagne. Cet entraînement me fit perdre quelques kilos et à mon retour à Loughton je trouvai une lettre officielle du Ministère de l’Air. On avait décidé de développer la Réserve volontaire de la R.A.F. Si j’étais toujours intéressé, je devrais me présenter dans les quarante-huit heures à Store Street, où siégeait le Quartier général de la R.V. à Londres, pour y passer une visite. J’étais au rendez-vous avant l’ouverture des portes. Avec une douzaine d’autres candidats, je subis une série d’examens médicaux. Après déjeuner, ceux qui avaient satisfait à la visite médicale furent introduits devant un commandant de groupe qui nous nomma, sans autre forme de cérémonie, sergents-élèves-pilotes dans la Réserve volontaire de la R.A.F.
Nous devions consacrer à l’entraînement tous nos week-ends et, éventuellement, les longues soirées d’été. De plus, il y avait des conférences à suivre sur la navigation, la signalisation, l’armement, etc., etc. Théorie et pratique étaient enseignées parallèlement, et toute absence aux amphis entraînait la disqualification immédiate.
Notre recrutement comprenait des paysans, des ingénieurs, des employés de banque, ainsi que de jeunes gens destinés aux professions libérales. La compétition était sévère. Nous avions à passer une série d’épreuves théoriques et pratiques, et ceux qui échouaient étaient impitoyablement éliminés. Comme il y avait beaucoup de candidats en réserve, pour un qui échouait dix étaient prêts à prendre sa place.
À Stapleford Tawney (Essex), notre centre d’entraînement, les débutants apprenaient à piloter des Tiger Moths, cependant que les anciens avaient le prestige, de piloter des Hawker Harts. Quelquefois, le calme de notre espace aérien était troublé par l’apparition de petites formations de Hurricane provenant de l’aérodrome voisin de North Weald.
« Prenez garde à eux, nous répétait notre instructeur. Ils arrivent à une vitesse terrible, et quand ils foncent vers vous ils ne paraissent pas plus grands qu’une lame de rasoir. »
Au début d’août 1939, nous reçûmes nos fascicules de mobilisation. De retour dans nos foyers, nous eûmes une brève période de liberté, mais dès le 1er septembre l’Armée allemande et la Luftwaffe s’unirent pour démontrer au reste du monde une nouvelle technique, le Blitzkrieg. Ce fut la mobilisation générale pour la Royal Air Force ; cependant que retentissaient à Londres les premières sirènes, quelques centaines de réservistes de l’Air prirent le train pour Cambridge.
À notre arrivée nous fûmes accueillis sur le quai de la gare par un adjudant à la large carrure et au teint brique qui s’appelait Dalby. Nous l’entendîmes grommeler en guise de bienvenue :
« Jamais vu autant de sergents dans toute ma carrière – sergents, ils sont tous sergents – pas un seul caporal parmi eux. »
De ce soliloque nous conclûmes que l’adjudant Dalby n’avait pas une impression très favorable de son premier contact avec les Volontaires de Réserve.
Il me prit par le bras :
– Sergent, me dit-il en insistant sur ce grade qu’il avait dû mettre beaucoup d’années à conquérir, vous allez être chef de section. Groupez-moi cette foule quatre par quatre et emboîtez-moi le pas, si vous en êtes capable.
Avec toute la dignité requise, nous nous ébranlâmes derrière M. Dalby. Notre marche à travers Cambridge nous conduisit au Jesus College, où nous allions loger pendant quelques semaines.
Au début de décembre, une trentaine d’entre nous furent transférés à l’aérodrome de Marshall, aux environs de Cambridge, pour reprendre l’entraînement sur des Tiger Moths. Marshall était avant la guerre une école d’aviation civile et beaucoup d’instructeurs du temps de paix, maintenant officiers ou sergents-pilotes, étaient maintenus sur place. C’est à eux qu’allaient être confiées nos destinées dans les mois à venir.
Enseigner est un art difficile et un bon pilote n’est pas nécessairement un bon instructeur. Certains de ceux avec qui nous avions la malchance de voler étaient si anxieux de prendre part aux opérations militaires qu’ils considéraient comme un gaspillage de perdre leur temps avec une bande de blancs-becs. Une critique inopportune et mal fondée, alors qu’un mot d’encouragement aurait été mieux approprié, décourageait et retardait souvent un débutant enclin à la nervosité. Sans aucun doute, des élèves pilotes ont été éliminés qui auraient réussi avec des instructeurs sachant les comprendre et leur inspirer confiance.
J’ai eu personnellement la chance d’avoir pour instructeur le sergent Tappin, que nous avions surnommé Tap. C’était un homme d’une parfaite simplicité et d’une grande gentillesse. Pilote accompli, il savait maintenir le moral de ses élèves. Il trouvait toujours le temps d’expliquer un problème délicat de pilotage, et quand nous traversions la piste après un vol sur un appareil à double commande il passait en revue toutes les phases du vol pour être sûr que la leçon était bien comprise.
Lorsque je quittai Marshall, j’avais seulement quatre-vingt-quatre heures de vol. J’avais satisfait aux divers examens. Nous allions être mutés à une école d’entraînement où nous piloterions des monoplans et, si tout allait bien au bout de dix semaines, nous pourrions être affectés à des escadrilles.
1. Royal Air Force.
À l’entrainement
En compagnie d’un camarade, Butch Lyons, je me rendis de Cambridge à l’École de Seâland, près de Chester.
Une fois encore, j’eus la chance d’avoir un bon instructeur. Après deux vols accompagnés, le sergent Broad m’envoya seul sur un Miles Master. Le Master était un appareil agréable à piloter, relativement rapide, avec un plafond supérieur à tous les appareils sur lesquels j’avais volé antérieurement. Lorsque la plaine du Cheshire était obscurcie par un ciel de plomb, je trouvais passionnant de m’élever au-dessus des nuages qui, vus d’en haut, resplendissaient sous les rayons, ardents du soleil.
J’eus une expérience déplaisante pendant mon séjour à Sealand. La Luftwaffe avait repéré notre aérodrome et nous fûmes attaqués à deux reprises pendant nos vols d’entraînement, la nuit. On décida de continuer cet entraînement nocturne sur un petit aérodrome isolé, où il était peu probable qu’une piste faiblement éclairée attirât les avions ennemis. Un soir, nous fûmes conduits sur ce terrain. Six Master, pilotés par nos instructeurs, nous attendaient au rendez-vous. Petit à petit, la brume envahit le terrain. Le vent rabattait la fumée d’une agglomération industrielle voisine et la visibilité, déjà limitée, devenait de plus en plus mauvaise. Cependant, il fut décidé que l’entraînement de nuit aurait lieu comme prévu.
Je devais d’abord exécuter un vol, accompagné d’un instructeur et, avant de décoller, je me remémorai les données du vol avec instruments. Durant la plus grande partie du vol par cette nuit sans lune, je devais me fier aux instruments de bord, car les impressions du pilote sur son altitude n’ont absolument aucun rapport avec l’altitude exacte, indiquée par les divers instruments.
Mes premiers tours de vol furent sans histoire. J’avais derrière moi un instructeur qui commentait notre position par rapport à la piste d’atterrissage. Après une heure, nous nous posâmes et je fumai une cigarette pour me décontracter avant mon vol en solo.
La fumée provenant des usines avait augmenté, et lorsque je repris les commandes je constatai avec angoisse que la visibilité était beaucoup plus réduite que pendant mon premier vol. J’avais envie d’en rester là et de déclarer que les conditions étaient trop mauvaises pour mon expérience, mais la lumière verte qui clignotait au bout de la piste emporta mes hésitations. Plein d’appréhension, je me lançai sur la piste et après deux ou trois cahots l’avion décolla.
Les roues sont repliées. Je prends de l’altitude et me concentre sur les instruments. – 150 mètres. Tout va bien. – J’amorce à bâbord un virage ascensionnel et je me stabilise à 500 mètres. La piste balisée doit être environ à 300 mètres à bâbord. Je regarde à l’extérieur, mais je n’aperçois à droite et à gauche que la réflexion sur les nuages de mes feux de position vert-rouge. (C’était mon troisième vol nocturne sur un Master et ma seconde expérience en solo.) Circonstance aggravante, l’avion est pris dans un remous. Dans un moment de panique, j’ai l’impression que l’avion plonge vers la terre en tournoyant et, automatiquement, je commence à redresser l’appareil. Mais les instruments du bord me révèlent que l’avion vole en ligne droite et de niveau, avec une légère tendance à monter. Concentrons-nous sur les instruments. Je me concentre tellement que je suis vissé au palonnier et que mes pieds sont collés aux pédales du gouvernail. Il faut me décontracter. Il le faut, en chantant, en jurant ou en criant !
À 900 mètres je trouve un ciel clair. Pas de lune, mais des étoiles scintillent, qui semblent amicales après l’enveloppement des nuages. J’ai enfin devant moi un horizon. Perdu dans un monde limité par des nuages et des étoiles, je retrouve mon calme. Je n’ai pas de radio pour me guider jusqu’au terrain que les nuages cachent. La région est entourée de collines et la chaîne Pennine n’est qu’à quelques kilomètres. J’ai encore une demi-heure d’essence et d’ici là je dois avoir regagné le sol, avec mon Master ou en parachute.
J’avais pris la précaution de voler pendant cinq minutes et de tourner pour faire exactement le même parcours en sens inverse, afin de rester au voisinage de l’aérodrome. Je décidai de descendre à 150 mètres, d’essayer de repérer ma position et, si cela était impossible, de remonter et de sauter en parachute. Maintenant que ma décision était prise, je me sentis considérablement mieux. J’ajustai les bretelles de mon parachute, j’en vérifiai la voilure. Puis je commençai la descente.
Les étoiles s’évanouirent, cependant que le Master glissait dans un nuage et, une fois de plus, je me trouvai emprisonné dans un monde hostile.
L’avion descend à la cadence de 150 mètres par minute. Pas très rapide, mais suffisant pour percuter dans une colline. À 300 mètres d’altitude, je suis encore dans les nuages. Une fois de plus, une peur irraisonnée entre en conflit avec les enseignements de la logique. À 200 mètres, les nuages s’effilochent et je vois la lumière d’une ferme isolée. Recherchons maintenant l’aérodrome. Deux minutes en direction de chaque point cardinal, et, si je ne trouve rien, je remonte dans les nuages pour parachuter. Deux minutes vers le sud : rien. Deux minutes vers l’ouest : toujours rien. Et maintenant, direction nord, je vois un faisceau lumineux se déplacer à la base du nuage. Je vole dans sa direction pour apercevoir enfin la piste balisée. Résistant à l’envie de me poser brutalement, je décris un orbe pour donner mon identification. Mon signal est enregistré. C’est l’atterrissage et la détente de n’avoir rompu ni mon coucou ni mes os.
L’instructeur se précipite vers moi :
– Que vous est-il arrivé ?
– Volant à 300 mètres, il m’était impossible de voir la piste balisée. J’étais dans les nuages.
– Évidemment, espèce d’idiot ! Les nuages sont descendus à 200 mètres. Pourquoi n’êtes-vous pas resté au-dessous ?
Sur la défensive, je répondis :
– Mes instructions étaient de voler à 300 mètres. Je ne savais pas que les nuages étaient descendus avant d’être en plein dedans.
– D’accord, mais le bon sens exige de voler au-dessous des nuages. De toute évidence, vous devez acquérir une plus grande expérience des vols de nuit.
De toute évidence, à mon avis, il n’aurait pas dû permettre à un élève sans expérience de voler seul dans ces conditions. J’étouffai ma colère et j’allai me coucher, mais nous ne volâmes jamais plus la nuit que par temps clair.
Notre entraînement à Sealand se termina fin juillet. Nous commandâmes de nouveaux uniformes et fûmes mutés à une base d’entraînement opérationnel, afin de nous familiariser avec les Spitfire avant de rejoindre nos escadrilles.
Je me souviendrai longtemps de la première fois que je pilotai un Spitfire. L’instructeur me fit faire le tour de ce chasseur camouflé en gris et vert et m’expliqua le maniement des commandes. Je m’installai dans l’étroite carlingue et, comme je suis large d’épaules, mes avant-bras se trouvaient plutôt mal à l’aise. J’en fis la remarque.
– Vous en prendrez l’habitude, me dit l’instructeur, surtout quand vous aurez les chasseurs ennemis à vos trousses. Vous rentrerez la tête et attraperez le torticolis quand vous regarderez derrière vous. Sinon, vous ne ferez pas de vieux os.
Une demi-heure après, mon instructeur vérifiait ma ceinture cependant que j’ajustais mon casque de cuir.
– Partez, et bonne chance.
Cependant qu’il s’éloignait, l’ail nonchalant, je savais qu’il surveillerait d’un œil critique mon décollage et mon atterrissage.
Soucieux de ne pas entrer en collision avec d’autres Spitfire ou des ravitailleurs d’essence, j’allai jusqu’au bout de la piste et, avant de tourner face au vent, je procédai à une dernière vérification. Rien en vue. J’avais tout l’aérodrome à ma disposition. Je piquai vent debout ; l’accélération était rapide, beaucoup plus qu’avec le Master. L’avion quitta la piste et monta à la vitesse de 320 km à l’heure. Je rabattis le cockpit. J’aurais aimé voler avec le cockpit ouvert, mais je n’aurais pu ainsi ni voler ni combattre à de hautes altitudes, et je devais m’habituer à toutes les caractéristiques de l’avion.
Maintenant, je devais prendre en mains ce pur-sang. J’exécutai un virage et j’essayai de m’y retrouver. Quatre ou cinq minutes s’étaient à peine écoulées depuis le décollage et nous étions déjà à plus de 30 km de Hawarden. Je fais demi-tour, chaque seconde augmentant ma confiance. Devant moi, légèrement au-dessous, j’ai un Master. Je le dépasse confortablement et, pour démontrer ma supériorité, je tente une boucle en hauteur. Mais je n’ai pas suffisamment tenu compte du lourd nez du Spitfire et je perds de la hauteur. Il vaut mieux se concentrer sur les caractéristiques du pilotage et réserver les acrobaties pour un autre jour. De nouveau, je survole Hawarden. Je passe en vitesse de croisière. J’ouvre le cockpit. Je descends les roues et j’amorce un virage dans le vent. Maintenant, les ailerons, et un dernier virage dans le vent. Près de 200 km à l’heure, et nous sommes trop haut. L’avion descend comme une pierre. L’indicateur marque 160, et nous sommes hors du terrain. Un demi-tour. Tête hors de la carlingue, je contrôle l’atterrissage. Il est plutôt brutal. Et, comme je l’imagine, mon instructeur est là, avant que j’aie coupé les gaz.
– Si vous aviez laissé faire le Spit, il aurait fait un meilleur atterrissage que vous. Si vous ratez votre approche, reprenez de la hauteur et refaites un tour. On a dû vous le dire, quel que soit l’appareil que vous pilotiez.
Quatre jours plus tard, je ratai encore mon approche, et cette fois ce fut le désastre. J’avais reçu instruction d’atterrir à Sealand et de livrer une petite liasse de cartes. Le circuit, à Sealand, était encombré de Master, et je me faufilais au milieu d’eux pour me trouver dans une position favorable, face au vent. Le vent soufflait fort à travers ce petit aérodrome gazonné, et je m’efforçais de descendre à proximité des limites de l’aérodrome, pour avoir le maximum de distance pour l’atterrissage. J’arrivai trop haut et trop lentement, et le Spitfire, en perte de vitesse, tomba comme une bombe. L’atterrissage fut brutal et mes courroies devaient être insuffisamment ajustées, car je fus violemment projeté en avant avec une torsion pénible de l’épaule. Nous labourâmes profondément le sol pendant quelques mètres et l’avion s’immobilisa, au grand dommage des roues. Je fermai l’admission d’essence et coupai le contact. L’officier de service arriva en voiture et me dit froidement :
– Il était évident que vous alliez cafouiller. Vous étiez trop haut et trop lent. Pas assez de puissance. Une approche défectueuse... Vous n’avez pas l’air de vous douter que nous manquons de Spitfire. Et que venez-vous faire ici ?
– J’ai instruction de vous remettre ces cartes.
Je rentrai à Hawarden et fis un rapport au commandant sur ce désastreux incident. C’était un chic type et il tint compte du fait que je devais atterrir sur un terrain exigu. On me confia un autre Spitfire très peu après et je n’entendis plus parler de l’incident. Mais j’étais devenu suspect. Mes vols étaient contrôlés de très près. Un autre cafouillage, et j’aurais certainement été vidé.
Fin août, je reçus l’ordre de rejoindre la 19e escadrille, à Duxford, près de Cambridge. Je voyageai par le train, avec mon maigre bagage.
Je totalisais alors 205 heures de vol, dont 23 sur des Spitfire.
Des Messerschmitt dans le ciel
Le 19e squadron était basé à Fowlmere. Cet aérodrome n’était guère qu’une grande prairie et lorsque j’y arrivai, en compagnie de deux autres pilotes ; il n’y avait que deux Spitfire sur le terrain. Le « squadron » avait reçu l’ordre de décoller une demi-heure auparavant.
Le Spitfire le plus proche paraissait différent de ceux sur lesquels nous avions volé à Hawarden, et je m’en approchai pour l’examiner en détail. Un changement radical lui avait en effet été apporté. Bien que le moteur Merlin et la cellule fussent les mêmes, les huit mitrailleuses étaient remplacées par deux canons.
Des mécaniciens étaient en train de démonter et de nettoyer ces canons. Un jeune officier surveillait l’opération, en discourant avec un sous-officier qui l’écoutait, l’air accablé. Je choisis le moment opportun pour me présenter à lui en tant que nouvel arrivant à l’escadrille. Il ne se perdit pas en paroles de bienvenue, mais entreprit un long discours sur le nouvel armement. Les premiers Spitfire équipés de canons étaient arrivés au début de juillet, et ma nouvelle unité servait de cobaye au Fighter Command. Il désigna ces nouveaux canons par un qualificatif énergique. Tous les membres du squadron partageaient son indignation. Lorsque ces canons voulaient bien fonctionner, ils étaient extrêmement efficaces contre les bombardiers ennemis, car ils avaient une puissance accrue, une plus grande rapidité de pointage, une portée plus considérable que les mitrailleuses. Mais il était rare qu’ils fonctionnent correctement. Une semaine auparavant, sept Spitfire avaient attaqué une vaste formation de chasseurs et bombardiers ennemis. Trois bimoteurs 110 Messerschmitt avaient été détruits, mais six appareils avaient eu des ennuis avec leurs canons, sans quoi la chasse eût été encore plus fructueuse. En une autre occasion, où toute l’escadrille était engagée dans des combats individuels, deux Spit seulement avaient réussi à tirer tout leur stock d’obus. C’était plutôt malsain, dans ces conditions, d’avoir affaire à des Messerschmitt. Tous les pilotes regrettaient leurs Spit armés de huit mitrailleuses.
– Je me demande comment nous trouverons le temps de vous entraîner. Il va falloir d’abord faire marcher ces satanés engins.
Ce soliloque désabusé fut interrompu par le grondement d’une formation de Spitfire au-dessus de nos têtes.
– Pas de casse cette fois ! s’exclama mon compagnon, sans quoi ils reviendraient en ordre dispersé. Allons au-devant d’eux.
Les pilotes descendirent d’avions et se groupèrent autour du squadron leader. C’était leur troisième patrouille de la journée, et ils n’avaient pas rencontré la Luftwaffe.
Déjà, les deux commandants de vol inscrivaient à la craie, sur un grand tableau noir, les noms des pilotes pour le prochain vol. Un officier rejoignit le groupe et annonça que le Fighter Command venait de téléphoner. Il se fit un grand silence. L’officier expliqua que, selon toutes probabilités, l’escadrille serait retirée de la bataille jusqu’à ce qu’il soit remédié aux défauts du nouveau canon. Elle serait envoyée sur un aérodrome plus au nord et remplacée à Fowlmere par un squadron d’appareils à huit mitrailleuses.
Les pilotes exprimèrent à haute voix leur mécontentement. Pourquoi ne pas leur redonner des Spit à huit mitrailleuses ? Il y en avait, au centre d’entraînement de Hawarden. J’opinai avec vigueur, heureux de pouvoir prendre part à la discussion. Pourquoi ne pas envoyer à Hawarden ces sacrés Spitfire à deux canons et les échanger contre des appareils d’entraînement ?
Le squadron leader, qui était resté silencieux, promit d’intervenir le jour même auprès de l’échelon supérieur, à Duxford.
– Et maintenant, mes amis, c’est l’heure du thé.
Notre commandant profita de cet intermède pour nous poser un certain nombre de questions :
– Combien d’heures de Spit ?
– Dix-huit, Sir.
– Vingt-trois, Sir.
– Dix-neuf, Sir.
– Hum !... Vous aurez droit à quelques heures de pratique avant de participer, aux opérations. Pour le moment, votre problème est de trouver un lit. Revenez me voir demain.
L’ordre de départ arriva bientôt et nous vîmes les Spitfire s’élever et disparaître dans le crépuscule. Ils devaient patrouiller au-dessus de Debden et seraient peut-être aux prises, dans quelques minutes, avec des Messerschmitt volant à haute altitude. Nous autres, blancs-becs, retournâmes à Duxford dans un morne silence.
Bien qu’appartenant officiellement au 19e squadron, un monde nous séparait de la poignée de pilotes qui venaient de disparaître à l’horizon.
Pendant le dîner, nous tirâmes des plans. Le repas terminé, nous prendrions à part un ou deux pilotes chevronnés et, autour de quelques bouteilles de bière, nous tâcherions de leur soutirer des tuyaux.
Notre stratagème fut couronné de succès et nous fûmes bientôt gratifiés de récits de combats entre Hurricane et Messerschmitt.
Nos nouveaux amis étaient qualifiés pour parler avec autorité. C’étaient des pilotes tchèques qui, fuyant leur patrie envahie, s’étaient réfugiés en Angleterre. Ils appartenaient maintenant au 310e squadron. Heureusement pour nous, ils étaient moins discrets que les pilotes britanniques, et bientôt nous nous trouvions dans le vif d’un combat – verbal – à 8 000 mètres d’altitude, contre des Messerschmitt qui paraissaient surgir du soleil.
C’était l’époque où la Luftwaffe survolait le sud de l’Angleterre en larges formations de chasseurs et de bombardiers pour pilonner nos aérodromes de chasse. Ces formations comprenaient généralement de cinquante à cent bombardiers, Heinkel 111, Dornier 17 ou Junker 88, escortés par des hordes de Messerschmitt 110 bimoteurs et des 109 monomoteurs. La proportion était d’environ trois chasseurs pour un bombardier, si bien qu’une formation de bombardiers était souvent accompagnée par plus de deux cents Messerschmitt 110 ou 109.
D’après nos amis tchèques, les Hurricane étaient robustes, mais plus lents et moins maniables que les Spitfire. La tactique idéale était que les Hurricane s’attaquassent aux Dornier, et aux Heinkel, plus lourds et plus lents, cependant que les Spitfire neutraliseraient les Messerschmitt à haute altitude. C’était très beau en théorie, mais en pratique les Hurricane étaient presque toujours attaqués par les 109 avant d’être aux prises avec les bombardiers.
Le 109 ? Ils échangèrent un regard qui trahissait leur appréhension. Un bon avion de chasse, avec un plafond supérieur à celui des Hurricane et des Spitfire. Et, de plus, le 109 E était armé de deux excellents canons de 20 millimètres, montés sur les ailes, et de deux mitrailleuses. Pilotés par des vétérans de la guerre d’Espagne, qui connaissaient la valeur de l’élément surprise et l’importance tactique de l’altitude et du soleil. Le 110 n’avait rien d’inquiétant. Il était plus lent que le Hurricane. Dès qu’ils étaient attaqués, les pilotes du 110 formaient le cercle, mais il était facile de percer leur défense si aucun 109 n’intervenait. Le 109, nous apprendrions bientôt à le connaître.
Je commandai une nouvelle tournée.
– Quelle était notre tactique ? demandai-je. En quelle formation volions-nous ? En file arrière ou en ligne de front ?
L’agressivité des 109 ne laissait guère à nos chasseurs le temps d’exécuter des manœuvres savantes. La technique devait être simple. Surprendre l’ennemi et l’attaquer avec le soleil dans le dos, pendant que votre numéro deux protégeait vos arrières. Et rester toujours aux aguets. Il suffit de quatre secondes pour abattre un chasseur. Il fallait donc faire un tour d’horizon toutes les trois secondes !
Les formations de squadrons variaient d’une unité à une autre. Il n’y avait pas de règle fixée d’avance, et tout était laissé à l’initiative du squadron commander. En temps de paix, les chasseurs volaient en formation de trois, en V renversé. Quelques squadrons avaient gardé cette formation et allaient au combat en quatre V renversés, d’autres en trois sections de quatre appareils. Ces formations de quatre faisaient une ligne arrière, mais quand le chef de file commençait des zigzags, le numéro quatre (qu’on appelait « Charlie-en-queue »), n’avait guère le temps de regarder derrière lui, occupé qu’il était à rester dans la formation. Aussi, les Charlie-en-queue étaient-ils les premiers à être arrosés, d’autant que leurs pilotes étaient invariablement les derniers venus.
Avions-nous entendu parler de Douglas Bader, le pilote amputé des deux jambes, qui commandait le 242e squadron ? La plupart de ses pilotes étaient canadiens. Son squadron était basé à Coltishall, dans le Norfolk, mais il opérait souvent à partir de Duxford. Il ne mâchait pas son opinion sur l’avantage des larges formations de chasseurs et avait proposé que les deux squadrons de Duxford, le 19e et le 130e, soient fondus avec son squadron pour former un wing. En tant que leader, il se placerait en bas de la formation. Le 310e volerait vers le soleil à 600mètres au-dessus, et le 19e protégerait les Hurricane en restant dans le soleil. Trente-six chasseurs. Voilà comment il concevait le combat, plutôt que d’attaquer par petits paquets.
Les Tchèques devinrent silencieux et finirent leur bière. Il n’était que dix heures du soir, mais ils s’étaient levés à l’aube et avaient besoin de sommeil. Ils claquèrent discrètement des talons et se retirèrent.
Le lendemain matin, nous nous rendîmes à Folmere. Le squadron était déjà engagé contre une soixantaine de bombardiers, escortés de cent cinquante chasseurs, au-dessus de North Weald. Ils revinrent individuellement, ou par deux, et nous firent le récit du combat. Deux avions ennemis avaient été descendus, et un certain nombre endommagé. Mais le mauvais fonctionnement des canons avait une fois de plus empêché de meilleurs résultats.
Toutefois, d’excellentes nouvelles étaient venues du Fighter Command. Le commandant en chef avait décidé de remplacer les Spitfire à canons par des chasseurs à huit mitrailleuses, qui devaient arriver dans la soirée. Le squadron pourrait ainsi participer de nouveau aux opérations.
Deux journées d’automne passèrent, sans nuages, et je ne m’étais pas encore approché de la carlingue d’un Spitfire ! Une fois de plus, l’alerte avait été donnée, et lorsque, quarante minutes plus tard, les Spit revinrent sur le terrain, deux d’entre eux avaient été endommagés. Le squadron leader n’était pas rentré. Ils avaient rencontré des bombardiers ennemis, escortés en force par des Messerschmitt.
Le lendemain, nous reçûmes instruction de rejoindre le 616e squadron à Coltishall. Cette unité venait d’être retirée de la ligne du front et aurait ainsi la possibilité de former les pilotes nouvellement arrivés à l’escadrille. La sonnerie du téléphone retentit :
– On a retrouvé le squadron leader. Il était probablement mort lorsqu’il s’est écrasé au sol.
Il y eut une minute de silence.
– Eh bien, bonne chance avec le 616e !
De nouveau, nous prîmes le train pour nous rendre à l’aérodrome de Coltishall, dans le Norfolk. Notre nouveau squadron-commander était Billy Burton, un jeune homme bien découplé d’environ mon âge. Il était « de l’active » et avait eu une carrière rapide. Très exigeant, pour lui-même comme pour les autres, il était toujours plein de vitalité et d’enthousiasme. Je sympathisai immédiatement avec lui et je puis dire maintenant que je n’ai jamais servi sous les ordres d’un meilleur chef. Il se confia immédiatement à nous.
– Le squadron a connu des heures difficiles à Kenley. En quelques semaines, il a perdu un assez grand nombre de pilotes, si bien qu’on l’a retiré du front il y a deux jours, pour m’en donner le commandement. Je veux le remettre sur le pied de guerre aussi rapidement que possible, pour que nous soyons prêts à retourner dans le Sud. Quant à vous, Johnson, vous allez voler avec moi dans une demi-heure. Je veux voir ce que vous avez dans le ventre.
Je plaçai mon Spitfirè à côté de l’aile tribord du commander et nous montâmes de conserve au-dessus des chaumes et des étangs de l’East Anglia. C’était un temps idéal pour voler ; la visibilité était sans limites. Après quelques virages faciles en formation serrée, je pris position derrière lui, sur un signal de Burton. Et le cirque commença. De rapides piqués avec moteur – l’indicateur de vitesse enregistrant plus de 650 km à l’heure. Ensuite, une montée en chandelle, à pleins gaz, suivie par un tonneau en partant du sommet de la boucle. Des tonneaux lents et rapides. Des demi-tonneaux et des piqués, des virages sur l’aile et des renversements. Et, sur un signal, de nouveau en formation frontale.
Lorsque nous atterrîmes, une heure après, mon épaule droite était douloureuse, mais j’étais gonflé à bloc, car, après mes déconvenues de la semaine précédente, je sentais que j’avais fait quelques progrès.
– Pas mal, Johnson, pas mal du tout. Mais vous devez toujours rester aux aguets. Votre vie en dépend. Il ne s’agit pas de regarder simplement en l’air. Apprenez à vous concentrer sur un coin du ciel et à le fouiller à fond. Essayez d’identifier les appareils que vous détectez. Avec l’entraînement, vous verrez que vous pouvez améliorer considérablement votre acuité visuelle.
Le samedi suivant, Burton nous donna congé, à l’exception d’une section de garde. Après une douche, nous nous changeâmes en vitesse et nous nous empilâmes dans une vieille voiture, pour nous rendre à Norwich par une route fertile en cahots et en virages.
Quelques heures plus tard, nous formions encore un groupe compact dans le bar de la Cloche, lorsque la police militaire fit irruption dans la salle enfumée et nous annonça que tout le personnel de la R.A.F. devait rallier immédiatement ses bases.
À Coltishall, nous apprîmes que l’alerte n° 1 avait été déclarée. « Invasion imminente et probable dans les douze heures. » Nous trouvâmes le mess en pleine agitation. Notre commandant restait invisible et les rumeurs les plus sensationnelles circulaient. L’explication la plus populaire était que l’invasion avait commencé par des débarquements, ennemis sur la côte orientale. C’est à ce moment qu’un squadron leader à la démarche gauche fit son apparition au milieu de notre petite assemblée bruyante. En termes imagés, il s’enquit des raisons du vacarme. Plusieurs proposèrent des explications. Son regard fit le tour de la salle, établissant un lien de camaraderie entre nous.
Il y eut un moment de silence pendant qu’il digérait les nouvelles.
– Les salauds ont débarqué. Il va y avoir du sport avec ces cibles vivantes qui vont s’offrir sur nos plages. On pourra faire du tir à volonté.
Et, avec ses lèvres, il fit une vague imitation du bruit d’une mitrailleuse.
L’effet fut immédiat et extraordinaire. Chacun entreprit la tâche qui lui était assignée et tout fonctionna sans heurts. Plus tard, nous apprîmes que c’était une fausse alerte, mais l’incident nous laissa une profonde impression sur les qualités de chef de ce squadron leader. Ce fut ma première rencontre avec ce personnage légendaire qu’était déjà Douglas Bader.
Mon épaule droite me causait beaucoup d’inquiétude. À l’époque j’ignorais que ma blessure de rugby n’avait pas été convenablement traitée en 1938 et que mon atterrissage forcé à Sealand n’avait pas arrangé les choses. La fracture de l’omoplate restait sensible. Je devais prendre des précautions pour serrer ma ceinture dans la carlingue ou pour fixer les bretelles de mon parachute. Je commençai par capitonner mon épaule avec un tampon de coton, que je fixai avec du sparadrap. Mais mes ennuis n’en restaient pas là. Quelquefois, je ressentais une crampe dans la main droite. J’en arrivais à utiliser ma main gauche pour manier le levier de commande, ce qui n’était pas sans danger.
Je voulais éviter un examen médical officiel. Chaque jour, je me sentais davantage un membre de l’équipe. Johnson s’était contracté en « Johnnie », et je voulais faire mes preuves au combat.
Je me souvins qu’avant de rejouer au rugby, après mon accident, j’avais subi un traitement thermique et des massages. Peut-être cela me réussirait-il encore...
J’en parlai, au mess, à un jeune docteur qui était pilote. Il me témoigna beaucoup de sollicitude et insista pour que je l’accompagne à l’infirmerie :
Je n’étais pas très « chaud », car je redoutais un examen approfondi. Mais le jeune docteur insista et me promit la discrétion. Il fit divers tests avec une aiguille, qu’il enfonça dans les doigts de ma main droite. C’est à ce moment qu’un médecin d’un grade plus élevé fit son apparition. Qu’est-ce qui n’allait pas ? Le jeune docteur donna des explications, et son collègue se livra à un examen approfondi.
Les deux médecins furent pleins de prévenances. Je ressentirais probablement le bienfait d’un traitement thermique et de massages, mais il serait indiqué de me faire des rayons X... Je devais entourer mon épaule avec du coton et éviter toute fatigue du bras. Ils me réexamineraient dans deux jours.
Le lendemain, je me préparais pour un vol, lorsque Burton vint à moi.
– Le station-commander veut vous voir, Johnson. Et il veut me voir en même temps.
Nous nous rendîmes en silence chez le station-commander, qui répondit à mon salut par un bref signe de tête.
– Johnson, les docteurs me disent que vous souffrez d’une affection de l’épaule droite.
Il regarda à travers la fenêtre deux des Spitfire qui prenaient leur vol.
– Dans ces conditions, je vous interdis de voler. Tous nos pilotes doivent être dans une forme parfaite. Puisque votre épaule ne vous a pas gêné quand vous étiez, à l’entraînement, je pourrais vous transférer au Training Command, où vous deviendriez instructeur sur des Tiger Moths ?
Il marqua une pause et regarda de nouveau par la fenêtre. Je compris soudain pourquoi il paraissait si mécontent. Il me soupçonnait de souffrir d’une maladie qui n’était pas inconnue, et qu’on appelait officiellement « manque de fibre morale ». Nous autres, pilotes, appelions cette maladie d’un autre nom. Sans aucun doute, il pensait que je me servais de mon épaule comme excuse pour échapper au service actif.
– À moins que vous ne vouliez tenter une opération ? Les docteurs pensent que si votre épaule est ouverte et ressoudée, vous avez une bonne chance de vous rétablir complètement. C’est à vous de choisir.
Je ne marquai aucune hésitation :
– Quand puis-je aller à l’hôpital, Sir ?
La tension disparut et le wing-comander esquissa un sourire... Contre les meilleurs usages, Billy Burton sortit une pipe.
– D’accord, Johnnie. Je vais arranger ça... Vous allez rester quelque temps sans voler... Est-ce que vous voulez l’avoir ensuite, Billy ?
Pendant une seconde, mon avenir resta en balance. Ou bien rejoindre mon squadron, ou être envoyé dans un pool de chasseurs pour remplir la première vacance.
– Je crois que j’en ferai quelque chose, répondit Burton.
À l’hôpital de Raucehy, dans le Lincolnshire, mon épaule fut opérée par un jeune chirurgien qui fit un excellent travail. À la fin de l’année, j’étais de nouveau apte à voler sans restrictions, et je me préparai avec la joie qu’on devine à rejoindre mon squadron.
La tactique du combat aérien
Quand je retournai à l’escadrille, en décembre, la brume hivernale enveloppait l’Angleterre et la Luftwaffe avait complètement interrompu ses attaques de jour. Mais la Force aérienne allemande n’était nullement défaite, comme les années à venir devaient en administrer la preuve. On pouvait dire seulement que la R.A.F. l’avait tenue en échec et l’avait empêchée de réaliser son objectif immédiat : conquérir la supériorité aérienne dans le ciel de l’Angleterre du Sud, prélude essentiel au succès de l’invasion nazie.
Il est intéressant de constater que les Allemands ont abordé la bataille contre la R.A.F. avec la rigidité qui les caractérise. Leur plan contre la Force aérienne polonaise avait remporté un plein succès. Pourquoi, pensèrent-ils, ne pas l’utiliser contre nous ? En conséquence, la Luftwaffe passa d’un objectif à un autre avec des plans préétablis, sans se préoccuper du succès ou de l’échec de ses attaques. Finalement, sur les instances d’Hitler en personne, l’attaque fut concentrée sur Londres, ce qui donna à notre Flight-Command un répit dont il avait le plus grand besoin.
Incontestablement, les Allemands ne se rendirent pas compte de l’effort nécessaire pour mettre hors de combat notre force aérienne, bien entraînée et scientifiquement organisée, et ils sous-estimèrent la puissance de récupération de la R.A.F. Si la Luftwaffe avait persisté dans ses attaques contre nos aérodromes dans le sud de l’Angleterre, le résultat eût incontestablement été différent.
La Luftwaffe possédait d’excellents appareils, tels le Messerschmitt 109, dont le plafond était plus élevé et l’armement supérieur à celui du Spitfire et du Hurricane. Le chasseur ennemi était équipé de quatre mitrailleuses, ou de deux mitrailleuses et deux canons. Cette dernière combinaison était préférable à nos huit mitrailleuses Browning. Le 109 F, qui devait bientôt faire son apparition au-dessus de l’Angleterre, portait un canon monté dans l’axe et tirant à travers l’hélice, et les modèles suivants de ce magnifique chasseur furent pourvus de trois canons.
Pendant les combats au-dessus de Dunkerque, nos pilotes s’aperçurent que leurs Spitfire avaient une légère supériorité en vitesse et en altitude sur le 109 F. Mais la plupart de ces combats se déroulaient au-dessous de 6 000 mètres, et plus tard, quand nous eûmes à combattre bien au-dessus de cette altitude, nous ne fûmes pas longs à découvrir que le chasseur ennemi était réellement supérieur, parce que son compresseur avait été conçu pour fonctionner plus efficacement aux grandes altitudes. Quand le Messerschmitt se dégageait en faisant des demi-tonneaux et des piqués à la verticale, nous ne pouvions pas l’accompagner dans cette manœuvre. Certes, le Spitfire était plus maniable, mais la maniabilité ne gagne pas des victoires aériennes, et les virages serrés constituent une tactique plus défensive qu’offensive. Le rayon de virage du Spitfire vous tirait d’affaire si vous voyiez votre adversaire à temps, mais seul un plafond supérieur vous mettait à l’abri d’une surprise.
La Luftwaffe plaçait beaucoup d’espoirs dans le compagnon d’écurie du 109, le bimoteur Messerschmitt 110 D. Il avait un plus grand rayon d’action que le 109 et, en conséquence, était souvent employé pour escorter les formations de bombardiers. Il était formidablement armé, mais il ne pouvait tenir tête ni au Spitfire, ni au Hurricane, et plus d’une fois les 109 durent venir au secours des chasseurs bimoteurs en difficulté.
Le bombardier en piqué Junker 87, le Stuka, avait remporté un grand succès comme arme de support rapproché, dans les récentes campagnes. C’était une pièce d’artillerie volante, qui pouvait plonger presque à la verticale, vitesse réduite. Cela lui permettait d’atteindre ses objectifs terrestres avec une grande précision, et de lâcher ses bombes au dernier moment. Mais il ne pouvait se défendre contre nos Spitfire, comme il l’apprit à ses dépens.
Des trois types de bombardiers ennemis, Heinkel 111, Dornier 17 et Junker 88, ce dernier était supérieur aux deux autres, et le plus difficile à abattre.
Il faut reconnaître aux Allemands le mérite d’avoir mis au point la meilleure formation de chasseurs. Elle était basée sur ce qu’ils appelaient la rotte, qui comprenait deux chasseurs à environ 200 mètres l’un de l’autre, la tâche principale de l’ailier étant de protéger le leader contre une attaque de côté ou par derrière. En même temps, le leader était chargé de la navigation et de la protection de son ailier. La Schwarme, avec quatre chasseurs, consistait tout simplement en deux paires, et, quand nous copiâmes la Luftwaffe et adoptâmes ce dispositif, nous l’appelâmes « finger four », car la position relative des chasseurs était celle des quatre doigts de la main.
Regardons la main droite et supposons que le soleil brille bien, au-dessus du côté gauche de la main. Le majeur représente le leader ; l’index, le numéro deux, dont le rôle est de scruter l’espace aérien au-dessous du soleil. L’ailier vole plus bas que le leader, si bien que les pilotes peuvent le voir facilement sous le reflet direct du soleil. Une attaque partira généralement du soleil ; aussi doit-on faire constamment le guet dans cette direction. C’est pourquoi les numéros trois et quatre volent à droite du leader, mais légèrement plus haut, pour qu’il y ait toujours deux paires d’yeux en train de scruter la zone dangereuse.
Quand vous volerez en Spitfire à 8 km au-dessus de la terre, vous constaterez que vos ailes vous cachent une partie importante du terrain et du ciel au-dessous de vous. À cette hauteur, une superficie de 2 500 km vous est dérobée. Mais la formation « en quatre doigts » permet de remédier à cette lacune. Cette formation est lâche, et peut évoluer facilement. Les trois pilotes qui suivent le leader peuvent scruter l’espace aérien sans attraper de torticolis. Il est plus facile de maintenir cette formation que de voler en ligne arrière. Elle peut aisément se scinder en deux éléments de deux avions, ce qui est la plus petite formation concevable, car un pilote isolé ne peut se protéger en même temps dans toutes les directions. Elle se transforme facilement en une escadrille, ou un wing. Elle est réconfortante pour le moral, car le dernier d’une formation en ligne arrière, le « tail-end Charlie », sait qu’il sera le premier à être descendu en cas d’attaque, alors que son équivalent dans l’autre formation a autant de chances de s’en tirer que ses camarades.
Le fait est que cette formation a survécu à la guerre, et qu’elle a été utilisée par les Sabre-Jets et les Mig 15 pendant la guerre de Corée.
Le chasseur est simplement une mitrailleuse volante ; il doit utiliser à son avantage ses qualités de vitesse et de surprise. Le leader, qui a l’avantage de la hauteur, contrôle la bataille. Avec l’altitude, il peut utiliser au mieux le soleil ou les nuages. Les pilotes de la Première Guerre mondiale avaient découvert cette simple vérité, qu’ils concrétisaient dans la formule : « Prenez garde aux Huns dans le soleil. » Cet avertissement reste toujours valable, aujourd’hui comme hier.
Le bombardier est le véritable instrument de la puissance aérienne. Le chasseur, quand il est utilisé offensivement pour prêter assistance au bombardier, est simplement un moyen pour une fin. Dans un combat pour la domination aérienne, c’est le bombardier, aidé par le chasseur, qui décidera de l’issue. Utilisés seuls, les chasseurs peuvent provoquer les défenseurs au combat, mais le nombre d’avions abattus dans de telles rencontres décidera rarement du résultat d’ensemble.
Il y a deux moyens, pour un chasseur, d’apporter son concours à des opérations de bombardement. Des formations rangées de chasseurs peuvent balayer le ciel en avant, au-dessus et sur les côtés des bombardiers. Habituellement, ils ne sont pas en vue de ces derniers, dont ils peuvent être séparés par cent ou cent cinquante kilomètres. Leurs leaders doivent avoir une complète liberté d’action, et ce type d’opération, qui donne d’excellents résultats, s’appelle support de bombardiers par des chasseurs.
L’escorte de bombardiers par des chasseurs est différente du support, car les chasseurs qui protègent les bombardiers sont en vue de ces derniers, et les plus rapprochés ne sont pas autorisés à donner la chasse à l’ennemi en s’éloignant de la formation. L’expérience a démontré que, sur trois escadrilles d’un wing servant d’escorte, deux devaient être libres de s’écarter pour donner la chasse à l’ennemi.
Les chasseurs doivent toujours être utilisés aussi offensivement que possible, et il ne fait aucun doute que Goering s’en rendit compte, car, après une conférence avec ses commandants de l’Armée de l’Air, avant la bataille d’Angleterre, il donna des instructions précises sur l’emploi de la chasse. Une partie seulement des chasseurs devait être utilisée pour escorter les bombardiers ; le reste devait être, employé dans des opérations individuelles contre les chasseurs de la R.A.F., ce qui constituerait une protection indirecte pour les bombardiers.
Ces instructions furent assez mal suivies par la Luftwaffe, car, durant le mois d’août et au début de septembre, les chasseurs allemands furent rarement utilisés en dehors de l’accompagnement des bombardiers.
Après la guerre, Galland nous déclara qu’à cause des lourdes pertes en Stuka, les bombardiers se plaignirent à Goering de l’incapacité des chasseurs à fournir une protection adéquate, à la suite de quoi le Reich-Maréchal modifia ses instructions.
Donc, au début de septembre, l’ennemi abandonna ses attaques sur nos aérodromes, et concentra son attention sur Londres. Les attaques diurnes sur Londres furent marquées par un changement de tactique. Les bombardiers pénétraient sur un large front, leur nombre variant entre vingt et quarante appareils. Un nombre similaire de 110 constituait une escorte rapprochée et de larges formations évoluaient au-dessus et sur les côtés des bombardiers. Ces formations étaient envoyées en deux ou trois vagues, et l’attaque durait parfois une heure.
L’importance des formations que nous devions opposer à l’ennemi était l’objet de discussions animées entre le vice-ma