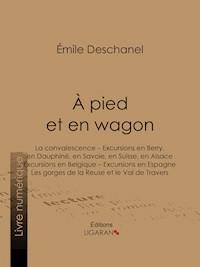
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lorsque rit la belle saison, ne trouvez-vous pas qu'il est agréable d'errer, sans plan, sans parti pris, au jour le jour, – et de laisser aller son esprit – comme ses jambes – au hasard ? Voilà comme je viens de faire, depuis tout à l'heure trois mois, en Berry, en Dauphiné, en Savoie, en Suisse, en Alsace. Vive l'école buissonnière ! Chacun le fait de son côté, en été. Si vous voulez venir du nôtre, vous n'irez que jusqu'où vous voudrez".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce volume devait être intitulé : Par Monts et par Vaux, comme l’avait été, il y a six mois, une partie des chapitres qui le composent, lors de la première publication dans le Journal des Débats. Déjà le livre était entièrement imprimé avec ce titre, qui lui convient plus précisément que le titre actuel ; déjà même le volume était broché, et il allait être mis en vente, lorsque nous apprîmes que, depuis deux mois environ, il existait en librairie un autre volume portant le même titre : Par Monts et par Vaux. Quoique la prise de possession de ce titre, dans les Débats, par M. Émile Deschanel, eût de beaucoup l’antériorité, cependant, pour prévenir les contestations qui auraient pu s’élever, nous avons jugé à propos, d’accord avec l’auteur, de changer la couverture et le titre du présent volume ; mais on comprend que le titre courant n’a pu être modifié.
La convalescence. – Voyage par ordonnance du médecin.
Mme de Sévigné écrit quelque part à sa fille : « Vous souvient-il quand nous trouvions qu’il n’y a rien de si bon qu’une méchante compagnie, par la joie du départ ? »
Je me demandais l’autre jour si l’on ne pourrait pas mettre les maladies au nombre des méchantes compagnies, et dire qu’il n’y a rien de si bon que cela, par le plaisir de la convalescence ?
Premièrement, on trouve quelque charme à se rappeler en sécurité une douleur passée, Habet enim præteriti doloris secura recordatio delectationem, c’est Cicéron qui écrit cela à Luccéius. Après des souffrances aiguës, absence de toute sensation devient volupté. Bien plus, on goûte la douleur qui s’éloigne ; on en ressent, non sans plaisir, les dernières titillations, qui, comme une souris, courent de çà, de là. Puis, peu à peu, tout s’apaise et s’éteint dans un engourdissement vague. C’est le dernier nuage qui voile le ciel avant le retour complet du beau temps.
Dans ce crépuscule éclairé d’un premier rayon de santé, on ne bouge pas, on ne souffle pas ; on craindrait de déranger les couches paisibles de l’atmosphère qui nous enveloppe de silence et de douceur ; on craindrait d’agiter les molécules pacifiées du corps à peine rétabli, et d’aviser les nerfs d’un désordre à quoi ils ne pensent plus.
La convalescence est la halte heureuse, le plateau fleuri, la douce oasis, d’où l’on contemple les tristes chemins que l’on n’a plus à parcourir.
Deuxièmement, cette oasis est un terrain neutre, un lieu de franchise, un asile, dans lequel, en dehors du monde et des travaux et des tracas de chaque jour, on jouit de sa liberté. Comment n’en jouirait-on pas ? Il y a cas de force majeure : on est de loisir, et l’on n’y peut rien. On voudrait ne pas dire : À demain les affaires ! que le docteur le dit pour vous. C’est une liberté forcée, on n’en peut mais, on s’en lave les mains, on est libre parce qu’on est cloué sur son lit. Alors on en prend son parti ; on goûte ce repos sans remords : que dis-je ? on a la joie d’accomplir un devoir, – ce devoir est de ne rien faire ! C’est le monde renversé ! O beatitudo !
Pythagore disait qu’il n’y a point de temps présent et que ce que nous appelons le présent n’est que la jointure du passé et de l’avenir, – c’est Montaigne qui traduit ainsi. – Hélas ! il est trop vrai, dans la vie ordinaire, où le tourbillon nous emporte, où nous allons, comme Ahasverus ou Isaac Laquedem, obéissant à la fatale voix : Marche ! marche ! fatigués de ce que nous faisons, inquiets de ce que nous ne faisons pas, il n’y a point de temps présent, tout fuit, tout nous échappe,
mais dans la convalescence, oh ! non pas ! j’en demande bien pardon à Pythagore ; la convalescence est un point présent qui se détache d’hier et de demain, une île fortunée, qu’aucun pont ne relie aux tristes pays d’alentour. Le docteur a coupé les ponts, – ce bon docteur ! Et l’on y vit dans l’état bienheureux des dieux oisifs du poète Lucrèce et de son maître immortel Épicure. On se sent peu à peu convertir, sans formules, et par un travail latent qui s’opère en nous, aux croyances des Indiens, les maîtres de ce maître, qui enseignent que le repos et le néant sont le fondement de toutes choses, la fin où elles aspirent et où elles aboutissent, des Indiens rêveurs et contemplatifs qui regardent l’entière inaction comme l’état le plus parfait, qui en font l’objet de tous leurs désirs, et qui donnent au souverain Être le surnom d’immobile.
Voltaire écrivait à Mme de Bernières : « Je regarde les maladies un peu longues comme une espèce de mort qui nous sépare et nous fait oublier de tout le monde ; et je tâche de m’accoutumer à ce premier genre de mort, afin d’être un jour moins effrayé de l’autre. »
Et, plus tard, il écrivait à Mme du Deffand : « La maladie ne laisse pas d’avoir de grands avantages. »
Donc, la conscience dégagée, puisque la paresse est en ce moment le seul devoir que l’on ait à accomplir, on l’accomplit. On dort, on rêve, on se souvient, on se recueille, on s’analyse, on s’étudie, dans les moindres nuances, dans les moindres détails. On se rappelle successivement toutes les phases de sa vie, marquées par tel ou tel évènement, surtout par telle ou telle lecture, par tel ou tel air de musique : car tout être intellectuel pourrait, ce me semble, écrire ses mémoires personnels rien qu’avec deux listes, l’une de morceaux de musique, et l’autre de livres. On revit toute sa vie passée ; on vit d’avance toute sa vie à venir : avec cette double vue que produit le jeûne, on aperçoit ce qui est encore caché sous l’horizon. On vit sa mort même, si la fantaisie vous en prend ; tantôt on reste de ce côté-ci de la tombe, et tantôt on va de ce côté-là, on flâne dans sa vie future.
De sorte que l’on ne vit jamais tant que dans ces jours où l’on ne fait rien. C’est qu’en effet ce qu’on appelle vivre, à l’ordinaire, ce n’est pas vivre. Faire des chapeaux si l’on est chapelier, des chaussures si l’on est cordonnier, des pains si l’on est boulanger, des tartines si l’on est député, avocat ou journaliste, des mécontents si l’on est ministre, des envieux si l’on est heureux, est-ce que c’est là vivre ? Non, non, c’est jouer d’une mécanique, c’est tourner une manivelle, c’est faire aller un tournebroche ou un tourniquet, – métier de caniche ou d’écureuil ; – mais ce n’est pas faire œuvre d’homme ! Faire œuvre d’homme, c’est ne rien faire, – que penser peut-être, ou croire qu’on pense ; – c’est vivre dans la quiétude ; c’est sentir son âme, ou s’imaginer qu’on la sent. Tout le reste, travailler, manger, boire, dormir, et les autres choses, – quoiqu’on en fasse cas, et que peut-être on n’ait pas tort, – ne sont que des apprêts du vivre et des moyens de l’entretenir. C’est le recueillement qui est la vie. Heureux qui sait goûter cette tranquillité sans plaisirs, ce bien-être simple, ce repos mêlé de tristesse douce, qui est préférable à la joie ! S’ennuyer un peu, d’une manière calme, c’est peut-être le plus véritable bien d’ici-bas. Les plaisirs bruyants sont le passe-temps stérile des gens qui ne sentent rien, qui ne se plaisent pas avec eux-mêmes, et qui cherchent à s’en distraire. Oh ! plaignons-les ! Étourdir la vie, est-ce en jouir ? Écoutez ce qu’écrivait une jeune femme poêle, Mlle Louise Bertin, dans ses Glanes :
On s’en va donc ainsi flânant en soi-même, pendant ces longues et agréables journées de la convalescence, – agréables justement parce qu’elles sont longues ; – tout en faisant l’école buissonnière dans son for intérieur, on étudie tout ce qu’on y rencontre ; et on s’aperçoit à la fin qu’on a étudié, sans s’en douter, la convalescence elle-même.
Or, je ne sais pas si mes observations se rapporteront avec les vôtres, mais il me semble que la convalescence, au moins telle que je l’ai éprouvée, se divise en quatre périodes distinctes :
La période apathique,
La période poétique,
La période philosophique,
Et la période famélique.
La première – que, sans y prendre garde, je viens de décrire en partie, en empiétant même un peu sur la seconde – est ce relâche de la souffrance, cette voluptueuse insensibilité, ce repos du corps et ce recueillement de l’âme, hors desquels la vie n’est qu’un tumulte importun. Dans cet apaisement de la douleur et dans cette solitude aimable, dans ce silence de tous les bruits du monde, loin des tracas et des criailleries, on se possède enfin soi-même, on se retrouve ; et avec quel plaisir ! il y a si longtemps qu’on ne s’était vu ! On goûte le bonheur d’être avec soi, de se reposer et de se taire ; on est tranquille comme doivent l’être les morts dans leurs tombeaux par une belle nuit de lune sereine ; c’est un avant-goût d’une existence meilleure ; on comprend cet état charmant célébré par Horace,
et l’on se rappelle aussi ce vers de Virgile :
De temps en temps, survient, sans que vous en ayez tout à fait conscience, un léger assoupissement, qui n’interrompt pas le cours des pensées, mais qui plutôt les poétise, en les combinant d’une manière plus rapide et plus fortuite, et en ne les laissant entrevoir qu’à travers un nuage mobile, au prisme changeant. C’est la transition de la période apathique à la période poétique.
L’inaction mène à la rêverie. Pendant que cette vieille carriole qu’on appelle le corps est sous la remise, l’âme s’envole et jouit de l’espace. Après qu’on a compté toutes les fleurs de la tapisserie qui couvre les murs, et distingué dans leurs combinaisons mille paysages auxquels le dessinateur n’avait pas songé, mille personnages bizarres, mille poèmes inédits, on a épuisé l’horizon de la chambre, on se tourne d’un autre côté, on regarde en soi. Les impressions de l’enfance et de la jeunesse reviennent une à une, calmes et riantes, du fond du passé ; tout s’idéalise dans les lointains bleus. Les souvenirs éveillent les espérances, et les espérances consolent les souvenirs. Des multitudes de conceptions vagues flottent tranquillement sur le léger fluide de l’imagination assoupie ; elles s’en vont à la dérive, sans voiles, sans lest et sans gouvernail. La vie animale est comme suspendue, on ne la sent pas ; on vit à peine de la vie végétale ; c’est le beau moment pour la flânerie de l’esprit.
Dans ce grand silence, si quelques beaux vers nous reviennent à la pensée, si quelque strophe gracieuse se met à chanter dans notre mémoire, c’est un évènement heureux, qui nous ranime et nous récrée. Sans sortir de sa somnolence délicieuse, on en est ému doucement : ainsi, dans les paisibles bosquets de l’Élysée, les poètes nous peignent les ombres réveillées par la chute d’une rose. Parfois on suit une étymologie qui vous traverse le cerveau et l’on fait de charmants voyages, embarqué sur un mot dans les abîmes du passé, comme un insecte qui flotte au gré d’un fleuve sur un brin d’herbe. Parfois on construit des drames immenses, ou plutôt ils se construisent tout seuls en nous ; et nous en sommes spectateurs naïfs encore plus qu’auteurs émerveillés. On conçoit mille plans, mille scénarios, mille cadres. On fait mille projets en tous genres. Tout s’arrange, tout est facile, absolument comme lorsqu’on vient d’écouter de belle musique. On soulèverait des montagnes. On se garde d’essayer rien le docteur l’a défendu ! Par là on reste libre de croire qu’il n’en coûterait que d’essayer pour réussir. C’est à peu près l’histoire de Boileau écrivant à Racine : « Avec tout ce que je vous dis de mon extinction de voix, je ne me couche point que je n’espère le lendemain m’éveiller avec une voix sonore ; et quelquefois même, après mon réveil, je demeure longtemps sans parler, pour m’entretenir dans mon espérance. » De même on s’entretient aussi dans l’espérance qu’une fois relevé on accomplira des merveilles : l’amour-propre y trouve son compte, sans que l’esprit y dépense rien ; tout est pour le mieux.
Ou bien on se crée dans son cœur quelque idéal de tendresse impossible, on s’éprend de belle passion imaginaire pour des êtres fantastiques, comme cette jeune fille qui, au siècle dernier, mourut d’amour pour Télémaque, fils d’Ulysse.
Cependant l’influence du jeûne va croissant, et, si l’on continue de s’analyser, on comprend alors la faculté d’extase que les solitaires puisaient dans leur abstinence ascétique ; on a, par soi-même, quelque idée des hallucinations splendides qui travaillaient ces cerveaux austères excités par l’inanition, et des visions apocalyptiques que faisait éclore sous leurs crânes chauves le soleil ardent des Thébaïdes. C’est là qu’on passe, ce me semble, de la période poétique à la période philosophique ou mystique.
Dans la solitude, on est moins l’homme de son siècle et de son pays, on redevient l’homme de tous les temps et de tous les lieux. Les nœuds qui nous attachent à ce monde se délient. Par sa seule nature, on se sent monter loin de la terre. « Et je montais immobile, dit Stahl, dans l’air immobile comme moi-même, sans le secours d’aucun mouvement, et par cela seul que j’étais une âme immortelle, faite pour monter de la terre au ciel. » Bientôt, sans qu’on sache comment, on goûte la joie enivrante de flotter dans les grands mystères de la destinée humaine ; de la naissance, de la mort, de l’origine et de la fin de toutes choses, et l’on se perd dans ces abîmes. On nage, on roule dans le vague de l’infini. Par moments, une réminiscence de Platon nous soulève et nous porte au-dessus des mondes, avec ces deux ailes sublimes qu’il donne aux âmes. « L’âme, dit-il, fait le tour du ciel entier sous différentes formes. Tant qu’elle est parfaite, et portée sur des ailes rapides, elle voyage dans les régions éthérées et parcourt tout l’univers… Les âmes que l’on nomme immortelles, lorsqu’elles sont arrivées au faîte du monde, sortent du ciel et s’arrêtent sur sa voûte convexe ; dans cette position, le mouvement circulaire les emporte, et elles contemplent ce qui est hors de l’univers. Le lieu qui est au-dessus du ciel n’a encore été célébré par aucun de nos poètes, et il ne sera jamais célébré dignement… Pendant cette révolution, l’âme contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse en soi, elle contemple la science en soi : non cette science sujette au changement et variable suivant les différents objets que nous appelons des êtres, mais celle qui se trouve dans l’être véritable. Après avoir ainsi contemplé toutes les essences et s’en être nourrie, elle se rentre dans les limites de la convexité du ciel et se replonge dans sa demeure. »
Rien de plus agréable que cette indolence contemplative, mêlée d’élévations extatiques, qui va, par une ascension naturelle, à la pensée de l’être et de l’éternité, lentement roulée et ruminée au milieu de l’ombre et d’un profond loisir.
Et voilà comment, pour avoir le temps de philosopher en rêvant, ou de rêver en philosophant, il est indispensable de ne rien faire.
Par un mouvement insensible, mais irrésistible, l’esprit s’élève de l’ordre individuel à l’ordre social, de l’ordre social à l’ordre humain, de l’ordre humain à l’ordre universel. On songe aux rapports insaisissables de notre espèce avec les mondes autres que la terre, avec les populations innombrables qui sont probablement suspendues, comme nous, dans l’immensité céleste. On se demande s’il n’y aura pas, un jour à venir, une télégraphie possible entre eux et nous. De même que chaque peuple n’est qu’un individu dans la famille humaine, on a l’intuition que l’humanité tout entière n’est qu’un individu dans la famille universelle des êtres. Au-dessus de l’amour de soi-même, de la famille, de la patrie, de l’humanité, on sent et on éprouve que des routes nouvelles sont ouvertes au cœur et à la pensée. Et l’on regrette d’être venu si tôt sur la terre, ou de n’y pouvoir revenir plus tard.
Mais le jeûne, après avoir produit en nous toutes ces méditations et aspirations célestes, commence à y former, hélas ! des aspirations moins nobles et des convoitises moins élevées. Nous ayant promenés par-dessus les cieux, il nous ramène sur la terre. Après la période poétique et la période philosophique, voici venir, ô honte, ô corps, ô guenille ! la période famélique. On retombe, comme dit M. Michelet, sous cette ignoble fatalité du boire et du manger. Ou plutôt, chose pire encore ! on désire d’y retomber, et on n’y retombe pas ! Le docteur l’a défendu !
Un beau matin, – la nuit a été bonne, – l’appétit du convalescent s’ouvre en même temps que ses yeux. La concupiscence de l’estomac s’éveille, et miaule. Je dis miaule, parce qu’il n’y a point de chat qui n’avoue qu’un convalescent le surpasse de beaucoup en gourmandise. Les sens et surtout l’odorat, ont acquis, par la longue diète, une richesse extrême, une délicatesse exquise, une acuité déplorable. Ils pompent tout, avidement. Les yeux saisissent avec joie la première ombre de lumière qui, entre les grands rideaux enfin soulevés, se tamise gaiement à travers les petits. L’oreille entend parfaitement, du fond de l’alcôve, ce que chuchotent tout bas, près de la croisée, la jeune femme et la bonne mère, faisant pour vous des plans qu’elles ne vous disent pas, de peur de vous troubler, et afin de vous ménager quelque surprise de relevailles. Mais surtout, entre six et sept heures du soir, l’odorat hume avec délices et avec envie tous les parfums qui viennent de la salle où dînent les heureux ! Comptez qu’il n’y a chien de chasse ni Mohican qui puisse le disputer à un convalescent sur l’article du flair. Ce malheureux devient tout nez, et respire par tous les pores, comme les habitants du Soleil, dans le voyage de Cyrano de Bergerac.
Vous vous rappelez cette bonne histoire, cher lecteur. Les habitants du Soleil ne se nourrissent que de l’odeur des mets, et, pour prendre leurs repas, se mettent absolument nus, afin d’absorber par les pores. Cyrano, voyageant chez eux, demande un potage, et sent aussitôt « l’odeur du plus succulent mitonné qui frappa jamais le nez du mauvais riche. » Il veut se lever de sa place pour chercher à la piste la source de cet agréable fumet ; mais son porteur, celui sur lequel il va partout à califourchon, l’en empêche : « Où voulez-vous aller, me dit-il, nous irons tantôt à la promenade, mais maintenant il est saison de manger, achevez votre potage, et puis nous ferons venir autre chose. – Et où diable est ce potage (dit notre affamé qui n’est pas encore instruit de cette façon de manger) ? Avez-vous fait gageure de vous moquer de moi tout aujourd’hui ? – Je pensais, me répliqua-t-il, que vous aviez vu, à la ville d’où nous venons, votre maître ou quelque autre prendre ses repas ; c’est pourquoi je ne vous avais point dit de quelle façon on se nourrit ici. Puis donc que vous l’ignorez encore, sachez que l’on n’y vit que de fumée. L’art de cuisinerie est de renfermer dans de grands vaisseaux moulés exprès l’exhalaison qui sort des viandes en les cuisant, et, quand on en a ramassé de plusieurs sortes et de différents goûts, selon l’appétit de ceux que l’on traite on débouche le vaisseau où cette odeur est assemblée ; on en découvre, après cela, un autre ; et ainsi, jusqu’à ce que la compagnie soit repue. »
Cyrano ne s’accommode guère de cette manière de manger par trop subtile. Mais le pauvre convalescent s’en accommode bien moins encore. Il essaye de se satisfaire au moins par l’imagination ; il convoite si fortement les mets, qu’il les goûte presque : l’eau lui vient à la bouche, – et reste sans emploi ! – Toutes les houppes papillaires de son palais se dressent et s’agitent comme des petites filles à qui l’on va raconter une histoire. Et quelle belle histoire, en effet, on leur raconte, à ces houppes tantalisées ! Celle de tous les mets qu’elles aiment le mieux ! On leur en fait l’analyse en détail, on les déguste avec elles en idée !
On sent tout à coup pour Vatel, et pour les autres héros de la cuisine, une admiration incroyable. On lirait avec plaisir, en de telles heures, la Gastronomie de Berchoux ; ou bien ce dialogue dans lequel Asellius Sabinus avait fait discuter ensemble un champignon, un becfigue, une huître et une grive, – chef-d’œuvre pour lequel Tibère lui donna deux cent mille sesterces (quelque chose comme quarante mille francs). On éprouverait pour les personnages de ce dialogue une sympathie irrésistible.
La mémoire s’empresse de fournir au convalescent toute une bibliographie gastronomique, depuis cet Asellius jusqu’à Brillat-Savarin, sans oublier ce fameux traité des Pois au lard, CUM COMMENTO ! qui était, à ce que nous raconte Rabelais, un des volumes de la Bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor.
Je connais un convalescent qui pria sa jeune femme de lui lire quelque chose ; elle crut qu’il allait lui demander quelques pages de George Sand ou de Balzac, quelques poésies de Victor Hugo, de Lamartine ou d’Alfred de Musset ; il lui demanda, quoi ? la Cuisinière bourgeoise ; et lui fit lire à haute voix l’article des Artichauts à la barigoule. Son idéal, pour le moment, était là. La jeune femme lut donc ce qui suit, avec sa voix douce :
Artichauts à la barigoule (entremets).
Parez et lavez des artichauts, et les faites cuire à l’eau ; égouttez-les et ôtez le foin, que vous remplacerez par une farce ainsi faite : hachez fin persil, oignons, champignons, lard gras, ris de veau blanchi, et en remplissez chaque artichaut, que vous mettez avec du beurre sur un feu très doux. Servez après les avoir égouttés de leur beurre et sur une sauce quelconque qui soit brune.
Autres artichauts à la barigoule.
Parez et lavez ; faites blanchir assez pour pouvoir ôter le foin avec une cuiller ; faites chauffer de l’huile dans une poêle, mettez-y les artichauts du côté des feuilles, faites prendre couleur, égouttez-les. Placez-les dans une casserole, les feuilles en dessus et sur des bardes de lard, avec bouillon, feuille de laurier, peu de thym, sel, poivre ; faites cuire, feu dessus et dessous. Servez-les, la sauce réduite.
Le convalescent écouta avec ravissement cette double description, qui n’eut qu’un tort, celui de le laisser flottant dans l’alternative du désir : d’un côté, les champignons avec le ris de veau l’alléchaient ; de l’autre, l’huile et les hardes de lard, avec feu dessus et dessous, et la roustissure onctueuse et croustillante qui devait en résulter, avaient des séductions puissantes. Il finit par demander qu’au premier repas que lui permettrait le docteur on essayât de combiner les deux recettes en une seule. On le lui promit. Cette lecture et cette promesse avaient été, faute de mieux, un baume bienfaisant pour son estomac délabré. Toutes les poésies du monde lui eussent paru fades au prix de ce style culinaire, et il eût donné pour une feuille de laurier sauce, avec un peu de sauce dessus, tous les lauriers apolloniens du Permesse et de l’Ilissus.
Cependant la faim va croissant. Le patient évoque involontairement tous les souvenirs d’affamés illustres. Il éprouve pour les exploits gloutons d’Hercule, ami de la purée, pour ceux de Mercure-Mange-tout-cru, pour les prouesses gastronomiques de Grandgousier, de Gargamelle et de Gargantua, je ne sais quel enthousiasme mêlé d’attendrissement. En même temps, il se sent animé d’une compassion fraternelle à l’égard de l’antique Érésichthon se dévorant lui-même, sort cruel ! déchirant à belles dents ses propres membres, dit Ovide, et nourrissant son corps aux dépens de son corps.
Où s’est-il arrêté, bon Dieu ?…
La faim croît toujours. Le convalescent ne fait que bâiller et crier famine. Mais il faut avoir l’avis du docteur, qui précisément, n’ayant plus d’inquiétude au sujet du malade, tarde ce jour-là. Ah ! si l’on avait les clefs des armoires ! si l’on pouvait s’échapper de son lit ! si ! si ! si !… Que de nouveaux projets on accumule ! On s’ingénie comme un prisonnier. On payerait un potage au poids de l’or. On comprend alors Pérugin qui peignit à fresque tout l’intérieur d’un oratoire pour une omelette, una frittata ! Si l’on était aussi un grand artiste, on voudrait avoir à conclure tout de suite un marché semblable, à la condition d’être payé comptant. On souhaiterait d’avoir pour ami, dans ces moments désespérés, cet évêque de Rennes qui, au dire de Mme de Sévigné, marquait les feuilles de son bréviaire avec des tranches de jambon. Ah ! comme on appellerait ce saint prélat près du lit de douleur ! comme on le prierait d’apporter son livre, rempli de consolations ! comme on le dévorerait avec lui !
En de pareils instants, on serait disposé, Dieu me pardonne ! à excuser l’ignoble Antoine qui donna un jour la maison d’un citoyen à son cuisinier, parce qu’il lui avait fait un excellent souper, et on serait presque tenté de pardonner à ce tyran si toutefois l’histoire nous eût révélé qu’il fût alors en convalescence !
Dans ces moments-là on est capable de tous les manèges, rien que pour avoir un simple bouillon.
Il y avait autrefois à l’infirmerie du lycée Louis-le-Grand, à Paris, pour soigner les élèves malades ou soi-disant tels, deux bonnes sœurs de Saint-Joseph, je crois, qui s’appelaient sœur Firmin et sœur Adrien. La première est morte de la poitrine, il y a quelques années. J’espère que la seconde vit encore : car elle était fort vive et fort allante ; toutes deux bonnes autant qu’on peut l’être, pieuses, bien entendu, et, de plus, ferventes jansénistes, comme si elles eussent encore été au lendemain de la destruction de Port-Royal ; ne parlant que de M. Arnauld et de M. de Saint-Cyran, de la mère Angélique et de la mère Agnès, et du miracle de la sainte épine. On connaissait leur faible, on les prenait par là, pour en obtenir quelque allégement à la diète cénobitique.
Le soir, par exemple, un quart d’heure avant la prière lue à voix haute dans le dortoir, au moment où sœur Adrien vous apportait l’éternelle timbale de tilleul miellé, on avalait cette potion telle quelle ; puis s’engageait un dialogue à peu près comme celui-ci :
« Ma sœur, je meurs de faim !
– Mangez votre poing, gardez l’autre pour demain.
– Ma sœur, vous ne voudriez pas me faire mourir cette nuit !
– Moi, mon cher enfant ? Que le bon Dieu m’en préserve !
– Eh bien ! ma sœur, je vais mourir, et par votre faute, si vous ne me donnez pas quelque chose à manger.
– Mon enfant, le médecin l’a défendu.
– Si peu que vous voudrez, ma sœur !
– Rien du tout ! c’est l’ordonnance.
– Mais l’ordonnance ne défend pas que je boive ?
– Vous venez de boire.
– Peuh ! Du tilleul !… Savez-vous, ma sœur, ce qu’il me faudrait pour m’empêcher de mourir cette nuit ?
– Quoi ?
– Une petite tasse de bouillon.
– Ah bien oui !
– Du bouillon, ce n’est pas manger, cela !… Oh ! ma sœur, quelle belle lettre de M. Arnauld je viens de lire dans ce livre que vous m’avez prêté !
– N’est-ce pas que c’est bien beau, M. Arnauld ? Ah ! c’était un saint, voyez-vous !
– Admirable, ma sœur ! Pourquoi ne voulez-vous pas que je continue à le lire ?
– Moi ? comment cela ?
– Puisque vous voulez que je meure cette nuit !
– Allons, allons ! vous ne mourrez pas encore cette fois-ci. Bonsoir, dormez bien.
– Ma sœur ! une petite timbale de bouillon ! J’adore le bouillon !
– Vilain enfant, voulez-vous bien vous taire ? on ne doit adorer que Dieu.
– Quel beau caractère, ma sœur, que celui de la mère Angélique ! quelle fierté dans sa lettre à la reine !
– Et la mère Agnès donc ? Vous verrez ! Lorsqu’elle refuse de signer le formulaire ! Et la suite ! ce que dit M. de Saint-Cyran à M. de Sacy ! Avez-vous lu aussi, dans l’autre volume, les bons passages que M. Nicole prépare à M. Pascal pour sa troisième lettre au Provincial ? Ça me rappelle une jolie histoire.
– Laquelle, ma sœur ? »
La bonne sœur me l’avait déjà racontée dix fois ; mais, comme elle l’avait aussi racontée à d’autres, elle ne savait plus à qui.
« Figurez-vous, mon enfant, que, lorsque M. Pascal était en train d’écrire ses Petites Lettres contre les jésuites, sous le pseudonyme de Louis Montalte, la maison où nous sommes, le collège Louis-le-Grand, était dirigé par les Pères de la Compagnie de Jésus.
– Oui, ma sœur.
– Or M. Pascal demeurait là en face, dans la petite rue des Poirées ; il logeait dans une toute petite chambre, qui existe encore.
– J’irai la voir.
– Un jour qu’il venait d’étendre sur des cordes les feuilles de sa troisième lettre au Provincial pour les faire sécher, parce qu’elles sortaient de l’imprimerie et qu’elles étaient encore tout humides, – pan, pan ! voilà qu’on frappe à la porte. “Qui est là ?” dit M. Pascal. – C’était le Père proviseur des jésuites du collège Louis-le-Grand. Il se nomme à travers la porte. M. Pascal qui, tout janséniste qu’il était, vivait en bons termes avec ce jésuite, enlève à la hâte toutes les feuilles de dessus les cordes, et les fourre sur son lit, derrière les rideaux ; – et puis d’ouvrir, et d’être fort poli, fort aimable, car il avait beaucoup d’esprit M. Pascal ! – Comme tout Paris, à ce moment-là, ne s’entretenait que des Petites Lettres, le jésuite, qui était bien loin de soupçonner que M. Pascal en fût l’auteur ni même le complice, enfile ce sujet, s’anime et déclame. M. Pascal dit comme lui, et que l’auteur mérite le feu, pour le moins. Il ne laissait pas que d’être sur des épines, et quelquefois, tout en causant, regardait à la dérobée du côté du lit. Si quelque bout de feuille mal rangée avait montré son nez par la fente des rideaux, et attiré l’attention du jésuite, tout était perdu ! Enfin, après quelque conversation, le jésuite s’en alla, sans se douter de rien. Et M. Pascal, en riant beaucoup, après avoir eu très grand-peur, se mit à corriger ses feuilles.
– Celles de la troisième Provinciale, ma sœur ? Je veux la relire demain. Je me figurerai ce bon jésuite survenant tout à coup chez ce traître de janséniste…
– Vous voulez dire que ce sont les jésuites qui sont des traîtres !
– Bien entendu !… Ma sœur, votre histoire est charmante ; mais, par grâce, avant la prière, donnez-moi une petite timbale de bouillon, une toute petite timbale ! Et vous me sauvez la vie !
– Mais, mon cher enfant, que dirait sœur Firmin, si elle le savait ?
– Mais elle ne le saura pas, ma sœur !
– Motus ?
– Soyez tranquille ! Apportez-moi cela comme une timbale de tilleul.
– Allons, méchant enfant, je vais vous en apporter une goutte, car je ne veux pas que vous mouriez.
– Une grosse goutte, ma sœur !
– Chut ! »
Et la bonne sœur Adrien revenait à pas de loup, m’en apportant une timbale pleine. Car elle voyait bien que je n’étais pas malade.
Sœur Firmin, cinq minutes après, faisait sa ronde à son tour. Même jeu, comme bien vous pensez ; même scène, sauf quelques détails ; et enfin même dénouement :
« Mais si ma sœur Adrien le savait !
– Oh ! n’ayez pas peur, elle n’en saura rien. »
Et sœur Firmin m’apportait aussi une bienheureuse timbale.
Moyennant quoi, on attrapait le lendemain sans mourir.
Et le lendemain, on entremêlait, dans ses lectures, M. Arnauld, M. Pascal et M. Nicole, avec les Feuilles d’Automne ou Jocelyn. Et le tout, mélangé ensemble, ne formait pas, je vous assure, un trop méchant ragoût.
Pour en finir avec la période famélique, l’estomac du patient crie de plus en plus fort ; et le docteur n’arrive pas ! Cela tourne au tragique, cela devient le supplice d’Ugolin ; on a des crises enragées, où l’on mangerait sa garde-malade, pour peu qu’on la crût tendre. On a des paroxysmes de fureur, où l’on menace résolument de s’échapper de la maison si l’on n’obtient pas tout de suite un consommé.
Heureusement, on l’obtient enfin, car le docteur est arrivé. Seulement, pour tout consommé et pour tout potage, vous n’avez d’abord qu’un pâle bouillon de poulet.
Mais n’importe ! oh ! comme on l’aspire ! comme on le contemple ! comme on le hume ! comme on le gourme ! comme on le déguste ! comme on le savoure ! cuillerée par cuillerée !
Après cela, et par degrés, arrivent les extases du premier œuf à la coque ! Et les élans du cœur vers le chapon au riz ! ou vers les artichauts à la barigoule, déjà nommés, et depuis si longtemps caressés par l’espoir !
En même temps, quelques intimes commencent à forcer la consigne et à venir vous faire visiter. On est encore au lit. C’est le moment de la coquetterie pour les jolies convalescentes. N’est-ce pas encore Mme de Sévigné – puisque je la tiens, ne la lâchons pas – qui nous crayonne cette charmante esquisse d’une convalescente du bel air ?
« Mme de Brissac était au lit, belle, et coiffée… à coiffer tout le monde. Je voudrais que vous eussiez su l’usage qu’elle faisait de ses douleurs, et de ses yeux ! Et des cris, et des bras, et des mains qui traînaient sur la couverture ! Et les situations ! Et la compassion qu’elle voulait qu’on eût !… Chamarrée de tendresse et d’admiration, je regardais cette pièce, et je la trouvais si belle, que mon attention a dû paraître un saisissement dont je crois qu’on me saura fort bon gré. »
Ces premières visites sont très agréables. On a failli mourir, on a failli être orné de toutes les vertus, et célébré à plein cœur : il ou elle était le plus ceci, le plus cela, qui fut jamais ! Les inimitiés ont fait trêve ; les amitiés se sont souvenues ; toutes les tendresses d’autrefois ont refleuri sur la terre fraîchement remuée au bord de la tombe que l’on vous creusait. Tout est rajeuni, tout est renouvelé, tout est beau ; chacun ne vous montre que ses qualités et ne vous offre que le dessus de ses paniers. Plus tard, on prendra sa revanche, quand vous serez tout à fait rétabli.
Mais, hélas ! vous l’êtes déjà ! La convalescence, si longue qu’elle soit, a toujours un terme. Peu à peu l’engrenage de la vie vous reprend. Adieu famine ! mais aussi, adieu liberté ! Vous êtes ressuscité, ô douleur !
Heureusement qu’après une convalescence de la sorte, le bon docteur, pour la consolider, m’ordonna de faire un voyage, et de flâner longtemps encore.
Je ne me le fis pas dire deux fois, et tout aussitôt je partis.
À travers champs. La Suisse berrichonne. Châteaubrun. – Les confins de la Marche. Crozant. – Le Péché de M. Antoine. – Les bords de la Creuse et de la Sédelle. – Déjeuner sur l’herbe. Éguzon. – Un âne en pantalon (il y en a bien d’autres !). – Issoudun. Les Chevaliers de la Désœuvrance. – Balzac. – Frapesle. – Mme Carraud. – Un autographe de Balzac.
Lorsque rit la belle saison, ne trouvez-vous pas qu’il est agréable d’errer, sans plan, sans parti pris, au jour le jour, – et de laisser aller son esprit – comme ses jambes – au hasard ?
Voilà comme je viens de faire, depuis tout à l’heure trois mois, en Berry, en Dauphiné, en Savoie, en Suisse, en Alsace. Vive l’école buissonnière ! Chacun la fait de son côté, en été. Si vous voulez venir du nôtre, vous n’irez que jusqu’où vous voudrez.
Berry, en vieux français, veut dire plaine. Le Berry serait donc un pays plat. Généralement on le croit. On ne commence à en douter qu’après avoir lu George Sand. On croit aussi que les armes de Bourges sont : un Âne dans un fauteuil. On croit encore bien d’autres choses. Mais, dit le rudiment du vieux Lhomond, « c’est se tromper que de croire, » errat qui putat !
Il en est du Berry comme de la Belgique, dont une partie seulement justifie l’ancien nom de Pays-Bas, tandis que l’autre, pleine de variété et de mouvement, présente une telle succession de montagnes et de vallées, que, pour un trajet d’une heure seulement, entre Liège et Pépinster, on a dû percer onze tunnels. Pépinster est la station où s’embranche le chemin de Spa.
Si les Flandres, prairies spongieuses, entrecoupées de cent canaux grands et petits, sont déjà presque la Hollande ; d’autre part, le pays de Spa, l’Ardenne, avec ses sites pittoresques, ses rivières encaissées de roches abruptes, et ses cascades magnifiques, sont déjà presque la Suisse.
Eh bien ! la même différence se remarque entre le Berry plat des environs de Bourges, mélancoliques prairies nuées de colchiques et encadrées de peupliers, – et le Berry accidenté, mouvant et émouvant, soit de la Vallée Noire, soit de Châteaubrun jusqu’à Crozant.
Je n’ai pas encore vu la Vallée Noire, si ce n’est dans Valentine et dans Mauprat ; mais je viens de voir Crozant et Châteaubrun, qui sont admirables.
Crozant est situé sur les confins de la Marche, au confluent de la Creuse, bien nommée, et de la Sédelle. Sur de grands rochers escarpés et noirs, on voit à Crozant les tours en ruines d’un vieux château fort attribué aux Sarrasins, et dont les débris pourtant n’ont rien de moresque.
Châteaubrun est juché, à quatre lieues de là, sur des roches plus hautes encore, toujours au-dessus de la Creuse.
C’est dans ces deux paysages grandioses que George Sand a placé les scènes du Péché de M. Antoine.
N’aimez-vous pas à lire ou à relire un livre dans le cadre où l’auteur l’a rêvé ? Je relus donc à Châteaubrun et à Crozant, sur l’herbe fraîche, au milieu des ruines, le Péché de M. Antoine. Nous eûmes le plaisir, mes amis et moi, de déjeuner à la place où déjeunent M. Antoine et sa fille Gilberte avec M. Émile Cardonnet, ou plutôt en face de cette place, et à celle-là même où Émile déclare à Gilberte son amour, et où Gilberte, émue, sans rien lui dire, lui laisse deviner le sien. C’est la plus jolie scène du livre, et le plus beau site, je crois, de la Marche et du Berry.
On peut dire des bords de la Creuse ce que nous disions de l’Ardenne : c’est déjà la Suisse en petit. C’est du moins la Suisse d’en bas.
Vous savez que la Suisse présente aux voyageurs trois étages de beautés diverses : en bas, les vallons, les lacs, les prairies, les collines verdoyantes et déjà les montagnes, les forêts de pins, les cascades ; au-dessus, les rocs dénudés, où la végétation n’atteint plus, les grands amphithéâtres granitiques ; enfin, au-dessus encore, les glaciers.
Je dis donc que Crozant et Châteaubrun – et sans doute la Vallée Noire – sont la Suisse du premier degré : une Suisse berrichonne, charmante, adorable. Rivières aux lits profonds, rochers escarpés, bastilles naturelles de granit, couronnées de burgs bâtis de main d’homme et démantelés par les siècles, tout s’y rencontre pour enchanter les yeux.
Dans les ruines de Crozant, en y arrivant le matin, nous avions vu passer au-dessous de nous, bien loin, parmi les roches, un peintre, armé de la boîte et du grand bâton. Deux heures après, et au moment où nous venions de déployer sur l’herbe la nappe du festin, – c’était, Dieu me pardonne ! le Journal des Débats, avec l’Indépendance belge





























