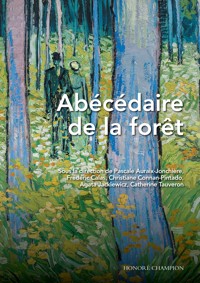
Abécédaire de la forêt E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Honoré Champion
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Champion les Dictionnaires
- Sprache: Französisch
"L’Abécédaire de la forêt" n’est pas un dictionnaire comme les autres : le genre y est en parfaite harmonie avec l’objet d’étude. Telle la forêt, où s’ouvrent sentiers et chemins de traverse, l’Abécédaire croise les analyses de biologistes, littéraires, linguistes, juristes, écologues et vétérinaires sur un espace qui ne semble unique qu’en apparence : la forêt et ses composantes, végétales ou animales, visibles ou invisibles, que scrutent des regards croisés entre disciplines artistiques et scientifiques. Il s’agit d’un kaléidoscope raisonné, non exhaustif mais éclectique, miroir des questionnements actuels sur la forêt, aussi merveilleuse que menacée. Le lecteur peut à son goût suivre l’alphabet, qui le mène d’ « Album » à « Zoonoses », trouvant sur sa route aussi bien les réalités de l’écosystème forestier (Arbre, Champignons, Essences, Mycorhize…) que les fictions et inventions de nos imaginaires (Baba Yaga, Blanche-Neige, Loup, Perché, Sorcières et fées…). Libre à lui de tracer son propre parcours et, comme les auteurs, d’emprunter une première allée avant d’en suivre une autre, qui bifurque. Il (re)découvre ainsi les univers boisés, leur histoire, leur actualité, les risques que présente leur avenir. Il enrichit son expérience et sa représentation de la forêt, immense et mystérieux domaine de nos rêves.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
Pour qu’une forêt soit superbe
Il lui faut l’âge et l’infini.
Ne mourez pas trop vite, amis
Du casse-croûte sous la grêle.
Sapins qui couchez dans nos lits,
Éternisez nos pas sur l’herbe.
René Char, Alsace, 1939
La forêt fascine, la forêt brûle, la forêt souffre.
Plus que jamais la forêt a besoin qu’on plaide pour elle – pour tout ce qu’elle est au-delà même de sa réalité biologique et physique, objet premier des menaces qui pèsent sur elle. Si elle venait à disparaître, s’évanouiraient alors avec elle promenades, sensations, peurs et émotions, et tout ce que l’intensité de sa vibration a suscité, représentations, contes et légendes, récits et méditations.
La fascination qu’exerce la forêt date vraisemblablement des premières heures de l’humanité, alors qu’elle couvrait la quasi-totalité de la terre et offrait à l’homme refuge et nourriture, tout en l’exposant à divers dangers qui se sont si profondément ancrés dans nos imaginaires, qu’ils ont la vie dure, et qu’aussi essentielle qu’elle apparaisse, la forêt reste appréhendée en termes d’altérité radicale pour l’homme. Elle est l’Autre absolu. Son étymologie témoigne de ce clivage qui nous enferme dans une vision très manichéenne du monde : l’adjectif latin forestis, sur l’adverbe foris « à l’extérieur », dit qu’elle est « dehors », hors de la ville, de ses murs, de la culture. Baptiste Morizot met en garde contre tous les dualismes qui piègent l’esprit (Raviver les braises du vivant, 2020), comme l’ont fait avant lui Francis Hallé pour les plantes en général (Éloge de la plante, 1999) ou sur un ton plus militant, Jean-Baptiste Vidalou (Être Forêts. Habiter des territoires en lutte, 2017) : nature vs culture ; préserver vs exploiter ; sanctuariser vs déforester, un verbe tardivement apparu mais aujourd’hui usuel pour rendre compte d’une opération commerciale de « déracinage » des arbres à grande échelle. Ces dualismes, y compris au niveau local ou associatif, ne conduisent pas à des solutions efficaces, et ne font souvent que dresser les amoureux de la nature contre les pouvoirs publics. Sans parler des manipulations ou des fausses bonnes idées, comme ces leitmotive médiatiques ou refrains de micro-trottoir « faire un geste pour la planète » et « planter un arbre pour compenser les émissions de CO2 » : on sait que les forêts de peuplement appauvrissent la biodiversité au lieu de la restaurer. Que faire alors ? Quelle praxis adopter ? Ne pas aggraver le mal, ne pas se tromper de cible, laisser faire le vivant, avec le moins d’actions imprudentes et d’initiatives délétères… est-ce seulement possible ?
De cette conception binaire réductrice qui fait que pour l’homme, tout ce qui n’est pas lui est objet, et objet à son service, provient une attitude systématiquement utilitariste ou consumériste : la forêt, les végétaux, les animaux, les minéraux mêmes, ne sont là que pour satisfaire nos besoins. Or ces besoins vont grandissant, les révolutions technologiques qui se succèdent sont toujours plus consommatrices des réserves fossiles, mais aussi des matières ligneuses. Les conséquences en chaîne de cette surexploitation incessante, de la déforestation en particulier, s’accélèrent et s’intensifient de nos jours : multiplication des mégafeux ; érosion des sols ; disparition des étendues boisées, qui, une fois réduites, cessent de réguler les températures, l’humidité, le CO2 ; perte de la biodiversité nécessaire à la survie des écosystèmes ; porosité des maladies entre l’animal et l’homme ; perturbations climatiques. Cette liste fait peur. Pourtant, nous ne semblons pas prendre les mesures nécessaires pour enrayer un phénomène qui a peut-être déjà atteint le tipping point (point de non-retour), avant des effondrements irrémédiables.
Pourquoi dès lors écrire de nouveau sur la forêt ? Des documentaires et des émissions de télévision, des reportages et des productions scientifiques, ouvrages et articles, de multiples récits de témoignage ou d’invention voient le jour, associant description et démonstration. Jamais nous n’avons été si bien informés. Que ce soit dans les grandes revues scientifiques comme Nature ou Science, dans les hebdomadaires à diffusion plus large comme Télérama, qui, en mars 2023, recense les initiatives autour des micro-forêts urbaines et des plantations d’arbres en ville, ou dans le journal Le Monde, les articles sur la forêt font régulièrement « la une ». Géo a réalisé un numéro hors-série sur des questions environnementales sous le titre « Une planète plus belle, c’est possible » (avril 2022). Ont été proposées des solutions innovantes pour lutter contre les dysfonctionnements liés à nos sociétés hyper-consommatrices du vivant. Le magazine Philosophie a consacré plusieurs numéros à la forêt et aux arbres, dont un hors-série « Vivre et penser comme un arbre. Philosophie du monde végétal » (été 2022). Un autre genre de publication s’est développé, celui de récits mi-fictionnels, mi-autobiographiques, qui relatent, en milieu forestier, les expériences solitaires ou collectives de spécialistes qui veulent partager avec le public leur connaissance du terrain et leurs savoirs théoriques, comme Laurent Tillon, Être un chêne, sous l’écorce de Quercus (2021) ; Alexis Jenni, Parmi les arbres, essai de vie commune (2021) ; Peter Wohlleben, L’homme et la nature. Comment renouer ce lien secret (2020) ; David G. Haskell, Un an dans la vie d’une forêt (2012) ou encore Écoute l’arbre et la feuille (2017).
Dans ces « nouveaux récits », philosophie, science et littérature sont étroitement associées pour dire une vérité nouvelle sur le vivant et sur la forêt, ouvrir d’autres façons de penser qui tentent d’échapper aux binarismes du type nature/culture, frayer des voies d’accès différentes ou tout simplement « écouter » la forêt d’une oreille singulière, responsable, respectueuse. Notre abécédaire se nourrit lui aussi de l’abolition de ces frontières « enfermantes » de la pensée et de l’émotion : littérature, science, écologie et arts y dialoguent, croisent leurs points de vue, ouvrent la voie à une pensée plus holistique du vivant. Il se propose d’offrir un « kaléidoscope raisonné » de la forêt. Qu’au lieu d’effrayer le lecteur, l’oxymore qui définit la forme et la finalité d’un abécédaire conduise justement à la « résolution paradisiaque des contraires » dont parlait, à son propos, Jean-Pierre Richard : contraint par l’ordre alphabétique mais délibérément libre, ouvert à tout choix de lecture suivie ou nomade, l’abécédaire favorise l’aller et retour entre analyse et synthèse, la réfraction des points de vue, l’enrichissement des regards. Le général et le particulier s’éclairent mutuellement, toute frontière s’efface entre « esprit de géométrie » et « esprit de finesse ».
Les récentes découvertes sur les plantes, les arbres, les forêts primaires, dont certaines ne sont pas encore totalement confirmées, ont montré que l’homme s’est trompé à propos du règne végétal, que ce dernier est loin d’être aussi « végétatif » qu’on a pu le croire pendant des siècles : une vie invisible, secrète, souterraine, anime la forêt, dont les ramages et frondaisons ne sont pas simplement mus par Éole en personne. C’est le monde merveilleux de la mycorhize ; des échanges cachés entre les racines et les champignons ; des « trocs » que certains scientifiques vont jusqu’à qualifier de « communication ».
Notre abécédaire de la forêt propose des parcours et des promenades entre les mots et entre les branches, en lisière ou au cœur de la forêt : il invite au vagabondage, il suscite des réflexions. Au fil des entrées imposées par l’ordre du genre, le projet se donne pour vocation de faire interagir des approches disciplinaires variées. Il s’agit de représenter la forêt dans sa réalité la plus concrète – visible ou moins visible – comme espace et corps vivants, comme source d’exploitations diverses, dans une perspective diachronique qui met au jour l’évolution des usages et de l’appréhension même de l’« objet forêt ». Ce panorama, conjointement scientifique, écologiste et culturel, se double d’un parcours plus symbolique, qui explore les légendes, les mythes et les contes dans une approche intermédiale. Le lecteur peut à son goût suivre classiquement l’alphabet, qui le mènera d’Album à Zoonose, de réalités en réalités, d’imaginaires en imaginaires. Mais il peut aussi inventer son propre chemin et, comme les auteurs, emprunter tel sentier avant d’en découvrir un autre qui bifurque.
L’ouvrage, destiné à éveiller la curiosité, ne se veut pas encyclopédique mais éclectique. Il est le fruit des regards croisés de littéraires, de linguistes, de biologistes, d’agronomes, de spécialistes des questions environnementales, de juristes, de vétérinaires, réunis dans un projet commun : chercher à mieux connaître « la » forêt, objet unique en apparence mais d’une profonde complexité. Cette forêt d’essence unique (sans jeu de mots…) se déploie en effet sous des individualités variées : la forêt amazonienne n’est pas la forêt polonaise de Białowieża, le Bois du Chapitre à Chaudun dans les Hautes-Alpes, classé au titre de « forêt primaire » au Patrimoine de l’Unesco et désormais protégé, n’a rien à voir avec la forêt cambodgienne des Cardamomes, menacée par la déforestation, le braconnage et l’agriculture intensive. La forêt entretient aussi de multiples prolongements, dans le sensible et l’imaginaire. Il s’agit, pour l’abécédaire, aussi bien d’en percer les secrets, pour les sauvegarder au moment où sa survie est en suspens, que d’en répertorier les représentations, pour éviter de perdre ce qu’ont construit des siècles de civilisation.
La forêt, par son obscurité métaphysique, attire autant qu’elle effraie. Elle est un lieu magique peuplé d’un bestiaire fantasmé, le lieu d’émergence des peurs ancestrales que disent et redisent les contes : les loups, tapis en embuscade, y attendent la chair fraîche des petites filles, toutes sortes d’esprits ou de créatures (liéchis, fées, ermites, ogres…), bienveillants ou maléfiques, y trouvent refuge. On y rencontre des êtres surnaturels, mages et magiciennes comme Merlin ou Morgane, protagonistes de la légende arthurienne. De méchantes sorcières s’y installent durablement au début du XIXe siècle et ne la quitteront plus. On les retrouve dans toutes les représentations contemporaines, que ce soit dans le cinéma hollywoodien, ou sous la plume d’écrivains, qui, comme Anne Sexton, reconfigurent le motif et lui offrent un nouveau visage. Mais la forêt peut être aussi un lieu de déambulation apaisée, occasion d’une expérience sensorielle irremplaçable. Les biologistes ouvrent les yeux du randonneur bien souvent inattentif aux signes ténus de la vie qui s’agite en silence dans l’humus, au cœur des troncs, sur et sous les branches. Les écologues et les forestiers invitent à « s’enforester » ou à s’initier aux bienfaits oubliés des odeurs et des couleurs de la forêt. Paradoxe de notre monde urbanisé, où l’individu s’enferme entre les quatre murs de sa chambre, il faut l’aider à humer, à respirer, à ouvrir ses sens, et même à se promener, comme si la promenade tant chérie des écrivains, Rousseau en tête, avait disparu des pratiques et des usages, nécessitant désormais un apprentissage.
Tout un monde, animal et végétal, voire hybride (comme ces chimères que sont les lichens, étonnamment semblables à des elfes ou à des lutins), requiert un examen attentif, presque une initiation, pour que se révèle la structuration fascinante de son organisation et de son développement, souvent microscopique ou souterrain. Les modes de communication de cet écosystème, invisibles à nos sens aveugles, étonnent autant les spécialistes que le profane, et ouvrent sur une possible intelligence des arbres. Se déroule depuis quelques années une véritable révolution concernant le vivant, les arbres et la forêt, alors que depuis l’Antiquité, le monde végétal avait été enfermé dans une altérité réductrice et statique par rapport à un monde animal surévalué.
Sous les feuilles, fourmillent toutes sortes de relations, d’échanges, de communications, de parasitages, qui réclament de l’homme patience et attention, lui qui s’est trop longtemps contenté d’exploiter la surface de la forêt. Les mots, quant à eux, font autant rêver que les êtres ou les choses qu’ils désignent : Baba Yaga, Brocéliande, Mycorhize, Xylophage, Yggdrasil ou Zoonose convoquent autant de lieux, d’êtres vivants et d’histoires. La forêt est aussi un être en devenir, et l’abécédaire l’envisage transversalement dans sa temporalité : il relie, par exemple, la tentation médiévale de l’érémitisme aux désirs de repli forestier de certains activistes d’aujourd’hui, la représentation du bûcheron dans les contes traditionnels et sa fonction contemporaine, de vandale ou de serviteur du bois qu’il abat ; il associe les connaissances anciennes et les découvertes scientifiques les plus récentes sur la communication racinaire des arbres, l’élaboration ancestrale des droits (de l’homme) sur la forêt aux droits nouveaux de la forêt ; il pose, ce faisant, la question du devenir de l’espace forestier.
L’abécédaire ménage ainsi de puissants changements de perspective. La forêt peut s’observer par le sol, par les racines, à hauteur de fourmi, ou, au contraire, depuis la canopée, par tel personnage perché sur son arbre et qui ne veut plus en descendre. Microcosme et macrocosme, arbre et forêt, houppier et racine, tronc et feuille, sont tour à tour l’objet d’étude des biologistes, des littéraires, des linguistes, qui ont collecté quelques dénominations émergentes pour dire une autre manière d’être avec la forêt : « forêt-jardin, bains de forêt, micro-forêt urbaine… ». Ces couplages antithétiques concrétisent la profonde dualité de notre relation à la forêt et notre dépendance à son égard, même si nous l’enrichissons d’expériences inédites, quand nos besoins, toujours plus consommateurs et agressifs, risquent de l’affecter. La forêt, c’est aussi le mouvement et les mille et une facettes que le cinéma documentaire ou de fiction offre sur ce lieu si singulier dans l’histoire de l’homme, et pourtant si fragile. Utopies et dystopies tentent de nous parler de demain, de ce qui restera ou sera sauvé de ces territoires de plus en plus livrés à la précarité.
Le lecteur pourra ainsi (re)découvrir le monde forestier, se forger une opinion sur son histoire, son actualité et son avenir menacé, enrichir son expérience et son image de la forêt, reconstituer un pan de l’immense domaine qu’elle occupe dans nos rêves.
Frédéric CALAS
Avertissement
Chaque notice renvoie à d’autres notices avec lesquelles elle entretient des liens étroits ou larges. Elle suggère des références bibliographiques au lecteur qui voudrait approfondir ses connaissances. En fin d’ouvrage, une bibliographie sélective permet de suivre les différents travaux réalisés sur la forêt et les arbres, aussi bien dans une perspective scientifique que littéraire ou écologiste. Des index complètent l’abécédaire pour signaler d’autres cheminements possibles entre les textes, les notions et les disciplines.
A
ALBUM – FORÊT – COULEURS
Omniprésente dans les contes et leurs réécritures, sombre par tradition ou reverdie dans une perspective nouvelle, « la forêt fait office de chronotope […] : [elle représente] un espace-temps solidaire, celui de “l’autrefois” étroitement lié à [ce] genre littéraire spécifique » (Brière-Haquet, Politique des contes, 2021). Aujourd’hui, cette forêt se donne à voir dans l’album, « seule forme de la littérature d’enfance et de jeunesse qui ne doit rien […] aux genres développés dans la culture adulte » (Nières-Chevrel, Dictionnaire du livre de jeunesse, 2013) et terrain de création privilégié pour les artistes. Le stéréotype de la « forêt profonde », la sombre forêt des enfants perdus, pèse toujours sur cette production graphique : « malgré l’imagerie écologique, reste logée dans notre cerveau le plus ancien cette forêt imaginaire d’arbres gigantesques, de monstrueuses végétations, anarchiques et puissantes, enténébrant l’espace et s’animant de tous les remuements, sans confins ni clairières ; nous y perdons le nord, et la raison, et l’humanité. » (Garat, 2004). Toutefois, une autre veine se dessine, qui se montre sensible à l’air du temps et se propose de repeindre la forêt en couleurs.
Décrite par Perrault comme « une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance on ne se voyait pas l’un l’autre » (« Le Petit Poucet », 1697), la « forêt profonde » trouve sa représentation la plus mémorable dans les illustrations de Gustave Doré pour le luxueux volume in-folio publié chez Hetzel en 1862. L’artiste joue des effets d’échelle et des contrastes du clair-obscur pour mettre en valeur les racines tentaculaires au premier plan et l’intrication des fûts dans la perspective, ce qui rend plus dérisoire encore la taille des enfants regroupés au bas de l’image. Fasciné par le nom de la « Forêt-Noire » depuis l’enfance, Hugo décrivait déjà en 1842 « une forêt prodigieuse, impénétrable, effrayante, une futaie pleine de ténèbres avec des profondeurs brumeuses, […] des racines tortueuses sortant à demi de terre comme des poignées de serpents ; de sinistres branchages épineux, des fouillis de sarments hideux se découpant comme des filets d’encre sur le ciel livide et y traçant çà et là l’inextricable paraphe du démon » (Le Rhin). C’est dans une forêt aussi sombre qu’il aménagera la rencontre de Cosette et de Jean Valjean, vingt ans plus tard (Les Misérables, 1862).
Ce topos de la forêt noire, sauvage et labyrinthique continue à investir l’imaginaire des artistes de l’album contemporain. D’après Michel Pastoureau (Le petit livre des couleurs, 2005), « [l]’univers du noir et blanc, que l’on croyait relégué dans le passé, est toujours là, profondément ancré dans nos rêves et peut-être dans notre manière de penser » (2005). Dans l’illustration de « Hansel et Gretel » (2009), Lorenzo Mattotti dessine ainsi à l’encre de Chine « la sauvagerie monstrueuse de la forêt, un inextricable chaos où tentent de progresser les silhouettes également noires des enfants, perdus dans un entrelacs de troncs et de branches » (Tauveron, 2017). Cette vision persiste dans deux albums en noir et blanc de Marien Tillet. Dans Et Gretel (2015), la maison de la sorcière est enserrée par un réseau d’arbres squelettiques aux troncs incurvés en forme de cage thoracique. La forêt hante les pages, répliquant le parallélisme des troncs pour souligner l’enfermement des enfants – barreaux de la cage, prison de la maisonnette. De même, Ogre (2019), long poème en alexandrins où le monstre pleure son désespoir après avoir dévoré ses filles, est illustré par des paysages de forêt hivernale balayée par la tempête : enroulements de branches nues et motifs graphiques tracent un décor ondulant et des silhouettes déformées qui font écho au tableau de Munch, Le Cri. Dans les forêts de ces albums, aussi noirs au plan thématique que graphique, le contour tourmenté des arbres reflète un paysage intérieur.
L’album sans texte de Thomas Ott, La Forêt (2021), se montre plus ambivalent. Sans se fonder sur un conte précis, il suit l’itinéraire d’un enfant au cœur de la forêt. L’artiste emploie une technique originale de grattage : après avoir recouvert de peinture noire un support blanc, il dessine par petites touches des figures striées qui émergent ainsi du noir. On pense à l’« outrenoir », mot et concept inventés par Pierre Soulages, pour désigner son usage paradoxal de la lumière révélée par la couleur noire. Encadrées de blanc sur fond noir, comme des cartes de deuil inversées, les images content une histoire qui commence dans une maison endeuillée. Un petit garçon s’en échappe et gagne la forêt proche. Peu à peu le sentier disparaît, la forêt se referme, troncs et racines ralentissent sa marche tandis que surgissent des figures troublantes – une forme velue indécise, une femme nue, des hommes pendus… S’ouvre enfin une clairière où apparaît son grand-père qui l’étreint et s’entretient avec lui. Comme dans les contes, la retraversée de la forêt s’effectue sans encombre. De retour, le petit garçon se rend dans la chambre mortuaire, sort de sa poche une petite branche de pin et la place entre les mains de son grand-père, dont le visage esquisse un sourire. Le chemin parcouru tient de la « [p]romenade dans notre imaginaire », sous-titre de l’ouvrage de Robert Harrison (1992) qui met en relation la forêt et l’inconscient. L’enfant peut désormais « faire son deuil », et son dernier geste signe symboliquement le rôle cathartique de la forêt dans son avancée. Par la puissance et la concaténation de la narration iconique, Thomas Ott met en valeur le double visage de la forêt : après celle de tous les dangers, c’est la forêt refuge qui se révèle, la forêt ressource, la forêt régénératrice qui aide l’enfant à grandir, comme le montreront les exemples suivants.
Les reconfigurations du « Petit Poucet » qui exorcisent les maléfices de la forêt profonde relèvent de cette littérature à visée palliative dont Alexandre Gefen souligne la prégnance dans l’édition actuelle (Réparer le monde, 2017). Ces albums iconotextuels revisitent le conte à la lumière de différentes préoccupations contemporaines car ils sont mâtinés de care, de résilience et de conscience écologique. Magnifiée par les images, la forêt prend des couleurs. Loin d’emprisonner et de perdre les protagonistes, elle devient le lieu où l’on se trouve et se retrouve.
Certains de ces albums s’apparentent au genre de l’écofiction, défini par Christian Chelebourg comme « l’ensemble des discours qui font appel à l’invention narrative pour diffuser le message écologique » (2012). Dans la forêt de Ghislaine Herbera (2021) déploie dans les images à fonds perdus une forêt dessinée au pastel où dominent le vert, le jaune et le rose : antinomique de celle de Gustave Doré, c’est une forêt vivante, riante, claire et lumineuse, qui foisonne de végétaux multicolores. L’aventure inverse les données du conte : ce sont les parents qui s’égarent, tandis que les enfants organisent une joyeuse robinsonnade grâce aux ressources offertes par la forêt. Si les héros de cet album métanarratif ont lu le conte source, ils expérimentent un tout autre visage de la forêt, où il fait bon vivre. Beaucoup plus explicite, Comment le Petit Poucet a semé des graines en jetant des cailloux (Paris & Tigréat, 2018) oppose la géométrie de la ville en noir et blanc à la forêt exubérante dans laquelle un paisible géant jardinier donne quelques semences et une leçon de vie à l’enfant. En célébrant les pouvoirs de la forêt pour changer la vie, l’« éco-graphie » transmet « les représentations de l’écologie et de l’inquiétude environnementale par le texte et par l’image, selon une esthétique et une poétique adaptées » (Prince & Thiltges, 2018) au jeune public.
D’autres albums donnent à la forêt un rôle plus symbolique, lié à l’actualisation du thème de la famille. Dans Ti Poucet (Servant & Green, 2009), l’enfant qui traîne dans la rue pour fuir un foyer déficient, trouvera dans la forêt les figures tutélaires qui manquent à sa vie, et pourra se reconstruire. En contraste avec la grisaille de la ville, la forêt parcourue flamboie de vives couleurs, renouvelant à chaque page les motifs des branchages, des lianes, du feuillage et de la flore qui se détachent sur le fond nocturne. L’itinéraire du jeune héros dans la forêt dessine une quête de famille idéale pour construire un « roman familial » (Robert, 1972) compensatoire. L’album met en valeur la représentation d’une forêt séduisante et magique dans laquelle Ti Poucet échappe au déterminisme social et change de camp en réalisant son destin. Dans Mille Petits Poucets (Autret & Serprix, 2011), non seulement les enfants, avertis par le texte source, ne se laissent plus perdre en forêt par leur marâtre, mais ils en reviennent chaque fois plus nombreux : « Car voici : les profondeurs de la forêt luisaient du regard innombrable des fillettes et des garçonnets perdus là par des parents plus habiles […]. Cette forêt sécrétait des enfants comme elle faisait des arbres et de la mousse d’herbe tendre… ». Le père épouse une autre femme et la moralité s’en réjouit : « Les familles se recomposent/Les marmots éclosent/Toujours la vie renaît/À l’ombre des forêts ». Les gouaches en pleine page soulignent la hauteur des troncs brun rouge et la densité des frondaisons vert et or, toutes couleurs chaudes et réconfortantes. L’abondante famille se réunit dans une clairière en forme de cœur autour de la maisonnette comme pour illustrer la formule de Robert Harrison : « C’est dans les seules limites de la clairière que la famille maintient sa cohésion et protège sa généalogie de l’“infâme promiscuité” de l’état sauvage » (Harrison, 1992).
Forêt noire, forêt verte, l’album contemporain s’empare des images traditionnelles mais se montre aussi capable de les renouveler. La forêt continue à fasciner les artistes qui accompagnent les contes de leurs images car, même si elle se montre parfois sous un jour effrayant, comme le conte lui-même, elle aussi saura offrir « la Fantaisie, le Rétablissement, l’Évasion, la Consolation » (Tolkien, Faërie, 1959).
Christiane CONNAN-PINTADO
FVoir : Album – Forêt réenchantée, Conte
•Références
CHELEBOURG, Christian, Les écofictions : mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2012.
GALLÉ, Hélène, HOUSSAIS, Yvon, (dir.), La forêt est une métaphore, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté (à paraître).
GARAT, Anne-Marie, Une faim de loup. Lecture du Petit Chaperon rouge, Arles, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », 2004.
PRINCE, Nathalie et THILTGES, Sébastian, Éco-graphies. Écologie et littératures de jeunesse, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2018.
TAUVERON, Catherine, « Illustrations contemporaines de Hänsel et Gretel : entre lecture aveuglée et lecture aveuglante », Lendemains, n° 166-167, 2017, p. 227-240.
ALBUM – FORÊT RÉENCHANTÉE
La forêt des contes traditionnels (destinés par tradition aux jeunes enfants) est une forêt d’angoisse, sauvage et inhospitalière, un étau qui emprisonne celui qui s’y égare et dont il ne peut s’extraire qu’au prix de souffrances et de renoncements. Elle habite nos mémoires, nourrit nos images mentales. Pour autant, la littérature de jeunesse d’aujourd’hui, qui ne saurait se tenir à l’écart des préoccupations écologiques de son temps, propose à ses jeunes lecteurs, dans le genre littéraire iconotextuel qu’est l’album, un ensemble fourni de nouveaux contes ou paraboles sur et dans une forêt partiellement ou totalement « réenchantée ». Les dires ancestraux sur la forêt y sont en partie réinvestis pour être finalement reformulés dans le souci de créer un nouveau lien organique entre petits lecteurs humains et communauté fraternelle des arbres. On perdait autrefois en forêt les enfants dont on ne voulait plus, ils sont invités aujourd’hui à y vivre, par eux-mêmes ou par les personnages, des expériences revigorantes. Dans l’espace sylvestre pacifié, frais et protecteur, ils apprennent à « respirer l’ombre », à intégrer la confrérie des arbres, à soulever les feuilles (des arbres et du livre) pour y surprendre une vie secrète, à palper les écorces miroirs de la peau et, souffle contre souffle, à rendre leur corps perméable à toutes les effluences des frondaisons, autant de fécondations symboliques.
L’enfant racine (2003) de Kitty Crowther raconte l’histoire d’une femme, Leslie, vêtue de noir, vieillie avant l’heure, solitaire et misanthrope, poussée à pénétrer fusil en mains la forêt profonde à la poursuite d’un renard qui lui a volé ses poules. L’espace où elle s’enfonce est conforme au stéréotype de la « vaste forêt » des Grimm, un lieu enténébré hors du monde, un ailleurs insituable et surtout incernable. Sa marche est arrêtée par des pleurs entendus près d’un tunnel, dans lequel elle s’engouffre. Au trou noir du tunnel creusé sous les racines des arbres succède un trou de lumière, cercle blanc dessiné par la lanterne de Leslie. Apparaît alors au centre du cercle un enfant-racine, qui a perdu ses parents. Leslie le prend dans ses bras, comme dans une Vierge à l’enfant. Et c’est en ce point que le conte bascule, quitte la forêt germanique menaçante pour la forêt celtique et ses propres légendes. Une tenture fleurie se découvre, tout comme le visage de Leslie, parce qu’en somme, en cet instant, elle découvre en elle une forme inconnue d’altruisme qui lui procure forme humaine pleine et entière. Une petite fée ailée et « délicieuse », la reine Mab, sage-femme et accoucheuse dans les traditions galloises et irlandaises, lui dit : « Prends soin de cet enfant et de toi ». La femme, obscure à elle-même dans la forêt obscure, a, dans cette clairière où fées subalternes, elfes et lutins multicolores virevoltent, chantent et dansent, la révélation de sa nature profonde. Plus tard, dans sa maison retrouvée, revêtue désormais d’une robe colorée, elle amorce avec l’enfant-racine un apprivoisement réciproque, qui prend fin lorsqu’il est temps pour l’enfant-racine de retrouver les siens. Sur la dernière image, l’on voit Leslie, se dirigeant dans le sens inverse de son premier voyage, en direction de la campagne ouverte. Elle part « rejoindre les autres, ceux qui sont comme elle ». La dernière phrase laisse entendre qu’elle a trouvé les « autres, comme elle » mais pour autant n’oublie pas « les autres, légèrement différents d’elle ». La forêt dans les contes classiques, « à la fois lieu du tremendum et du fascinans, des forces adjuvantes ou destructrices, des rencontres bouleversantes ou de la solitude stérile, est impliquée dans un processus dynamique, organisateur, alchimique : celui de la métamorphose du héros » (P. Ballais, J. Thomas, L’arbre et la forêt dans l’Énéide et l’Éneas, 1997). Il en va bien ainsi dans ce conte contemporain. La forêt y fait figure d’espace transitionnel. L’aventure dans sa totalité est pilotée, à l’insu même de Leslie, par les forces surnaturelles « adjuvantes », qui avec constance suivent son parcours. Il y a donc dans ce conte une reprise et une réorganisation toute personnelle du fond (sylvestre) des contes traditionnels venus de plusieurs horizons, pour une leçon à la fois universelle et contemporaine, bien qu’inscrite dans la nuit des temps. Le conte pointe son regard sur une femme ermite, en conflit avec la nature et sans doute avec elle-même. En la plongeant au cœur de la forêt, une forêt maternelle, la reine Mab maïeuticienne lui enseigne que l’arbre est vivant, un vivant semblable à elle, un vivant qui se reproduit alors qu’elle est stérile. L’enfant racine, truchement de la fée, lui répète sans cesse : « pourquoi es-tu toujours seule ? ». Mais passant de l’obscurité à la lumière, elle finit par s’ouvrir aux attentes de la nature et à travers elles aux attentes de ses semblables, les « autres », humains et non-humains, tous confondus dans la même chair vivante. Ayant protégé et choyé l’enfant-racine, arbre en devenir, Leslie, elle peut alors prendre elle-même racine et construire son propre arbre généalogique. Sa régénérescence ou, si l’on veut, la reconstitution naturelle de son tissu vivant, appelle la « générescence ».
Plus directs sont sans doute le discours et l’objectif de l’album pop-up destiné à de très jeunes lecteurs, La vie cachée de la forêt (M. A. Gaudrat et H. Galeron, 2019). Il ôte le voile ténébreux et angoissant de la forêt pour y faire apparaître résolument, au moyen de languettes à tirer, de livrets à consulter, de doubles pages à déployer, une vie fantaisiste soustraite aux regards. En explorateur-manipulateur, l’enfant étirera une guirlande en accordéon de gnomes joufflus, présentés, dans un message écologique très discret, comme les gardiens et les réparateurs de la forêt ; dans une clairière exubérante de fraîche verdure, il apercevra sous les feuilles une heureuse colonie d’elfes et de lutins et ouvrira les livres qui rapportent leurs mœurs avec humour et tendresse. Mais, bien sûr, l’aventure forestière du petit lecteur ne serait rien s’il n’éprouvait un instant, juste un instant, une petite peur… factice, entretenue, cela va de soi, sans raison par les contes traditionnels, ceux des Grimm tout particulièrement : « En s’enfonçant toujours plus loin, on peut s’égarer en chemin… Alors, attention, pas un bruit : un ogre s’est peut-être endormi ! ». Une sombre, sombre forêt se déploie sur une double page, des visages menaçants se dessinent sur les troncs noueux : il faut bien recourir un instant au topos, quelque peu convenu désormais, de l’arbre vivant, humanoïde grimaçant dardant ses yeux farouches sur le pauvre hère égaré que bien des illustrateurs des contes des Grimm ont repris chacun à sa manière. Sur l’un de ces troncs s’ouvre un nouveau livre : en couverture, derrière des barreaux de prison, un ogre hargneux exhibant sa dentition transylvanienne et un titre noir, très noir « Wanted Ogre ! ». À l’intérieur toutes les histoires d’ogres. Mais la page de droite se soulève et l’ogre apparaît en effet, bonhomme certes imposant mais inoffensif, béatement plongé dans une délicieuse petite sieste, un lutin endormi à ses pieds. De cet album, l’on retient qu’il invite l’enfant à sentir, à entendre, à palper la douceur, le moelleux, la fraîcheur, la paix, le rire et la joie de la forêt dont toutes les puissances maléfiques sont successivement neutralisées ou démasquées. Dans Parler avec les arbres (Sara Donati, 2018), c’est une expérience similaire que connaît un petit bonhomme au bonnet de lutin, minuscule figure verte fondue par le pinceau mouillé dans le vert du feuillage, à ceci près qu’il se déplace dans une vraie forêt et entre en contact avec de vrais arbres, dépouillés de leur mythologie. Voir les veines des vrais arbres, entendre leurs mots, humer leur parfum, palper leur écorce et s’y diluer, avoir, si l’on ose, un regard tactile, auditif et olfactif, telle est son expérience. Sur les troncs serrés, sur le paysage crevassé de leur peau, lui apparaissent des figures humaines ou animales qui l’incitent à tenter le dialogue avec un premier arbre rencontré. Renonçant au langage articulé, il opte pour une intense et intime approche sensorielle et pour tout dire sensuelle : « Je suis tout contre son tronc, j’écoute. Pas de battements à l’intérieur, ce ne sont que des odeurs de mousses et de vent. Odeurs sauvages ». L’enfant palpe, hume, incorpore le corps vivant de l’arbre, ses émanations, les frémissements de sa chair palpitante. Et plus l’enfant se serre contre lui et plus il découvre leur parenté. L’image présente côte à côte les veinures concentriques d’une branche coupée et celles de la peau du bout de ses doigts, étonnamment similaires : « Plus je me rapproche et moins je vois, Plus je me rapproche et plus je vois ». Alors « sans même avoir franchi une porte », il entre dans l’arbre : « Je lui dis mon nom, j’en invente un pour lui. L’écorce, les jambes, le ciel et mon cœur s’entremêlent ». S’opère une fusion organique, un fantasme voluptueux de régression dans le végétal. On pourrait voir là une récupération narrative de la mode new age de la sylvothérapie ou encore une extrapolation narrative des découvertes scientifiques récentes sur la sensibilité végétale et l’aptitude des arbres à communiquer. On peut y voir aussi l’illustration de ce don merveilleux qu’a l’enfance (et que partagent bien des poètes) de discourir avec les arbres : « Quand un enfant/ de femme et d’homme/ adresse la parole à un arbre/ l’arbre répond/ l’enfant entend ». (Jacques Prévert, Arbres, 1976). Ces trois albums choisis parmi une multitude d’autres disponibles relèvent d’une entreprise de désensauvagement de la forêt. Ils neutralisent les figures mythiques mortifères qui, depuis la nuit des temps, courent, agressent et dévorent au tréfonds des forêts dans les contes traditionnels, mettent en lumière la forêt même, supposée si sombre, et sa vie secrète, tapie sous terre dans les racines, cachée dans ses feuillages ou sous ses écorces, quand les contes traditionnels la présentent comme un désert stérile.
La forêt, que l’on caresse, que l’on protège, que l’on idéalise, ne peut plus (ne devrait plus) être aujourd’hui l’espace inquiétant d’où vont surgir des loups affamés ou des charbonniers hirsutes. Elle est au contraire l’agent de notre survie. Et l’on comprend dès lors que Roberto Innocenti (pour les images) et Aaron Frisch (pour le texte) choisissent (dans La petite fille en rouge, 2013) de modifier le cadre du « Petit Chaperon rouge » de Perrault et de présenter la ville tentaculaire, forêt minérale de brique et de béton, « pieuvre ardente », dont le poète Émile Verhaeren percevait déjà en 1895 la puissance mortifère, comme espace anxiogène de substitution et « horizon inquiétant » des temps modernes : absence totale de vie végétale, ciel invisible ou d’un gris-noir menaçant (« Le soleil clair ne se voit pas / Bouche qu’il est de lumière, fermée / Par le charbon et la fumée », disait Verhaeren), saturation complète de l’espace (de la page) où s’accumulent véhicules vrombissants, foules bigarrées qui « s’écrasent sans plus se voir », tags sur les murs, détritus sur les trottoirs, poubelles débordantes, enseignes de restaurants, affiches de cinémas et affiches électorales, panneaux publicitaires réalistes ou parodiques. Le loup est toujours là mais adapté au contexte, sous la forme d’un motard glaçant : « tout de cuir noir vêtu », du casque aux gants, du manteau aux bottes, les yeux cachés par des lunettes également noires, la coupe en brosse, les jambes écartées, du haut d’un mur de brique il surplombe, démesuré, la scène, comme le ferait « un Vopo ou un policier de la Gestapo ». Dans un retournement culturel d’importance, dont la littérature (de jeunesse) est ici le vecteur, la ville ogresse qui a digéré la forêt, en a usurpé et surpassé les propriétés vénéneuses décrites dans les contes traditionnels, et se présente aux enfants égarés comme le nouvel agent de terreur.
Le déplacement des valeurs explique la fonction subtilement didactique assumée de certains autres albums qui mettent en scène les ravages et les sournoises motivations de la déforestation au service de l’urbanisation. C’est le cas de Forêt des frères de Yukiko Noritake (2020) qui montre en symétrie le destin de deux parcelles vierges de forêt héritées par deux frères aux philosophies de la vie dissemblables. Il s’agit d’une sorte de fable clairement écologique, qui, comme bon nombre de fables, oppose sur chaque double page (par le langage) deux comportements et (par les images qui adoptent une vue aérienne) deux effets différents : la contemplation gratuite et l’exploitation économique. À gauche, en épicurien, le premier frère jouit du temps présent de la rencontre, hic et nunc (« Être ici, juste bien ») tandis que l’autre en est incapable et se projette dans l’avenir (« Penser à la suite »). L’un, respectueux des lieux majestueux, se fait tout petit devant eux (« Se faire une petite place ») tandis que l’autre, prédateur, en envisage aussitôt la destruction (« Faire de la place »). La devise de l’un, pour faire sa petite place – un minuscule chalet – est « Faire avec ce qu’on a » (le bois de deux arbres seulement suffira, pour réduire au mieux l’impact de son geste sur l’environnement), tandis que la devise de l’autre, « Faire ce qu’on fait ailleurs », le conduit à construire une villa démesurée et arrogante, nécessitant le massacre d’une grande surface de la forêt, le perçage de routes d’accès, l’importation de camions, ouvriers, grues, parpaings et ciment. L’un, humble, discret et solitaire, se contente de jouir in petto du travail accompli (« Admirer le résultat »), l’autre, m’as-tu-vu, ne trouve de plaisir que dans l’exhibition de sa richesse et le regard d’envie des autres (« Faire voir le résultat »). L’un cultive son jardin (« Récolter ») et vit des fruits de la nature (« Se nourrir »), l’autre souhaite « Faire venir », autrement dit monnayer le restant de terrain en attirant les acheteurs potentiels (« S’enrichir »). L’un, qui s’est rapproché de la nature sans la dénaturer, sait aussi, autour d’un feu de camp, à l’occasion de Noël, « Se rapprocher » de son semblable et avec lui (une « elle » en l’occurrence) « Sentir l’air embrasser son cou » et « Être ici, juste bien » tandis que l’autre organise une fête gigantesque pour « S’entourer » (et non « Se rapprocher ») et « Habiller la nature en couleurs », autrement dit disposer un sapin de plastique avec ses boules devant l’entrée. Sur la dernière double image, le champ de vision s’élargit et offre au regard, à gauche, une vaste forêt, en tout point semblable à la forêt première si ce n’est la présence, point minuscule, du chalet et plus loin d’une tente de randonneurs ; à droite, autour de la maison initiale, tant il est apparu nécessaire et lucratif de « s’entourer », un quadrillage de rues et de maisons, dessinant une grande ville de bord de mer, et, comme il se doit, çà et là, souvenirs lointains des origines, quelques arbres citadins bien taillés. Une très belle fable minimaliste qui, évitant tout didactisme appuyé, a le mérite de ne pas fournir, clé en mains, sa morale, et confie au jeune lecteur le travail d’interprétation.
Catherine TAUVERON
FVoir : Album – Forêt – Couleurs, Conte, Expérience sensorielle, Déforestation, Forêt enchantée.
•Références
BALLAIS, Pierre, THOMAS Joël, L’arbre et la forêt dans l’Énéide et l’Éneas. De la psyché antique à la psyché médiévale, Paris, Champion, 1997.
CALAS, Frédéric, AURAIX-JONCHIÈRE, Pascale (dir.), Nouveaux récits sur la forêt, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2023.
AMAZONIE
Jusqu’au XVIe siècle, l’Amazonie n’avait rien d’un écosystème menacé, même si des populations autochtones y vivaient déjà depuis plus de 10 000 ans et si, au moment de la conquête, elle était peuplée de plus de 9 à 12 millions d’Indigènes. L’Amazonie était certes déjà un environnement anthropisé : au fil des millénaires, ses habitants ont progressivement transformé sa composition arboricole et floristique, mais de manière surprenante, il a été prouvé que loin de diminuer la biodiversité, ces interventions l’ont au contraire augmentée. Les colons n’ont cependant pas reconnu cette expérience plurimillénaire de cohabitation fructueuse entre l’homme et la forêt. Ce déni a pris la forme d’un processus de construction idéologique caractéristique du discours de la « tropicalité » (mot formé par analogie avec le discours de l’« orientalisme ») – à savoir, un discours de pouvoir dramatisant l’opposition entre les Tropiques et l’Occident, et réduisant l’Amazonie à une terre sauvage ne pouvant être que dans l’attente d’une intervention civilisatrice. Pratiquement, cela a conduit à une double catastrophe qui se poursuit encore aujourd’hui, à la fois écologique (destruction de l’écosystème le plus riche de la planète) et humaine (génocide de tribus entières d’« hommes de la forêt »).
L’« invention » de l’Amazonie par l’Europe se produit dès les premières décennies de la colonisation, dans les rapports, lettres et récits des conquistadors et missionnaires, et elle prend la forme de quelques grands stéréotypes – notamment ceux du Paradis, de l’El Dorado, de l’Enfer et des Amazones. L’Amérique du Sud, et en particulier le bassin amazonien avec sa faune et sa flore magiques, stupéfient littéralement les explorateurs. Christophe Colomb, arrivé à l’embouchure de l’Orénoque lors de son troisième voyage en 1498, ne doute pas que ce fleuve vient tout droit du Paradis terrestre [Textos y documentos completos, 1982]. Il en va de même pour Amerigo Vespucci, impressionné en 1502 par la profusion des arbres et des animaux aux abords de l’Amazone. D’autres explorateurs renchérissent en découvrant ces lieux où tout est à portée de main, fruits, animaux, femmes, esclaves et bois d’exportation. Le mythe du Paradis culmine dans celui de l’El Dorado, déclenché par la découverte des trésors des Incas et attisé par des légendes indigènes évoquant une ville d’Or perdue en pleine forêt. Gaspar de Carvajal (1500-1584), missionnaire dominicain espagnol et chroniqueur de l’expédition menée par l’explorateur Francisco de Orellana (1511-1584) pour localiser la mystérieuse cité, narre dans Descubrimiento del río de las Amazonas (1542) chacune des étapes de leur difficile parcours à travers la forêt, le chaos végétal et aquatique leur opposant une résistance importante. Il reviendra à l’explorateur anglais Sir W. Raleigh (1552-1618) de donner pleine popularité à l’El Dorado : dans The Discovery of Guiana (1596), il donne un compte rendu fortement exagéré de son voyage dans la forêt de Guyane où il prétend avoir découvert d’importantes réserves d’or. C’est Carvajal également qui donne corps au mythe des Amazones de la forêt vierge : au cours d’un combat avec des Indiens, ceux-ci auraient obtenu le renfort d’une douzaine de grandes femmes guerrières déployant chacune la force de dix hommes. À la suite de cet épisode, Orellana aurait donné au fleuve le nom d’Amazone. Si les aspects hostiles de l’Amazonie ne sont pas passés sous silence par Carvajal, l’idée d’une forêt démoniaque et infernale ne se développe qu’avec les Jésuites, installés en Amérique du Sud dès 1549. Les lettres qu’ils envoient en Europe sont révélatrices de leur vision d’un monde pris dans un combat entre Dieu et le Diable – en l’occurrence, entre les missions et la forêt tropicale. Les arbres (menaçants par leur prodigalité), les fauves (féroces par définition) et les Indigènes (anthropophages guidés par des chamans-sorciers) sont représentés comme des complices dans le mal et deviennent la cible de la bataille antinature des Jésuites menée au nom de « l’œuvre civilisatrice ».
Dès le XVIIIe siècle, ce sont les naturalistes qui occupent le devant de la scène amazonienne : dans la foulée de L’Orénoque (1814) d’Alexander von Humboldt, ouvrage qui ouvre de nombreux champs de recherches sur la forêt d’Amazonie, les traités de botanique (Martius), de zoologie (Spix, Wallace), d’entomologie (Bates), d’ichtyologie (Agassiz), d’archéologie (Harrt) ou encore d’ethnographie (von den Steinen) se multiplient. Néanmoins, tout en évacuant de leurs récits les déclarations non vérifiées pour privilégier la rigueur scientifique, les clichés d’une forêt tantôt paradis, tantôt enfer, dissimulant dans ses profondeurs l’El Dorado, et habitée non seulement par des Indigènes anthropophages, mais encore par des Amazones, ne disparaissent pas de leurs descriptions, quoiqu’elles se présentent désormais sous une forme rationalisée : les Amazones sont en fait des femmes dont les maris ont été exterminés, et qui ont dû apprendre à combattre les dangers de la forêt par elles-mêmes ; la ville d’Or est une fiction de géographe, ce qui n’empêche pas que l’or et le diamant soient des matières premières réelles en Amazonie ; quant aux images paradisiaques et infernales, elles sont valables aussi bien les unes que les autres et se mêlent. « Je fatiguerais le lecteur en continuant l’énumération des merveilles végétales que renferment ces vastes forêts » (Humboldt) ; néanmoins, « l’âge d’or a cessé et, dans ce paradis des forêts américaines, une triste et longue expérience a enseigné à tous les êtres que la douceur se trouve rarement unie à la force ». De manière générale, les naturalistes estiment que l’Amazonie, Paradis ou/et Enfer, offre d’immenses possibilités d’exploitation et de découvertes, et que ce qui peut arriver de mieux, c’est que « la civilisation européenne reflue en grande partie dans les régions équinoxiales du Nouveau Continent » (Humboldt).
Au tournant des XIXe et XXe siècles, les relevés d’espèces inédites et endémiques livrés par les récits des naturalistes commencent à stimuler les imaginations et à inspirer les romanciers européens. Espace bien réel mais permissif parce que non entièrement balisé, la forêt amazonienne apparaît comme un lieu idéal pour situer les aventures les plus héroïques et extraordinaires. Que le romancier connaisse les lieux, tels Louis Boussenard dans les Chasseurs de caoutchouc (1887), Blaise Cendrars dans Moravagine (1926), et Algot Lange dans In the Amazon jungle (1911), ou qu’il se fonde uniquement sur ses lectures et sa créativité, comme Conan Doyle dans The Lost World (1912) et Jules Verne dans La Jangada (1881), tous ces récits se caractérisent par une série de passages obligés : navigation difficile (rochers, tourbillons), perte d’orientation (forêt labyrinthe), attaque par des Indiens cannibales, confrontation avec une animalité grouillante (vermines, insectes porteurs de fièvres) ou agressive (jaguars, serpents venimeux, caïmans). Le héros finit cependant invariablement par avoir raison de tous les obstacles et trouver un lieu en surplomb lui permettant de se repérer et de se rasséréner (sommet d’un arbre, pic rocheux). Enfin, il quitte la forêt sans autre conséquence que d’avoir acquis une nouvelle maturité. De manière générale, ces romans incitent à l’optimisme et œuvrent en faveur d’une justification de l’attitude coloniale : l’exploration des taches blanches sur les cartes de la forêt amazonienne doit être poursuivie (Conan Doyle), la Guyane est un Eldorado pour les colons français (Boussenard), les régions sylvestres n’attendent que la main de l’homme pour augmenter en beauté et en utilité (Verne). La tragédie du génocide et de la mise en esclavage d’Indiens pour l’exploitation du caoutchouc (à son apogée à cette époque) est dans ces récits soigneusement évitée.
Au début du XXe siècle, le roman sud-américain réagit à l’appropriation littéraire des paysages d’Amazonie par l’Europe en produisant un genre de littérature qualifiée d’« anthropophage » (selon le titre d’un manifeste de 1928 d’Oswald de Andrade). La métaphore de l’anthropophagie, provocatrice car elle éveille l’image d’Indigènes cannibales, sert à désigner un procédé littéraire basé sur la dévoration et la digestion d’éléments culturels étrangers – non pas pour les imiter, mais pour les transformer, les parodier et les intégrer à des éléments autochtones, et produire ainsi une littérature proprement sud-américaine. C’est ainsi que les protagonistes des « novelas de la selva », s’ils sont soumis comme ceux des romans européens à une série d’épreuves, ne les traversent pas de la même façon : la forêt dans laquelle ils se trouvent, étrangère aux catégories esthétiques de l’Europe, n’engendre plus qu’épouvante par son activité productrice incessante et sa physionomie rongée par la laideur et la putréfaction ; dans cet environnement, la raison et l’héroïsme du protagoniste ne sont plus d’aucun secours, c’est la nature qui domine l’homme : « La jungle était maîtresse de tout. L’homme ne comptait pour rien au milieu des feuilles » (José Maria Ferreira de Castro, A Selva, 1930). Conformément aux mythes amérindiens (fonctionnant selon une logique animiste de la perméabilité entre les règnes), la forêt, loin d’être un décor, est une force, une « personne » sensible et sentiente qui parle et interagit avec ses occupants – mais qui, dans le contexte de la fièvre du caoutchouc (clairement évoquée dans ces romans), ne peut être que perverse et agressive. « Le caobab remua les branches et j’entendis […] : – Piquez-le […], car lui aussi détruit les arbres et il est juste qu’il connaisse notre martyre » (José Eustasio Rivera, La Vorágine, 1924). Dans la nouvelle poétique sud-américaine de la jungle, la forêt est sans compromis : si la dissolution identitaire qu’elle provoque est sans danger pour l’Indigène, elle est fatale pour l’homme « civilisé » qui tantôt sombre dans la folie, tantôt disparaît sans laisser de trace, « dévoré » par la puissance du monde végétal (Rivera).
Dans les années 1980, l’Indigène d’Amazonie fait son entrée dans la « République des Lettres ». L’homme de la forêt, l’Autre par excellence, celui ayant fait l’objet pendant plusieurs siècles des constructions littéraires les plus fantaisistes (allant de l’Indien primitif et anthropophage au noble et bon sauvage), refuse désormais qu’on parle à sa place et que l’on s’approprie et défigure impunément ses récits oraux : il réclame le droit de présenter lui-même sa version des « choses indiennes » (Coisas de Índio est le titre d’un livre de Daniel Munduruku de 2020). Cette nouvelle littérature, souvent multimodale (complétée par des dessins), fait surgir des histoires locales qui rendent compte de manière inédite des traditions et modes d’être des Amérindiens, et qui fonctionne en même temps comme un véritable appel à la préservation de la forêt : « Notre forêt n’est pas morte et posée là sans raison » et « il ne faut pas penser que la forêt soit vide », car « même si les Blancs ne les voient pas, les esprits y vivent en très grand nombre », déclare le chaman yanomami Davi Kopenawa (La Chute du ciel, 2010). La forêt est étroitement liée à l’identité et à la survie des Indigènes car chacun de ses éléments est considéré comme une « personne », un « parent », voire un « ancêtre », c’est-à-dire comme un partenaire social avec lequel il est possible de communiquer et de négocier à la faveur de certaines circonstances (rêves, absorption de plantes hallucinogènes, pratiques ascétiques). Outre des récits mettant en évidence une pensée moniste (l’homme n’est qu’un élément de la nature), la littérature indigène se voit également enrichie par des initiatives collectives destinées à l’éducation des enfants (indigènes ou non) : ainsi en est-il du Livro das árvores (1997), rédigé par des enseignants Ticuna, qui, d’une part, révèle de véritables trésors sylvestres là où le Blanc ne voit qu’uniformité, et qui, d’autre part, en expliquant la fonction et les vertus de chaque arbre, plante et animal, mais aussi de chaque esprit de la forêt, ouvre une porte d’accès aux mythes constitutifs de la communauté.
Corinne FOURNIER KISS
FVoir : Amazonie littérature de jeunesse, Arbres – Allégories, Communication, Danger, Esprit de la forêt
•Références
GONDIM, Neide, A Invenção da Amazônia, Manaus, Editora Valer, 2007.
HEMMING, John, Tree of Rivers: The Story of the Amazon, London, Thames & Hudson, 2008.
MUNDURUKU, Daniel, Le Banquet des dieux [O Banquete dos deuses], trad. C. Fournier Kiss, Bellevaux, Éd. Dehors, 2024 (à paraître).
TETTAMANZI, Régis. Les Écrivains français et le Brésil. La construction d’un imaginaire de « La Jangada » à « Tristes Tropiques », Paris, L’Harmattan, 2004.
WYLIE, Lesley, Colonial Tropes and Postcolonial Tricks: Rewriting the Tropics in the novela de la selva, Liverpool, Liverpool University Press, 2009.
AMAZONIE – LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Ce vaste territoire (5 500 000 km2) qui abrite la plus grande forêt tropicale de la planète, est divisé par les frontières de neuf pays et irrigué par un important réseau hydrographique relié à l’Amazone, le majestueux « fleuve-mer ». Hébergeant une biodiversité tellement variée qu’elle ne nous est pas entièrement connue, l’Amazonie constitue l’habitat traditionnel des tribus amérindiennes d’Amérique du Sud. Objet de tous les désirs, la forêt a été explorée, puis exploitée. Elle fait aujourd’hui l’objet d’études et de mesures de sauvegarde. La littérature pour la jeunesse rend compte de cette évolution.
Présenté par Blaise Cendrars (son traducteur en français) comme un « documentaire extraordinairement vrai » sur l’Amazonie, l’ouvrage Forêt vierge de Ferreira de Castro (1930) décrit la jungle au début du XXe siècle. Le lecteur découvre ainsi un territoire immense et monotone : « C’était du déjà vu, toujours et toujours la même chose, de la forêt et de l’eau, aussi loin, aussi longtemps qu’on avançât ». Un lieu sombre, accablé par une chaleur étouffante, hostile, sauvage, mystérieux et dangereux qui mérite son surnom : « “l’Enfer vert” de la grande forêt équatoriale, niveleuse et mangeuse d’hommes ». Un lieu archaïque, labyrinthique, opprimant, déprimant, qui épouvante et peut conduire à la folie : « L’Amazonie était un monde à part, une terre embryonnaire, énigmatique et tyrannique, faite pour étonner, pour détraquer le cerveau et les nerfs ». Car la forêt est habitée par des tribus indiennes, des animaux, des insectes – tous hostiles, qui profitent de l’exubérance de sa végétation pour se dissimuler et attaquer : « La brousse masquait tout. Et derrière, tout était à craindre ». Cette luxuriance fait disparaître l’horizon, il devient dès lors facile de se perdre et elle constitue parfois « un obstacle infranchissable ». La jungle est trompeuse à l’image de « son silence symphonique » ; elle est « maîtresse de tout » constate le narrateur, et cette prise de conscience ramène l’homme à une position plus humble : « L’entrée en forêt nous sort du monde où nous supervisons les choses du regard, nous sommes contenus, nous faisons partie d’un temple qui nous enveloppe, nous ne sommes plus les rois du monde, nous apprenons très physiquement l’humilité, notre proximité de l’humus » (Haberer). Cette perception négative de la Selva doit beaucoup à l’époque où le livre a été écrit et à la situation du personnage-narrateur, piégé dans une exploitation de caoutchouc (« l’or noir » de l’Amazonie) dans une condition proche de l’esclavage. Moins d’un siècle plus tard, la Selva est devenue – certes, souvent de manière invraisemblable – un espace propice aux aventures des personnages de littérature de jeunesse.
Les caractéristiques de la forêt qui terrorisaient le personnage de Ferreira n’ont pourtant pas disparu. L’Amazonie conserve son climat tropical chaud et humide. Elle reste un lieu immense, « infini », « aussi vaste que les océans » (Janichon, Amazonas, 2002), dans lequel on ressent l’impression de s’enfoncer dans le « monde sans limite » de Bachelard (1957). La forêt est aussi hyperbolique car elle renferme les « plus beaux, les plus grands, les plus rares arbres » (Janichon.). La densité, l’épaisseur, la luxuriance de sa végétation continuent de la définir et de la plonger dans la pénombre : « Les arbres sont parfois si serrés et la végétation si touffue que même en plein jour il fait toujours sombre ou carrément noir ! » (ibid.). L’absence d’horizon brouille toujours les points de repère et confond les personnages : « Maia avait parfois l’impression qu’elle connaissait déjà tous ces endroits. Mais à d’autres moments, tout lui paraissait différent » (Ibbotson, Reine du fleuve, 2003). Enfin, l’Amazonie est grouillante de vie et abrite encore des espèces dangereuses, les plus grandes n’étant pas les pires : moustiques, fourmis, asticots, chauves-souris, mygales, serpents ou caïmans.
Si la forêt tropicale conserve la plupart de ces caractéristiques, ce qui change, en littérature de jeunesse, c’est l’âge des personnages, les circonstances historiques conditionnées par la prise de conscience écologique mondiale, la variété des points de vue : scientifiques, amérindiens ou écologistes. Même lorsque l’intrigue est contemporaine de celle de Ferreira, l’« enfer » ne résonne plus de la même manière : « Si c’est ça, l’enfer vert de l’Amazonie, alors je veux vivre en enfer » (Ibbotson). Et l’idée de paradis, de bonheur et de liberté finit par l’emporter sur la désignation traditionnelle : « Dans l’inextricable jungle d’un monde que bien des hommes appellent l’Enfer vert, j’ai connu, durant plusieurs semaines, une vie de paradis et de liberté incomparables » (Janichon). C’est une question subjective comme le montre un motif récurrent qui consiste à présenter des points de vue opposés sur une réalité identique, et c’est à nous de faire de tout endroit un enfer ou un paradis, comme on a pu le lire dans Reine du fleuve. C’est aussi affaire de préjugés construits par l’école ou les médias (Causse, Green traffic, 2022). Mais l’image du paradis est immanente à la forêt par son immensité, sa beauté, sa spiritualité. Souvent comparée à un « temple végétal », l’Amazonie semble l’œuvre d’un créateur divin : « On aurait dit […] que quelqu’un avait dessiné ça avec une idée derrière la tête : quelqu’un qui voulait un monde aussi sauvage, aussi verdoyant et vivant que possible » (Rundell, L’explorateur, 2022). Son immensité nous enseigne certes l’humilité, mais elle sait aussi devenir « une immensité protectrice » (Causse). Loin d’être déprimante comme chez Ferreira, la couleur verte omniprésente se fait « opulente » (Rundell). Dix tons de vert sont ainsi nécessaires pour la représenter, par exemple « vert citron, émeraude, vert mousse, jade et vert foncé, presque noir » (Rundell). L’air se charge des « mille parfums mêlés de la jungle, comme l’odeur enivrante d’un bouquet géant » (Janichon). Le paysage devenu « spectacle » (Resplandy-Taï, Le pacte de Léon et Tukutsi, 2012) est qualifié de féerique (Rundell), magique, magnifique, merveilleux (Ibbotson). Dans les romans qui se déroulent à l’époque contemporaine, la beauté et l’étendue de la forêt s’apprécient d’autant mieux que les personnages ont la possibilité de retrouver l’horizon en prenant de la hauteur en avion, hélicoptère ou dans le « radeau des cimes » utilisé pour étudier la canopée. L’Amazonie leur apparaît alors comme « une mer d’arbres », « un champ géant de brocolis » (Resplandy-Taï) ou « un tapis persan pour les dieux » (Rundell). Cette comparaison nous renvoie de nouveau à la spiritualité de la forêt qui, selon les Amérindiens, aurait une âme.
Cet espace infini et mystérieux reste angoissant, mais les auteurs pour la jeunesse nous disent qu’il est possible d’apprivoiser nos peurs en gardant un esprit ouvert et en apprenant à connaître la forêt dans les livres, grâce à la médiation d’initiés, ou simplement par l’observation. Pour donner l’exemple, les romanciers corrigent les idées fausses (non, l’anaconda n’est pas si dangereux) et nomment les animaux qu’il faut réellement craindre : les moustiques, surtout, mais aussi le serpent fer de lance, le serpent liane ou les fourmis paraponera ou balle de fusil. Ils décrivent leur comportement, font des recommandations pour s’en protéger et n’hésitent pas à rappeler que ces animaux ne font qu’obéir à leur nature : « les piranhas sont des piranhas » (Pope Osborne, La cabane magique. Perdus en forêt amazonienne, 2020). Les écrivains n’oublient pas de mentionner d’autres créatures plus sympathiques : papillons, libellules, toucans, aras, paresseux. Enfin, plutôt que de considérer les dangers de l’Amazonie, ils préfèrent en souligner l’intérêt pour l’ensemble de l’humanité. La forêt renferme « des trésors » sous forme d’une « incroyable biodiversité » (Resplandy-Taï) présente sur les marchés locaux qui rassemblent « tous les aspects, secrets et spectaculaires, de la vie amazonienne » (Janichon). Certaines plantes pourraient être utiles en médecine et, pour montrer l’intérêt planétaire de cette forêt, les romanciers perpétuent l’idée – contestée par Haberer – qui en fait « le poumon de la terre ».
Pourtant, comme le dénoncent la plupart des ouvrages, ce paradis est menacé. La déforestation et la pollution accompagnent la prospection minière ou pétrolière, l’exploitation agricole forcenée, la construction de barrages, de routes pour lesquelles on laboure « la chair vive de l’immense corps amazonien » (Janichon). La contrebande pour répondre, entre autres, aux attentes des collectionneurs, met en péril certaines espèces. Le tourisme pourrait bien lui aussi devenir inquiétant. Le tout dans une ambiance de corruption politique nous dit le roman pour jeunes adultes Green Traffic de Manu Causse qui adopte le ton de la politique-fiction avec informations chiffrées et références appuyées à l’actualité brésilienne, en particulier depuis 2019 et les grands incendies qui ont ravagé une partie de l’Amazonie. Le souci de développement économique mais surtout la cupidité humaine mettent en danger la forêt : « La pire menace envers le vivant, c’est l’homme » (Rundell). Face à eux, les ONG et les organismes institutionnels agissent quand ils en ont les moyens (Le Peuple du chemin de Marion Achard est soutenu par Amnesty International). Les enjeux sont tels qu’il peut être dangereux de défendre l’Amazonie face à ceux qui veulent l’exploiter, nous explique-t-on dans Green Traffic. Les tribus amérindiennes, qui pourraient nous réconcilier avec la forêt et nous transmettre leur savoir, sont obligées de fuir pour préserver leur existence et leur mode de vie au rythme des saisons et des lunes, en harmonie avec la nature : « Et nous nous enfoncerons dans la végétation. Si loin qu’aucun étranger ne pourra jamais nous retrouver » (Achard). Mais peut-être que, comme le soutiennent les écopoéticiens, la littérature ne se contentera pas de servir de réceptacle à l’évolution des pensées et qu’elle contribuera aussi à éveiller les consciences, faire évoluer les mentalités, découvrir des vocations. Peut-être nous convaincra-t-elle, comme le colibri de Gwendoline Raisson (La légendaire histoire du colibri qui sauva l’Amazonie, 2021), de faire chacun notre part, et, comme l’explorateur de Katherine Rundell, peut-être comprendrons-nous que « la beauté du monde nous donne des devoirs ».
Esther LASO Y LEÓN
FVoir : Amazonie, Danger, Fourmis, Forêt primaire
•Références
BACHELARD, Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, 1957.
FERREIRA DE CASTRO, José Maria, Forêt vierge, Blaise Cendrars (trad. port.), Paris, Grasset (les Cahiers Rouges), 1988, (1930, 1re éd. en portugais).
HABERER, Patrice, Mots sauvages. La forêt dernier refuge du sauvage. Paris, L’Harmattan, 2020.
ARBRE
Parmi les quelque 400 000 espèces de plantes terrestres actuelles, il y a 73 000 espèces d’arbres. Autrement dit et en simplifiant, une plante sur cinq sur Terre est un arbre ! Si l’on peut compter les arbres, c’est que l’on peut facilement les reconnaître. Selon les botanistes, pour être labellisée « arbre », une plante terrestre remplit un cahier des charges listant quatre caractéristiques essentielles.
Premièrement, un arbre est une plante emplie de bois, une plante ligneuse (du latin lignum = bois) par opposition aux autres plantes dites herbacées. Le bois est le tissu majoritaire des arbres, emplissant tous ses axes, au-dessus du sol dans l’air (le tronc, les branches) ou cachés dans le sol (les racines). Il est fabriqué par une mince couche de cellules-souches située sous l’écorce, le cambium. Ces cellules juvéniles se divisent activement dès le réveil printanier et les cellules-filles





























