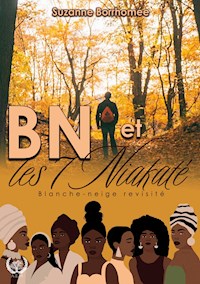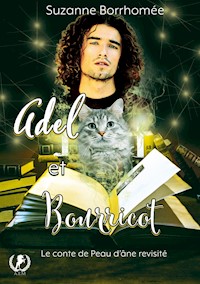
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art en Mots Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Adel parviendra-t-il à retrouver le bonheur après le décès de son père ?
Adel, un adolescent de dix-sept ans, voit son monde basculer après la mort de son père. Contraint de retourner vivre chez sa mère adoptive qu’il n’a pas vue depuis des années, il découvre avec surprise qu’elle vit dans le luxe des beaux quartiers de Levallois. La source de cette richesse ? Bourricot, un chat têtu comme une mule, qui joue un rôle étonnant dans la vie de sa mère.
Tandis qu’il tente de s’adapter à cette nouvelle vie, Adel doit faire face à ses propres émotions et mettre de l’ordre dans ses sentiments. Grâce au soutien de ses nouveaux amis et à la douce présence d’Aïtana, il apprend à naviguer entre le désir de se rapprocher de sa mère et le besoin de trouver sa propre voie. Trouvera-t-il enfin sa part de bonheur malgré les turbulences de son quotidien ?
Plongez sans attendre dans ce conte de Peau d'âne revisité, rempli d’émotions et de surprises !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Pédiatre en réanimation néonatale, Suzanne Borrhomée vit en région parisienne où elle élève ses quatre enfants avec son mari. Entre deux larmes et trois éclats de rire, elle trouve le temps de redonner vie à ses contes favoris, offrant à ses lecteurs des histoires touchantes et réinventées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adel et Bourricot
Suzanne Borrhomée
Fantastique
Images : Adobe stock
Illustration graphique : Graph’L
Art en Mots éditions
Chapitre 1
Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu’on pouvait dire qu’il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu’il avait fait d’une princesse aussi belle que vertueuse]… [De leur mariage était née une fille, douée de tant de grâce et de charmes, qu’ils ne regrettaient pas de n’avoir pas une plus grande lignée.
Charles Perrault
— Vous avez compris ?
Le médecin lève les sourcils, et je le vois travailler activement à dessiner l’empathie sur ses traits. Il n’a pas plus que moi envie d’avoir cette conversation, mais contrairement à moi, il est payé pour ça. Je n’ai rien écouté depuis qu’il a prononcé « stade terminal » et pourtant je hoche la tête en réponse. Ça fait six minutes que ce vieil homme me donne des explications qui pourraient aussi bien être en mandarin. La moitié des mots qu’il utilise sont en jargon médical, il a oublié qu’un seul de nous deux a fait 10 ans d’études et ce n’est pas moi… Il est évident que je n’ai rien compris.
— Ai-je été assez clair ? répète-t-il
— Heu… ça ne s’arrange pas, c’est ça… ?
— Il est décédé.
— Il est… quoi ?
— Je suis désolé.
J’ouvre la bouche et la referme une fois, deux fois, sans pouvoir émettre le moindre son. Est-ce qu’il vient de dire que mon père est mort ? Pourquoi sommes-nous dans ce bureau à discuter et pas dans sa chambre dans ce cas ? À quoi bon me retenir ici et me parler une langue incompréhensible en triturant les embouts de son stéthoscope ? Je me lève d’un bond.
— Je vais vous conduire à lui, monsieur…
— Adel.
Je l’interromps sèchement, et il baisse la tête en silence. J’ai été « jeune homme » ou « mon garçon » durant ces deux dernières semaines, je n’ai pas besoin d’être promu « monsieur Bartier » le jour où on perd l’original. Monsieur Bartier c’est mon père, David. Pas moi. Je le suis sans rien dire, en essayant de contenir mes pleurs. Ce n’est pas ce que David aurait voulu. Il avait une profonde aversion pour toutes les manifestations de tristesse : sanglots bruyants ou discrète complainte. J’entends encore sa voix, me répéter avec une pointe d’humour : « Il n’y a pas de raison de chialer, tant qu’il reste de la vodka ! » ou « Si je te vois pleurer, je te fais écouter tout mon album Tragédie du groupe Tragédie… Avec un verre de vodka par chanson ! » ou « Mon fils ne peut pas être coiffé comme une fille, et pleurer comme un môme à la moindre occasion. Prends plutôt un coup avec papa »…
La jeune femme qui m’ouvre la porte de la chambre 313 me sort brutalement de ces souvenirs. Je ne me suis même pas rendu compte que nous avons parcouru tout ce chemin. Je croise son regard avant qu’elle ne baisse les yeux, et ses joues rosissent. C’est l’élève infirmière de nuit avec qui j’ai flirté l’hiver dernier lorsque la cirrhose de mon père a rechuté. Son prénom m’échappe aujourd’hui, mais je lui dois beaucoup : elle avait presque réussi à rendre mon quotidien entre lycée et service d’hépatologie normal. Et à l’époque, je pensais déjà qu’on touchait le fond. Au moment où nous entrons dans la chambre, je garde mes yeux rivés sur le sol en me demandant si maintenant, je suis en train de le toucher, le fond. Ou si la situation ne fait que commencer à se creuser… Le médecin m’observe en achevant une nouvelle phrase que je n’ai pas non plus écoutée, et qu’il dit sûrement par politesse. Lentement, je finis par m’approcher de David. Allongé sur le lit, comme endormi, mon père a l’air paisible et je suis déchiré entre ma peine et le soulagement de voir ses traits enfin relâchés. Il ne reste aucune trace de douleur, toute la souffrance l’ayant abandonné en même temps que la vie. Quelle ironie, hein ? Il a arrêté l’alcool parce que la boisson lui avait tout pris, de ma mère à sa santé, mais tous les jours il se plaignait que la sobriété était une souffrance sans nom. Je devais sans cesse lui rappeler qu’il le faisait pour sa vie. Mais la douleur s’incrustait chaque jour un peu plus dans ses traits. Pour sa santé, je lui disais… Et aujourd’hui, pour la première fois en deux ans de sobriété, je le vois dénué de cette souffrance. Mais aussi privé de sa santé. De sa vie. De notre lien. Plutôt injuste, à mon avis. Je pose une main tremblante sur la sienne, elle est encore tiède. C’est comme ça que je le réveille, habituellement, quand je viens le voir à l’hôpital, et je ne peux m’empêcher de secouer un peu son poignet. Son teint jaune cireux, qu’il arborait déjà avant de décéder, contraste avec ma peau mate. L’équipe médicale ici nous connaît bien, et c’est le seul endroit où on ne s’étonne pas de nous voir ensemble. Je suis aussi grand que mon père était petit, je suis élancé et sec, là où il était trapu et presque trop musclé. Mon teint est hâlé, et ma chevelure ébène, épaisse et ondulée, révèle des origines exotiques, tandis que mon père, lui, était blond clair, du moins le peu de cheveux qu’il lui restait. Il plaisantait souvent en disant que lorsque ma mère et lui m’avaient vu pour la première fois, avant l’adoption, ils avaient tout de suite su que j’étais le leur, parce que j’étais son portrait craché. Au premier regard posé sur moi, il m’a reconnu. J’espère que les anges qui posent leurs regards sur lui aujourd’hui ressentent la même chose.
— On peut vous appeler quelqu’un ?
Ma seule famille est allongée, inerte sur le lit face à moi. Pendant un long instant, ma respiration est la seule réponse. L’alcool ronge mon père depuis quasiment aussi longtemps que je peux me souvenir de lui, pourtant j’ai été assez naïf pour laisser venir ce jour sans me demander ce qui allait m’arriver si le pire se produisait.
— Je vais me débrouiller.
J’ai murmuré ma réponse, mais l’infirmière m’a entendu et elle soupire longuement, trop polie pour dire à voix haute ce qu’elle pense sûrement : « Tu as dix-sept ans, et tu ne sais probablement même pas où va aller le corps de ton père dans l’heure qui suit, ni avec quoi tu vas payer tes prochaines courses. Tu comptes te débrouiller comment ? »
Je me lève et quitte la pièce sans lui jeter un regard, et sans ajouter un mot. Ce qui est sûr, c’est que je ne mettrai plus les pieds ici.
À l’extérieur, le mois de janvier a étendu un règne froid et sec sur la région parisienne. Le vent glacial m’attaque les joues sans pitié. Un temps que seule la vodka peut réchauffer, dirait mon père, qui ne savait pas faire une phrase qui n’inclue pas la promesse d’une boisson. Je quitte l’hôpital Beaujon, les mains dans les poches pour les maintenir au chaud et m’empêcher de faire un doigt d’honneur à cette vieille bâtisse, où tous les abandons importants se font, en ce qui me concerne. Je me retourne pour fixer une dernière fois les briques rouges, tout en me dirigeant vers l’arrêt de bus.
Cet hôpital, c’est celui où je suis né. Le lieu où celle qui m’a mis au monde a décidé de me laisser et de disparaître sans laisser de trace. Né sous le secret, parce qu’on ne dit plus « naître sous X »… Comme si le nom de la procédure était ce qui nous faisait le plus mal. Comme si être le secret de quelqu’un n’était pas aussi sale, et ne laissait pas la même trace que la lettre X… Des jeux de mots pour décorer nos maux, à mon avis. En tous cas, c’est comme ça que j’ai pu rencontrer mes parents adoptifs, fous amoureux à l’époque, lorsque mon père était encore cascadeur professionnel, jeune, beau et fidèle à sa femme… avant qu’il ne se donne à la plus exigeante des maîtresses : la bouteille.
Dans cet hôpital, on lui a annoncé le diagnostic de cirrhose alcoolique. Il n’a pas fondu en larmes. Il s’est consolé avec le remède le plus efficace qu’il connaisse, en déclarant qu’il préférait mourir d’avoir trop bu, plutôt que mourir de soif. Ça l’avait fait bien rire. Ma mère, un peu moins… Il faut dire qu’elle ne riait déjà plus beaucoup à l’époque.
Et elle l’a quitté un matin en sortant de ce même hôpital, lorsqu’il a déclaré qu’il ne serait jamais éligible pour une greffe de foie, parce qu’il n’arrêterait jamais de boire. Elle l’a quitté, et moi qui n’avais jamais bu une goutte, elle m’a quitté aussi. Bien plus tard, quand la cirrhose est devenue cancer, et que mon père a finalement choisi la sobriété, il était trop tard.
Et voilà, l’histoire se conclut ici pour lui, dans ce même hôpital… Sans famille, sans possibilités de traitement, et même sans alcool, ce que je trouve encore plus triste que le reste, bizarrement.
En ce qui me concerne, je le répète, c’est la dernière fois que je mets les pieds dans cet endroit.
Je ne vois même pas passer le chemin du retour et je suis devant la porte de notre appartement en un clignement de paupières. Je fais tomber deux fois la clé avant de réussir à l’introduire dans la serrure, tant ma main tremble. Il s’est passé quasiment deux heures, mais je sens le poids de la nouvelle commencer à vraiment s’écraser sur ma poitrine et je me sens suffoquer. Je referme la porte derrière moi et m’y adosse en essuyant les larmes qui quittent mes yeux malgré moi. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? Quelle étape vient après celle-ci ?
Mon téléphone vibre dans ma poche arrière pour la énième fois depuis que j’ai quitté l’hôpital. On tente de me joindre, et même si je me méfie des numéros inconnus en général, le nombre croissant d'appels en absence attise ma curiosité.
— Allo ?
— Adel ? Enfin, tu réponds, je t’ai appelé au moins 12 fois !
Je ne reconnais pas la voix au bout du fil, mais elle m’appelle par mon prénom avec assurance, et si je ne m’abuse, une note d’impatience. Une voix de jeune fille, mais aucune de mes camarades de classe n’a cet accent.
— C’est qui ?
Elle met un moment à répondre et je me demande comment cette question peut être compliquée, lorsque sa voix murmure, après avoir reniflé à l’écart du combiné, je pense :
— C’est maman, Adel.
— Qui ?
Oh, j’ai bien entendu, mais je vais avoir besoin qu’elle me répète ça une fois ou deux. Maman, celle qui a quitté le foyer lorsque les choses ont commencé à vraiment sentir le moisi et qui a disparu de la circulation sans exprimer de regrets ? Celle que je n’ai pas vue depuis huit longues années ? Celle qui a envoyé sa dernière carte d’anniversaire il y a 4 ans ? Celle à qui je n’ose même pas en vouloir, parce que, peut-être au fond, elle pense… Que je ne suis même pas son… vrai fils .. ?
— C’est maman, Adel. C’est moi.
— Qu’est-ce que tu veux ?
Mon ton est plus sec que je ne le souhaite.
— L’hôpital m’a appelée, je sais que David est… parti. Je suis en route pour te récupérer chez lui.
— Me récupérer ? Pourquoi l’hôpital t’a appelée ?
Les questions se bousculent dans ma tête et hors de ma bouche sans logique évidente.
— Je suis sa personne de confiance, soupire-t-elle. Adel, je suis en route, je ne peux pas rester au téléphone. Prépare un sac, s’il te plaît. J’imagine que tu n’as pas grand-chose dans ce trou à rat de toute façon. Tu viens à la maison.
Je ne sais pas exactement pourquoi mon téléphone me glisse des mains pour atteindre le sol à grand fracas, ni pourquoi je suis incapable de bouger pour le récupérer. Ma respiration est saccadée, mes mains moites.
Quinze minutes plus tard, lorsque la sonnerie de la porte d’entrée retentit derrière moi, je suis toujours adossé à la porte. Je ne dirais pas forcément que je suis effrayé, mais…
— Adel ! Tu comptes ouvrir ?
Mes gestes sont lents, mais je sais que j’ai toutes sortes d’excuses. Mon père est mort. J’ai passé deux heures sans famille. Puis ma mère me retire son abandon, sans prendre la peine de me demander ce que j’en pense. J’ouvre la porte, millimètre par millimètre, en prenant de grandes inspirations, en essayant de me calmer pendant les secondes qui me restent, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui m’attend.
— Maman ?
Juchée sur des talons de 15 cm, une petite blonde de moins d’un mètre cinquante se tient devant moi, lunettes de soleil sur le nez malgré la météo, coca zéro dans la main droite, i phone dans une housse à fourrure rose bonbon dans la main gauche. Son manteau est ouvert sur une robe trop courte, trop échancrée, et mon regard essaie d’éviter à tout prix le décolleté qu’elle révèle avant de remonter sur des lèvres charnues, rouge vif, et pour finir, lorsqu’elle retire enfin des lunettes Dior, une paire de grands yeux verts surpris.
— Adel ? C’est toi ?
Qui veut-elle que ce soit ? Si la situation n’était pas aussi dramatique, je sourirais presque à la façon dont ses yeux semblent vouloir se décrocher de leurs orbites. Elle me parcourt de haut en bas, puis, lentement, remonte le long de mon jean, mon T-shirt froissé, ma veste de survêtement tachée, mes longs cheveux sales lâchés en une cascade ondulante sur mes épaules carrées, mon visage angulaire, et comme je mesure 1 mètre 97, elle doit pencher la tête pour venir regarder au fond de mes yeux noirs. Elle fronce les sourcils, me fixe un long moment, avant que le coin de ses lèvres ne se soulève en un sourire infiniment triste :
— Adel, mon fils, c’est fou ce que tu as grandi… Le temps a passé. Trop de temps. Et toi… Tu es toujours aussi beau. Tu es la plus belle personne que j’aie vue depuis le jour où j’ai rencontré ton père.
Chapitre 2
Ce n’était pas par fantaisie, mais avec raison que le roi lui avait donné une place particulière et distinguée. Les vertus de ce rare animal méritaient cette distinction, puisque la nature l’avait formé si extraordinaire, que sa litière, au lieu d’être malpropre, était couverte, tous les matins, avec profusion, de beaux écus au soleil et de louis d’or de toute espèce, qu’on allait recueillir à son réveil.
Charles Perrault
— On part, Adel.
Le lundi suivant, je n’ai pas le choix. Je vais devoir quitter la chambre que j’occupe dans l’appartement de ma mère. Cette femme est minuscule, mais lorsqu’elle en a besoin, elle sait se montrer persuasive. Elle m’a laissé me terrer ici durant les obsèques, et n’a pas pipé mot lorsque j’ai refusé d’aller à l’enterrement jeudi et de saluer le bal des hypocrites que papa n’avait pas vus depuis dix ans et qui se fichaient bien de mon existence jusque-là. Elle m’a laissé ignorer le week-end, rideaux fermés, muré dans le silence de la chambre, survivant d’un régime de chips et de coca. Elle m’a laissé l’ignorer elle. Elle a compris que je ne pouvais pas, en quelques jours, perdre un père, et retrouver celle que j’avais appelée maman depuis ma naissance. Ça demande du temps. Donc faute de pouvoir me créer du temps, elle m’a laissé de l’espace. Et dans son duplex de 92 mètres carrés dans les beaux quartiers de Levallois-Perret, elle en a, de l’espace. Ma chambre seule fait la moitié de notre ancien appartement.
— Adel !
— Je suis là, je suis là.
Je la rejoins dans l’entrée et fronce les sourcils en voyant sa tenue. Manteau de fourrure blanche, bottes à talons aiguilles, lunettes de soleil et masque léopard… Où a-t-elle dit qu’on allait ? Le lycée, c’est bien ça ? Je la suis sans rien dire jusqu’à son garage souterrain. Lorsqu’elle ouvre les portes d’une Lamborghini Huaracan jaune, je pense que j’ouvre des yeux ronds comme des soucoupes, ce qui ne lui échappe pas, puisqu’elle sourit en me faisant un clin d’œil. Ma mère, telle que je me souviens d’elle, était discrète, silencieuse, et pour beaucoup, invisible. Plus mon père s’enfonçait dans l’alcool, plus elle maigrissait. Son humeur glissait, elle s’effaçait, semblait-il… À l’époque, je croyais être le seul capable de la faire sourire, et j’y employais tous mes efforts. En m’asseyant, incrédule, à bord du bolide, je me demande si c’est l’argent qui la rend heureuse maintenant. Si elle nous a troqués, papa et moi, contre une Lamborghini et un duplex, et si l’échange a été source de beaucoup de sourires.
— Si tu penses à conduire ce bijou, Adel, même pas en rêve, dit-elle avec un sourire en démarrant.
Ce n’est pas du tout ce à quoi je pensais. Que fait-elle dans la vie et d’où vient tout cet argent ? Que s’est-il passé pendant ces huit dernières années ? Est-ce vraiment ma mère que j’ai retrouvée ? Je garde les yeux rivés sur la route qui défile, bien plus vite que la limitation de vitesse en ville ne le permet normalement.
— Ce n’est pas indiqué lycée, par ici… ?
— On va plus loin, au lycée privé Montalembert. Et tu peux m’appeler maman, Adel. Je sais que je te dois beaucoup d’explications. Et tu les auras.
Je lui jette un regard en coin, sans répondre parce que je ne me fais pas confiance pour rester poli. Et elle est le rempart entre moi et le foyer pour ados à l’heure actuelle. Donc si elle veut jouer à la maman huit ans après, qu’à cela ne tienne, je ne vais pas la retenir. Par contre, si je peux essayer de me protéger cette fois-ci, je le ferai. Parce que la dernière chose dont j’ai besoin, c’est de perdre à nouveau une mère. Ce scénario s’est déjà répété suffisamment, et elle a déjà prouvé qu’elle n’avait pas à cœur d’être ma mère lorsque ça ne l’arrangeait pas. J’aurais tort de m’attacher cette fois.
— Adel, je sais que tu m'en veux, et c’est normal...
— Je ne t’en veux pas… Maman. C’est gentil de m’héberger. Je ne sais pas comment te parler, c’est tout.
— Bien sûr que tu m’en veux, et tu as raison. Et je ne suis pas « gentille » de t’héberger. Tu es mon fils. Tu l’as toujours été, et tu ne peux pas savoir comme je m’en veux…
Elle laisse sa phrase en suspens et tourne les yeux vers moi un peu trop longtemps.
— Ce soir, dit-elle. Dîne avec moi ce soir et on parlera.
Le lycée privé Montalembert est un établissement beaucoup trop bien pour moi. Nul doute que ma mère a dû payer des suppléments et venir lécher des bottes en personne pour m’obtenir une place dans cet endroit, en si peu de temps, avec le bulletin scolaire que j’ai.
Si je n’en étais pas déjà persuadé, l’entretien avec Mme Belgrise, la CPE, aurait fini de me convaincre. C’est une belle femme dont les yeux bleus dégoulinent de mépris, et elle retrousse son joli petit nez lorsqu’elle s’adresse à moi comme si une odeur pestilentielle émanait de mes pores. Hier, je ne dis pas… Mais aujourd’hui j’ai pris une douche, et je sais que je sens bon, en plus d’être aussi séduisant qu’à mon habitude. Je ne veux pas paraître vantard, parce que je ne suis en rien le lycéen modèle, mais le peu de qualités que j’ai, je les connais. Je suis plutôt sympathique, bien élevé la plupart du temps, excellent à quasiment tous les sports, et… oui, la plupart des filles me trouvent à leur goût. J’ai toujours eu ce que mon père appelle une « gueule d’ange » venue d’ailleurs : un teint et des traits de polynésien, un visage enfantin et de longs cils quasi efféminés entourant l’amande de mes yeux noirs. Mais depuis que l’adolescence a gracié mon corps trop grand d’une carrure athlétique, et que j’ai laissé pousser mes cheveux, je ressemble de près à l’acteur Jason Momoa, et la plupart de la gent féminine est sensible à mon charme. En toute modestie. Ce matin, hélas, je ne trouve pas grâce aux yeux de madame Belgrise. Elle a mon dossier scolaire en main, et aucun physique ne peut rattraper ce qu’elle y lit sûrement : Absentéisme, absentéisme, deux fois renvoyé pour être venu au lycée en état d’ivresse, absentéisme, absentéisme. Et je ne parle même pas des notes.
— Et être le fils d’une célébrité ne changera rien, poursuit-elle, nous nous réservons la possibilité de vous renvoyer à la fin du semestre si les résultats ne suivent pas. Il va falloir vous accrocher. Deux avertissements, le renvoi. Une moyenne inférieure à 12, le renvoi.
Elle penche la tête en haussant les sourcils, mais comme elle n’a pas posé de question, je ne me sens pas l’envie de répondre. Elle a bien dit le fils d’une célébrité ? Mais de qui parlait-elle ? Je pense qu’il serait mal venu de lui demander si elle sait ce que fait ma mère dans la vie, donc je garde le silence.
— C’est bien, conclut-elle. Au moins vous n'êtes pas bavard. Je vais vous conduire à la classe.
Tandis que je la suis dans un long couloir qui me semble interminable, elle souffle, si bas que je ne suis pas sûr qu’elle s’adresse à moi :
— On n’est plus dans votre ghetto, ici. Deux avertissements, c’est tout ce qu’il faudra.
Sur ce, elle ouvre la porte et me pousse presque dans la salle d’un cours de mathématiques. Enfin, je crois. Un œil sur le tableau confirme mes suspicions : ma mère vient de dépenser inutilement le fruit de son labeur en m’envoyant ici. Elle ferait mieux de m’emmener avec elle apprendre ce métier qu’elle pratique, qui lui permet de rouler en Lamborghini. Je secoue la tête en allant m’asseoir au fond de la classe, sans prêter attention à la vingtaine de paires d’yeux qui me dévisagent sans essayer de dissimuler leur curiosité.
À la première pause de la matinée, je suis heureux de découvrir que la cour de ce lycée pour adolescents privilégiés offre un espace suffisant pour me perdre dans la masse. Le soleil, fainéant, pointe à peine le bout de ses premiers rayons à travers les nuages, et je me pose sur un petit muret pour en profiter.
— Eh, le nouveau !
Je tourne la tête pour voir arriver vers moi l’ensemble de la mixité sociale de ma classe, voire du lycée, venir vers moi, sous la forme d’un grand brun maigrelet d’origine visiblement maghrébine, suivi par une adolescente couleur caramel, aussi petite que ronde et plantureuse, dont le visage rond est entouré d’une auréole de cheveux frisés, épais et denses, dont je ne peux détacher mon regard.
— Moi c’est Sammy, dit le grand maigre.
— Et Lana, poursuit son amie.
Je hoche la tête en signe de salut.
— Moi c’est Adel.
— Alors, tu es qui ? Tu arrives d’où ? On a tous vu ta mère se garer sur la place handicapée ce matin pour te déposer. Entre la voiture et… ta mère, on s’est dit que tu appartenais sûrement à une famille célèbre, non ?
Sammy fait de grands gestes lorsqu’il s’exprime et Lana lui fait plusieurs fois signe de se calmer.
— Je ne crois pas, non.
— Comment ça tu ne crois pas ? Si c’est secret ou quoi, on comprend. C’est juste que tu n’avais pas l’air de te comporter comme les autres trouducs, donc on s’est dit que ce serait cool de venir discuter, c’est tout.
— Sammy, laisse-le, interrompt Lana.
Sa voix est aussi chaude que son teint. Elle poursuit calmement :
— Si tu veux qu’on te montre les deux trois trucs à savoir par ici, n’hésite pas.
Son sourire est contagieux. C’est à Sammy que je réponds en premier.
— Merci de constater que je ne suis pas un trouduc. En vrai, c’est un peu compliqué, mais je viens de perdre mon père. Et ma mère… Ma mère adoptive m’a récupéré, il y a quelques jours, mais… Je ne l’avais pas vue depuis des années alors on peut dire que je ne la connais pas très bien. Donc voilà. Tout est nouveau en ce moment. Ici, chez moi, partout. Je risque de dire des trucs bizarres de temps en temps.
Si j’en crois le silence qui s’ensuit, j’ai peut-être fourni un peu trop d’informations d’un coup, malgré l’effort que j’ai fait pour condenser et rester soft. Je ne suis pas surpris de voir Sammy reprendre la parole le premier.
— Tu es en train de nous dire que ton père est mort, et la bombe atomique de ce matin est venue te chercher en talons aiguilles, à bord de sa Lamborghini pour vivre avec elle ?
— En Uber… Mais ouais, c’est ça…
— Putain, pourquoi ce n’est pas à moi que ça arrive ?
— Sammy, ça ne va pas !
Lana lui assène une tape dans le dos et lui jette un regard acide.
— C’est bon, on peut rigoler, non ?
Il pose une main sur mon bras droit en poursuivant :
— Ça ne te vexe pas j’espère, je ne peux pas ne pas dire ce que je pense, ce n’est jamais méchant !
Ce n’est pas forcément approprié non plus, mais je garde ce commentaire pour moi.
— Pas de problème, je réponds à la place.
Et aussi facilement, au détour d’une plaisanterie sur la mort d’un père et le physique de ma mère, je me suis fait mes deux premiers amis. Sur ces vingt minutes de pause, j’apprends que Sammy est d’origine libanaise, issu d’une famille richissime, qui a choisi de s’exiler en France à cause de la situation économique et politique instable actuelle. Il en parle avec détachement, comme si son pays n’était pas en train de subir une crise qui pourrait complètement bouleverser son futur, et je crois que c’est le mode de communication par défaut de Sammy : beaucoup, avec une grosse dose d’humour, et sans tenir compte des codes sociaux attendus. Lana, elle, est la petite fille d’une célèbre chanteuse martiniquaise, décédée trop tôt, mais dont ses parents ont pu hériter. Aujourd’hui, sa famille lui met une pression de taille, pour être bonne en tout, et partout. Et comme elle n’a pas d’autre choix, Lana ne les déçoit pas, et excelle en tout. Quand elle apprend que j’ai dû cumuler un mois de cours sur la totalité de l’année dernière, un frisson la parcourt.
— Adel, comment tu vas faire ? Si tu as un bulletin avec moins de douze de moyenne, tu vas être renvoyé.
Rien que de prononcer le mot lui fait faire une grimace anxieuse, et je ne peux m’empêcher de sourire.
— La CPE m’a déjà mis sur la liste des prochains expulsés, je ne me fais aucune illusion. Ne vous attachez pas trop à moi.
— Ben voyons, plaisante Sammy, ta mère viendra à bord de sa Lamborghini te sauver de ce lycée de luxe et te trouvera un autre endroit où être nul en paix… Comme un lycée public par exemple…
— Mais Sammy, tu es fou de dire des choses comme ça ! se lamente Lana.
L’angoisse vient se dessiner dans son regard, comme si au lieu d’un établissement public, il avait parlé de m’envoyer à Guantanamo.
— Ça va, j’en reviens du public. Je suis sûr que ça ne me tuera pas d’y retourner.
Pas plus que de rater mon année, ou même de ne pas avoir mon bac, cette année ou jamais. Voilà ce que j’ai bien envie d’ajouter, mais je ne crois pas que Lana ne supporte qu’on aborde la possibilité d’un échec aux examens au milieu de sa pause du matin. Je choisis de la ménager.
— Tu sais, Lana, poursuit Sammy, tu pourrais l’aider, vu que tu as 19, 7 de moyenne en maths et que c’est son point faible.
Le regard qu’elle lui jette dit « Tiens, tu ne dis pas que des conneries, quand tu veux » et celui qu’il lui renvoie est tendre, dénué de toute note d’humour. Leur échange silencieux est terminé avant que j’aie eu le temps de finir de reprendre mon souffle, et la décision de Lana est prise. Mon opinion, si j’ai bien compris, est facultative.
— On va commencer le mercredi et le samedi après-midi, m’informe-t-elle.
— Oh… OK.
— De rien, s’écrie-t-elle, pour couvrir la sonnerie qui retentit.
Et elle se retourne pour partir vers son cours de Physique appliquée aux sciences de l’ingénierie. Nul besoin de préciser que je ne suis pas inscrit à cette matière. Sammy et moi, nous nous dirigeons ensemble vers notre cours d’espagnol à la place.
C’est là que je la croise. La plus belle fille qu’il m’ait été donné de voir depuis longtemps. Je pense qu’elle mesure un mètre soixante-dix-huit, ce qui est grand pour une fille, et à cause de ça, elle ne peut pas passer inaperçue de toute façon. Non pas qu’elle fournisse le moindre effort de discrétion. Elle se pavane, flanquée de trois petites blondes qui rient haut et fort à tout ce qu’elle dit, et elle secoue ses longues boucles rousses dans tous les sens en parlant avec agitation. Chez elle, tout est bruyant, tout est voyant, de sa beauté criarde à sa richesse étalée, mélange de bling et de chic. Et même si l’ensemble de ces qualités me font habituellement fuir, je me sens viscéralement attiré par ce grand bout de jeune femme.
— C’est qui, elle ?
Sammy hoche la tête en souriant.
— Je suis avec toi, mon frère. Aïtana Diaz est méga bonne. Mais tu peux commencer à l’oublier dès maintenant.
— J’ai juste demandé son nom…
— Oui oui, son nom, son numéro, son adresse… Tu crois que tu es le seul à vouloir faire la connaissance d’Aïtana ? De préférence de nuit, chez elle, quand ses parents sont absents ?
— N’importe quoi, tu n’as pas besoin d’en rajouter !
— J’en rajoute peut-être, chuchote Sammy en rigolant, mais je suis sérieux quand je te dis de l’oublier. Son père c’est un diplomate espagnol, je crois. Un mec vraiment important. Elle a un destin tout tracé et je peux te dire que tu n’en fais pas partie.
Je suis un peu piqué par son insinuation que je ne suis pas assez bien pour la royauté espagnole que voilà. Mais il a raison. Lorsque je lui lance un dernier coup d’œil par-dessus mon épaule, elle surprend mon regard et son discours est suspendu une seconde. Je la fixe bêtement, au lieu de sourire comme le suggère mon instinct, et les trois filles qui l’accompagnent tournent à ce moment-là tête vers moi avant d’éclater de rire en l’emmenant vers l’intérieur de la classe.
— Nous sommes des plaisanteries, pour ces filles, me traduit Sammy
Je ne me faisais pas d’illusion de toute façon. Au prochain bulletin, je serai expulsé de ce lycée comme le moins que rien que je suis. Cette pensée assombrit si bien mon humeur, que je reste semi-maussade jusqu’à la fin de la journée, que j’abrégerai de deux heures, n’y tenant plus.
Je réussis à échapper à la vigilance de cet établissement pourtant régi comme une prison, et je parcours à pied, les rues de Courbevoie, sans but précis, tentant d’échapper à mes pensées, même si c’est aussi vain que de vouloir esquiver son ombre.