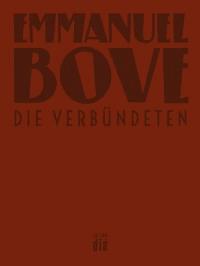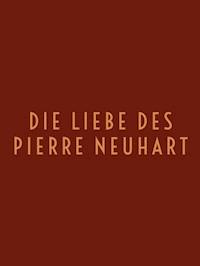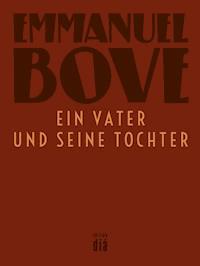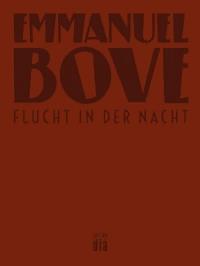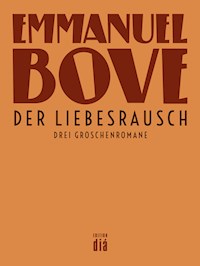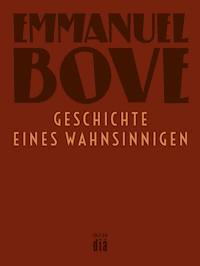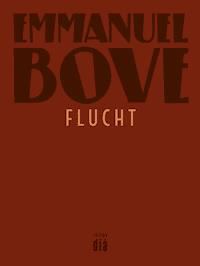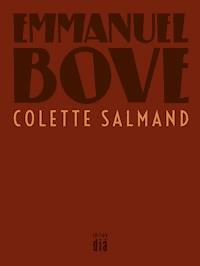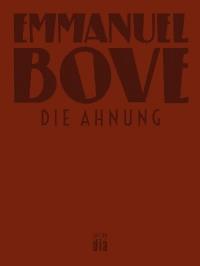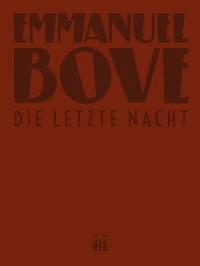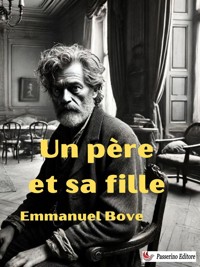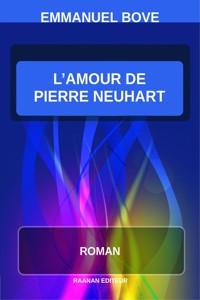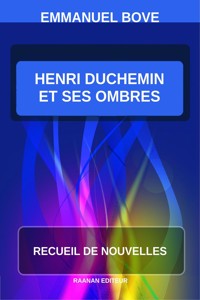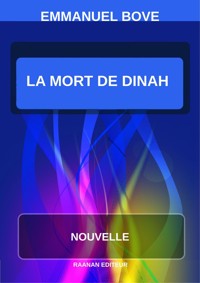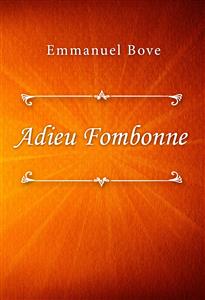
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Roman peut-être moins pessimiste mais dont les relations humaines ne sont guère décrites sous un jour très riant. Charles Digoin héros, ou anti-héros bovien, n’a guère d’envergure et brille par sa passivité si l’on excepte des épisodes d’errance. Juliette dont l’activisme tranche avec la compréhension mesurée de Simone ne sauvent pas notre espoir dans l’humanité.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Emmanuel Bove
ADIEU FOMBONNE
Copyright
First published in 1937
Copyright © 2019 Classica Libris
1
À la fin d’un après-midi humide et froid de janvier 1936, un homme de petite taille remontait la rue de la Sous-Préfecture. Il n’était pas pressé car cette rue n’est pas le plus court chemin pour se rendre de l’hôtel de Cambrai, où il venait de boire un apéritif, au chalet qu’il habitait voici bientôt cinq ans. C’était ainsi que sa femme et lui appelaient leur maison, après avoir longtemps hésité entre les mots de villa et de propriété. Il avait passé le pont de l’Oise, parcouru dans toute sa longueur la rue Félix-Faure. Place Saint-Lazare, au lieu de continuer par les rues Dupuget et Saint-Corneille, il avait obliqué à gauche de façon à gagner, en passant derrière l’église, puis sur la place du Château, le quartier dit des Avenues, de la Ville haute.
Cet homme, qui boitait légèrement, paraissait âgé d’une cinquantaine d’années. Il portait un pardessus de ratine foncée dont le grain était écrasé, dont le rembourrage des épaules avait glissé vers les manches, dont les revers, sans doute piqués sur de la sparterie de mauvaise qualité, n’avaient plus aucune raideur. Ce pardessus visiblement vieux et usé ne lui donnait cependant pas un air besogneux. Il le portait négligemment, fermé par un seul bouton, celui du haut, comme un père qui a pris au portemanteau familial un pardessus au hasard, celui d’un de ses fils par exemple. Le pantalon trop court découvrait des chaussures à tige montante. L’ensemble dénotait un certain mépris des apparences. Pourtant cet homme aux joues creuses, aux yeux vifs, à l’aspect de fonctionnaire, de médecin, de commerçant, enfin d’homme honorable dont les premières paroles ne peuvent causer aucune surprise, devait avoir pour sa personne physique des attentions assez inattendues. Cela se devinait en le regardant attentivement. Il portait une petite moustache soigneusement taillée, d’un noir trop profond pour ne pas être celui d’une teinture. Il avait le poil trop dru, le dessus des phalanges trop velu, pour que l’absence de tout duvet aux narines, aux oreilles, entre les sourcils, ne fût pas la conséquence de soins régulièrement répétés.
Un léger brouillard, venu de la forêt proche, s’aventurait dans les rues désertes. Les maisons, les réverbères le gênaient. Il se déchirait sans raison, car il n’y avait aucun vent, passait par-dessus les murs ainsi qu’une fumée de train.
L’homme arriva bientôt à la hauteur du haras. Il ralentit, jeta son habituel regard respectueux et étonné sur la cour d’honneur, sur les écuries, sur le parc au milieu duquel se dressait l’habitation du directeur, le comte de Villefossé. Le rez-de-chaussée était éclairé. Devant l’économat, on apercevait trois voitures de fourrage. Les haras ne sont pas des établissements qui semblent, comme tant d’autres, à l’abandon et où l’activité ne reprend que sur une injonction venue de l’extérieur. Le matin même, les chevaux avaient fait leur promenade quotidienne. Ce n’était pas les imposantes écuries, ni les employés pleins de la fierté de ceux qu’on protège en haut lieu, ni les étalons pourtant superbes, ni l’hôtel du XVIIIe servant de demeure au directeur, qui attiraient ce regard si particulier. C’était l’Administration générale des haras pour tout ce qu’elle laisse deviner de fermé, de rigide dans ses statuts, de sévère dans le choix du personnel.
L’homme prit la rue Léon-Jacquet (c’est le nom d’un conseiller municipal fusillé par les Allemands en 1914), puis l’avenue Royale. Cette avenue, bordée d’un côté par le champ de courses sur lequel, entre les pistes et les haies, un golf a été aménagé, de l’autre par d’opulentes propriétés, est plantée de quatre rangées d’arbres. Elle prend fin huit cents mètres plus loin, brusquement, ainsi qu’une perspective de château, dans la forêt même. L’humidité était telle ce soir-là, qu’on eût dit qu’il pleuvait dans les arbres et dans les taillis. Au milieu de ce crépitement monotone qui faisait penser à celui du dégel, des cris bizarres d’oiseaux ou d’animaux retentissaient, tantôt comme des appels déchirants, tantôt comme des exclamations grotesques, tantôt encore, parce qu’ils se répétaient plusieurs fois de suite d’une manière identique, comme des bruits de machine. Au-dessus de la vaste clairière formée par le champ de courses, le brouillard était à la fois plus épais et plus lumineux. L’homme suivit d’abord l’allée de droite que coupait, de distance en distance, une barrière blanche où juste le passage d’une personne était ménagé, puis il traversa la voie latérale séparant cette allée des propriétés. Il longea les grilles. Certaines étaient symboliques mais d’autres étaient de véritables défenses de plusieurs mètres de haut se terminant par des piques. De temps en temps, un chien aboyait, une sonnette tintait très loin de celui qui l’avait tirée. Le trajet que le visiteur aurait à faire avant d’atteindre le perron se présentait à l’esprit. Il ne se présentait que des pensées de ce genre à l’esprit. Malgré le froid et l’humidité, l’homme marchait moins vite maintenant. Cette avenue sauvage, à peine éclairée par quelques lampadaires, ces propriétés dédaigneuses, parce qu’en retrait, faisaient sur lui grande impression. Soudain, de très loin, un faisceau de lumière surgit dans le brouillard. C’était une auto. L’homme s’arrêta. Il aimait à regarder ces lumières qui dansaient sur les arbres, qui surprenaient toute une vie nocturne. Comme il repartait, l’auto tourna et emprunta la rue latérale. Un instant il fut aveuglé, puis il perçut le bruit qui lui était devenu familier tant il se répétait souvent à Fombonne-sur-Oise, d’un coup de frein brusque.
— Monsieur Digoin, monsieur Digoin, cria-t-on presque aussitôt.
Il revint sur ses pas, s’approcha de la voiture.
— Comment allez-vous, monsieur Digoin ? On vous surprend dans les avenues !
Le conducteur de la voiture était un lieutenant de spahi, le lieutenant de la Motte. Il était accompagné d’un autre officier et d’une femme que Charles Digoin n’avait jamais vus. Tous trois étaient assis sur la banquette avant, les bras passés par-dessus les épaules.
— Si vous voulez profiter de la voiture, monsieur Digoin, elle est à votre disposition. Vous voyez, il y a de la place derrière. Vous ne nous dérangerez pas.
Digoin refusa. Et il s’éloigna sans songer à ce que cette offre avait d’imprévu de la part d’un officier qu’il connaissait à peine, qu’il ne saluait que par intermittence, quand il le rencontrait en ville, sans soupçonner qu’il avait déçu cet officier si fier, parce qu’il avait peut-être un peu bu, de paraître avoir des amis partout, même le soir, dans les Avenues.
Quelques instants plus tard, Charles Digoin s’arrêta devant le cercle. Celui-ci était en vérité la principale raison de ce détour. Il n’y avait pourtant rien à voir hors une grande maison obscure à campaniles. Seules des voitures rangées dans le jardin, à la droite d’une plate-bande fraîchement bêchée, ornée d’une grotte de pierre rose, comme rongée par l’océan, et une lumière sous la marquise du perron, aussi humble qu’un rayon sous une porte, indiquaient qu’il y avait du monde. À gauche, un sentier conduisait à une tonnelle juchée au sommet d’une petite tour. Personne ne la remarquait plus, si bien qu’un jour de course au trésor, le comte de Ville-fossé justement, qui était rusé, y avait caché l’enveloppe contenant le trésor. Deux énormes pierres coniques encadraient la seule entrée ouverte pendant la mauvaise saison. On eût dit des menhirs sous les grands arbres, dans cette humidité druidique. Digoin demeura immobile entre ces blocs, le regard fixé sur la façade. Ce n’était plus le regard respectueux et intrigué de tout à l’heure, mais celui d’un promeneur qui en regardant ce que beaucoup de gens ont admiré avant lui, confronte ce qu’il a entendu dire et ce qu’il ressent. Puis il se remit en route. Il était presque arrivé. Il n’avait plus qu’à monter la rue de Gommery. Soudain, comme il traversait la rue Lord-Buxley, il aperçut un jeune homme qui se dirigeait vers lui. La silhouette était élégante, mais d’une élégance nouvelle : des épaules trop larges, des bas de pantalon trop larges également, le cou trop dégagé, un pardessus à ceinture de tissu, trop serré à la taille. « Eh ! bien, vous ne me reconnaissez plus ? » dit un instant après ce jeune homme en s’arrêtant devant Charles Digoin.
2
Il y avait en 1900, à Drugny, ville de dix-sept mille habitants, située entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, une agence de location que tenait Monsieur Digoin père. Elle était à deux pas de la gare, dans une ruelle qui avait ceci de pittoresque que sur sa plus grande partie elle était creusée d’une sorte de tranchée où prenaient jour les sous-sols des maisons. Des enfants s’accrochaient aux balustrades. La rue Mège était la plus commerçante et la plus populeuse de la ville. L’agence se trouvait au premier étage d’une maison ancienne mais sans style. Devant, sur le trottoir, des panneaux légers, auxquels le vent faisait faire parfois quelques pas comme sur des échasses, représentaient Bruges, le Mont-d’Or, Lisieux. L’agence de location était aussi une agence de voyage. Le porche et l’escalier avaient toujours été encombrés de sculptures, de bas-reliefs dont jamais personne n’avait pu dire la provenance. De nombreuses affiches, pour la plupart jaunes et vertes, étaient fixées, souvent les unes sur les autres, au mur du palier. C’étaient des affiches de ventes immobilières, de saisies, presque toutes datant de loin et ne demeurant là que pour attester une grande activité. Ce n’était pas tout. Suspendus à des clous, des écriteaux donnaient chacun un renseignement différent. L’agence fermait entre midi et deux heures. En cas d’urgence, on pouvait téléphoner au 7, à Cottereaux. Il ne fallait pas frapper avant d’entrer. La maison était de confiance. Elle n’avait pour ambition que satisfaire sa clientèle. Le goût de la publicité qui perçait timidement sous ces panneaux, affiches et indications, n’avait pas nui à l’agence. Elle était considérée comme la plus sérieuse de la ville. Elle comptait dans sa clientèle les châtelains des environs, les riches commerçants, les gros propriétaires de vignobles. Ils venaient souvent causer affaires avec Monsieur Théodore Digoin. Ils le regardaient avec une pointe de curiosité. Monsieur Digoin, grâce à sa situation, ne connaissait-il pas les projets d’un ennemi, les exigences d’un rival dont ils projetaient d’acheter un bien ? Et ils avaient toujours, pendant ces entretiens, l’attitude à la fois respectueuse et condescendante que nous avons devant les professions indispensables que nous ne voudrions pas exercer.
Monsieur Digoin n’habitait ni au-dessus, ni au-dessous de son agence. Il avait gardé la vieille maison qu’il avait héritée de son père. Elle se trouvait à un kilomètre cinq cents de Drugny, sur la route nationale, entre la voie ferrée et la Saône. Elle était entourée de trois hectares de terre répartis en potager, cour, vignes et champs. Ceux-ci, loués à un voisin, rapportaient quarante francs par an. C’était dans cette grande maison délabrée dont Monsieur Digoin disait qu’elle n’avait besoin que d’être ravalée, que Charles avait grandi. Les souvenirs auxquels nous tenons le plus sont ceux des premiers lieux où nous avons été livrés à nous-mêmes. Ces lieux n’étaient pas, pour le jeune Digoin, des squares, ni des rues, ni la place plantée de platanes d’une charmante ville de province, mais la campagne avec ses chemins creux, ses sous-bois, ses cachettes et son espace. À quatre heures, quand il rentrait chercher son morceau de pain et sa tablette de chocolat couverte de médailles, dans cette maison où l’eau coulait sur les murs, à cause d’un phénomène de condensation disait son père, il tombait dans une tristesse sans borne. Le perron surmonté d’une armature de marquise, la double porte d’entrée avec ses vitraux de couleur, le salon à gauche, la salle à manger à droite, la véranda dans le fond, dont la toiture de verre laissait passer la pluie si bien qu’on était obligé de disposer un peu partout des bols, des cuvettes, des brocs, tout cela respirait la misère des soucis domestiques. Plus tard, ce fut le collège, les devoirs, et ce qui était pire, les conversations au sujet de l’avenir du jeune homme. On les tenait devant lui. On exigeait même qu’il y prît part. « Si ton désir est de devenir avocat (il n’avait jamais manifesté un pareil désir), il faut que tu travailles. Nous voulons bien faire des sacrifices pour toi, mais mérite-les au moins. Ton père a bien du mal. Si tu devais échouer à tes examens, il vaudrait mieux que tu le dises tout de suite. » Des parents venaient parfois de la campagne admirer le jeune prodige. Il devait répondre aux questions, parler des familles de ses camarades, faire étalage de ses connaissances. Le père, en homme à qui la chance n’a pas tourné la tête, écoutait tout cela avec ravissement. Il ne se doutait pas alors que deux ans plus tard son fils échouerait au baccalauréat. Quand il apprit la mauvaise nouvelle, il fit preuve de courage. Il avait été sévère jusque-là. Jamais son fils ne travaillait assez. Il lui avait prédit les pires malheurs s’il manquait cet examen. Du jour au lendemain, il redevint le père affectueux de jadis. Il rendit responsable de l’échec les professeurs, les camarades, tout le monde sauf son fils. Puis il décida que Charles le seconderait. Cela dura jusqu’au conseil de révision. Après trois mois de service, le jeune homme fut réformé. Il n’avait aucune maladie particulière mais il était, comme on dit, délicat. Un changement d’air et de régime avait suffi à lui donner une dysenterie qui n’avait pas tardé à devenir chronique.
Pendant l’absence de son fils, Monsieur Digoin avait reçu la visite du directeur d’une banque parisienne, Monsieur Peyroutet. Celui-ci avait été informé par un de ses amis qu’un certain Monsieur de Vaugrigneuse cherchait acquéreur, ce fut l’expression que cet ami employa, pour son château. De grandes amitiés avec des personnages importants embellissaient périodiquement la vie de Monsieur Digoin. Elles avaient toujours le même point de départ. Quand il discernait chez un visiteur une situation sociale supérieure à celle de ses clients habituels, il montrait une complaisance et un dévouement surprenants. On eût dit alors qu’il défendait ses propres intérêts. Il ne demandait aucune commission, se chargeait d’enquêtes inutiles, prévoyait des difficultés qu’il écartait. Une façon aussi anormale d’agir n’étonnait pourtant jamais ceux qui en bénéficiaient et lorsque les relations d’affaires prenaient fin, il était bien rare qu’il n’en naquît pas d’amicales.
C’est pourquoi, au retour de son fils, Monsieur Digoin eut l’idée de demander à Monsieur Peyroutet s’il n’entrevoyait pas la possibilité, un jour, de faire entrer le jeune homme dans sa banque. Mais il y avait une difficulté. Une telle demande ne donnerait-elle pas à penser que le désintéressement de Monsieur Digoin avait été calculé ? Il garda le silence plusieurs mois. Lorsque Monsieur Peyroutet venait à Drugny, Monsieur Digoin s’arrangeait pour mettre la conversation sur son fils, mais chaque fois il n’osait faire plus. Finalement il se décida à parler. Il se rendit exprès à Paris, au lieu de profiter d’un voyage de Monsieur Peyroutet, ce qui lui semblait indélicat, après avoir écrit pour annoncer son arrivée, en donnant à sa démarche toute l’ampleur possible. Puisqu’il demandait un service, il lui paraissait plus noble d’en exagérer l’importance que de chercher, comme il avait fait jusque-là, à la diminuer.