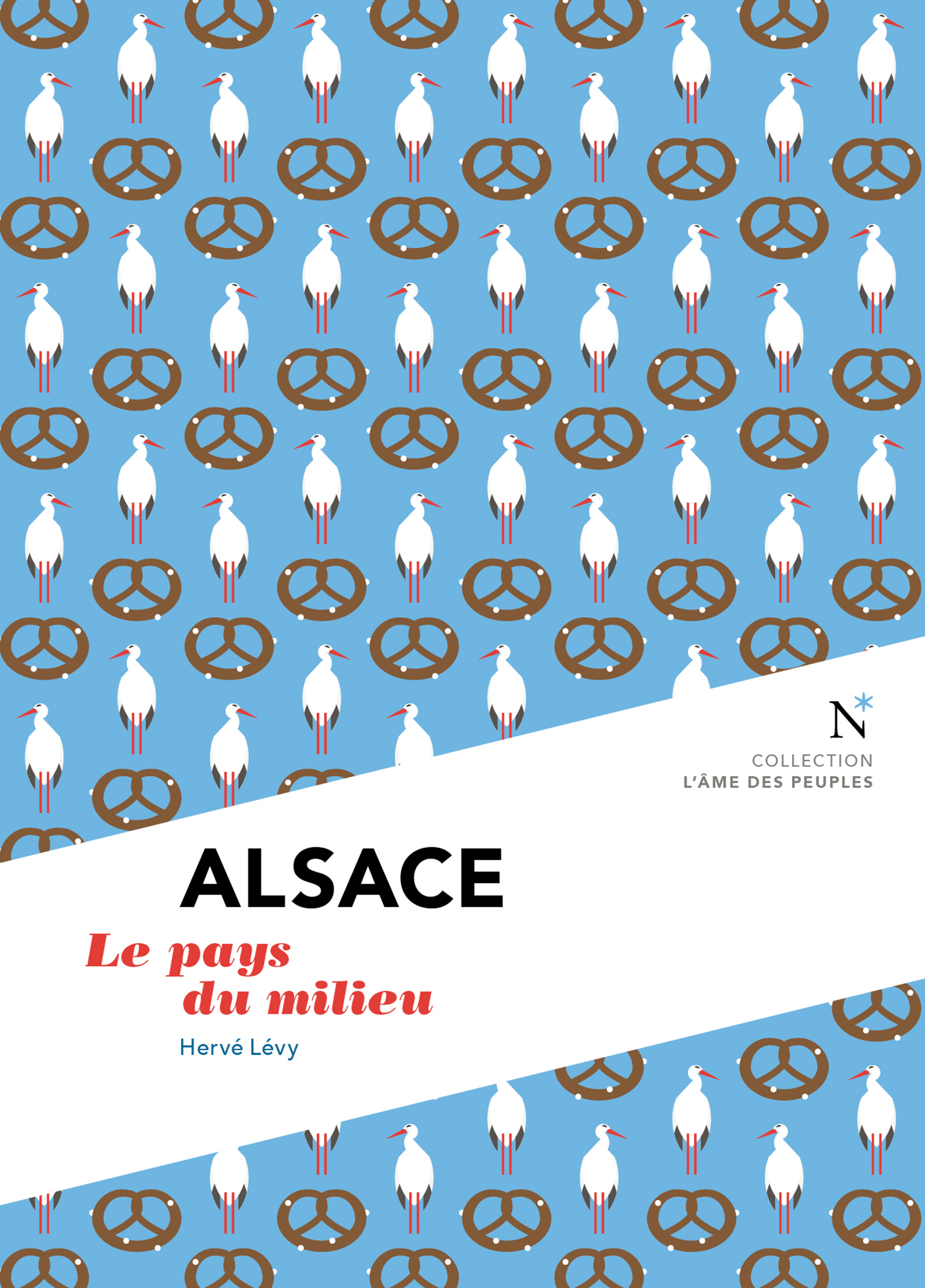
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’Alsace est un déchirement. Ou plutôt un trait d’union. Tout au long de son histoire, cette région tiraillée entre France et Allemagne a souffert des grandes fractures européennes et célébré l’unité du continent par sa culture, sa joie de vivre et l’ambition de Strasbourg, sa capitale. L’Alsace, dont les cabaretiers ont toujours rythmé la vie publique, est d’abord une volonté : celle de ses habitants d’affirmer, envers et contre tous, leur identité métisse et pourtant si française.
Ce pays du milieu dit la France, car elle est sa fenêtre sur l’autre Europe : protestante, germanique, dure au mal, où la rigueur du climat cesse lorsque s’ouvrent les portes des winstubs. Elle dit aussi le vieux continent, dont elle porte les blessures.
Ce petit livre n’est pas un guide, même s’il promène le lecteur au fil des contreforts alsaciens, jusque dans ses typiques marchés de Noël ! Il dit l’âme de l’Alsace et celle des Alsaciens. Parce que pour comprendre ce peuple-là, romantique et taiseux, il faut d’abord apprendre à l’écouter.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Hervé Levy est journaliste, écrivain et conteur, passionné par sa région, qu’il estime aujourd’hui en quête d’identité dans le « Grand Est » français dans lequel peu se retrouvent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
L’ÂME DES PEUPLES
Une collection dirigée par Richard Werly
Signés par des journalistes ou écrivains de renom, fins connaisseurs des pays, métropoles et régions sur lesquels ils ont choisi d’écrire, les livres de la collection L’âme des peuples ouvrent grandes les portes de l’histoire, des cultures, des religions et des réalités socio-économiques que les guides touristiques ne font qu’entrouvrir.
Ponctués d’entretiens avec de grands intellectuels rencontrés sur place, ces riches récits de voyage se veulent le compagnon idéal du lecteur désireux de dépasser les clichés et de se faire une idée juste des destinations visitées. Une rencontre littéraire intime, enrichissante et remplie d’informations inédites.
Précédemment basé à Bruxelles, Genève, Tokyo et Bangkok, Richard Werly est le correspondant permanent à Paris et Bruxelles du quotidien suisse Le Temps.
Retrouvez et suivez L’âme des peuples sur
www.amedespeuples.com – (âme des peuples)
(@amedespeuples) – (amedespeuples)
Carte
AVANT-PROPOS Pourquoi l’Alsace ?
Lorsque je pense à l’âme de l’Alsace, revient à ma mémoire la destinée de mon grand-père, disparu à plus de cent ans, dans le tourbillon du siècle. Alfred Lévy, né Allemand en 1913, avait appris la langue de Molière avec la cravache des hussards noirs de la République. Perdu sur les bords du Rhin, dans un inutile fort de la Ligne Maginot pendant la Drôle de Guerre, il était redevenu Allemand malgré lui en 1940, dans une Alsace annexée au Reich, soumise à l’impitoyable normalisation d’un idiome manipulé par la propagande, la LTI (Lingua Tertii Imperii)1 que décrivit si bien le philologue Victor Klemperer2.
Redevenu Français pour la seconde fois en 1945, il avait découvert, après ces années de cendre, stupéfait dans un premier temps, puis heureux, que les deux voisins, réputés irréconciliables, pouvaient être à l’origine d’un espace de paix sur le continent. Et pendant tout ce temps, il avait continué à parler en dialecte alsacien avec les siens…
« Sommes-nous les Allemands de la France ? Ou bien les Français de l’Allemagne ? » Posée par Tomi Ungerer3, cette question un brin ironique résume les interrogations existentielles souvent doloristes – l’Alsacien a vite fait de se considérer comme un oublié, voire un incompris – qui agitèrent la vie intellectuelle au cours du vingtième siècle dans la région. La réponse de l’auteur des Trois Brigands est une pirouette, peut-être un peu facile, mais elle vaut mieux que des centaines de pages de psychanalyse de winstub, sport par trop pratiqué sous nos latitudes. « Notre identité caméléonesque prend toutes les couleurs et les formes possibles. » Née d’un jeu dialectique permanent entre histoire et géographie, France et Allemagne, l’âme alsacienne qui s’est forgée au fil des siècles se moque en effet des frontières et des identités, les intègre pour mieux les dépasser. C’est en cela, et en cela seulement, que Strasbourg peut être considérée comme une capitale européenne.
L’Alsacien grappille ainsi les stéréotypes des deux côtés du Rhin. On le dit sérieux et travailleur comme un Allemand. Sa convivialité et son art de vivre, eux, sont éminemment français. La région ressemble à une île posée au point exact où se rencontrent les océans latin et germain.
Voilà pour le constat. Mais qu’est ce « Beau jardin » – pour reprendre l’expression attribuée à Louis XIV – devenu ? Aujourd’hui, la modernité semble avoir normalisé la région. Strasbourg et Mulhouse, ses deux grands pôles, sont devenues des villes comme les autres, alignements d’enseignes que l’on retrouve de Lille à Marseille, de Rennes à Lyon, tandis que leurs entrées ont la laideur des zones commerciales mitées de banlieues pavillonnaires ou de grands ensembles. Envahi par des champs de maïs dont la surface semble croître de manière exponentielle remplaçant la structure agricole traditionnelle, le reste de la région aligne des villages où un folklore made in China, fait de cigognes en peluche ou de poteries de mauvaise qualité, a pris ses aises.
Au fil des siècles, s’est néanmoins forgée une identité forte, puisant ses racines dans un passé complexe, une identité éloignée du folklore de pacotille oscillant entre pathétique et ridicule des fêtes de village que l’on sert aux touristes l’été venu, une identité qui permet de lutter contre l’uniformisation imposée par la modernité triomphante.
Cette identité, cette âme, on peut l’appeler comme on le souhaite, n’est cependant pas fermeture, comme certains pisse-vinaigre font mine de le croire. Elle ne recrée pas de nouvelles frontières, mais transcende les anciennes, permettant à chacun, d’où qu’il vienne, d’en devenir une partie constitutive.
Écrivain brillant, un brin sulfureux, fou de musique, le très oublié Marcel Schneider (1913-2009) évoqua avec élégance cette « possibilité de l’Alsace » ouverte à tous dans L’Apparition de la rose4. « Au hasard d’un voyage en Alsace, pays où je n’étais jamais allé et qui m’apparaissait aussi légendaire que la Courlande ou la Dalécarlie, je découvris au fond de la vallée de Munster, au pied même du Petit Ballon, le village dont je portais en moi l’image pour l’avoir vue en rêve. (…) Je me dis que j’étais arrivé, que j’étais enfin chez moi. »
Les quelques pages qui suivent sont une invitation au voyage « chez moi », une Alsace si bien décrite par le poète Jean-Paul de Dadelsen : « Pays du milieu, pays façonné par le légionnaire romain et le moine missionnaire irlandais, pays où les Bibles familiales gardent la trace d’aïeules ukrainiennes, polonaises, souabes, grisonnes, piémontaises, franc-comtoises, flamandes, pays qui se souvient des grands-ducs d’Occident et de Napoléon, pays qui a semé de jeunes morts la Palestine et les Allemagnes, l’Égypte et le Mexique, l’Indochine et toutes les Russies. Pays du général Rapp, aide de camp de l’empereur. Pays de Kléber. Pays d’Albert Schweitzer. Par sa vitalité, sa solidité, sa lourdeur, ses lits à hauts édredons rouges, carrefour de tous les rangs d’Europe, pays fait pour durer. »5
1 « Langue du IIIe Reich », novlangue nazie utilisée comme moyen de propagande.
2 Écrivain et universitaire allemand d’origine juive (1881-1960), auteur de LTI, la langue du IIIeReich.
3 Peintre, dessinateur, caricaturiste, sculpteur, affichiste, écrivain alsacien (1931-2019), célèbre dans le monde entier pour ses albums jeunesse (Les trois brigands, Jean de la lune, le Géant de Zéralda…).
4 Éd. Balland, coll. L’instant romanesque, 1980.
5 Extrait de Goethe en Alsace.
Le pays du milieu
Sur une carte, l’Alsace a la semblance d’un corridor orienté nord-sud encadré par le Rhin et les Vosges, deux limites géographiques, mais également deux éléments consubstantiels à sa destinée.
À l’est, l’eau, ce « noble fleuve, féodal, républicain, impérial, digne d’être à la fois français et allemand. Il y a toute l’histoire de l’Europe (…) dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l’Allemagne », écrivait Victor Hugo1.
En se promenant sur ses bords, quelques indices sur les contours de l’âme de l’Alsace affleurent déjà : derrière la rectitude des rives canalisées, se dévoile en effet un système hydrographique plus complexe, incertain, parfois mystérieux où se rencontrent bras morts et marécages comme dans le Grand Ried2. Entre Erstein et Marckolsheim alternent en effet prairies inondables et forêts alluviales primitives. Au printemps et à l’été, c’est un fourmillement de vies minuscules et de floraisons exubérantes qui justifient le surnom d’Amazonie du Rhin, très éloigné de la rigueur qu’on accole généralement à la région.
À l’ouest, l’épine vosgienne. Pas des pics enneigés et effilés, mais un massif aux formes délicatement arrondies – pour certains, une « montagne à vaches » – buriné par les glaciers du quaternaire, culminant à 1 424 m d’altitude au Grand Ballon. S’y découvre une vue à 360° à couper le souffle : par beau temps, le regard porte jusqu’aux Alpes dont la dentelure blanche est aisément lisible, du massif du Mont-Blanc à la Jungfrau ou l’Eiger3.
Marquant souvent, au cours des siècles passés, la frontière entre France et Allemagne, cette « ligne bleue » est devenue un cliché né sous la plume de Jules Ferry, natif de Saint-Dié, qui stipula dans son testament : « Je désire reposer dans la même tombe que mon père et ma sœur, en face de cette ligne bleue des Vosges d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la plainte des vaincus ».
Entre ces deux bornes se trouve l’espace communément appelé Alsace, dont l’étymologie renvoie vraisemblablement à sa géographie, même si les origines d’un nom apparu au septième siècle demeurent incertaines. Pour certains, il signifierait le peuple habitant au pied de la falaise (les Vosges), tandis que d’autres prétendent qu’il désigne la terre de ceux qui vivent sur les bords de l’Ill. Ces deux hypothèses ne réussissant néanmoins pas à dissiper les brumes d’un épais mystère sémantique.
Une région Janus
Dans l’inconscient collectif, l’Alsace est une « région Janus » regardant à la fois vers la France et vers l’Allemagne. En se promenant dans Strasbourg, on découvre que ce dieu romain en est une parfaite incarnation avec une fontaine installée en 1988, dessinée par Tomi Ungerer.
Il suffit de faire quelques pas pour apercevoir une autre statue incarnant le versant tragique de l’identité alsacienne. Sur la place de la République se trouve un monument aux morts élevé en 1936, signé Léon-Ernest Drivier : une jeune femme éplorée tient ses deux fils morts dans ses bras, une mère alsacienne pleurant ses enfants tombés pendant la Première Guerre mondiale, le premier pour la France, le second pour l’Allemagne. Héritage d’une histoire souvent tourmentée, cette dualité irrigue encore la vie quotidienne des habitants sans que, bien souvent, ils en soient conscients.
En vigueur uniquement en Alsace-Moselle, un droit local est encore en application, corpus législatif composite en usage au moment de l’Armistice de 1918, rassemblant notamment des textes du droit allemand spécifiques aux territoires annexés en 1871, et des dispositions du droit français antérieures à cette date, comme le Concordat. Il couvre certains aspects liés aux associations, aux cultes, à la chasse, à la sécurité sociale qui connaît un régime spécial, etc. Un exemple concret ? L’Alsace possède deux jours fériés de plus que le reste de l’Hexagone : le Vendredi saint et la Saint-Étienne (26 décembre).
Alors Premier consul, Bonaparte avait signé un concordat avec le pape Pie VII, le 15 juillet 1801, afin de rétablir la paix religieuse. Il a été abrogé en 1905 par la loi de séparation des Églises et de l’État, mais est demeuré en vigueur en Alsace et en Moselle qui, à cette date, n’étaient pas françaises, si bien que les ministres des quatre cultes reconnus dans ce cadre (catholique, luthérien, réformé et juif) sont, par exemple, salariés par l’État, tandis que les évêques de Metz et Strasbourg se voient nommés par décret du président de la République, après accord du Saint-Siège.
Pays de l’entre-deux, l’Alsace voit encore ses identités germanique et latine profondément enchâssées dans son ADN depuis des générations. Il suffit de se souvenir des mots de Victor Hugo : « Son profil, dont toutes les lignes étaient arrondies sans cesser d’être fermes, avait cette douceur germanique qui a pénétré dans la physionomie française par l’Alsace et la Lorraine ».4 Et Alfred de Musset de renchérir, évoquant les charmantes filles, « pleines à la fois de la langueur germanique et de la vivacité française »5. Assertions charmantes dont la légèreté ne peut dissimuler une part de véracité.





























