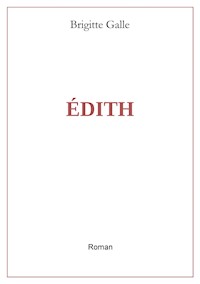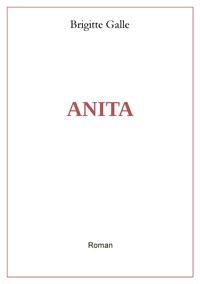
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je m'appelle Anita. J'ai 20 ans. Je vis à Rome. Oui, je suis italienne. Ma famille est une famille comme on en trouve classiquement en Europe. J'ai un frère, une oeur et des grands-parents aimants. Pourtant, ma peau est foncée, mes cheveux sont raides comme des baguettes et je suis arrivée bébé, par avion, dans les bras de mon père et de ma mère. À l'aéroport tous étaient heureux d'accueillir une progéniture si attendue. Vous l'avez deviné, j'ai été adoptée. Je suis heureuse dans ma famille. Pourtant, mes études sur l'anatomie du corps m'ont bousculée. D'où est-ce que je viens ? Je ne suis pas née de mes parents italiens. Qui sont mes parents géniteurs ? Mes premiers jours se sont passés à Bénarès, dans la ville sainte de l'Inde profonde. J'ai besoin de connaître cette ville. Je dois y retourner. Je dois retrouver ma mère indienne et peut-être aussi mon père. Je vous raconte mon voyage. Venez avec moi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
En route vers... Éditions Brumerge, 2013 ;
Rita, Éditions Brumerge, 2019 ;
Ismaël, Éditions Brumerge, 2020 ;
Édith, BoD, 2023 ;
Hicham, TheBookEdition, 2023.
Je tiens à remercier Marie-Joseph HP pour sa patience. Elle est une précieuse collaboratrice.
Sommaire
chapitre 1
chapitre 2
chapitre 3
chapitre 4
chapitre 5
chapitre 6
chapitre 7
chapitre 8
chapitre 9
chapitre 10
chapitre 11
chapitre 12
chapitre 13
chapitre 14
chapitre 15
chapitre 16
chapitre 17
chapitre 18
chapitre 19
chapitre 20
chapitre 21
chapitre 22
chapitre 23
chapitre 24
chapitre 25
chapitre 26
chapitre 27
chapitre 28
chapitre 29
chapitre 30
chapitre 31
chapitre 32
chapitre 33
chapitre 34
chapitre 35
chapitre 36
chapitre 37
chapitre 38
chapitre 39
chapitre 40
chapitre 41
1
Je m'appelle Anita. Je vis à Rome. Une des plus belles villes au monde. Oui, messieurs, mesdames les Français, plus belle ville au monde avec Paris.
J'ai vingt ans. Mon père est propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter. Il emploie une dizaine de vendeurs et vendeuses. Cela vous donne une idée de la taille du magasin. Ma mère est pharmacienne de formation, mais elle a décidé de se consacrer à sa famille.
Mais ça n'est pas ce qui m'amène vers vous.
Ah ! J'oubliais de vous dire, j'ai un petit frère et une sœur adolescente.
L'autre jour, Julio, mon petit frère de six ans, est arrivé en pleurant. À l'école, ses camarades l'ont traité de visage calciné. D'autres se sont moqués de ses lèvres épaisses, sans compter ceux qui ont ri de ses cheveux crépus. J'ai connu cela alors que j'étais enfant. La moquerie des enfants n'a pas de limites, lorsque nous sommes différents.
Ma sœur Nella est différente, elle aussi. Elle est porteuse d'un chromosome en plus. Pudiquement nous disons qu'elle a une trisomie 21.
Oui, nous sommes une famille classique, papa travaille, maman s'occupe de ses enfants. Elle aide parfois son mari. Mais nous sommes différents des familles italiennes. Nous avons été adoptés.
Je suis née à Varanasi, en Inde, appelée aussi Bénarès. Mon petit frère est né à Dakar, au Sénégal, et Nella dans une maternité de Venise, née sous X.
Nella est la seule d'entre nous qui a la peau blanche, comme nos parents.
Ma mère est belle. Elle est blonde, ses yeux sont bleus, parfois verts, selon le temps ou son humeur.
Mon père est digne d'un bon Italien. Ses yeux sont noirs, sa peau claire et ses cheveux sont châtain très foncé.
Et moi, comme vous pouvez vous en douter, je suis une jolie petite Indienne. Ma peau est foncée, mes cheveux raides comme des cannes de bambou, noirs comme les corbeaux qui tournent autour de la basilique Saint-Pierre.
Je suis arrivée à Rome à l'âge de quatorze mois. Mes grands-parents maternels étaient à l'aéroport, venus pour m'accueillir. Notre avion en provenance de Delhi avait du retard. Mes parents étaient venus me chercher dans un orphelinat indien. Ils avaient dû faire plusieurs voyages avant de pouvoir me ramener avec eux. Quel orphelinat ? Je ne sais pas. Je sais simplement que nous nous sommes retrouvés tous les trois, à Rome, à l'aéroport, devant mes grands-parents maternels. Ils avaient les yeux brillants de bonheur face à leur progéniture venue d'Asie.
Mes grands-parents paternels n'avaient pas pu venir, avaient-ils dit. Les années ont défilé jusqu'à mes vingt ans, ils n'ont pas trouvé le temps de nous rendre visite. Les réunions de famille se sont souvent passées sans eux, surtout lorsque Julio est arrivé du Sénégal.
Un après-midi, alors que ma grand-mère paternelle, en mal de réconfort à la suite du décès de son mari, mon grand-père, est venue nous rendre visite, j'ai surpris une conversation téléphonique, entre elle et une de ses amies :
« Ça n'est pas vraiment mes petits-enfants, Jorgetta, » disait-elle. « Mon fils est beau comme une de nos statues romaines. Je me retrouve avec ces petits noirs, venus de je ne sais où, sans compter cette débile, trouvée dans une pouponnière. Non, je te le dis Jorgetta, il est hors de question que mon fils m'impose ces minots. C'est la faute de ma belle-fille, c'est elle qui est stérile. S'il avait épousé la fille du juge, comme je lui avais demandé, on n'en serait pas là... Oui... Oui, tu as raison... Je te remercie Jorgetta. Tu sais, je souffre beaucoup. Quand je pense qu'ils portent le nom de famille de mon tendre mari. Une famille d'aristocrates qui se retrouve avec des noirs et une mongolienne... Merci Jorgetta pour ton soutien... Oui c'est très difficile. Mais que veux-tu que je fasse ? C'est mon fils, mon unique fils... Qui va s'occuper de moi quand je serai vieille ? »
Ma grand-mère paternelle avait téléphoné à son amie Jorgetta, alors qu'elle pensait être seule. Tous étaient assoupis dans une lourde sieste, sauf moi. Je m'étais réfugiée dans la cuisine, en quête d'une boisson fraîche qui allait faire fuir la chaleur de mon corps, en ce mois d'août.
« Mais de qui parle-t-elle ? ». Je n'avais qu'une dizaine d'années. Je pensais qu'elle avait peut-être des petits-enfants que je ne connaissais pas. Pourquoi parlait-elle de noirs et de débile ?
Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre, ou plutôt pour admettre, qu'elle parlait de nous. L'amour inconditionnel de mes parents pour nous trois, n'était pas partagé par tous les membres de notre tribu.
Mes grands-parents maternels ont toujours été débordants d'amour. Nous avons ainsi pu jouir de magnifiques fêtes de Noël et d'une flopée de cadeaux pour nos anniversaires.
J'ai 20 ans. J'ai entrepris de brillantes études de médecine. Je réussis avec brio. Je suis également douée pour les langues. Je parle l’anglais et le français, en plus de l'italien, ma langue natale.
Pourtant, un vide abyssal s'est installé tout au fond de mon être. Mon cœur est rempli de l'amour de ma famille, mais il y a une interrogation qui m'obsède à longueur de journée. Mes pensées tournent en rond, sans trouver d'issue.
Pourquoi ne suis-je pas en Inde, aujourd'hui, avec mes parents indiens ?
Je suis une enfant adoptée. Où est ma génitrice, ma mère biologique ? Qui est mon géniteur ?
Je refuse d'appeler mes géniteurs, « mes vrais parents ». Mes vrais parents sont ces êtres attentionnés qui m'ont élevée.
Comme beaucoup d'enfants adoptés, j'ai besoin de connaître le mystère de mon incarnation.
2
Aujourd'hui, je rejoins ma fidèle amie Lucia. Nous nous retrouvons régulièrement, en fin de journée ou durant le week-end. Nous nous sommes rencontrées sur les bancs de l'école. Nous avions six ou sept ans.
Lucia est belle. Elle est grande. Elle a le teint clair et de longs cheveux cendrés. Je suis de petite taille. Mes cheveux sont raides et noirs. Ma peau est caramel. Nous sommes très différentes, mais nos cœurs battent à l'unisson. Nous n'avons pas de secrets l'une pour l'autre.
Nous suivons les mêmes études. Nous avons choisi un cursus scientifique. Encore un point commun qui nous permet d'avancer à l'unisson. Nous avons idée de devenir médecins. Nous choisirons notre spécialité plus tard. Lucia envisage d'être oncologue. Je ne sais pas encore ce que je choisirai.
Nous aimons nous retrouver au centre de Rome, sur la place Navona, dans un petit café typiquement romain.
Je suis un peu en avance. J'aime être seule, attablée à une petite table ronde. J'aime regarder les Italiens qui se promènent nonchalamment en ce week-end ensoleillé.
– Anita, Anita.
J'entends Lucia qui m'appelle. Elle s'est installée dans un bar à côté de celui que nous avons l'habitude de fréquenter.
– Oh ! Lucia. Pourquoi as-tu changé ?
Je la regarde d'un air amusé et interrogateur.
– C'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de places quand je suis arrivée. Je suis là depuis longtemps. Je ne t'ai pas vu arriver. Et puis, c'est bien le changement. Tu ne crois pas ?
– Si tu veux, c'est bien. Tu sais que je n'aime pas le changement. Tu sais que ça m’angoisse.
De mauvais cœur, je m'assois à ses côtés. Je n'aime pas la table qui ressemble pourtant comme deux gouttes d'eau à celles de notre café favori. Lucia tente de rebondir sur mon désarroi, si futile à ses yeux. Elle me parle avec un sourire qu'elle veut rassurant :
– Je sais, mais il faut aussi vivre avec un peu d'aventures. Changer de café, ça n'est qu'une petite diversité de rien du tout. Tu ne crois pas ?
– Je n'aime pas. Tu le sais.
Je reste silencieuse. De nouveau, une sourde crainte envahit mon corps. Je suis inquiète.
– Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour si peu ? Ça n'est pas grand-chose.
– Je sais. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas me contrôler.
– Il faudrait enfin comprendre ce qu'il se passe dans ta petite tête. Je trouve que tu es de plus en plus paniquée, pour un rien ou pour si peu.
– Je m'en suis rendu compte. Comment faire ? Si je ne contrôle pas, je ne contrôle pas.
Lucia, que j'aime pourtant par-dessus tout, commence à m'agacer. Elle sait que je stresse pour un oui ou pour un non, et elle insiste :
– Si tu veux, on en parle. Tu ne peux pas vivre comme cela. La vie est faite de changements et c'est ce qui fait le terreau du bonheur.
– Oui. Mais que veux-tu que je te dise ? Je n'aime pas changer. Ça me fait peur, je suis inquiète et j'ai l'impression que je vais perdre quelque chose.
– Tu vas perdre quoi ? Essaie de me dire plus exactement.
– Je ne sais pas, mais je sais que je vais perdre une chose très importante.
– Une chose très importante ? Mais quoi exactement ?
– Bon. Ça suffit. Tu n'es pas ma psy, et je n'ai nulle envie d'en avoir une.
Lucia bat en retraite. Elle a compris que je ne voulais ou que je ne pouvais pas plonger dans les méandres de mon inconscient. Elle me regarde avec tristesse. Elle sait à quel point je suis tourmentée. Elle s'inquiète pour moi.
– Bon ! Qu'est-ce que tu veux boire aujourd'hui ? Une grenadine, comme d'habitude, pour ne pas changer.
Je ne relève pas la moquerie de sa part et je réponds :
– Oui.
Les boissons sur la table, nous reprenons nos conversations coutumières. Nous balayons les événements importants ou futiles de la semaine, études, sorties, petits copains, famille...
Pourtant, le regard de Lucia est anxieux. Elle m'observe. Son attitude me montre que j'ai besoin de régler un problème. Elle devine un trouble en moi. Oui, elle comprend. Je suis perdue, tout simplement parce qu'on a changé le café de notre petit rituel.
Mon adolescence s'est bien passée. Mes parents craignaient une crise. Elle n'est pas venue. J'étais avec des parents aimants et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Pourtant aujourd'hui je me sens mal, un mal indéterminé.
L'intelligence de ma mère a calmé, jusqu'à présent, mes angoisses. Lorsque je n'avais que trois ou quatre ans, les lectures du soir étaient des contes où la rencontre entre une maman et un bébé trouvé au hasard de la vie faisait le bonheur de tous. J'aimais particulièrement l'histoire du petit canard, adopté par une famille. La famille avait des canetons jaunes, alors qu'il était noir. En grandissant, le petit canard, aussi appelé « le vilain petit canard » est devenu un magnifique cygne qui a fait la fierté de sa mère adoptive. Il y a eu aussi l'histoire de Moogli, élevé par des louves. Moogli a reçu l'amour de tous les animaux de la jungle, ou presque. Tous étaient débordants de fierté face à ce petit bonhomme.
Nous avions plusieurs animaux de compagnie, arrivés à la maison dans les bras de mon père. Cette scène s'est renouvelée à la venue de ma sœur et mon frère. Mes parents me les ont présentés comme des membres de la famille, mon frère, ma sœur et mes animaux. Le chien, le chat, la tortue et autres ont été adoptés, venus d'on ne sait où, comme nous l'avions été. C'est ainsi que mes parents nous l'avaient expliqué, et que nous l'avons compris.
– Regarde comme il est mignon. Tu vois ce bébé chiot ? C'est maintenant un membre de notre famille. Nous venons de l'adopter.
Devant toutes les adoptions de chaque membre de la famille, un lapin, un hamster, des oiseaux et autres mammifères, j'ai entendu la même phrase.
– Maintenant, il fait partie de notre famille. Nous l'avons adopté.
J'ai longtemps pensé que les enfants et les animaux, arrivaient dans une famille par magie, et que nous étions tous des adoptés. Cette croyance s'est renforcée lorsque mon père est revenu un jour, avec dans les bras un petit être effarouché, avec de grands yeux noirs, les cheveux crépus, la peau tout aussi foncée que la mienne. Ma mère m'avait dit :
– Papa est allé chercher ton petit frère. Nous venons de l'adopter.
J'ai très peu de souvenirs de l'arrivée de ma sœur. J'étais plus jeune. Ce jour-là, ma grand-mère maternelle est venue me récupérer à la sortie de l'école. Nous sommes arrivées à la maison et j'ai vu un landau. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai eu la conviction que ma famille avait préparé une surprise à mon intention. Je pensais y trouver une poupée à l'intérieur. C'était Nella, ma petite sœur, une poupée vivante. Là également, il m'a fallu des années pour comprendre qu'elle était différente. J'ai très souvent entendu ma mère dire :
– Elle ne peut pas comprendre, ou elle ne peut pas le faire. Avec sa trisomie 21, c'est difficile pour elle.
Dans notre famille, nous avions certaines habitudes. Personne ne les remettait en question. Ma sœur ne comprenait pas tout, à cause de sa trisomie, moi je ne pouvais pas agir comme les adultes, car j'étais encore jeune, notre chien ne pouvait pas parler parce que c'était un chien et idem pour les autres membres de la famille, le lapin, le chat et les oiseaux.
Durant mon adolescence, je ne m'interrogeais jamais sur nos différences. Elles me paraissaient banales. Je ne m'interrogeais pas plus sur les différences d'âge, de couleur de cheveux et autres détails. L'amour régnait entre nous et c'est ce qui comptait.
Puis vint le jour où la professeure d'anatomie, a abordé un sujet qui a suscité, dans l’amphithéâtre, une vague de gloussements et de rires en sourdine. Le si prisé sujet de la sexualité était à l'honneur. Le but n'était pas de nous initier sur ce que nous savions déjà pour la plupart d'entre nous, mais pour nous parler des organes génitaux et du phénomène de la fécondation. C'était il y a trois ans.
Je savais déjà que « le papa mettait une petite graine dans le ventre de la maman », ce qui donnait un bébé, comme me l'avait expliqué ma mère. J'en étais restée à ces notions puériles. Elles me suffisaient. Je n'avais pas fait le lien avec la venue par avion de mon frère et de ma sœur. Je pensais peut-être que la graine était mise dans les entrailles de ma mère, et qu'ensuite, mes parents devaient prendre un avion afin de revenir avec le bébé chez nous. Bon, tout ceci est vraiment ridicule, pourtant, je n'avais jamais approfondi cette étrange situation.
Mais ce jour-là, alors que je venais de fêter mes vingt ans, une vague d'émotions a tétanisé mon corps. J'ai reçu un choc, qui aurait pu être comparable à un cataclysme suite à un accident de voiture.
Munie de sa baguette, Madame Castelli, notre professeure, désignait des gravures défraîchies, où l'on pouvait voir un utérus, des spermatozoïdes, et le chemin qu'ils devaient parcourir afin d'arriver à l'ovaire. Dans un premier temps, cette boule, qui ressemblait à un œuf, accroché à une corolle, me faisait penser à un bouton de coquelicot. Elle nous expliquait qu'à l'intérieur de l'ovaire, se trouvaient les futurs bébés. Sa baguette avançait doucement. Nous pouvions suivre le trajet, parsemé d'embûches, que ce pauvre spermatozoïde devait parcourir, pour rencontrer sa dulcinée, l'ovule. Nous entendions dans l'assistance des remarques toutes aussi grivoises les unes que les autres :
– Allez, vas-y ! Tu y es presque. Il t'attend, ton ovule ne demande que ça. C'est bon pour toi.
Habituée à ces attitudes aimées par les garçons de l'amphithéâtre, jugées ridicules par de nombreuses filles, notre professeure continuait sa leçon sans sourciller.
Elle a ensuite accroché une autre série de planches. Nous y voyions l'ovule fécondé. Sur la planche suivante, il devenait un fœtus, grâce à une multitude de transformations. Plusieurs démonstrations plus tard, il était un bébé. Madame Castelli s'obstinait à nous montrer sa tête déjà formée, les yeux, les petites mains, les orteils...
Mon mal-être est devenu intolérable, lorsque la gravure du passage de la tête sortant du corps de sa maman, a été accrochée. Mon état de stress contrastait avec la désinvolture de Madame Castelli. Elle dispensait ce cours depuis de nombreuses années.
J'avais devant moi, la démonstration nette et précise, que je n'étais pas sortie de l'utérus de ma mère, ni entrée dans ce douillet réceptacle, grâce à une graine de mon père.
Je suis une enfant adoptée.
Le ver de la curiosité venait de s'installer brutalement dans mon cerveau.
« D'où est-ce que je viens ? »
À qui appartenait cet utérus dans lequel j'ai vécu neuf mois, et de qui est la graine qui m'a permis de voir le jour ? Qui sont mon père et ma mère biologiques ?
3
Je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, ma mère était absente. Je revoyais défiler les démonstrations pénétrantes de Madame Castelli. Les images s'affichaient devant mes yeux sans mon autorisation. Je lui en voulais. Les panneaux avec les ovules, les spermatozoïdes, les ovules fécondés, les fœtus s'imposaient à moi. Je la rendais responsable de mon malaise. Je ne parvenais plus à respirer. Un poids immense bloquait le mouvement de ma cage thoracique. J'ai fermé les yeux. J'espérais que les gravures de cet ovule fécondé allaient s'évanouir. Il n'en était rien. Impossible d'oublier les planches de ce cours de sciences humaines.
J'ai voulu m'endormir. Le sommeil allait peut-être faire disparaître ce sentiment d'insécurité. Nouvel échec, le sommeil n'est pas venu. Durant les jours qui ont suivi, j'ai tenté diverses actions, lectures, marches, courses à pied.
Le fardeau de mes origines a pris le pas sur mon équilibre. Un soir, l’œil attentif de ma mère, si attentionnée, a détecté mon mal-être :
– Qu'est-ce que tu as, ma chérie ? Tu as l'air soucieuse. Est-ce que tu as une contrariété ? Tes études ou tes amis te posent problème ?
– Non. Ce n'est rien. Je suis fatiguée.
– Tu peux me parler si tu veux.
– Laisse-moi tranquille, je parle si je veux.
Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un élan d'humeur contre celle qui m'a donné tant d'amour. Une colère immense m'a envahie. Je lui en voulais d'être celle qui ne m'avait pas enfantée. Durant les jours qui ont suivi, j'ai renouvelé avec force, mes attitudes agressives.
« Elle n'est pas ma mère. Elle est blonde et je suis noire comme un corbeau. Elle est grande et je suis petite. Pas de doute, elle n'est pas ma mère. »
Mon esprit perturbé est devenu de plus en plus fou.
Elle était inquiète et son inquiétude m'agaçait au plus haut point. Pourtant, elle tenait à comprendre ce qui me tourmentait. Elle a insisté :
– Anita. Parle-moi. Je vois bien que tu ne vas pas bien.
– Qu'est-ce que ça peut bien te faire, si je vais bien ou pas ?
– Je suis heureuse quand tu es heureuse. Je te vois torturée par une pensée. Alors tu vas me faire comprendre ce qu'il se passe, car je ne supporte pas de voir ta mine malheureuse.
– Malheureuse, je le suis depuis ma naissance, alors ça change quoi ?
– … Mais que dis-tu ? Je sais bien que tu as été heureuse jusqu'à présent.
Je venais d'être prise en flagrant délit de transformation de la vérité.
– Oui. Enfin... Ce n'est pas ce que je voulais dire.
– Ah ! Tu me rassures. Et qu'est-ce que tu voulais dire ?
– Euh. Tu sais bien. Tu devines.
– Je sais certaines choses, mais aujourd'hui, je ne peux pas deviner ce que tu as dans le cœur.
Malgré mes vingt ans, je me suis dandinée comme une petite fille.
– Mais si. Tu vois bien ce que je veux dire.
– …
Ma mère est restée silencieuse. Elle réfléchissait. Elle m'a observée. Son visage est devenu sombre, elle était accablée par son impuissance. Elle a deviné ce qui me tourmentait, mais elle espérait que je lui dévoile mes interrogations. Elle ne voulait pas me brusquer.
En cet instant, je n'ai pas supporté de constater que j'étais la cause de son désarroi. Lâchement j'ai proclamé :
– Je te laisse. Je vais me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin de toi.
– Anita !
Sa voix était tremblante. Je me suis retournée sans vergogne. Elle m'a regardée, désespérée. J'étais consciente d'avoir brisé son univers si bien construit.
Je suis montée dans ma chambre. À cet instant, j'ai eu l'intime conviction que j'étais dans mon bon droit. Je m'accordais ce sentiment puisqu'elle n'était pas ma mère. Les minutes et les heures ont passé. Les yeux fixés au plafond, j'ai repensé aux années dans le sein d'une famille aimante. Mon enfance, mon adolescence sans révoltes, les repas, les fêtes, tous ces merveilleux moments qui avaient fait mon bonheur. En quelques instants, j'avais décrété qu'ils n'étaient plus les miens. Ils sont devenus des instants volés. Ils ne m'appartenaient plus. J'étais indienne et pas italienne. J'étais née à Bénarès. J'étais arrivée à Rome par accident. Cette ville n'était plus la mienne.
Plus je réfléchissais, plus je me persuadais que je n'avais rien de commun avec ma famille. Je noircissais les événements qui jalonnaient ma vie. Ma mère a prétendu m'aimer, mais elle comblait un vide, le vide que sa stérilité avait créé. Ma sœur ne pouvait pas comprendre et mon petit frère n'était là que pour me demander des câlins, conséquence des carences affectives de sa naissance.
En un après-midi, j'ai minutieusement démoli l'équilibre construit durant des années. Je suis descendue pour le repas du soir. Mon attitude a fait comprendre à chaque membre de la famille, que je les fréquentais par contrainte. Mon esprit révolté a pris un malin plaisir à détruire ceux qui avaient mis tant d'amour pour me construire. À la fin du repas, je me suis levée sans dire un mot.
– Où vas-tu ? Tu ne nous dis pas bonsoir ?
– Non.
Pour la première fois de ma vie, mon père a montré des signes de colère.
– Tu reviens poliment et tu embrasses ton frère et ta sœur. Tu n'oublies pas ta mère.
Sa voix était calme et ferme. L'ordre qu'il venait de m'intimer, n'appelait aucun refus. Après une minute d'hésitation, j'ai redescendu les marches déjà gravies. J'ai embrassé Julio, il m'a enveloppé de ses petits bras pleins de tendresse. Nella m'a caressé la joue avec un sourire affectueux. Elle m'a regardée généreusement au travers de son strabisme. Ma mère a voulu me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussée. J'ai embrassé mécaniquement mon père. La grimace de son visage révélait le reproche et l'interrogation.
Je suis montée dans ma chambre. Je me suis effondrée sur le lit. Les regards rayonnants d'amour de mon frère et de ma sœur, m'ont rappelé que sans eux je n'avais rien.
J'avais poignardé en plein cœur mes parents. Je me détestais.
Je venais de prendre conscience du manque affectif qu'avait créé ma naissance chaotique. Ce trou béant avait été camouflé par les tonnes de tendresse que j'avais reçues. La tendresse ne suffisait plus. J'avais mal. Le gouffre de ce manque devenait sanguinolent.
4
Le lendemain, je suis retournée à la faculté, comme chaque jour :
– Bonjour. Nous avons cours ce matin avec Mme Castelli à 11 h. On vient de nous annoncer qu'il y a un changement d'amphi. Il paraît qu'ils sont obligés de faire des travaux.
– Ah ! OK. À 11 h tu dis ?
– Oui. On a peu de temps après le cours de physique. Ça n'est pas grave. Elle le sait et elle attendra.
Lucia était pétillante, comme toujours. J'aimais sa personnalité enjouée. Elle était enthousiaste à l'idée de s'instruire, en particulier sur tout ce qui a un lien avec le corps.
11 h est arrivé. Je me suis dirigée vers notre lieu d'apprentissage, flanquée de mon amie. Arrivée devant les portes béantes de l'amphithéâtre, j'ai de nouveau eu le souffle court. Un poids invisible a comprimé ma cage thoracique. J'avais si mal que j'ai poussé un petit cri. Lucia, qui avait déjà pénétré dans la salle de cours, est revenue sur ses pas. Ardente comme à son habitude, elle était proche de sa place préférée.
– Que t'arrive-t-il ? Tu es toute pâle.
– J'ai mal.
– Mais où ça tu as mal ?
Je lui ai montré ma poitrine.
– Je n'arrive plus à respirer.
– Tu veux que j'appelle l'infirmière.
Je n'ai pas pu lui répondre. J'ai senti qu'elle m'allongeait sur un banc, probablement aidée par d'autres étudiants. Un brouhaha s'est fait entendre autour de moi. Je m'étais évanouie. Sans que le temps ne passe pour moi, dû à l'absence de conscience de mon état, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le visage de l'infirmière de la faculté qui me prenait le pouls.
– Anita. Parlez-moi. Que ressentez-vous ? Dites-moi quel âge vous avez. Quel jour sommes-nous ?
J'étais suffisamment lucide pour reconnaître les premières paroles qu'une secouriste digne de ce nom, devait prononcer. Je me suis relevée en répondant. L'infirmière a paru rassurée, Lucia également. Pendant que je continuais à répondre aux investigations de ma soignante, j'ai invité Lucia à retourner dans l'amphithéâtre. Je savais que rater des heures de cours était pour elle un sacrifice.
– Vas-y Lucia. Je me sens mieux. Tu me passeras les cours plus tard. Je crois que je vais rentrer chez moi.
– Tu es certaine ? Tu ne veux pas que je reste avec toi ?
Toujours aussi dévouée, Lucia dirige son regard vers l'infirmière afin d'avoir un signe d'approbation.
– Ne vous inquiétez pas Mademoiselle, je vais rester avec elle.
– Bon, je t'appelle quand je sors du cours.
Lucia s'est précipitée vers la salle de cours. Je suis restée sans paroles face à l'infirmière qui avait compris mon besoin de silence. Le couloir, où nous étions toutes deux, était silencieux. Mon esprit, lui, était au milieu d'une tempête. Je revoyais, sans ordre, les gravures qui avaient fait le cours de la semaine précédente. Fœtus, ovules, spermatozoïdes, ma mère italienne, ma mère indienne, toutes ces images se battaient en duel. Je ne pouvais les contrôler.
Après un temps qui m'a paru trop court, j'ai entendu la voix de l'infirmière.
– Vous vous sentez de me suivre ? Nous devons aller à l'infirmerie. Je dois vous ausculter.
– Oui. Je pense que je vais pouvoir marcher. Je me sens mieux.
À pas lents, puis plus rapides, nous sommes arrivées dans le local bien organisé de son lieu de travail, sur l'aile droite de la faculté.
– Est-ce que vous avez un membre de votre famille qui pourrait venir vous chercher ? Je ne peux pas vous laisser partir seule.
– Mais je me sens mieux, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer chez moi.
– Non. C'est impossible. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu ce malaise, alors il faut vous faire accompagner.
Mon regard s'est posé vers le sol, puis vers le mur de gauche. Je ne voulais pas affronter le regard inquiet de ma mère. Elle seule pouvait se déplacer. Je savais qu'elle allait venir en appuyant sur l'accélérateur, au risque d'avoir un accident.
J'ai regardé l'infirmière qui continuait ses investigations.
– Savez-vous ce qui vous est arrivé ?
– Non. Je ne sais pas.
– Décrivez-moi vos symptômes.
– J'ai eu un poids sur la poitrine et je ne pouvais plus respirer.
L'infirmière parlait lentement, moi aussi. Entre chacune de ses questions, elle attendait un long moment.
– À quel moment avez-vous commencé à ressentir ce poids ?
J'ai compris qu'elle reformulait mes paroles afin de me faire comprendre qu'elle était en empathie avec moi.
– Quand je me suis approchée des portes de l'amphithéâtre.
– Devant les portes de l'amphithéâtre.
– Oui... Nous allions avoir le cours de Madame Castelli.
– Le cours de Madame Castelli.
– Oui.
– Est-ce que vous redoutiez un événement dans ce cours ?
– …
Impossible de répondre. Ma gorge s'est nouée. Malgré mes efforts, aucun mot n'a pu sortir. Elle a renouvelé ses douces paroles.
– Qu'est-ce qui vous oppressait autant dans ce cours ?
– …
Toujours impossible de répondre. J'ai remarqué son regard compatissant. J'ai voulu lui parler des gravures avec l'ovule, le fœtus… mais je n'ai pas pu. Je me suis effondrée en sanglots. J'ai pleuré et encore pleuré. Elle me regardait toujours.
Je l'ai vue se lever. J'ai pensé qu'elle allait me prendre dans ses bras. Non, elle est passée derrière moi afin de prendre un objet que je ne voyais pas. Elle est revenue et m'a présenté une boîte de mouchoirs en papier. La surprise passée, je suis revenue à la réalité de l'instant. Je savais qu'une infirmière ou un médecin ne doit pas se laisser happer par la douleur de son patient. Elle avait pourtant un regard perspicace. Elle avait compris que mon malaise n'était pas physiologique, mais émotionnel. Elle a rajouté :
– Tu peux me parler si tu veux. Je suis là pour t'écouter si tu en as besoin.
Je suis restée silencieuse. Puis je lui ai raconté le choc de la vue, durant le cours de Madame Castelli, de la naissance de l'enfant qui sort du ventre de sa mère. J'ai continué sur mes interrogations à propos du mystère autour de ma naissance.
Au fur et à mesure de l'avancée des tentatives d'explications de mon mal-être, elle est restée silencieuse. Elle ne m'a pas interrompue sauf pour me dire :
– Et tu aimerais savoir qui sont ta mère et ton père biologiques.
– Oui... mais non... je ne sais pas. Mes parents sont si gentils. Je ne veux pas leur faire de peine, vous comprenez ?
– Je comprends. Et comment vas-tu faire avec toutes ces interrogations qui se bousculent dans ta tête ? Penses-tu que tu vas devoir faire un choix entre ta mère et ta mère biologique ?
– …
Très bonne question. Comment allais-je faire avec ce capharnaüm émotionnel?
Elle était fine psychologue. Elle savait que j'étais en dualité entre la loyauté que je devais à mes parents, et ce besoin naturel de connaître mes origines.
De nouveau le silence s'est installé entre nous. Après un instant, elle a ajouté :
– Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je voudrais te revoir avant la fin de la semaine, si tu le veux bien.
– Oui. Je veux bien.
– Tu auras réfléchi et on avancera ensemble dans ta quête intérieure.
Elle a eu les bons mots. Je ne me sentais plus seule. Elle ne m'avait pas jugée, certainement moins que je ne l'avais fait moi-même.
Je lui ai donné sans hésitation, le numéro de téléphone de ma mère. Notre échange m'avait fait comprendre que je ne devais pas la rejeter. Il fallait juste admettre que j'avais deux mères. Encore un conflit de loyauté qui s'est miraculeusement envolé.
Ma mère est arrivée affolée, comme je l'avais prévu. Elle avait les mains légèrement enfarinées, probablement à cause de l'interruption de la préparation d'une tarte ou d'un gâteau. Après avoir envisagé l'idée de m'emmener à l'hôpital pour un check-up général, elle a consenti à rentrer chez nous. À cette minute, notre maison était bien la mienne, contrairement aux idées de rejets que j'avais eues les jours avant. Cet incident avait eu le mérite de me réapproprier ma famille. Ma mère italienne est bien ma mère, ma mère indienne est ma génitrice.