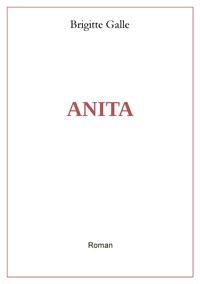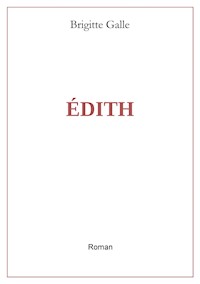
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je m'appelle Édith. Je suis née en France, à Grenoble. J'ai été placée par les services sociaux dans une famille d'accueil. À l'âge de 19 ans je me suis enfuie. Je suis arrivée à Paris. La vie d'aventures qui m'a emmenée à Jérusalem et en Inde, n'était pas celle que j'avais imaginée enfant. Ma mère, à laquelle j'avais été arrachée alors que j'étais encore une enfant, avait rêvé pour moi, une vie paisible, entourée de ma famille. Le destin avait prévu bien autre chose. La paix, je l'ai trouvée après un très long voyage. Les imprévus, les contretemps ont jalonné mon existence. J'ai aimé vous faire part de mes espoirs et de mes désespoirs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
En route vers... Éditions Brumerge, 2013Rita, Éditions Brumerge, 2019Ismaël, Éditions Brumerge 2020
J'apporte mes affectueux remerciements à Marie-Joseph HP pour sa précieuse aide, sa patience et son amitié.
Sommaire
Et à la fin
Ma mère
Les services sociaux
Je pars
Parisienne
Boulangerie - pâtisserie Bertrand
Ma sœur
Le détective
Fin Début
Faustine et Hubert
J'y vais
Vérone
Sœur Maria
Venise - Zadar - Istanbul
Istanbul
Mariage turc
Partir d'Istanbul
Liban
Tel-Aviv, Jaffa
Jérusalem
La vieille ville
Le Saint Sépulcre
Volontaire
Sœur Édith
Déjà quatre mois
Vivre ensemble
La foi
Mikaël
L'amour ?
La guerre des pierres
Le choix
Le destin
Début ou fin ?
Et après
Nazareth
Les Clarisses
Les confitures
Après un an
Delhi
Agra
Tous mes frères
Départ d'Agra
Sarnath
Fin
Les anges
Et à la fin
Je suis allongée sur mon lit de fin de vie.
Je revois ma mère dans notre appartement de la rue Lavoisier à Grenoble.
Son souvenir s'impose à moi.
J'avais quatre ou cinq ans. J'étais seule avec elle, alors qu'elle attendait mon père.
Je jouais avec un puzzle acheté chez Emmaüs, ou peut-être au Secours populaire, à moins qu'il n'ait été donné par une des nombreuses associations caritatives que nous avions l'habitude de contacter.
Je ne jouais pas vraiment, ma mère était triste, elle repassait avec un air triste et un fer à repasser abîmé. Alors j'étais triste aussi.
Les pas de mon père se sont fait entendre dans l'escalier de l'immeuble. Nous étions au premier étage et il montait toujours à pied. Je reconnaissais son pas entre mille. Ma mère savait également que c'était son pas puisqu'elle a commencé à ranger son fer à repasser abîmé.
Je suis au milieu de cette scène qui s'est pourtant passée il y a plus de soixante ans.
Il frappe à la porte. Ses doigts sont autoritaires. Il frappe fort, certain qu'il va être accueilli.
Ma mère se précipite pour lui ouvrir. Elle n'est pas joyeuse. Elle est anxieuse.
Il entre sans la regarder. Il ne me regarde pas non plus. Il s'assoit sur une chaise. Il attend quelque chose. Il est impatient.
– Édith, va dans la chambre, m'a-t-elle dit.
Je savais que je devais exécuter cette injonction. Inutile de manifester une quelconque désapprobation. Alors je me suis précipitée dans la chambre sans regarder derrière moi. C'était comme cela deux fois par semaine, la même routine. Mon père arrivait dans l'après-midi et ma mère m'envoyait dans la chambre que je partageais avec mes frères et sœurs. Quatre lits superposés par deux avaient été installés. Les deux garçons dormaient en haut, ma sœur et moi en bas. Le ventre fraîchement arrondi de ma mère annonçait la naissance de mon dernier petit frère. L'espace était étroit entre les deux rangées de lits. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'envoyait dans cette pièce sans attrait. Quelques instants après, je les entendais émettre des bruits que je ne comprenais pas. Pourquoi étaient-ils dans la chambre de ma mère, puis dans la pièce à vivre qui nous servait de salle à manger ? Je savais que ma mère allait me rappeler quand les bruits auront cessé. Mon père buvait alors une collation en regardant dans le vide, sans se soucier de ma présence. J'aimais voir les joues roses de ma mère. J'aimais ce sourire discret qui montrait sa satisfaction d'être près de lui. Après quelques minutes, il partait, sans m'adresser la parole, en lui posant un léger baiser sur le front. Il était plus vieux qu'elle, ses cheveux étaient grisonnants. Elle restait éternellement jeune malgré les grossesses qui se succédaient. Le petit baiser posé sur le front de ma mère me permettait de penser qu'il l'aimait. Ses épaules légèrement voûtées montraient le poids de la situation que nous vivions.
Je me souviens d'elle alors que je suis allongée sur mon lit d'hôpital, à Vârânasî. Ma jambe blessée par un motard, pendant que je traversais trop précipitamment une avenue embouteillée, me fait souffrir. Elle est maintenant attaquée par la gangrène. J'ai 72 ans. Pourquoi me souvenir de ma mère et de ces instants enfouis dans un ramassis de souffrances, les miennes et celles de ceux que j'ai accompagnés ?
D'autres images de mon passé surgissent sans que je ne les appelle. Pourquoi ne suis-je plus maître de mes pensées ? Que se passe-t-il ?
– Édith ! Sister ! Amma !
Cette voix douce et ferme m'appelle.
Qui est-ce qui me demande avec autant de force de lui répondre ?
Ma mère est de nouveau devant moi. Elle est belle. Elle rayonne d'une lumière tendre. Elle me tend la main. Elle sourit. Elle ne parle pas.
– Édith, Édith !
De nouveau cette voix que je ne reconnais pas m'appelle.
– Édith ! Sister !
La voix est lointaine. Je n'entends plus rien. Ma mère recule. Elle disparaît dans un halo de lumière. Je m'avance vers elle.
– Elle part. Elle nous quitte. C'est terminé.
J'entends la voix qui semble maintenant être triste. C'est la voix de Sœur Maria, avec qui je partage ma chambre depuis de nombreuses années.
D'autres voix se font entendre.
Je plane au-dessus de mon lit. Je vois mon corps. Les personnes qui m'entourent me ferment les yeux. Il y a Maria, le médecin, la supérieure et Anita, notre fidèle servante. Anita pleure, le médecin a un air résigné, Sœur Maria est affolée, elle répète « Elle part, elle part », la supérieure a les traits tirés, elle reste digne, en prière.
Je me retourne. Un long couloir se présente à moi. Je sais maintenant que ma destinée est au bout de ce couloir noir, d'où je vois une lumière. Au loin je vois la silhouette de ma mère qui m'attend.
Ma mère
Ma mère est née à Grenoble. Tous les membres de notre famille sont nés à l'hôpital de la Tronche, nom si particulier qui nous a valu les ricanements de ceux qui ne connaissent pas Grenoble. « La Tronche », quel drôle de nom pour désigner une commune.
Sa famille était ni riche ni pauvre, de classe moyenne comme nous le disions si familièrement. Sa mère, ma grand-mère, était femme au foyer, mon grand-père contremaître dans une usine dont je ne me souviens plus du nom.
Elle était jolie, fine, les yeux gris vert, le teint clair, les cheveux châtains aux reflets blonds.
Elle avait aimé étudier, elle avait réussi ses examens brillamment. Après avoir obtenu la mention bien au bac, ce qui à l'époque était une prouesse, elle est devenue secrétaire médicale.
C'est grâce à ce diplôme qu'elle a rencontré mon père pour son plus grand bonheur, pour son plus grand malheur.
Il était réputé dans son domaine, spécialisé en cardiologie. Il était marié et avait deux garçons. Sa femme était d'une famille bourgeoise. Lui, avait pu se hisser au rang des plus grands médecins grâce à sa ténacité et à sa mère.
Sa mère, ma grand-mère que je n'ai jamais connue, était une mère célibataire. Elle a consacré sa vie à l'éducation de son fils en faisant des ménages et en travaillant à l'usine. Elle avait été engrossée, selon la formule consacrée de l'époque, par le fils d'une grande famille riche alors qu'elle était aide-cuisinière. Ses patrons l'avaient lâchement mise à la porte lorsqu'ils avaient appris qu'elle allait accoucher d'un bâtard, sans se préoccuper de son devenir, ni du devenir de l'enfant, qui était pourtant leur petit-fils.
Grâce à son mariage, mon père était uni à une famille riche, puisque son épouse était issue de la haute bourgeoisie grenobloise. A-t-il cherché une revanche avec cette union ? Probablement. Il a réintégré ainsi le milieu dont il était issu par son père de sang.
Ce mariage atypique avait été célébré contre l'avis de sa belle-famille. Le charme de mon père avait envoûté cette jeune bourgeoise qui n'a pas reculé devant l'adversité des siens pour épouser celui qu'elle considérait comme son prince charmant. Une façon de se distinguer et d'échapper aux diktats de son rang social. Le prix à payer pour cette transgression a été un poids lourd à porter. Les années de mariage ont été difficiles. La cruelle hypocrisie de son milieu a fait que cette union n'a connu le bonheur que les premières années. Son mari, mon père, portait sur ses épaules la masse des désillusions de sa femme. Il n'a jamais été reconnu par sa belle-famille. On oubliait de l'inviter pour les événements heureux ou malheureux. Quand il était là, il était ignoré ou subissait des remarques désobligeantes. Il souffrait et regrettait d'avoir entraîné son épouse dans ce mariage contre nature, à en croire la bonne société bien pensante.
Il a eu plusieurs aventures, échappatoire d'une non-reconnaissance de sa position d'époux.
Il a été toutefois valorisé par des succès professionnels qui l'ont hissé au rang des personnes respectées par la communauté médicale sans que sa belle-famille n'en fît cas.
Ma mère n'avait pas encore 26 ans lorsqu'elle a débuté sa vie professionnelle dans le cabinet de mon père. Elle était alors fine, légère, confiante en son avenir qui paraissait radieux. Être secrétaire médicale était déjà une profession dont elle pouvait être fière. Être au service d'un grand cardiologue très reconnu la remplissait de bonheur.
Durant les premières années, ils se sont côtoyés sans se regarder.
Puis la magie de l'amour a opéré, le jour où l'ancienne secrétaire est partie vers les douces joies de la retraite.
Ils se sont alors retrouvés tous deux dans cet appartement transformé en cabinet de cardiologie. Mon père n'a pas embauché d'autres aides. Il a rapidement compris que son assistante allait facilement faire le travail de deux.
Un an après, ma sœur aînée est née. Enfant illégitime qui a fait la honte de mes grands-parents maternels. Ils étaient de braves gens qui n'aimaient pas les aspérités. Le ventre ballonné de leur fille avait été une aspérité honteuse. Sans oser rejeter leur fille, ils se sont faits très discrets, se sont rendus indisponibles lorsqu'elle avait besoin de leur aide. Une longue marche de solitude a alors commencé pour ma génitrice. Bien que son amant soit médecin, il n'eut pas idée de lui épargner les quatre grossesses qui ont suivi.
Elle a dû arrêter de travailler pour s'occuper de mes frères et sœurs et de moi-même. Elle ne parvenait pas à trouver d'aide puisqu'elle était en position de pécheresse. Elle a bien tenté de maintenir en parallèle sa vie professionnelle et sa vie de mère. Mais elle devait s'arrêter régulièrement dès qu'un rhume, une fièvre ou une toux nous empêchaient d'aller à l'école.
C'est ainsi qu'elle est devenue totalement dépendante du bon vouloir de mon géniteur, des quelques francs qu'il voulait bien lui donner par mois. Pour compléter la petite allocation, variable chaque mois qu'il lui allouait, elle était devenue couturière à domicile.
C'est comme cela que je me souviens d'elle, entre une machine à coudre et un fer à repasser abîmé.
Puis est venu le jour où notre vie a basculé.
Je suis rentrée de l'école, accompagnée de mes petites copines de classe qui habitaient dans le même pâté de maisons. Je devais avoir huit ou neuf ans. Mes frères sont arrivés peu après moi. Ma sœur aînée était une adolescente tourmentée. Elle est arrivée plus tard dans la soirée. Elle aimait « traîner dehors » selon l'expression consacrée de la famille. Comme à son habitude, ma mère avait un ouvrage dans les mains. Elle regardait la bouillie qu'elle préparait pour notre dernier petit frère qui avait un peu moins de trois ans.
Les années étaient passées sur le beau visage de ma mère. Elles avaient creusé des rides d'anxiété. Mais en cette fin d'après-midi, j'ai pu voir des rides qui n'existaient pas le matin même.
Mes frères, turbulents d'ordinaire, étaient extraordinairement calmes. Sur leurs visages je détectais également une crispation incompréhensible. Eux aussi avaient ressenti un changement d'atmosphère sans que nul n'ose interroger l'autre.
Lorsque ma sœur est rentrée à la nuit tombée, ma mère nous a envoyés dans la chambre afin de s'entretenir avec elle.
Nous n'avons entendu que des bribes de conversation qui ne nous permettaient pas d'avoir la réponse à : pourquoi étions-nous tous inquiets ?
– Il n'est pas venu… pas assez d'argent… problème… loyer… dettes...
Les jours ont passé. Ma mère était de plus en plus crispée. Les repas étaient devenus frugaux. Les habits n'étaient pas renouvelés, seulement reprisés.
Nous n'avons rien su de ce changement peu perceptible. Nous avons compris qu'un événement inconnu s'était produit. Mais lequel, nous n'en savions rien.
Je n'avais pas remarqué que mon père ne passait plus les après-midi puisque je n'étais plus là lorsque cela se produisait. Depuis que j'étais scolarisée, il passait durant mon absence.
Les services sociaux
Le jour où la dame des services sociaux est arrivée, a été un jour qui m'a paru être un jour comme tous les autres jours. Nous avons eu un peu plus de pain, de beurre et quelques habits de rechange.
Le jour où la dame des services sociaux est arrivée accompagnée d'autres personnes qui étaient, eux également des services sociaux, est un jour que j'ai gardé en mémoire.
Ce jour-là, mes frères et moi, les quatre derniers de la fratrie, nous sommes partis avec eux. Il n'y a eu aucun pleur, aucun cri, aucune larme. Nous ne comprenions pas ce qu'il nous arrivait. Ma mère est restée assise sur la chaise, sans nous regarder, elle était prostrée, sans une seule larme, les yeux dans le vide.
Nous avons suivi les inconnus sans manifester puisqu'elle acceptait de nous voir partir. Elle ne pleurait pas, alors nous ne pleurions pas non plus.
Le soir même je dormais au milieu d'une autre fratrie de deux filles. J'avais été placée dans une famille d'accueil aimante, dans une maison spacieuse où j'avais ma chambre individuelle. Je suis devenue la troisième fille de la famille. J'avais neuf ans. Ils m'ont comblée par leur amour, leur éducation, leurs intentions multiples et variées. Les filles de la famille, plus âgées que moi d'une dizaine d'années, étaient des petites mères protectrices pour moi. Aujourd'hui je réalise que j'étais souvent traitée comme une petite princesse. Le père, la mère et les enfants étaient des êtres au grand cœur. Après les difficultés de la vie, je me suis retrouvée dans l'aisance matérielle et affective. J'ai eu de la chance, mais à ce moment-là je ne le réalisais pas.
J'avais été séparée de mes frères et sœurs. Seule ma sœur aînée étais restée avec ma mère. Je ne l'ai su que bien plus tard.
Ils ne me manquaient pas puisque j'avais plus d'amour et de cadeaux dans ma nouvelle famille.
C'est durant mon adolescence que j'ai appris que mon père était mort d'une crise cardiaque dans son cabinet de cardiologie. Pied de nez au proverbe qui nous rappelle que les chausseurs sont les plus mal chaussés. Ma mère n'avait pas été prévenue puisqu'elle et ses enfants n'étaient connus de personne. Il n'avait pas eu l'élégance de prendre quelques dispositions qui l'auraient mise à l'abri du besoin. Il était dans le déni. Il a refusé de voir qu'il avait avec nous une famille. Non. Rien de tout ça. Il n'a pas assumé d'être le père des cinq enfants qu'il a eus avec ma mère, tout comme son père biologique ne l'avait pas fait lors de sa naissance.
Le soir où nous sommes rentrés de l'école et que nous avons vu notre mère envahie par l'inquiétude, elle avait attendu sa venue toute la journée. Cela faisait plus d'une semaine qu'il n'était pas venu. Sans nouvelles de sa part elle avait pensé au pire. Elle ne s'était pas trompée. Elle a appris sa mort par une connaissance qui était dans la confidence. Cette connaissance avait lu un article dans les journaux annonçant que le brillant cardiologue avait succombé à une crise cardiaque devant un patient.
Sans elle, ma mère serait peut-être toujours à attendre son retour.
Elle n'avait pas jugé bon de nous faire part de son tourment. Elle était clandestine, nous étions clandestins. Sa logique a voulu que nous ne soyons pas informés puisqu’aux yeux de tous nous n'avions pas de père. Pourquoi nous faire part du décès de celui qui n'existait pas ? Il n'avait en effet jamais existé pour nous. Il ne nous avait jamais pris dans ses bras, n'avait jamais regardé notre travail scolaire. Nous n'étions rien pour lui. Je pense qu'il s'imaginait qu'il n'existait pas pour nous.
Aujourd'hui je trouve cette attitude révoltante. Enfant, je ne voyais pas ou ne comprenais pas la violence de cette situation.
En voyant la détresse de ma mère, l'amie qui était dans la confidence de notre clandestinité a entrepris généreusement de nous venir en aide. Elle a contacté les services sociaux en espérant qu'une solution adaptée à nos besoins serait mise en place. C'est ainsi que notre foyer a éclaté sans espoir de retour.
Je n'ai plus revu ma mère qu'en dehors de quelques visites annuelles, lorsqu'elle venait me voir dans ma famille d'accueil. Elle était alors accompagnée de ma sœur aînée qui vivait toujours avec elle. Je n'ai revu mes frères que bien plus tard, alors que nous étions adultes, lors d'une courte visite en France. Chacun a eu un destin différent selon la chance ou la malchance que représentaient les accueillants.
Les années ont passé. J'avais trouvé une vie familiale chaleureuse, chaleur affective inconnue jusqu'alors, grâce à ma famille d'accueil, ma famille d'adoption, ma famille de cœur.
Ma mère et ma sœur venaient régulièrement, de façon très espacée, trois ou quatre fois par an, pour mon anniversaire, Noël et au hasard de la vie. Elles entretenaient une relation courtoise avec ma nouvelle famille. Durant leurs visites, je trouvais que ma mère de sang vieillissait plus vite que ma mère de cœur.
Est venu le jour où ma sœur aînée s'est présentée sans elle. Ma mère était souffrante. Elle est revenue quelque temps plus tard pour m'informer qu'elle était décédée. J'avais alors 17 ans. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souffert. C'était une information parmi tant d'autres qui ne me touchait pas, du moins c'est ce que je me suis efforcée de penser alors.
Ma mère de cœur a pourtant essayé de me parler. Je devinais son regard inquiet sur ma non-souffrance de tout ce qui fait pleurer le commun des mortels.
Ma vie a continué sans que je ne puisse voir de différence. Ma sœur aînée a alors disparu. Je ne l'ai plus jamais revue. J'ai appris plus tard qu'elle était partie à Paris. Elle est décédée avant ses quarante ans d'un mal inconnu. Je ne sais toujours pas où elle a été enterrée.
Elle avait porté ma mère jusqu'à son dernier souffle. Tant de souffrance l'avait probablement usée avant l'heure. Je pense à elle avec tendresse. Elle a sacrifié sa vie pour notre mère.
Je pars
Je flotte au-dessus de mon lit d'hôpital. Je suis en Inde, à Vârânasî, aussi appelée Bénarès.
Je suis morte. Je le sais et pourtant je me sens encore vivante. Je vois défiler ma vie. De Grenoble à Vârânasî, quel long parcours, une vie remplie de souffrances, de belles choses et de la joie de l'amour universel.
Comment ce parcours parsemé d'embûches et de bonheur a-t-il été possible ?
Je suis partie de chez ma famille d'accueil, à 19 ans dépassés de plusieurs mois.
Je revois ma valise mal ficelée dans l'entrée. Il fait noir. Je sais que tout le monde dort. Je pars de façon clandestine, tout comme l'enfant clandestin que j'avais été. Les événements de mon enfance ont été cachés, alors je suis partie, cachée par un gros mensonge. J'ai refusé d'affronter celles qui ont été ma mère d'amour et mes sœurs de cœur. Elles le sont toujours restées.
Quelques jours avant il y avait eu des cris, des scènes, des affrontements. Je criais que je voulais partir.
– Vous n'êtes pas ma vraie famille. J'ai 19 ans et voilà un an que vous ne recevez plus d'argent pour m'élever.
Je pleurais de rage. J'avais réalisé peu de temps avant, par une conversation entendue malencontreusement entre ma mère et mes sœurs adoptives, que ma famille avait touché une allocation pour mes besoins. J'étais une enfant placée par les services sociaux et ma famille d'amour était une famille d'accueil payée par eux. À dix-huit ans, cette allocation cesse du jour au lendemain, sans que la protection à l'enfance ne se préoccupe de notre devenir. Il y a eu ainsi de nombreux drames, où des enfants se retrouvaient dans les rues sans attache.
La violence de cette annonce avait déclenché chez moi une colère incontrôlable.
– Vous ne m'avez jamais aimée, vous avez fait ça pour l'argent.
– Mais non, Édith, tu le sais. Je t'aime et tes sœurs aussi t'aiment.
Ma mère se lamentait sans trouver les mots qui de toute façon ne m'auraient pas apaisée.
– Je ne vous rapporte plus rien. Vous me nourrissez gratuitement depuis plus d'un an. Je suis maintenant une dépense supplémentaire.
Je m'acharnais à tourmenter ma pauvre mère qui ne savait plus comment exprimer son désarroi. Elle m'aimait, me le disait et je refusais de l'entendre. Je n'étais pas sa fille de sang et je voulais lui faire payer. Depuis quelques mois je voulais retrouver les miens sans comprendre que je vivais déjà avec les miens, ceux qui m'avaient accueillie alors que je n'avais que neuf ans.
Cette nuit-là, je suis partie sans un mot sur la table comme je l'ai souvent vu dans les films. Je n'ai pas compris que je brisais le cœur de celles qui avaient été ma famille. Mon père d'accueil, celui qui avait été un père de cœur, était parti lui aussi rejoindre mes parents de sang, ironiquement d'une crise cardiaque tout comme mon géniteur.
Je n'avais que peu d'idées de ce que j'allais faire à Paris. Je voulais simplement y aller, car je savais que ma sœur aînée y était.
Je travaillais depuis un an les week-ends et les jours fériés dans une boulangerie. J'avais un petit pécule qui sera utile, du moins je le pensais, pour mes premières dépenses.
« Cela me permettra de trouver un travail stable et je vais retrouver ma sœur », je me le répétais régulièrement et je faisais tout pour m'en convaincre.
Je suis partie comme une voleuse, une voleuse d'amour, l'amour que je refusais de donner à celles qui m'ont aimée plus que les miens, ceux que je recherchais pourtant.
La gare était loin de notre domicile. J'ai choisi de faire le trajet à pied, événement précurseur de ce que j'allais vivre les années suivantes. Je n'avais pas d'expérience concernant les trajets en train. Je l'avais pris une seule fois avec ma grand-mère de cœur pour des vacances au Sud, sur les plages méditerranéennes. J'étais alors une petite fille, assise sur une banquette qui ne permettait pas à mes pieds de toucher le sol.
J'ai pris un billet de seconde classe et quelques heures après je me suis retrouvée à Paris, gare de Lyon, sans connaître personne, seule au milieu d'un monde qui m'était totalement inconnu.
Je regardais de droite et de gauche. Il y avait une foule incroyablement dense pour la petite provinciale que j'étais. Tous se pressaient dans un sens et dans un autre sens. J'étais invisible, ils étaient affairés à la recherche de leur train et de leur wagon. J'étais perdue au milieu de ceux que je considérais comme des étrangers.
Où aller ? Que faire ? Je n'avais rien programmé, je pensais peut-être que les portes de la facilité allaient être ouvertes à mon arrivée à Paris et que j'allais trouver ma sœur en quelques minutes. Je m'étais peut-être imaginé qu'il aurait suffi de dire :
– Excusez-moi, savez-vous où habite Lucie ma sœur ? Comme on peut le faire lorsqu'on arrive dans un village.
Alors que je cherchais mon chemin pour une sortie vers un futur inconnu, dans le hall de la gare parisienne près de la célèbre brasserie Le Train Bleu, un homme en costume cravate s'est approché de moi.
– Tu es perdue, m'a-t-il demandé. Veux-tu que je t'aide ?
– Oui, je ne connais pas Paris et je voudrais un endroit pour passer la nuit. Il me faudra un travail et il faut que je retrouve ma sœur.
En une seule phrase, j'avais puérilement donné toutes les informations sur ma situation. Il a parfaitement compris que j'étais seule, sans famille à Paris, sans aide, sans argent, sans rien connaître de cette ville.
Son sourire était rassurant. Son apparence était celle de ceux qui m'inspiraient confiance. En quelques mots je lui ai décrit le pourquoi de mon aventure, ce qui m'avait amenée sur le quai de la gare, loin des miens à la recherche des miens.
– Ne t'inquiète pas, me dit-il, je vais t'aider. Tu as de la chance que je sois là pour toi. Suis-moi. Je connais un ami qui justement cherche une personne pour l'aider dans son atelier. Il a une chambre à l'étage qui est vide. Je suis certain que tu pourras trouver un accord avec lui.
– Oh ! Mais c'est formidable. Merci.
– Je te l'ai dit. Tu as de la chance. Je suis ton petit ange gardien.
– Oui ! J'ai vraiment de la chance de vous avoir rencontré.
Il m'a souri d'un large étirement des lèvres. Ses yeux n'étaient pas brillants, ils étaient froids, sans aucune étincelle de générosité. J'ai trouvé cela étrange, mais je me suis réconfortée en me disant que les Parisiens ne souriaient peut-être pas de la même façon que les Grenoblois. J'étais heureuse de pouvoir sortir de cette gare inhospitalière avec un protecteur. Je l'ai suivi avec confiance.
Son pas a été tout d'abord lent. J'ai trottiné derrière lui avec allégresse. Puis il s'est mis à marcher de plus en plus vite. Nous nous sommes enfoncés dans le dédale du métro de Paris. Les minutes passaient et son attitude changeait. Tout d'abord très souriant, il était maintenant taciturne. Il avançait sans me regarder tout en s'assurant que je le suivais. Son regard se posait sur les coins et recoins des couloirs. Je ne connaissais pas cet endroit, mais j'ai très rapidement conclu qu'il prenait un chemin tortueux pour se rendre à la destination qu'il avait choisie. Les soupçons ont commencé à envahir mon esprit.
– Mais où m’emmène-t-il ? Est-ce que c'est vraiment un protecteur ? Il ne m'a plus adressé la parole depuis dix minutes. Son attitude a changé.
Plus le doute sur les bonnes intentions de celui que je suivais s'amplifiait, plus la certitude que je devais déguerpir vite fait se précisait. J'ai compris qu'un destin très différent de celui qu'un gentil sauveur aurait pu me réserver risquait de se jouer.
Il a eu un petit mouvement de la tête pendant que nous attendions sur le quai d'une station dont le nom m'échappe aujourd'hui. Sa tête a bougé très légèrement de droite à gauche, puis de gauche à droite, alors que ses yeux étaient au maximum de leur rotation. Il était en contrôle et il vérifiait discrètement qu'on n'était ni suivi si surveillé. Une étincelle de génie m'a fait comprendre qu'il craignait d'être aperçu d'un ennemi que je ne connaissais pas.
La confiance que je lui portais s'est soudainement transformée en peur. Son attitude envers moi avait beaucoup trop changé pour que je me sente à l'aise. Il marchait d'un pas décidé, sans se préoccuper de mes ressentis. Il voulait que je le suive. Il n'y avait aucune compassion dans ses yeux. Une personne remplie de gentillesse m'aurait regardée pour me rassurer. Elle m'aurait parlé pour me faire connaître les lieux. Elle m'aurait expliqué où elle pouvait me permettre de vivre en sécurité quelques jours.
J'ai compris alors que je ne l’intéressais pas. Il voulait m'emmener où je ne trouverais pas le bonheur, pour un profit personnel, j'en étais persuadée.
Mon instinct de survie a envahi mon corps plus que mon cerveau. Au détour d'un couloir, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai détalé comme une gazelle qui échappe à un guépard. Je n'ai pas eu le temps de connaître sa réaction. Il me paraît évident qu'il n'a probablement pas bougé pour ne pas se faire remarquer.
J'ai plus tard eu la confirmation que des rabatteurs au service de proxénètes étaient formés pour repérer les jeunes filles en fuite qui débarquaient à Paris en espérant des jours meilleurs. Elles sont alors emmenées dans un premier temps dans un hôtel croyant y passer une nuit de repos. Malheureusement elles se retrouvent kidnappées et violées jusqu'à ce qu'elles acceptent de travailler pour ces marchands de la honte. Les rabatteurs sont parfois des rabatteuses qui se présentent comme de gentilles protectrices aux allures maternelles.
Il faut croire que j'ai pu échapper ce jour-là au pire. Il est vrai que j'avais été prévenue par ma maman de cœur des risques que prennent les jeunes filles en fuite. Elle m'avait parlé des destins de celles qui se retrouvent bien malgré elles, dans des réseaux de prostitution. Aujourd'hui je me dis qu'elle avait eu l'intuition de ce que j'allais faire. Elle me comprenait si bien. Elle savait que je partirais comme je l'ai fait.
Haletante de fatigue et de peur, après une longue course effrénée, inutile puisque plus personne ne me poursuivait, je me suis retrouvée dans une rue parisienne, à la tombée de la nuit, dans un quartier manifestement habité par des étrangers. Les visages multicolores m'ont surprise sans m'effrayer. Tous ces Parisiens d'origine asiatique, du Maghreb ou de l'Afrique noire, paraissaient inquiets. J'ai remarqué leur marche déterminée. En quelques instants j'ai compris que ces Parisiens non français étaient venus tout comme moi chercher une vie meilleure. Ils avançaient avec détermination et angoisse face à un futur rempli de périls. Je me suis sentie rassurée par cette ambiance. J'étais comme eux. Une âme en perdition qui voulait rester digne.
La bouche de métro mentionnait le nom de Barbes. J'ai compris que j'étais dans le quartier du même nom.
J'ai remarqué un hôtel à la devanture vieillotte dont l'entrée donnait sur une petite rue perpendiculaire à l'avenue dans laquelle je me trouvais. J'ai décidé d'y tenter ma chance. Je me suis dit que le prix devait être moins élevé que ceux qui avaient pignon sur rue.
Une femme d'une cinquantaine d'années était à la réception. Elle avait probablement été belle, mais ses cheveux délavés, sa peau bouffie me laissaient penser qu'elle avait abusé de ce que certains appellent les bonnes choses de la vie.
– Que veux-tu, ma p'tite, m'a-t-elle dit d'un air méfiant. Pourquoi tu veux une chambre toute seule ?
Je bafouillais que je venais voir ma sœur, mais que j'avais perdu son adresse.
– Et tu crois que je vais gober ça, a-t-elle insisté, les sourcils très gravement froncés. Et tu viens seule ? Tu n'as pas une mère, un père avec toi ? Tu veux leur téléphoner ?
Je ne savais quoi répondre. J'ai choisi de ne rien répondre et de regarder bêtement la pointe de mes chaussures.
– Montre-moi tes papiers. Est-ce que tu es majeure ? Tu as l'air d'être une petite adolescente. Je ne veux pas d'ennuis avec la police.
À ces mots, j'ai perçu dans sa voix le timbre d'une grande gentillesse. Elle me rappelait la mère de ma mère d'accueil qui avait souvent l'allure d'une femme autoritaire lorsqu'il fallait défendre mes intérêts.
– Oui, j'ai mes papiers.
Heureusement la petite fille de province que j'étais, avait pensé à les prendre avant de partir. Je m'étais souvenu des conseils de ma mère adoptive qui me répétait que je devais toujours les avoir sur moi en déplacement.
– Vous pouvez voir que je suis majeure.
Ouf ! Je me suis dit que j'étais sauvée pour la nuit qui était devenue bien noire et que j'aurais un toit pour ce soir.
– Voulez-vous que je vous paie en avance, lui ai-je demandé.
– Non, ça ira. Je te fais confiance. Mais ne me trahis pas.
Je ne m'étais pas trompée. Cette femme avait un cœur en or.
Première nuit de liberté. J'étais dans une chambre d'hôtel, avec WC et salle de bain sur le palier. J'étais à l'abri, sans me soucier de ce que pouvait penser ma mère et mes sœurs de cœur. Ma seule pensée était pour ma sœur que j'allais retrouver demain ou dans la semaine, j'en étais certaine.
Parisienne
Je me suis réveillée tôt le lendemain matin sous l'insistance des rayons du soleil qui s'obstinaient à balayer mon visage. Il n'y avait pas de volets et les rideaux étaient totalement non occultants.
Assise sur le rebord du lit, mes yeux se sont posés sur les tuiles rouges que je pouvais apercevoir par la fenêtre. Je ne voyais que les pointes des toits parisiens. Debout, j'ai observé cette ville mystérieuse et si attractive. J'ai réalisé à ce moment-là que la veille j'avais grimpé plusieurs étages sans ascenseur. J'étais sans le savoir, dans une chambre de bonne, au plus haut de l'hôtel. Le plafond était mansardé, la fenêtre formait une avancée, emboîtée dans un cube rectangulaire. En ouvrant les battants, je voyais de droite et de gauche le toit de l'hôtel. Ça n'était pas une chambre réservée aux clients. En négociant le prix avec la gentille dame de la réception, j'avais induit un classement sur le standing de mon logement.
Mon regard a scruté l'horizon. J'ai regardé longuement les sommets de Paris. Je voyais des dômes de monuments qui étaient probablement des cathédrales. Il y avait un édifice en métal très pointu. J'ai su plus tard que c'était la tour Eiffel. Des alignements de toits rouges se succédaient à ne plus en finir. L'immensité de la ville m'a donné le tournis. Je n'étais plus dans une petite ville de province, mais bien dans la capitale de la France.
Je n'avais rien prévu pour cette deuxième journée. Emportée par mon besoin incontrôlable de retrouver ma sœur, aucun plan de recherche n'avait été envisagé. Je m'étais juste dit que je devais avoir un petit travail au plus vite et que je la chercherais après. Mon expérience dans la boulangerie m'avait rendue confiante dans ma capacité à assumer mes besoins financiers.
La faim m'a alors tourmentée. J'ai compris qu'à mon arrivée j'avais tout simplement oublié de prendre un repas. Ce besoin physique très naturel m'a projetée dans la cruelle réalité de la vie d'adulte.
Ma mère n'était plus là pour me préparer mon chocolat chaud avec mes tartines beurrées. Elle n'avait pas lavé et repassé avec amour les vêtements que j'allais porter aujourd'hui. Elle n'était plus là pour me demander à quelle heure j'allais rentrer ce soir. Elle n'allait pas me préparer ma collation de fin d'après-midi, celle qui m'attendait chaque jour sur la table de la cuisine.
J'ai réalisé naïvement que ma vie à Paris devenait une vie de solitaire, avec ses dangers, comme celui auquel j'avais été confrontée à la gare.
Bien que mon ventre soit douloureux pour cause de famine, je ne parvenais pas à me décider à me lancer dans la vie que j'avais choisie. Je me suis allongée de nouveau, un long moment. La faim a eu raison de mon incapacité à me mouvoir. Je me suis habillée et j'ai descendu les six étages.
La gentille dame n'était plus là. Elle avait été remplacée par un sombre monsieur qui n'a pas daigné me regarder. J'en ai été très déçue, car je voulais lui demander où je pouvais m'acheter de quoi faire un petit-déjeuner. Je suis passée devant lui sans lui adresser la parole.
Je suis sortie dans la rue principale, celle qui avait été la première avenue empruntée par mes chaussures sur le sol parisien. J'étais seule. En plus des crampes d'estomac, j'avais maintenant des angoisses qui me faisaient trembler. Il fallait faire front. J'étais jeune et j'avais l'avenir devant moi.
Je suis entrée dans la boulangerie d'à côté. Les prix étaient plus élevés que ceux que je pratiquais dans celle qui m'avait donné mon premier salaire.
J'ai choisi de prendre une baguette que j'ai dévorée sans scrupules dans la rue. La soif s'est fait sentir. Une épicerie plus grande que celle de mon quartier grenoblois m'a permis d'acheter une boisson.
Le deuxième jour de ma vie d'adulte avait commencé.
Je me suis assise sur un banc. Comment organiser mon avenir ? Tout était si simple lorsque je rêvais dans mon lit douillet entourée de ma famille. Tout devenait réaliste, obscur. J'étais devant une page blanche sans aucune idée de ce que j'allais y inscrire n'y surtout comment j'allais m'y prendre.
J'ai déambulé durant plusieurs heures. Je me suis laissée griser par la beauté des bâtiments, des églises. J'ai avancé sans but. Le soir venu, lorsque j'ai voulu rentrer à l'hôtel, j'ai réalisé que je m'étais perdue. Heureusement je me suis souvenue du nom de la station de métro, Barbés, suivi d'un autre nom. Avec les quelques francs que j'avais en poche, j'ai acheté un ticket et je me suis retrouvée dans la même grande avenue que le matin.
Je suis rentrée dans ma chambre de bonne. La gentille dame m'a accueillie d'un air interrogateur :
– Vous avez passé une bonne journée ? Vous allez bien ?
J'ai émis un petit :
– Ça va. Merci.
À son regard j'ai vu qu'elle comprenait ce que je vivais.
Le lendemain a été en tout point similaire à ce deuxième jour, ainsi que les jours suivants.
Une semaine était ainsi passée avant que Colette, la dame de la réception, m'aborde plus franchement.
– Il faudrait me payer la chambre. Cela fait une semaine que vous êtes là.
– Oui, madame. Je vais le faire tout de suite.
Mon pécule que je croyais gros à mon départ de Grenoble avait fondu de plus de la moitié. Je réalisais naïvement que je devais travailler si je voulais rester vivre ici.
Mais comment faire ?
Depuis le premier jour, les regards inquiets de Colette me faisaient penser qu'une aide pouvait venir de sa part.
– Madame, je n'ai toujours pas trouvé ma sœur. Il faut que je travaille. Est-ce que vous savez comment je peux m'y prendre ?
Colette m'a regardé d'un air entendu. Elle se doutait bien que je finirais par lui poser cette question.
– Écoute ma p'tite. Si tu veux m'aider pour le ménage des chambres, je te loge et je te nourris. Ma hanche me fait mal et j'ai de plus en plus de difficultés à assumer cet hôtel. Je ne peux pas mieux faire pour le moment.
C'était inespéré. J'allais déjà avoir le minimum vital. Pour le reste je verrai plus tard.
C'est ainsi que je suis devenue la bonne à tout faire de Colette. Je faisais le ménage, je tenais la réception puisqu'elle avait demandé au sombre monsieur peu sympathique de partir. Je préparais occasionnellement les repas, je lui faisais la conversation, enfin c'est surtout elle qui parlait, je lui servais de dame de compagnie et de bien d'autres choses.
J'étais heureuse. J'avais un cadre, une ambiance familiale bien différente de celle que j'avais eue, mais qui me convenait. Je n'avais pas assez de liberté, trop de travail à assumer, mais j'étais heureuse de la présence de Colette, satisfaite d'avoir le gîte et le couvert.
Les jours ont passé, les semaines aussi. Je n'avais toujours aucune piste de ce qui m'avait amené à Paris, retrouver ma sœur. Il est vrai que je ne pensais plus vraiment à elle. J'étais libre, je m'étais émancipée et c'était le plus important. J'avais parfois des après-midi de liberté. J'aimais aller sur les Champs Élysées. Je suis souvent rentrée dans des boutiques de luxe sans me rendre compte que les vendeuses me suivaient comme des toutous. Elles devaient penser que j'étais une voleuse à la vue de mes vêtements bon marché.
Après six mois auprès de ma patronne-logeuse-amie protectrice, j'ai réalisé que je travaillais beaucoup pour une paye dérisoire. J'avais réussi à négocier un tout petit argent de poche pour mes besoins personnels. La somme était très maigre et ne me permettait pas d'envisager des lendemains heureux.
Je sentais que j'allais craquer. Je ne voulais pourtant pas en arriver à un conflit avec Colette. Je comprenais qu'elle était seule et que j'étais un réconfort affectif. Au fond, je l'aimais bien. Sa présence me réconfortait également.
Il fallait que je trouve une solution pour que je puisse avoir un salaire convenable et un logement à moi.
Je n'avais pas d'autres amis qu'elle, ni aucune connaissance. J'ai entrepris de me promener dans les rues de Paris. J'espérais trouver une petite affiche comme je l'avais trouvée à Grenoble dans la boulangerie où j'avais travaillé.
« Cherche vendeuse pour les week-ends et les jours fériés ».
Je suis passée devant plusieurs affiches collées sur la vitre de la porte d'entrée des magasins d'alimentation. J'en ai choisi plusieurs où je me suis présentée.
Parmi elles, il y avait une boulangerie-pâtisserie. La boutique était élégante, spacieuse. Il y avait déjà du personnel en plus des patrons. Après quelques négociations, j'ai été engagée par Monsieur et Madame Bertrand. Il a été décidé que je commencerai le lundi suivant et que je travaillerai la semaine. Nous étions mercredi. J'avais quelques jours pour avertir Colette et pour trouver un logement.
J'étais heureuse. J'allais avoir un vrai salaire. Cet établissement était prestigieux aux yeux de la petite provinciale que j'étais. Ils avaient déjà deux vendeuses. Ils semblaient être des pâtissiers renommés. Ce couple avait l'allure d'honnêtes personnes. Je leur ai fait confiance. J'étais entrée dans deux autres établissements avant eux. Les patrons ne m'avaient inspiré que méfiance. J'étais heureuse d'être engagée dans la boulangerie-pâtisserie Bertrand, dans l'espoir d'un avenir heureux.
Je ne pensais plus à ma mère et mes sœurs d'accueil. Je vivais ma nouvelle vie, sans regarder en arrière, comme je l'avais vécue à mon arrivée dans ma famille adoptive. La cassure brutale que le destin m'avait imposée, en m'arrachant à ma mère de sang, avait installé en moi l'idée que toute chose à une fin, et que cette fin amène un renouveau. Je ne prenais pas conscience que ces ruptures laissent d'immenses douleurs. Il m'a fallu des années pour comprendre que ma tendre génitrice était morte de chagrin. Ses enfants lui manquaient. La culpabilité de ne pas leur avoir donné ce qu'elle aurait aimé pour eux, a eu raison de sa santé. C'est en retrouvant plus tard ma famille d'adoption que j'ai réalisé à quel point ma mère avait souffert de mon départ. Depuis je hais les coupures nettes comme celle que je leur ai imposée en quittant Grenoble.
Boulangerie - pâtisserie Bertrand
– Mais tu ne peux pas partir, gémissait Colette. Tu es comme ma fille. Tu n'es pas certaine que ce sont des personnes dignes de confiance. Ces gens sont peut-être malhonnêtes. Tu ne connais pas les risques que l'on peut rencontrer sur Paris. Tu les crois gentils, mais il y en a tellement qui peuvent t'emmener pour te faire faire des choses terribles. Je veux savoir où ils sont. Je veux aller les voir.
Colette argumentait tant et plus. Je répondais par des petites phrases qui montraient que ma décision était prise.
En l'entendant protester, j'ai cru tout d'abord qu'elle ne pensait qu'à elle, à la solitude qui l'attendait le soir, aux chambres qu'il fallait nettoyer après chaque client, à mes heures de présence à la réception que ma jeunesse et mes jolis traits rendaient attrayante.
Plus son discours avançait, plus je comprenais que ses intentions étaient bien plus louables. Mon entêtement à vouloir partir m'aveuglait. Je ne voulais rien entendre.
– Tu sais moi aussi je suis venue de loin. Je ne suis pas née à Paris. J'ai quitté ma mère qui était seule à m'élever. La pauvre, que Dieu ait son âme. Elle faisait des ménages et peut-être d'autres choses pour que nous ayons de quoi vivre. Tu sais, je ne t'ai jamais raconté ce que j'ai subi en arrivant.
Je baissais pudiquement la tête. Je comprenais trop bien ce qui avait pu lui être fait. Je revoyais ce faux gentil monsieur qui était venu m'aborder à la gare. J'avais deviné en la côtoyant que son métier d'hôtelière était la face honorable d'une partie de sa vie.
– Je ne veux pas qu'il t'arrive ce que j'ai vécu, me dit-elle dans un immense soupir.
Elle n'avait pas vraiment formulé ce qu'elle avait vécu. Elle avait probablement été prise par des proxénètes qui l'avaient forcée à la prostitution. Mais elle ne me l'a jamais dit clairement. Je l'ai supposé. Elle était très au fait de tous les dangers que courent les jeunes filles seules dans la capitale.
Après quelques palabres, nous sommes arrivées à un terrain d'entente. Elle ne voulait pas rompre toutes relations avec moi, je voulais rester auprès d'elle tout en ayant un salaire.
– Pour les premiers temps il faut que tu restes dormir ici. Tu as le gîte et le couvert et ce que tu gagnes tu le garderas pour toi. Je ne veux pas te laisser seule. Lundi j'irai avec toi. Ils verront que tu n'es pas isolée dans Paris. Je jugerai par moi-même si tu peux leur faire confiance.
Elle tenait à jouer son rôle de protectrice. J'en ai été agacée, mais j'ai accédé à sa requête. L'idée de chercher en vitesse un autre logement ne me séduisait pas vraiment. Et puis, après tout, elle était ma seule famille à Paris, et je l'aimais bien.
C'était décidé. Je restais sa pensionnaire logée gratuitement.
Depuis quelques mois j'avais intégré une chambre au premier étage, ce qui me permettait d'être plus proche de l'accueil où j'allais garder mon rôle de réceptionniste à la fin de mon travail de vendeuse chez les Bertrand.
Le lundi matin, jour de mes débuts comme vendeuse dans la boulangerie-pâtisserie, nous avons eu une discussion très soutenue où je me suis opposée à ses habits trop clinquants qu'elle trouvait dignes d'une mère qui emmène sa fille à sa première journée d'embauche.
Sa jupe pas assez longue à mon goût, à carreaux bordeaux, son chemisier vert trop soutenu, ouvert jusqu'à la racine de sa poitrine m'avaient amusée si souvent. Mais ce jour-là je m'y suis totalement opposée. L'éducation vestimentaire que j'avais reçue n'était pas la même. Après une longue argumentation où je tenais à lui faire comprendre qu'elle ne m'accompagnerait pas si elle ne se décidait pas à mettre la jupe grise et le chemisier blanc qu'elle avait achetés quelques années auparavant pour l'enterrement de sa mère.
Par ces petits détails, je réalise maintenant que ma mère grenobloise m'avait inculqué des notions d'élégance discrète qui m'ont souvent été utiles.
Nous nous sommes présentées toutes deux à l'heure convenue, sept heures du matin, pour ma première journée de travail. Avant de quitter l'hôtel, je lui avais fait enlever son rouge à lèvres ainsi que la ligne trop longue de son eye-liner.