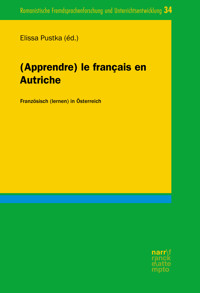
(Apprendre) le français en Autriche E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung
- Sprache: Französisch
Zum ersten Mal widmet sich ein Buch dem Französischen in Österreich. Aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive beleuchtet es, wie das Französische in Österreich als Fremdsprache gelernt und unterrichtet wird (insbesondere im Kontrast zu Deutschland), wie bilinguale Kinder zwischen Französisch und österreichischem Deutsch code-switchen und wie Österreicher*innen das Französische als internationale Sprache (insbesondere der Werbung) in der Wiener Sprachlandschaft wahrnehmen. Das Buch stellt aktuelle empirische Forschungsergebnisse auf Basis korpuslinguistischer Analysen, Online-Befragungen sowie Lehrplan- und Lehrwerksanalysen vor. Daneben liefert es auch zahlreiche neue Unterrichtsideen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mehrsprachigkeit und Diversität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elissa Pustka (éd.)
(Apprendre) le français en Autriche
Französisch (lernen) in Österreich
Publiziert mit finanzieller Unterstützung des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen des FWF-Einzelprojekts (P 29879) Pronunciation in Progress (Pro2F): French Schwa and Liaison.
Elissa Pustka, Institut für Romanistik, Universität Wien, Wien, Österreichhttps://orcid.org/0000-0001-6328-087X
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395768
© 2024 · Elissa Pustka
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2197-6384
ISBN 978-3-8233-8576-9 (Print)
ISBN 978-3-8233-0455-5 (ePub)
Inhalt
Préface
ILes professeurs de français et leurs associations
1La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
1969, cette année-là, on a marché sur la lune. Mais c’est aussi la naissance de la FIPF. En effet, après plusieurs années de travail ensemble, le 23 juillet 1969, à l’occasion d’un dîner à la tour Eiffel, le Belge Louis Philippart et le Français Jean Auba lancent la Fédération internationale des professeurs de français. La toute jeune fédération réunit alors 26 associations nationales du monde entier (cf. Cuq 2019 : 27). Elle se propose de regrouper tous les professeurs de français, qu’ils l’enseignent comme langue maternelle, seconde ou étrangère. Son objectif est de développer des outils et des méthodes pédagogiques. Sa philosophie : le partage d’une langue et des cultures francophones.
Au fil de ses 15 congrès, la fédération va bien évidemment évoluer tout comme le français et les sociétés que cette langue reflète. Les années 1980, c’est l’ouverture à la diversité et l’on se préoccupe d’adapter l’enseignement à la pluralité du monde sans calquer les modèles français, belge ou québécois. En 1988, le congrès de Thessalonique rassemble 1 450 participants. La petite fédération a bien grandi ; avec l’aide de ses partenaires, les ministères français des Affaires étrangères et de l’Education nationale, des Affaires culturelles du Québec et de Belgique, la FIPF est devenue une ONG moderne.
Avec l’effondrement du bloc communiste et l’accès à l’indépendance de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, les adhésions se multiplient, leurs enseignants souhaitant briser leur isolement pédagogique. Les demandes se font plus larges et l’on s’intéresse au français sur objectifs spécifiques que sont le français des affaires, des sciences ou des techniques…
Afin que les enseignants puissent s’appuyer sur une présence francophone élargie, la FIPF collabore avec l’OIF, l’Organisation internationale de la Francophonie. Et en 2000, ce sont 3 000 professeurs de français du monde entier qui se retrouvent à Paris pour leur Xe congrès, au cours duquel Le français dans le monde devient la revue officielle de la fédération.
En 2004, à Atlanta, le congrès réfléchit aux enjeux de la mondialisation et aux défis de la diversité. Cette réflexion aboutira à une déclaration solennelle de la FIPF lors de son 1er congrès européen à Vienne en 2006, en faveur de l’apprentissage effectif d’au moins deux langues vivantes dans tous les systèmes scolaires afin de défendre le plurilinguisme face à l’hégémonie croissante anglophone.
En 2025, c’est Besançon qui accueillera le XVIe congrès de la fédération pour une thématique prometteuse : « Utopies francophones en tous genres ».
50 après sa création, la FIPF participe activement à la création de la Journée internationale des professeurs de français en 2019 et coordonne le comité de pilotage de cet événement qui a lieu depuis chaque année, le dernier jeudi de novembre.
Forte de ses 292 associations et fédérations organisées en 8 commissions1, elle compte aujourd’hui 55 000 membres environ répartis sur 125 pays. La FIPF est ainsi devenue un acteur majeur de l’enseignement du français dans le monde.
Sa plus grande commission, la CEO, Commission de l’Europe de l’Ouest, rassemble plus de 15 000 adhérents aux 89 associations de ses 20 pays allant de l’Islande à Israël. Parmi eux, l’Autriche et l’APFA.
2L’Association des Professeurs de français en Autriche (APFA)
Historiquement, l’Association des Professeurs de français en Autriche (APFA), n’est pas la première association d’enseignants créée en Autriche. Au XIXe siècle, sous l’impulsion d’Hermann Bonitz, philologue et expert étranger nommé au ministère de Vienne, les enseignants se regroupent pour discuter de questions didactiques et de politique éducative. Mais c’est surtout dans les années 1920 qu’apparaissent des associations spécifiques à leurs classes (all. « standesspezifisch ») et à leurs couleurs politiques (cf. Engelbrecht 1988, cité d’après Viehhauser / Lehman 2021).
C’est en 1992, le 22 novembre, dans la bibliothèque de l’Institut français de Vienne, alors situé au palais Clam-Gallas, que fut signé l’acte de naissance de l’APFA en présence de Marc Appert, attaché de coopération éducative et linguistique et d’Ingrid Pleninger, sa première présidente, dans le but de développer, faciliter et renforcer les liens entre les enseignants de et en français, d’encourager, en outre, les relations culturelles, linguistiques, scientifiques et économiques avec la France et les pays francophones.
Depuis sa création, l’APFA compte onze congrès, dont un européen à Vienne en 2006 et deux transfrontaliers à Klagenfurt en 2015 et à Ljubljana en 2018 avec la SDUF. Le dernier en date, celui d’Innsbruck en octobre 2023, à peine clos, que déjà le prochain se profile pour 2025 à Vienne.
Mais l’organisation de tels événements n’est pas la seule activité de notre association. Plus particulièrement parmi beaucoup d’autres, elle lance régulièrement des concours, comme le désormais traditionnel concours d’écriture de haïkus, participe activement à la Journée internationale des professeurs de français, qui en est à sa cinquième édition, et publie l’apfascope, sa revue trimestrielle riche de plus de 90 numéros.
L’APFA s’enorgueillit aussi de l’introduction du français seconde langue vivante à partir de la 3e classe du secondaire qu’elle a implacablement défendue face aux autorités éducatives et obtenue dans 30% des établissements secondaires d’enseignement général.
Bien évidemment, les présidents en charge de l’entreprise ont changé au cours de ces trois décennies. En 2001, le Bureau démissionna et c’est Heinz Janssen qui reprendra le flambeau de la présidence, qu’il passera à Rotraud Roux en 2005. Pendant 18 ans, elle veillera aux destinées de l’association, assurant sa cohésion, sa reconnaissance et sa pérennité. Depuis le mois de novembre dernier, j’ai l’honneur et la tâche de maintenir le cap et de faire en sorte que l’APFA demeure un membre de poids au sein de la CEO-FIPF, un interlocuteur et un acteur important de la présence et de l’enseignement de la langue française en Autriche.
S’adressant aussi aux francophones et francophiles, à tous ceux et celles qui s’intéressent à la langue française et à son rayonnement, l’APFA n’oublie pas que sans les enseignants et les enseignantes du primaire au supérieur, de quelle structure que ce soit, son action et sa présence n’auraient pas lieu d’être.
Maurice Roux
Vice-président de la CEO-FIPF
Président de l’APFA
IILa promotion du français ou « faire le buzz »
Les acteurs de la promotion du français sont multiples : ambassades, instituts et ministères français, universités, associations et certaines organisations comme l’OIF, Organisation internationale de la Francophonie. Cependant, les protagonistes les plus importants sont, à mon avis, les enseignantes et enseignants qui, sur le terrain, essayent de transmettre tous les jours leurs savoirs et leur enthousiasme pour la langue française.
Il faudrait pourtant leur remonter de temps en temps le moral, car la langue de Molière, contrairement à celle de Cervantès, se voit souvent confrontée à de nombreux clichés et préjugés : elle est bien souvent considérée comme une langue très difficile, non seulement par le grand public, mais aussi par les lycéens. De plus, son aire de répartition et son importance géopolitique et économique sont relativement méconnues. Si la prétendue difficulté de sa grammaire est un critère de non-choix du français, sa prononciation en est un autre pour une grande partie des apprenants. Mais est-ce aussi difficile qu’ils le disent ou ne font-ils que reprendre des idées reçues (cf. Dorninger 2018) ?
Robert Marzari (2010) a étudié les degrés de difficulté des sept langues européennes que sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, le polonais et le russe. Il en est arrivé à d’intéressantes conclusions, dont celle que l’anglais n’est pas toujours plus facile et qu’il serait même plus difficile en ce qui concerne la phonétique. Quant au vocabulaire, le français dispose de moins de mots que l’espagnol, l’italien ou l’anglais et même l’allemand, ce qui, selon moi, le rend éventuellement moins complexe et plus rapidement maitrisable. En ce qui concerne les structures, celle de la phrase française semble plus simple que l’anglaise, et celle des textes français moins complexe que l’espagnole ou l’italienne. La conjugaison française est naturellement jugée très difficile (cf. Marzari 2010), quoique.
Cela dépasserait le cadre de cette préface d’y énumérer tous les résultats de l’étude de Mazari (2010), mais elle tend à montrer que l’on fait peut-être tort à la langue de Molière.
Et même si la grammaire française semble compliquée, la conjugaison des verbes réguliers est-elle si difficile ? Phonétiquement, seules la première et la deuxième personne du pluriel des verbes réguliers font bande à part. De plus, 45% des mots anglais viennent du français.1 On pourrait donc facilement profiter de la première langue étrangère (cf. Sahli 2017 : 19, 24) et du fait que l’accent « autrichien », avec sa prononciation douce des occlusives p, t, k dans la plupart des Länder, facilite la prononciation du français. Il suffirait de donner des exemples… Et il existe heureusement de plus en plus de techniques et de moyens didactiques pour mieux mémoriser et faciliter l’apprentissage.
Mais, il y a une chose que les élèves doivent savoir : quelle que soit la langue choisie, il faut s’investir si l’on veut atteindre un certain niveau. « C’est compliqué, mais vous allez voir, on va réussir ensemble », comme le dit Michel Boiron (2013), qui propose des outils opérationnels pour construire une pédagogie de la réussite. L’enjeu étant de rendre l’apprentissage et l’enseignement de plus en plus intéressants et de donner ainsi envie d’apprendre le français.
La diffusion d’une langue est naturellement en étroite relation avec son utilité sur le marché du travail, voire une future vie professionnelle. Et sur ce plan-là, le français n’est pas mal placé : seconde langue parlée sur le continent européen après l’allemand et ses 80 millions de germanophones et seconde langue apprise en Europe. Elle est langue officielle d’une trentaine d’États et présente sur les cinq continents, sans oublier qu’elle est entre autres langue officielle de l’ONU, de ses agences, de l’Union européenne, de l’OTAN, du Comité international olympique et de la Croix rouge internationale. La France est l’un des premiers partenaires économiques de l’Allemagne, ce qui ouvre certaines perspectives professionnelles. Avoir de bonnes connaissances en français ne peut être qu’un plus dans un CV ou dans une recherche d’emploi.
En 2023, les pays les plus visités au monde étaient par ordre décroissant la France, l’Espagne, les Etats-Unis, la Chine, l’Italie, la Turquie, le Mexique et la Thaïlande.
Sur leur page d’accueil, certains établissements donnent des informations aussi précises que concises sur les langues offertes ou, car rien ne remplace le papier, distribuent des prospectus lors de leur journée portes ouvertes.2
Beaucoup d’écoles proposent déjà des séjours linguistiques dans les pays francophones ou organisent des semaines intensives, des échanges scolaires, des sorties au cinéma, invitent des locuteurs natifs et profitent des offres de l’Institut français d’Autriche.
Il ne faut pas non plus oublier l’extrême importance de la visibilité : comment faire que l’on dise du bien du français en dehors des cours et que l’on en fasse la publicité ? En fait, c’est facile : « Faire du cours de français un buzz » (Boiron 2013), en utilisant des documents actuels, surprendre avec de nouveaux procédés didactiques, créer un lien permanent entre la classe et le monde extérieur en organisant des expositions, publier tout ce qu’on a fait sur le site de l’école etc. Pour ce qui en est du choix des thèmes, il faudrait créer du sens et se servir du français pour acquérir des connaissances, des savoir-faire extralinguistiques, bref, en faire un moyen pour découvrir le monde (cf. Boiron 2013).
L’enquête menée auprès des apprenants (cf. Dorninger 2018) a permis de dégager certains thèmes ou domaines, tels que le sport (football, ski, cyclisme ou tennis), le cinéma et la télévision (acteurs et séries), la musique et les grands problèmes sociétaux, qui les intéresseraient plus particulièrement.
Comme les élèves, et vraisemblablement leurs parents aussi, sous-estiment l’utilité du français et l’étendue de son aire linguistique, il semble en plus important de consacrer plus de temps à la présentation de la francophonie, parler de son étendue, de ses richesses, de sa jeunesse et de sa modernité, loin de toutes craintes et de tous clichés réducteurs.
Rotraud Roux
Présidente de l’AMOPA Autriche3
Vice-présidente de l’APFA
Références
Boiron, Michel (2013) : « Faire du cours de français un buzz », https://www.calameo.com/books/002321289dce775bf11d1.
Boiron, Michel (2017) : « Comment motiver et apprendre à motiver ? » (Webinaire), https://www.youtube.com/watch?v=xy8FbRtJWf0.
Cuq, Jean-Pierre (2019) (éd.) : La FIPF, 50 ans d’échanges et de projets dans le monde, http://fipf.org/sites/fipf.org/files/livre_50_ans_fipf.pdf.
Dorninger, Andrea Silva (2018) : Französisch in der Krise? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu Motiven der Fremdsprachenwahl in der Sekundarstufe II mit Fokus auf Französisch, Diplomarbeit, Universität Wien. http://othes.univie.ac.at/52570/1/55214.pdf.
Engelbrecht, Helmut (1988) : Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, volume 5: Von 1918 bis zur Gegenwart, Wien : Österreichischer Bundesverlag.
Marzari, Robert (2010) : Leichtes Englisch, schwieriges Französisch, kompliziertes Russisch: Evaluation der Schwierigkeiten des Englischen, Deutschen, Französischen, Italienischen, Spanischen, Russischen und Polnischen als Fremdsprache, Berlin : Schiler.
Sahli, Alissia (2017) : Fremdsprachenunterricht – Parallelen zwischen Englisch und Französisch nutzen, Vertiefungsarbeit zum Standard 2, Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung Primarstufe, https://blog.phzh.ch/akzente/files/2019/02/2017-VPS_Alissia-Sahli_Bachelorarbeit.pdf.
Viehhauser, Martin / Lehman, Lukas (2021) : « Geschichte des Lehrerinnen- und Lehrerberufs », in : Hascher, Tina / Idel, Till-Sebastian / Helsper, Werner (éds.) :Handbuch Schulforschung, Wiesbaden : Springer, 1–18.
Sitographie
http://fipf.org/qui_sommes-nous/historique.https://www.canalacademies.com/emissions/partager-le-savoir-le-francais-en-partage/fipf-les-professeurs-de-francais-a-letranger/la-fipf-40-ans-racontes-en-5-minutes.
Introduction : la situation du français en Autriche1
À l’heure actuelle, les étudiant.e.s de FLE en Autriche n’ont pas à leur disposition de manuel de didactique qui soit adapté à la situation en Autriche. Les manuels existants (p. ex. Fäcke 22017, Nieweler 2017) traitent exclusivement du FLE en Allemagne. Or, la situation linguistique et didactique diffère considérablement entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse alémanique.
Le français en Autriche
Tout d’abord, la distance géographique et politique par rapport à un territoire francophone n’est pas la même : en Suisse, le français est une langue nationale comme l’allemand (de même que l’italien et le romanche) ; en Allemagne, c’est la langue d’un pays voisin. En partant d’Autriche, il faut en revanche traverser d’abord ou l’Allemagne ou la Suisse alémanique pour arriver dans une région francophone. La France n’a pas non plus les mêmes relations historiques avec l’Allemagne et l’Autriche : d’un côté, la Prusse a accueilli des milliers d’huguenots expulsés après la révocation de l’Édit de Nantes (1598), et la francophilie de Frédéric le Grand (1712‒1786) est légendaire ; de l’autre, les Habsbourg ont marié plusieurs princesses aux rois de France, dont la plus connue, Maria-Antonia (1755‒1793), qui deviendra Marie-Antoinette, à Louis XVI, et pendant le Congrès de Vienne (1814/1815), le français est devenu omniprésent dans la ville.
Ainsi, au XIXe siècle, on parle autant d’un français berlinois („Berlinfranzösisch“) que d’un français viennois („Wiener Französisch“ ; Kreissler 1973, 171). Des emprunts comme Papa, Mama, Café, Restaurant, Feuilleton et Parfüm datent de cette époque entre le XVIIe et le XIXe siècle (cf. Thiele 1993, DWDS). Le purisme anti-français en Allemagne ayant ensuite mené à l’élimination de mots français comme Couvert (remplacé par all. Umschlag), le vocabulaire de l’allemand parlé en Autriche a fini par contenir plus de mots français que celui de l’Allemagne (cf. Kratz 1968 : 474). À cela s’ajoute que la prononciation est souvent différente dans les deux pays, p. ex. all. Champignon [ˈʃampɪnjɔŋ]/[ˈʃampɪnjɔ̃ː], en Autriche aussi [ˈʃampɪnjoːn], all. Garage [ɡaˈʁaːʒə], en Autriche en général avec un [ʃ] final (cf. Duden online).
Ainsi rencontre-t-on aujourd’hui beaucoup de mots d’origine française dans le paysage linguistique viennois : Coiffeur (cf. Fröschl 2017), Boutique, Bijouterie, Confiserie etc. (cf. Pustka 2021). Cette présence visuelle dans les lieux publics peut être explorée avec des élèves afin de leur faire découvrir les possibilités d’apprentissage du français dans leur environnement quotidien (cf. Pustka / Bäumler / Heiszenberger à paraître, Soukoup et al. 2023).
Apprendre le FLE en Autriche
Au niveau de l’enseignement, les différences entre l’Allemagne, la Suisse alémanique et l’Autriche sont également considérables. En Suisse alémanique, tous les enfants apprennent le français en tant que langue nationale comme 1ère ou 2ème langue vivante.1 En Allemagne, ce sont 15,3% des élèves qui ont appris le FLE pendant l’année scolaire 2021/2022. C’est de loin la langue la plus apprise après l’anglais, devant le latin (6,4%) et l’espagnol (5,9%). Dans les régions voisines de la France, le FLE est beaucoup plus répandu que dans le reste du pays : plus de la moitié des élèves en Sarre (51,2%), et respectivement un quart en Rhénanie-Palatinat (25,8%) et dans le Bade-Wurtemberg (24,3%) apprennent le français.2 En Autriche, en revanche, ce sont uniquement 6,3% des élèves qui ont appris le français en 2020/21 (67 531 de 1 080 038 élèves au total), 5,2% le latin, 5,1% l’espagnol et 4,7% l’italien.3 L’apprentissage du FLE est donc beaucoup moins répandu qu’en Allemagne et en Suisse alémanique.
Ces différences s’expliquent aussi par le fait que les langues étrangères jouent un rôle beaucoup moins important en Autriche que dans d’autres pays européens : pendant le premier cycle de l’enseignement secondaire, plus de 90% des élèves apprennent deux langues vivantes entre autres en Finlande, en Italie, au Portugal et en Roumanie. En revanche, ce sont moins de 10% en Bulgarie, en Autriche, en Irlande et en Hongrie (Eurostat 2021).4 En France, ce sont 75,9%, en Allemagne 36,4%.5 En Europe, 98,3% des élèves apprennent l’anglais, 30,5% le français, 22,4% l’allemand et 18,2% l’espagnol.6
La plupart des élèves qui apprennent le FLE en Autriche – 41 806 – le font au collège-lycée d’enseignement général et technologique (Allgemeinbildende höhere Schule, AHS) ; de plus, 20 969 l’apprennent au collège-lycée d’enseignement professionnel (Berufsbildende höhere Schule, BHS). Autrement dit : 19,7% des élèves d’AHS et 15,0% de BHS apprennent le français. Dans les années précédant le bac général (AHSOberstufe), ce sont 34,0% (cf. Statistik Austria 2023).
Au lycée général (Gymnasium7), les élèves apprennent habituellement deux langues vivantes (l’anglais étant dans la plupart des cas la 1ère langue vivante) ainsi que le latin. Ils peuvent aussi remplacer la 2ème langue vivante par le grec ancien et en choisir une 3ème à partir de 15 ans. Contrairement à la France, le latin n’y est pas une option (Langues et Cultures de l’Antiquité) que l’on peut choisir en plus des langues vivantes. Dans les lycées généraux autrichiens (contrairement aux lycées technologiques – Realgymnasien (RG) – et professionnels – BHS), c’est une matière obligatoire8, et des connaissances en latin sont nécessaires pour un nombre important de disciplines universitaires, non seulement pour le latin et l’archéologie (dès le début des études), mais aussi pour la médecine, le droit et les langues, entre autres.9 En revanche, on peut commencer des études de français en tant que grand débutant, le niveau B1 est seulement nécessaire pour commencer le 2ème semestre10, les études menant au niveau C1 (certains programmes même au niveau C2 en Master11). Les lycéens autrichiens apprennent donc ou le latin ou une 2ème langue vivante à partir de 12 ans et l’autre langue à partir de 14 ans.
Le français peut alors être appris comme 1ère langue vivante (à partir de 10 ans, donc pendant 8 ans), ce qui est rarement le cas (cf. infra), comme 2ème langue vivante (à partir de 12 ou 14 ans, donc pendant 6 ou 4 ans) ou comme 3ème langue vivante (à partir de 15 ans, donc pendant 3 ans). Dans le contexte scolaire, on appelle communément les élèves apprenant le français pendant 4 ans « Kurzfranzosen » et ceux qui l’apprennent pendant 6 ans « Langfranzosen » (< all. kurz ‘court’, lang ‘long’, Franzosen ‘Français’). L’enseignement commence par 4 heures par semaine pour se poursuivre avec 3 heures hebdomadaires jusqu’au bac (avec une exception en 5ème pour la 1ère langue vivante ; cf. tab. 1).
Nombre d’heures de FLE par semaine en langues au lycée général en Autriche (cf. programme AHS).
Selon les programmes, les élèves doivent atteindre au bac le niveau B2 du CECR en 1ère langue vivante et en 2ème langue vivante le niveau B1. S’ils apprennent cette dernière depuis 6 ans, le niveau B2 est attendu en lecture (cf. programme AHS). En Allemagne, en revanche, la totalité des compétences en français – généralement 2ème langue étrangère – doit correspondre au niveau B2, et en anglais – généralement 1ère langue étrangère – même au niveau C1 dans la réception de textes (cf. KMK 2012). En Bavière, cela est également le cas pour le français au niveau du bac.12
Alors que l’Allemagne a une longue tradition d’enseignement du FLE en tant que 2ème (et même 1ère) langue étrangère (cf. Reinfried 2017), le français a en Autriche longtemps été enseigné essentiellement à partir de 14 ans, car le latin était obligatoire à partir de 12 ans au lycée général et l’anglais constituait généralement la 1ère langue étrangère (rarement le français ou le russe). Entre 1995/96 et 2005/2006, le français à partir de 12 ans a d’abord été introduit dans le cadre de projets pilotes (cf. de Cillia 2002, de Cillia / Krumm 2010). Aujourd’hui, il existe toute une gamme de langues qui peuvent être choisies à partir de 12 ans : anglais, français, italien, russe, espagnol, tchèque, slovène, bosniaque/croate/serbe, hongrois, croate, slovaque, polonais et romani (cf. programme AHS).
Finalement, le français s’apprend rarement comme 1ère langue vivante en Autriche. C’est le cas notamment dans deux lycées de tradition à Vienne : l’Akademisches Gymnasium et le Theresianum. Ce sont les seuls en Autriche qui proposent un enseignement dans le cadre du programme FIPS (Français intégré aux projets dans le secondaire). Ce programme se caractérise par un enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère (EMILE/CLIL), par exemple des cours d’histoire, de géographie, de musique ou d’E.P.S. en français. De plus, le Lycée Français de Vienne – un établissement de l’État français à l’étranger13 –, fondé en 1946, propose de la maternelle au baccalauréat un enseignement qui suit les programmes français (ainsi que la Matura autrichienne en plus).14 Il accueille environ un tiers d’élèves français, un tiers d’élèves autrichiens et un tiers d’élèves de pays tiers (c.p.). À part ce cas, un diplôme binational correspondant à l’AbiBac (avec un niveau C1 en français15, préparé dans 83 établissements allemands) ou au deutsch-französisches Abitur (fr. baccalauréat franco-allemand; quatre établissements en Allemagne et un en France) n’existe pas en Autriche.16
À l’école primaire, l’enseignement du FLE est courant dans les régions frontalières en Allemagne (cf. Husemann 2017) : dans la Sarre notamment, les élèves apprennent le français à partir de la 3ème classe allemande (correspondant au CE2 français, donc à partir de 8 ans) et dans un quart des écoles même à partir de la 1ère classe (CP).17 En Autriche, seulement 543 élèves (0,2%) ont appris le français à l’école primaire en 2020/21 (cf. Statistik Austria 2023). La Stubenbastei à Vienne est la seule à proposer un cursus de FIP (Français Intégré à l’école Primaire) : mis à part l’allemand et les mathématiques, toutes les autres matières (sciences, musique, E.P.S., arts plastiques, etc.) sont enseignées en binôme allemand/français (avec des locuteur.rice.s natif.ve.s), pendant 5 heures par semaine.18 De plus, cette école propose le projet Papillon. Ici, les instituteur.rices.s intègrent des séquences d’une dizaine à une quinzaine de minutes par jour dans l’enseignement de différentes matières ; pendant une heure par semaine, un.e enseignant.e natif.ve vient en classe.19
Ces trois établissements scolaires – l’Akademisches Gymnasium, le Theresianum et la Stubenbastei – font partie des six en Autriche (dont cinq à Vienne) qui portent le LabelFrancÉducation.20
Les programmes de FLE et les manuels scolaires ne sont pas les mêmes dans les différents pays germanophones. Contrairement à l’Allemagne, qui se caractérise par des programmes très détaillés qui diffèrent d’un Land à l’autre, l’Autriche ne possède qu’un seul programme pour toutes les langues vivantes, qui reprend essentiellement le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR ; Conseil de l’Europe 2018). Il se limite à quelques pages et ne distingue qu’entre lycées généraux et lycées professionnels ainsi qu’entre 1ère, 2ème et 3ème langue vivante. Dans un sondage mené en 2018 auprès de 200 enseignant.e.s de FLE en Autriche et en Bavière, nous avons vu que les manuels les plus utilisés en Autriche sont Perspectives Autriche (indiqué par 59 participant.e.s), À plus! (27), Bien fait! (25) et Cours intensif (17) ; en Bavière, il s’agissait de Découvertes (60), À plus! (45), Horizons (39), Cours intensif (27) et Parcours (25) (plusieurs réponses possibles) (cf. Horvath et al. 2021).
Une autre différence est que la langue première (L1), l’allemand, n’est pas identique dans les trois pays – et leurs régions. Les différences dialectales ont surtout un impact sur l’apprentissage de la prononciation. Les dialectes du nord de l’Allemagne possèdent par exemple uniquement /z/ en position initiale et les dialectes du sud ainsi que ceux de l’Autriche et de la Suisse traditionnellement /s/ (cf. prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/SimAnlaut). L’opposition phonologique /s/:/z/ du français (cf. la paire minimale sceauvs zoo) est donc difficile pour les apprenant.e.s de toutes les régions germanophones, mais le problème concerne en partie l’articulation de la sibilante sourde et en partie celle de la sibilante sonore. L’influence des caractéristiques phonétiques et phonologiques de l’allemand autrichien sur le FLE a récemment été étudiée dans le projet de recherche Pronunciation in Progress : French Schwa and Liaison (Pro2F) (https://pro2f.univie.ac.at; Pustka / Heiszenberger / Courdès-Murphy 2021 ; cf. aussi Hießmanseder 1934). De plus, on note des différences au niveau du vocabulaire : les élèves autrichiens peuvent par exemple profiter du fait qu’il existe de nombreux emprunts français en Autriche qui sont inconnus en Allemagne comme Coiffeur, Fauteuil, retour etc. (cf. supra).
Finalement, la formation des professeur.e.s de FLE est différente. Alors que les études se terminent en Allemagne par un examen d’état (1. Staatsexamen), il s’agit en Autriche d’un diplôme universitaire. Après les études, les diplômé.e.s du 1. Staatsexamen en Allemagne effectuent deux ans de stage accompagnés d’une formation didactique (Referendariat) qui se termine par le 2. Staatsexamen. En Autriche, il n’existe plus que des stages pendant les études ; l’année de stage entre les études et la vie professionnelle (Unterrichtspraktikum) a été supprimée en 2019. De nombreux étudiant.e.s enseignent déjà pendant leurs études de Master.
Pour conclure, chaque pays a sa propre association de professeur.e.s de français : comme la Fédération allemande des professeurs de français (Vereinigung der Französischlehrerinnen und –lehrer e. V., FAPF/VdF), il existe en Autriche depuis 1992 l’Association des professeurs de français en Autriche (APFA ; https://www.apfa.at). Elle publie l’apfascope, son bulletin trimestriel, et organise tous les deux ans un congrès qui réunit une centaine de personnes.
Compte tenu de ces différences considérables entre l’Allemagne et l’Autriche, on comprend la nécessité de ce livre, qui aborde pour la première fois le français en Autriche : il traite d’un côté la présence du français en Autriche, notamment dans le paysage linguistique, de l’autre son enseignement en tant que langue étrangère.
Remerciements
J’aimerais adresser mes remerciements à Daniel Reimann et Andrea Rössler pour avoir accepté ce volume dans la collection « RFU – Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung » et à Kathrin Heyng de la maison d’édition Narr pour avoir accompagné la publication du volume du début à la fin. Je suis très reconnaissante aux nombreux collègues qui ont évalué les contributions dans le cadre d’une procédure évaluation par les pair.e.s en double aveugle et qui ont contribué de manière décisive à la qualité de ce volume. Je remercie en particulier Corinna Koch qui a organisé cette étape pour mon propre article en co-écriture avec Linda Bäumler. Un grand merci finalement à Frédéric Nicolosi pour sa relecture du volume entier !
Vienne, le 5 février 2024 Elissa Pustka
Références
Cillia, Rudolf de (2002) : « Fremdsprachenunterricht in Österreich nach 1945 », in : Lechner, Elmar (éd.) : Formen und Funktionen des Fremdsprachenunterrichts im Europa des 20. Jahrhunderts, Frankfurt, etc. : Lang, 115‒128.
Cillia, Rudolf de / Krumm, Hans-Jürgen (2010) : « Fremdsprachenunterricht in Österreich », in : Sociolinguistica 24.1, 153‒169.
Conseil de l’Europe (2018) : Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre – enseigner – évaluer, Paris : Didier.
Duden online : Wörterbuch der deutschen Sprache. https://www.duden.de/woerterbuch.
DWDS : Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache. https://www.dwds.de.
Fäcke, Christiane (22017) : Fachdidaktik Französisch : Eine Einführung, Tübingen : Narr.
Fröschl, Katrin (2017) : Soggiorni dell’estero davanti alla porta di casa : il francese e l’italiano nel paesaggio linguistico di Vienna, Diplomarbeit Universität Wien.
Hießmanseder, Margarethe (1934) : Phonetische Untersuchung über die französische Aussprache bei Ausländern (Doktorarbeit, Universität Wien).
Husemann, Veit (2017) : « Französischunterricht in der Bundesrepublik Deutschland », in : Nieweler, Andreas (éd.) : Fachdidaktik Französisch. Das Handbuch für Theorie und Praxis, Stuttgart : Klett, 38–47.
KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) (2012) : Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch / Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012) : https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf [02.01.2024].
Kratz, Bernd (1968) : « Deutsch-französischer Lehnwortaustausch », in : Mitzka, Walter (éd.): Wortgeographie und Gesellschaft. Festgabe für L.E. Schmitt, Berlin : de Gruyter, 445‒486.
Kreissler, Félix (1973) : Le français dans le théâtre viennois du XIXe siècle, Paris : PUF.
Lehrplan für allgemeinbildende höhere Schulen (AHS) Oberstufe : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568.
Pustka, Elissa (2021) : « Wo Österreich französisch ist : eine Pilotstudie zur Linguistic Landscape der Wiener Josefstadt (8. Bezirk) », in : Lücke, Stephan / Piredda, Noemi / Postlep, Sebastian / Pustka, Elissa (éds.) : Linguistik grenzenlos : Berge, Meer, Käse und Salamander 2.0 – Linguistica senza confini : montagna, mare, formaggio e salamandra 2.0. Korpus im Text, volume 14 (http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=75170&v=1).
Pustka, Elissa / Bäumler, Linda / Heiszenberger, Elisabeth (à paraître) : « Von café [kaˈfe] zu Kaffee [ˈkafe]: Kontaktlinguistik im Anfangsunterricht – oder sogar davor », in : französisch heute.
Pustka, Elissa / Heiszenberger, Elisabeth / Courdès-Murphy, Léa (2021) : « Comment enseigner le schwa et la liaison ? Ce que nous apprend l’analyse d’un corpus de parole de 145 élèves autrichiens », in : Pustka, Elissa (éd.) : La prononciation dans l’enseignement du FLE : perspectives linguistiques et didactiques, Tübingen : Narr, 17‒46 (open access : https://phaidra.univie.ac.at/o:1563837).
Reinfried, Marcus (2017) : « Die Entwicklung des Schulfachs Französisch », in : Nieweler, Andreas (éd.) : Fachdidaktik Französisch. Das Handbuch für Theorie und Praxis, Stuttgart, Klett, 34–37.
Soukup, Barbara / Pustka, Elissa / Krammer, Lisa / Seereiner, Sophia (2023) : « Citizen Science goes Sprachwissenschaft – Das Projekt ‘VisibLL – Schüler*innen erforschen die (un)übersehbare Mehrsprachigkeit der Wiener Linguistic Landscape’ », in : Wiener Linguistische Gazette 94 : 127–155.
Statistik Austria (2023) : Bildung in Zahlen : 2021‒22 (https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/BiZ-2021-22_Tabellenband.pdf).
Thiele, Johannes (1993) : « Die Schichtung des französischen Wortguts im Deutschen. Streifzüge durch die Geschichte der deutschen Sprache », in : Dahmen, Wolfgang et al. (éds.) : Das Französische in den deutschsprachigen Ländern, Tübingen : Narr, 3‒17.
Acquisition et apprentissage du français en Autriche
Pro2F – le premier corpus d’apprenant.e.s de FLE autrichien.ne.s : protocole d’enquête, conventions de transcription et codage schwa et liaison
1Introduction1
Compte tenu du fait que le français fait partie des langues les plus apprises au monde2 et que sa prononciation est considérée comme particulièrement difficile (cf. Kramer 2010), il est d’autant plus surprenant de constater que l’enseignement de sa prononciation se fait jusqu’à nos jours essentiellement de manière intuitive, sans fondement scientifique, ni en phonétique et phonologie ni en didactique. Les rares études empiriques portant sur la prononciation d’apprenant.e.s de FLE sont très récentes et se basent sur des corpus assez restreints d’étudiant.e.s universitaires. Dans le cadre du programme de recherche international Interphonologie du Français Contemporain IPFC (Racine et al. 2012), 21 équipes de recherche (http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc) ont documenté et analysé en général une douzaine de participant.e.s adultes. La seule exception présente l’enquête IPFC-Norvège, qui comprend aussi des enregistrements de huit lycéens (Andreassen / Lyche 2018). En dehors du programme IPFC, Schmid 2012 étudie 10 élèves entre 16 et 17 ans, et l’un des sept participant.e.s de Trouvain et al. 2013 a entre 15 et 16 ans. La majorité des apprenant.e.s de FLE, cependant, sont des adolescent.e.s en contexte scolaire (30,5% des élèves du premier cycle du secondaire en Europe en 2021).
Le projet de recherche autrichien Pronunciation in Progress : French Schwa and Liaison (Pro2F; https://pro2f.univie.ac.at/), financé de 2017 à 2022 par le Fond Autrichien pour la Science FWF (projet FWF P-29879 ; subvention : 349 644 EUR), comble cette lacune. Il se base sur les deux enquêtes IPFC-allemand dirigées par l’auteure de cet article : IPFC-Munich (2010–2011) et IPFC-Vienne (2015–2017) (cf. Pustka 2015, Pustka / Meisenburg 2017, Pustka / Forster / Kamberhuber 2018). Avant, la seule étude sur la prononciation des Autrichiens en français était Hießmanseder 1934.
L’objectif du projet de recherche Pro2F était d’accomplir la recherche fondamentale nécessaire en linguistique pour améliorer la didactique de la prononciation et ainsi les compétences des apprenant.e.s en FLE. Il fournit le plus grand corpus d’apprenant.e.s de FLE dans le monde (108 heures 45 minutes), le premier grand corpus avec des données de collégiens-lycéens (145 participant.e.s de 12 à 18 ans) et le premier corpus d’apprenant.e.s de FLE en Autriche (Vienne). Ce corpus sera mis à la disposition de la communauté des chercheur.se.s à travers le répositoire de l’université de Vienne Phaidra (https://phaidra.univie.ac.at). Le projet a non seulement permis de renouveler l’état de l’art sur l’acquisition-apprentissage du schwa et de la liaison en FLE, les deux phénomènes qui se trouvaient au centre du projet (cf. Kamerhuber / Horvath / Pustka 2020, Heiszenberger et al. 2020, Pustka / Heiszenberger / Courdès-Murphy 2021, Heiszenberger 2022, Pustka / Heiszenberger / Hartmann 2022), mais aussi de localiser les problèmes de prononciation les plus gênants pour l’intercompréhension (cf. Pustka 2020, 2021a) et de développer sur cette base un grand éventail de matériaux pédagogiques, notamment pour le niveau débutant (cf. Heiszenberger / Jansen 2020, Bäumler / Wagenpfeil 2021, Pustka 2021b).
Cet article donne un large aperçu de la méthodologie du projet Pro2F : il présente le protocole d’enquête (cf. section 2), le travail de terrain (section 3), l’archivage des données, les conventions de transcription, l’anonymisation et le codage du schwa et de la liaison (cf. section 4).3 Il est destiné à informer en détail les utilisateur.rice.s du corpus Pro2F sur la collecte et le traitement des données et à faire profiter de nos expériences les chercheur.euse.s désirant construire leur propre corpus.
2Protocole d’enquête
L’établissement du protocole d’enquête a été la première étape du projet de recherche Pro2F car il a dû être soumis aux autorités autrichiennes avant la soumission du projet de recherche au Fond Autrichien pour la Science (FWF). Ce protocole se base sur la méthodologie des programmes de recherche internationaux (Inter-)Phonologie du Français Contemporain PFC et IPFC, fondés en 1999 et 2008 (cf. Durand / Laks / Lyche 2002, https ://www.projet-pfc.net ; Racine et al. 2012, http ://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/). Dans le cadre du projet Pro2F, la méthodologie a été adaptée à l’âge et au niveau de compétence des participant.e.s ainsi qu’au contexte d’apprentissage et de recherche autrichien. Contrairement au projet IPFC, qui vise à documenter la prononciation en FLE dans le monde entier, nous n’avons pas opté pour des versions bilingues, mais des formulaires uniquement en allemand (cf. section 2.2) et des tâches non seulement en français, mais aussi en allemand (cf. section 2.1).
2.1Tâches
Le projet Pro2F (cf. tab. 1) reprend tout d’abord les tâches de PFC, destinées à des locuteur.rice.s natif.ve.s : une liste de mots avec des paires minimales à la fin et un texte, tous les deux lus à voix haute, ainsi qu’un entretien guidé. Ces tâches sont censées refléter un continuum d’autocontrôle (cf. Labov 1972). De plus, cette triangulation vise à balancer les avantages et inconvénients des différentes tâches, notamment la comparabilité des tâches d’élicitation (surtout pour l’étude des lexèmes de basse fréquence), l’influence de la présence virtuelle de la forme orthographique sur la prononciation en lecture (effet Buben ; Buben 1935, Chevrot / Malderez 1999) ainsi que la validité des données. Étant donné qu’il était difficile de faire parler les participant.e.s de PFC de façon naturelle dans la discussion dite libre (cf. Meisenburg 2003) et les apprenant.e.s d’IPFC dans la discussion entre deux apprenant.e.s (cf. Detey et al. 2018), que la totalité de ces longs enregistrements de parole spontanée n’a rarement été transcrite et analysée et que la prononciation ne différait guère entre ces deux types de parole spontanée, nous avons opté pour un seul enregistrement de parole spontanée, un entretien guidé (cf. section 2.1.3). La reprise de la liste de mots et du texte PFC nous permet de comparer un à un les productions des apprenant.e.s du projet Pro2F à celles des locuteur.rice.s natif.ve.s du programme PFC. De plus, nous avons repris la liste de mots spécifique IPFC-allemand pour les apprenant.e.s germanophones (cf. Chervinski 2013), dont 34 mots font partie de la liste spécifique IPFC pour toutes les L1 (cf. Detey et al. 2018), et rajouté une liste de mots Pro2F pour l’étude du schwa et la liaison (cf. section 2.1.1).
Comme nos premiers enregistrements ont montré que le texte PFC était trop difficile à lire pour des élèves de 12 ans en première année d’apprentissage de FLE, nous avons créé un texte supplémentaire adapté à leur niveau et basé sur un texte du manuel utilisé (cf. section 2.1.2). Pour collecter davantage de données comparables sans l’influence de la graphie, nous avons prévu une tâche de répétition, comme dans le projet IPFC (répétition des listes de mots IPFC-allemand et Pro2F ; cf. section 2.1.1). Comme l’entretien guidé suit un guide d’entretien beaucoup plus strict que dans PFC, cette tâche fournit également des données comparables.
Afin de prendre en compte la L1 allemand et notamment la variété autrichienne des participant.e.s, nous avons ajouté au protocole la lecture du texte allemand « Nordwind und Sonne » (‘Le Vent du Nord et le Soleil’), texte utilisé par l’Association Phonétique Internationale (cf. IPA 1999 ; https ://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-handbook-downloads). L’allemand des élèves enregistré.e.s ne correspond en effet guère aux variétés autrichiennes traditionnelles, mais se rapproche considérablement des variétés parlées en Allemagne ou dans les médias audio-visuels allemands, consommées également en Autriche. Certains détails sont particulièrement importants pour l’analyse du schwa et de la liaison, comme la prononciation du <e> et du <s>. Une partie de nos participant.e.s ne prononce pas par exemple le mot Sonne ‘soleil’ avec /s/ comme traditionnellement en Autriche (cf. https://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/SimAnlaut), mais avec /z/ comme en allemand standard d’Allemagne. Si un.e tel.le locuteur.rice produit une liaison en /s/ au lieu de /z/, cela ne s’explique pas par une interférence phonétique, mais par le graphème <s> (cf. Heiszenberger / Hartmann / Pustka soumis).
Tâche
Durée par élève
Lecture de la liste de mots PFC (94 mots)
4 min.
Lecture de la liste de mots IPFC spécifique pour toutes les L1 + IPFC-allemand + Pro2F (97 mots)
4 min.
Lecture du texte PFC (401 mots, sans titre)
7 min.
Lecture du texte Pro2F « Vacances » (260 mots)
5 min.
Lecture du texte allemand « Nordwind und Sonne »
‘Le Vent du Nord et le Soleil’ (108 mots)
3 min.
Répétition de la liste de mots Pro2F (31 mots)
5 min.
Entretien guidé avec une locutrice native
15 min.
TOTAL
43 min.
Tâches du projet Pro2F (Heiszenberger et al. 2020).
Au total, nous avons prévu 43 minutes pour les enregistrements de chaque élève (cf. tab. 1), contrairement aux deux heures que prend le protocole IPFC (cf. Detey et al. 2018).
Dans la suite de cette section seront présentées les tâches propres du projet Pro2F : la liste de mots Pro2F (cf. section 2.1.1), le texte Pro2F (cf. section 2.1.2) et le guide d’entretien (cf. section 2.1.3).
2.1.1Liste de mots IPFC(-allemand)
Pour le projet Pro2F, nous avons repris la liste de mots du projet IPFC, qui est composé d’un tronc commun pour toutes les L1 (cf. tab. 2) et d’une liste spécifique en fonction de la L1. Pour cette dernière, tou.te.s les responsables de projets IPFC de langues germaniques avaient établi une liste spécifique commune germanique (cf. tab. 3). De plus, Elissa Pustka et Juri Chervinski avaient établi une liste spécifique pour l’allemand (cf. tab. 4).
La liste de mots IPFC pour toutes les L1 complète la liste de mots PFC. Elle contient 34 mots qui recouvrent les oppositions phonologiques suivantes, censées poser problème à tou.te.s, sinon à de nombreux.ses apprenant.e.s de FLE : /ə/ : /e/, /u/ : /y/, /ɑ̃/ : /ɛ̃/, /ɑ̃/ : /ɔ̃/ ; /ø/ : /o/ ainsi que /œ/ : /ɔ/. Les mots de la liste comportent ces phonèmes en position initiale, médiale et finale, idéalement dans des paires minimales, p. ex. le pas vs les pas, bulle vs boule (cf. Detey et al. 2018).
Opposition phonémique
Position
initiale
médiane
finale
/ə/ : /e/
---
le pas/les pas
--
/u/ : /y/
eu/ou
bulle/boule
bu/bout
/ɑ̃/ : /ɛ̃/
Andes/Inde
tante/teinte
tant/teint
/ɑ̃/ : /ɔ̃/
anse/once
panse/ponce
pan/pont
/ø/ : /o/
eux/eau
---
peu/peau
/œ/ : /ɔ/
heure/hors
peur/port
---
Mots communs de la liste spécifique (cf. Detey et al. 2018 : 3).
De plus, la liste spécifique commune germanique (cf. tab. 3) teste l’opposition /ə/ : /e/ dans des mots polysyllabiques, l’opposition entre voyelles tendues et relâchées (p. ex. /y/ : /ʏ/ dans musique vs muscle), les oppositions de sonorité /s/ : /z/, /ʃ/ : /ʒ/, /f/ : /v/, /p/ : /b/, /t/ : /d/, /k/ : /ɡ/ (différentes positions syllabiques pour les fricatives, position finale pour les plosives qui sont sujettes à l’assourdissement final) ainsi que l’opposition des glissantes /w/ : /ɥ/.
Opposition phonémique
Mots / paires minimales
/ə/ : /e/
repartir/répartir/respect, général/revenant
/y/ : /ʏ/
musique/muscle
/s/ : /z/
seau/zoo (position initiale), des seaux/des zoos (position médiane)
/ʃ/ : /ʒ/
chat/jardin (position initiale), hacher/âgé (position médiane), cache/cage (position finale)
/f/ : /v/
file/ville (attaque simple), frais/vrai (attaque complexe devant liquide), griffe/grive (finale)
/p/ : /b/
chope/robe
/t/ : /d/
cote/code
/k/ : /ɡ/
drogue/phoque
/w/ : /ɥ/
oui/huit, Louis/lui
Liste spécifique commune germanique.
Enfin, la liste spécifique IPFC-allemand (cf. tab. 4) contient aussi des paires de mots qui comportent un /a/, suivi ou non de /ʁ/, pour tester si le /ʁ/ est complètement élidé comme en all. Karte [ˈkaːtə] vs fr. carte [kaʁt]. Pour la position en milieu de mot, on y trouve devant /b/ arbitre vsabeille et devant /k/ arctique vs actif, et en finale absolue noix vs noir (cf. Chervinski 2013).
Opposition phonémique
Mots / paires minimales
vocalisation du /ʁ/ après /a/
arbitre / abeille, arctique / actif, noix / noir
Liste spécifique IPFC-allemand (cf. Chervinski 2013).
2.1.2Liste de mots Pro2F
La liste de mots Pro2F vise à recueillir un grand nombre de contextes de réalisation du schwa et de la liaison. Elle contient au total 31 mots et constructions. Cette liste a été utilisée dans le cadre de deux tâches : la lecture d’une deuxième liste de mots (liste IPFC spécifique pour toutes les L1 + liste IPFC-allemand + liste Pro2F ; cf. tab. 1) et la répétition à partir de l’enregistrement d’un présentateur de radio parisien.
La liste contient tout d’abord les contextes les plus importants de réalisation ou de non-réalisation obligatoire des deux phénomènes (pour un état de l’art cf. Pustka / Heiszenberger / Courdès-Murphy 2021). Pour le schwa ont été intégrés des contextes en syllabe initiale, médiane et finale après une et deux consonnes. Un défi particulier pour les apprenant.e.s sont les internationalismes appartement et gouvernement, dans lesquels le schwa est réalisé en français car il se trouve après deux consonnes, contrairement aux mots correspondants en anglais et allemand (cf. Kamerhuber / Horvath / Pustka 2020). Un autre défi pour les apprenant.e.s sont les correspondances graphème-phonème irrégulières, en l’occurrence <on> (dans Monsieur) et <ai> (dans faisait) pour le schwa.
Pour la liaison, la liste contient surtout des contextes obligatoires : pronom personnel + forme verbale conjuguée (nous [z]avons), préposition monosyllabique + pronom personnel (chez [z]elle), adverbe monosyllabique très + adjectif (très [z]intéressant). Nous avons aussi intégré un contexte de liaison facultative rare, après un substantif au pluriel : parcs ([z])impressionnants, réalisé une fois avec et une fois sans liaison par le locuteur modèle dans la tâche de répétition. De plus, la liste contient un certain nombre de constructions figées pour les deux phénomènes comme tout [t]à coup et de temps [z]en temps avec liaison obligatoire et comm(e) ça ou tout l(e) temps où le schwa n’est pas réalisé, même en français méridional (cf. Hansen 1994, Pustka 2007). Le tableau 5 reproduit cette liste en expliquant pourquoi ces contextes ont été choisis.
N°
Mot / construction
Phénomène
Commentaire(s)
1.
tout à coup
liaison
construction figée
2.
comme ça
schwa
construction figée
3.
chez elle
liaison
liaison obligatoire
(préposition monosyllabique + pronom)
4.
tout le temps
schwa
construction figée
5.
de temps en temps
liaison
construction figée
6.
tout de suite
schwa
construction figée
7.
parcs impressionnants
liaison
liaison facultative rare (substantif au pluriel +)
8.
c’est-à-dire
liaison
construction figée
9.
maintenant
schwa
non-réalisation du schwa
(syllabe médiane après 1 consonne ; lexicalisé)
10.
je sais pas
schwa
schwa variable dans les clitiques :
non-réalisation fréquente en parole spontanée
11.
il était une fois
liaison
construction figée
12.
sera
schwa
schwa variable en syllabe initiale après 1 consonne :
non-réalisation fréquente en parole spontanée
13.
jeux olympiques
liaison
construction figée
14.
premier
schwa
réalisation du schwa
en syllabe initiale après 2 consonnes
15.
Mesdames et Messieurs
liaison
construction figée
16.
petit-déjeuner
schwa
non-réalisation du schwa fréquente
en parole spontanée
17.
Monsieur
schwa
schwa correspondant à <on>
18.
faisait
schwa
schwa correspondant à <ai>
19.
premier étage
liaison
liaison obligatoire
20.
semaine
schwa
schwa variable en syllabe initiale après 1 consonne :
non-réalisation fréquente en parole spontanée
21.
Allez-y !
liaison
liaison obligatoire
22.
appartement
schwa
réalisation du schwa
(syllabe médiane après 2 consonnes)
23.
très intéressant
liaison
liaison obligatoire (adverbe très +)
24.
heureusement
schwa
non-réalisation du schwa
(syllabe médiane après 1 consonne)
25.
comment allez-vous ?
liaison
construction figée
26.
gouvernement
schwa
réalisation du schwa
(syllabe médiane après 2 consonnes)
27.
États-Unis
liaison
construction figée
28.
bêtement
schwa
non-réalisation du schwa
(syllabe médiane après 1 consonne)
29.
nous avons
liaison
liaison obligatoire (pronom + verbe)
30.
chemise
schwa
schwa variable en syllabe initiale après 1 consonne
31.
accent aigu
liaison
construction figée
Liste des mots Pro2F (schwa et liaison).
Un certain nombre des mots de cette liste ont été repris du texte PFC pour permettre des comparaisons entre les tâches (jeux olympiques, premier, chemise, bêtement, nous avons). D’autres ont été intégrés pour la même raison dans le texte Pro2F (États-Unis, parcs intéressants, semaine, jeux olympiques, très intéressant, Monsieur, chez elle, appartement, premier étage, heureusement, de temps en temps ; cf. section 2.1.2). Bien évidemment, il est difficile d’éliciter des phénomènes qui apparaissent dans la chaîne parlée, surtout en parole spontanée, dans une liste de mots, notamment les non-réalisations de schwas en début de groupe comme dans j(e) sais pas ou p(e)tit-déjeûner. Nous les avons intégrés tout de même pour tester à quel point ces prononciations seraient éventuellement lexicalisées.
2.1.3 Texte Pro2F
Ayant constaté lors des premiers enregistrements que le texte PFC, créé pour des locuteur.rice.s adultes ayant le français comme L1, était trop difficile pour des apprenants de 12 ans en première année d’apprentissage de FLE, nous avons créé un texte supplémentaire adapté au projet Pro2F, sur la base d’un texte du tome 1 du manuel scolaire utilisé Bien fait! (Luner / Truxa-Pirierros / Wladika 2010). Ce texte de 260 mots, intitulé « Vacances », est reproduit ci-dessous :
Vacances
Alexandre est au Canada et aux États-Unis avec ses parents et sa sœur. C’est une aventure pour tout le monde ! Ils ont loué un camping-car pour être un petit peu plus indépendants. Ils veulent évidemment visiter plusieurs parcs impressionnants, parce qu’ils aiment beaucoup la nature. Ils espèrent voir des oiseaux et des ours. Il y a aussi de grands lacs où on peut faire du canoë. L’eau de ces lacs est plutôt froide, c’est pourquoi la sœur d’Alexandre est un peu déçue.
Marie et son frère Julien passent une semaine en Espagne dans une colonie de vacances au bord de la mer. On peut par exemple y faire du tennis, du hockey et aussi de la natation. Marie essaie presque tous les sports proposés. Elle est vraiment très sportive. Julien préfère regarder le foot à la télé, ou encore les jeux olympiques, qu’il trouve très intéressant. Ils sont dehors toute la journée. Quand ils ne font pas de sport, ils sont à la plage avec leurs copains.
Camille ne part pas en vacances cette année, parce que son père, Monsieur Dubois, doit travailler. C’est pourquoi elle doit rester chez elle dans son appartement au premier étage. Heureusement, sa meilleure amie ne part pas non plus, ce qui est formidable pour elle. Les deux filles font beaucoup de choses ensemble. Quand il fait beau, elles vont à la piscine ou font du vélo. Quand il pleut, elles font du shopping ou regardent la télé. De temps en temps, Camille garde le fils de sa sœur qui a neuf ans.1
Le texte Pro2F ne contient presque que des mots de niveau A1 selon les Référentiels (A1 : Beacco / Porquier 2007, A2 : Beacco et al. 2008, B1 : Beacco et al. 2011, B2 : Beacco / Bouquet / Porquier 2004), contrairement au texte PFC qui contient des mots de tous les niveaux du CECR et au-delà (cf. fig. 1).
Texte PFC :
« Le Premier Ministre ira-t-il à Beaulieu ? »
Texte Pro2F :
« Vacances »
Niveau de vocabulaire des textes PFC et Pro2F.
Dans le texte Pro2F, les mots de niveau A2 sont entre autres Canada, plage, formidable, natation et garder. Des mots de niveau B2 sont par exemple ours, camping-car, aventure, hockey et colonie. Comme les cours de FLE ne mènent en Autriche qu’au niveau B1 au bout de six années d’apprentissage, ces mots ne se trouvent pas dans la série de manuels Bien fait! (Luner / Truxa-Pirierros / Wladika 2010).
Dans le texte PFC, les mots en gras en bas dépassent le niveau de tou.te.s les élèves enregistré.e.s dans le cadre du projet Pro2F (au-delà du niveau B1) :
Le Premier Ministre ira-t-il à Beaulieu ?
Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier Ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d’année. Jusqu’ici les seuls titres de gloire de Beaulieu étaient son vin blanc sec, ses chemises en soie, un champion local de course à pied (Louis Garret), quatrième aux jeux olympiques de Berlin en 1936, et plus récemment, son usine de pâtes italiennes. Qu’est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand honneur ? Le hasard, tout bêtement, car le Premier Ministre, lassé des circuits habituels qui tournaient toujours autour des mêmes villes, veut découvrir ce qu’il appelle « la campagne profonde ».
Le maire de Beaulieu – Marc Blanc – est en revanche très inquiet. La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les élections. Comment, en plus, éviter les manifestations qui ont eu tendance à se multiplier lors des visites officielles ? La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les opposants de tous les bords manifestent leur colère. D’un autre côté, à chaque voyage du Premier Ministre, le gouvernement prend contact avec la préfecture la plus proche et s’assure que tout est fait pour le protéger. Or, un gros détachement de police, comme on en a vu à Jonquière, et des vérifications d’identité risquent de provoquer une explosion. Un jeune membre de l’opposition aurait déclaré : « Dans le coin, on est jaloux de notre liberté. S’il faut montrer patte blanche pour circuler, nous ne répondons pas de la réaction des gens du pays. Nous avons le soutien du village entier. » De plus, quelques articles parus dans La Dépêche du Centre, L’Express, Ouest Liberté et Le Nouvel Observateur indiqueraient que des activistes des communes voisines préparent une journée chaude au Premier Ministre. Quelques fanatiques auraient même entamé un jeûne prolongé dans l’église de Saint Martinville.
Le sympathique maire de Beaulieu ne sait plus à quel saint se vouer. Il a le sentiment de se trouver dans une impasse stupide. Il s’est, en désespoir de cause, décidé à écrire au Premier Ministre pour vérifier si son village était vraiment une étape nécessaire dans la tournée prévue. Beaulieu préfère être inconnue et tranquille plutôt que de se trouver au centre d’une bataille politique dont, par la télévision, seraient témoins des millions d’électeurs.
Au niveau grammatical, le texte Pro2F correspond également au niveau A1, alors que le texte PFC contient des formes du passé composé (a décidé), de l’imparfait (étaient), du participe passé (lassé), du conditionnel (indiqueraient) et du conditionnel passé (aurait déclaré). Étant donné le niveau élevé du texte PFC, nous avons laissé le choix aux élèves de première année du projet Pro2F de le lire ou non pour ne pas intimider et démotiver les plus faibles. Au final, 19 sur 31 de ces élèves l’ont lu.
Le texte Pro2F est non seulement adapté au niveau de français des participant.e.s, mais aussi aux besoins spécifiques du projet Pro2F. Ainsi, il inclut systématiquement les contextes les plus importants du schwa et de la liaison, notamment un certain nombre de contextes de schwa et de liaison de la liste de mots Pro2F (cf. section 2.1.1). Pour la liaison, il contient les contextes morphosyntaxiques et lexicaux obligatoires (cf. Pustka 2016 : 161) suivants (cf. tab. 6) :
Contexte
Exemples dans le texte Pro2F
Déterminant +
aux [z]États-Unis, des [z]oiseaux, des [z]ours, son [n]appartement
Numéral +
premier [ʁ]étage, neuf [v]ans
Pronom clitique + forme verbale conjuguée
ils [z]ont, ils [z]aiment, ils [z]espèrent
Conjonction monosyllabique
quand +
Quand [t]ils, Quand [t]il (2 occurrences)
Prépositions monosyllabiques
en +
en [n]Espagne
chez + pronom
chez [z]elle
Adverbe monosyllabique très +
très [z]intéressant
Constructions figées
États-[z]Unis, jeux [z]olympiques, de temps [z]en temps
Contextes de liaison obligatoire dans le texte Pro2F.
Parmi les contextes facultatifs, le texte Pro2F contient un cas de liaison fréquente, après la préposition monosyllabique dans suivie d’un groupe nominal : dans ([z])une colonie de vacances. De plus s’y trouvent des cas de liaison variable après des formes verbales conjuguées, plus fréquente après c’est et est qu’après sont, vont et passent. Après les adverbes monosyllabiques plus et pas et les substantifs au pluriel (ses parents ([z])et sa sœur, plusieurs parcs ([z])impressionnants, des oiseaux ([z])et des ours, Les deux filles font beaucoup de choses ([z])ensemble), la liaison est rare.
Quant au schwa, nous avons veillé à ce que les contextes suivants soient présents : tout l(e) monde, un p(e)tit peu et parc(e) que (constructions figées ; cf. Pustka 2007) ainsi que certains mots et constructions de la liste de mots Pro2F (cf. section 2.1.1).
2.1.4Guides d’entretien
Pour faire parler les apprenant.e.s de manière spontanée, nous avons opté pour un entretien avec une locutrice native du français provenant de la France septentrionale (la même pour tou.te.s les participant.e.s), suivant un guide d’entretien. Ce guide se base sur celui du projet IPFC pour le niveau A1–B1 (cf. Detey et al. 2018) en ce qui concerne les questions sur les voyages et le rapport à la langue française, et sur le manuel scolaire utilisé (Bien fait!, Luner / Truxa-Pirierros / Wladika 2010) pour ce qui est des thèmes de l’école, des loisirs et de la famille. De même que dans le cadre du projet IPFC, nous avons préparé deux guides d’entretien en fonction du niveau de français, dans notre cas un guide de base pour les niveaux A1–A2 (voir en bas) et des questions supplémentaires pour le niveau B1. Afin de pouvoir s’adapter à des informateur.rice.s plus ou moins bavard.e.s, nous avons prévu des questions obligatoires (en gras) et facultatives. Voici le guide d’entretien pour les niveaux A1–A2 :
Guide d’entretien A1–A2
Généralités :
Tu as quel âge ?*
Quelle est ta nationalité ?
École :
Qu’est-ce que tu vois dans cette pièce ?
De quelle heure à quelle heure tu as cours ?
Qu’est-ce que tu aimes à l’école ? Quelle est ta matière préférée ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que tu n’aimes pas à l’école ?
Environnement :
Qu’est-ce que tu aimes à Vienne ?
Décris le chemin pour aller de chez toi à la gare la plus proche.
Fêtes :
Qu’est-ce que tu fais à ton anniversaire ? (famille/copains ?)
Tu fêtes Noël comment ?
Loisirs :
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? (musique, cinéma, sport, etc.)
Qu’est-ce que tu aimes manger ?
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances ?
Tu t’habilles comment ?
Amis/Famille :
Où est-ce que tu aimes rencontrer tes amis ?
Décris ton meilleur ami !
Raconte-moi quelque chose sur ta famille !
Voyages :
Tu as déjà voyagé dans un pays étranger ? Si oui, raconte ton/tes voyage(s).
Si non, dans quels pays tu aimerais voyager et pourquoi ?
Projets :
Quels sont tes projets pour le futur (professionnels, personnels, etc.) ?
Langues/Le français :
Tu parles quelles langues ?
Quand tu as commencé à étudier le français ?
Pourquoi tu as commencé à étudier le français ?
Qu’est-ce qui est difficile en français ? Qu’est-ce que tu n’arrives pas à faire ?
Quel est le meilleur moyen d’apprendre le français ?
Tu as déjà remarqué des différences en français selon la région où on le parle ?
Où parle-t-on selon toi le meilleur français ?





























