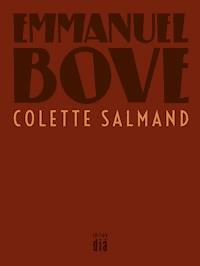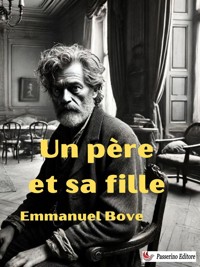1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Armand est le deuxième roman d’Emmanuel Bove, après Mes Amis, dont il est assez proche par le style et le propos. Armand vit avec Jeanne, une veuve plus âgée que lui, qui l’entretient et l’aime tout en lui laissant beaucoup de liberté. Armand ne travaille pas, il se balade souvent pendant la journée et la soirée, et vient à rencontrer un ancien ami, Lucien. Celui-ci n’a pas eu la chance d’Armand, il est resté pauvre, timide, emprunté dans tous ses gestes et mal à l’aise en société, mais c’est le « témoin d’un passé douloureux » pour le narrateur. À part une incartade d’Armand avec la jeune sœur de Lucien et une séparation à la fin du roman il ne se passe rien : pas d’intrigue, pas d’éclat même dans la séparation, pas de passion même dans les moments de douceur, seulement une observation psychologique et physique méticuleuse des faits, un amour du détail poussé à l’extrême, qui apportent un sentiment de malaise et une tension palpables à chaque page. La banalité et la médiocrité, la pauvreté, le malheur tranquille sont omniprésents, mais Bove surpasse cette monotonie en l’érigeant en style d’écriture innovant, qui a fait dire à plusieurs critiques qu’il était un précurseur du « Nouveau Roman ». Samuel Beckett a d’ailleurs dit de lui : « Il a comme personne le sens du détail touchant ».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table of Contents
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
EMMANUEL BOVE
ARMAND
Roman
Éditions Émile-Paul Frères , 1927
Raanan Éditeur
Livre 1233 | édition 1
raananediteur.com
I
Il était midi. À cause du froid, le soleil semblait plus petit. Les vitres et les glaces ne renvoyaient pas ses rayons. Mon attention, comme celle des enfants, se portait sur tout ce qui bougeait. Parfois je caressais la tête d’un cheval, sur le front pour qu’il ne me mordît pas.
Je suivais une rue si étroite que les fouets des voitures me touchaient en passant, lorsqu’une main se posa sur mon épaule.
Je la regardai, puis me tournai.
C’était Lucien. Au lieu de m’appeler, il avait voulu faire la plaisanterie de me toucher dans la rue comme l’eût osé un inconnu.
Je ne l’avais pas vu depuis un an. Il portait le même pardessus, une autre cravate, le même chapeau. Il n’avait pas grossi ni maigri. Pourtant il était différent. Il vivait dans mon souvenir sans rides, sans coupures, sans cette fossette du menton trop profonde pour qu’il pût la raser.
Je m’arrêtai. Notre haleine, dans le froid, s’échappait à contre-temps. Je remarquai autour de ses yeux une sorte d’affaissement qui donnait à son visage une expression triste et maladive. À ces endroits, la peau plissée battait à la cadence du cœur. À cause de sa lèvre inférieure, plus épaisse que celle du haut, il paraissait faire la moue. L’os de son nez était saillant, les oreilles, que je m’empresse toujours de regarder de peur de les oublier, brunes, lisses, sans les replis habituels du pavillon, et si petites qu’elles semblaient avoir cessé de grandir avant le corps.
Lucien n’avait jamais mis de fleur à la boutonnière intacte de son pardessus. Les revers en étaient déformés. Ses mains, dans les poches déchirées, ne s’appuyaient sur aucun fond.
Nous étions embarrassés, Lucien de m’avoir accosté familièrement, moi d’en paraître importuné. Nous demeurions immobiles. J’attendais qu’il parlât. De le voir si pauvrement vêtu, les années malheureuses que j’avais vécues repassèrent devant mes yeux. Je les avais oubliées petit à petit. Maintenant elles étaient aussi nettes que si aucun intervalle ne m’en eût séparé.
La fumée des cheminées, comme de petits nuages, masquait parfois le soleil. Au lieu de pendre, les bordures de toile, relevées par le vent, reposaient sur les stores.
À la fin nous fîmes route ensemble. Il se plaça à ma gauche, comme si j’étais une femme, à cause d’un vague respect de ce qui est à droite. À chaque carrefour, il craignait que je ne changeasse de direction sans le prévenir. Je lui disais alors : « tout droit ».
Il était encore midi. Nous traversions les rues, chacun pour soi, sans que l’un de nous se souciât de l’accident qui eût pu arriver à l’autre.
Un café faisait le coin d’un boulevard et d’une place moins grande que les photographies ne la représentent.
J’invitai Lucien à prendre quelque chose.
Nous nous assîmes à la terrasse que trois braseros argentés réchauffaient. Nos pieds écrasèrent des pistaches. Les siphons étaient grillagés pour qu’ils ne fissent pas explosion.
Lucien ôta son chapeau, le posa sur un guéridon, puis, parce qu’il cherchait constamment à deviner les usages, crut soudain qu’un chapeau ne se mettait pas sur une table et le reprit aussitôt.
Une cigarette fumant des deux bouts entre les doigts, la nuque à l’abri contre mon col relevé, je regardais les passants. C’était une distraction de mon père. Depuis sa mort, libéré de la crainte qu’il ne m’eût surpris à l’imiter, je m’applique sans grand plaisir à observer le va-et-vient des gens et à trouver un agrément dans le contraste de leur physionomie.
Lucien avait commandé un café sur lequel flottait une écume semblable à celle de la saccharine. Il était gêné. Ses doigts à peine plus longs les uns que les autres avaient des tics qui faisaient saillir jusqu’au poignet l’os qui les commandait.
Il se tourna vers moi. Il commençait de manger un croissant par la languette du milieu. Nos regards se rencontrèrent. Je me vis, une seconde, jusqu’aux épaules dans ses prunelles. Je baissai les paupières, sans pour cela fermer les yeux. Ils se portèrent tous deux sur son visage entier. Je sentis qu’il s’apprêtait à parler. L’arc de ses sourcils s’accentua. Il ouvrit la bouche, si lentement que ses lèvres retrouvèrent leur rougeur avant de se séparer. J’aperçus sa langue, courte comme ses doigts, se lever pour former un son. J’écoutais déjà. Il fit un geste.
— Comme tu as changé, Armand ! Maintenant, tu dois être riche. Tu ne pourrais plus venir dans notre restaurant. Te souviens-tu de l’année dernière ?
L’eau de Seltz faisait encore des bulles dans mon apéritif. Je tins ma cigarette à l’endroit où elle était sèche pour la lancer. J’en pris une nouvelle. Il y avait tant de soleil que je ne sus si mon allumette flambait.
Je me souvenais en effet de ma vie passée. À présent, c’était fini. Mais je devinai que Lucien, lui, prenait encore ses repas dans les mêmes restaurants, habitait la même chambre.
Pour qu’il ne me reprochât pas d’avoir changé, j’essayai de retrouver les manières timides et grossières de jadis. J’eus honte de mon pardessus chaud, de ma cravate surtout qui était de soie. J’affectai de ne prendre aucun soin de mes vêtements et, quand une goutte tomba sur mon pardessus, je laissai la tache se faire.
Pourtant j’avais beau prononcer les mêmes paroles, exécuter les mêmes gestes, je ne redevenais pas celui que j’avais été. L’aisance dans laquelle je vivais depuis douze mois avait chassé brutalement toutes mes habitudes. Je parlais davantage. Il me semblait que je n’avais plus raison contre les hommes. Ceux qui se plaignaient m’apparaissaient aigris ou privés de clairvoyance à cause de leur état de pauvreté.
Lucien me regarda sans méchanceté, mais avec une insistance qui, dans un endroit clos, m’eût fait rougir. Je ressentis alors cette gêne que me causait quand j’étais enfant des yeux trop près de moi.
Ce jour-là, après dix ans, je redevenais pour un instant timide. Dans un mouvement instinctif, je détournai la tête pour qu’il ne vît pas mes oreilles, pour que les parties de mon corps qui m’échappaient, même dans une glace, ne lui apparussent pas avec netteté.
Je demeurai ainsi quelques secondes. Je crus même que j’allais rougir. Le sang me monta à la tête, mais trop faiblement pour teinter mes joues. Maintenant que j’ai trente ans, je rougis souvent ainsi et je suis seul à le savoir.
Puis reportant mon regard sur Lucien, j’eus conscience qu’il était de chair comme moi-même quand, dans une glace, je regarde sous ma langue.
Il vivait. Ses narines reconnaissaient les odeurs. Un jour que plusieurs de celles-ci étaient mêlées, il les avait séparées, puis énumérées. Il ne confondait pas les bruits qu’il entendait. Il voyait l’heure d’aussi loin que moi. Il respirait à une cadence à peine plus lente que la mienne. La peau de son visage continuait sous son col. Il avait des seins, noirs parce qu’il était brun, du duvet, un nombril plein ou creux selon l’habileté de la sage-femme.
Je repris confiance. C’était un homme semblable à moi qui m’observait. Les tares qu’il découvrait sur mon visage, je les eusse découvertes sur le sien.
D’une table voisine une soucoupe tomba sans se casser. Les stores claquaient au vent. Leurs bras de cuivre montaient et descendaient dans les glissières sèches. Des bouffées d’acide carbonique, venues des braseros, nous enveloppaient. Lucien, chaque fois, toussait sèchement ainsi qu’au commencement d’un rhume.
Les jambes séparées par le pied unique du guéridon, nous faisions attention de ne pas toucher de nos genoux le dessous du marbre. De temps en temps, je surprenais dans sa bouche une réflexion bête. Sans cesse je l’approuvais pour qu’il ne pensât pas que j’étais devenu fier. Mais je sentis que c’était justement cela qui me trahissait.
À un moment, je voulus l’interpeller familièrement, lui donner un nom drôle, comme par le passé. Je n’osai pas : il ne l’eût point toléré.
Je l’examinai à la dérobée. Il avait bu son café. Le verre à la bouche, il attendait que le sucre pas fondu glissât jusqu’à ses lèvres.
Je me rappelai alors qu’il avait ri aux éclats, qu’il s’était emporté. À présent, près de moi, il ne se risquait même pas à parler.
La main entre les jambes pour tirer la chaise, je m’approchai de lui. Il eut un geste de recul.
— Tu as peur de moi ?
— Non, non. C’est un mouvement instinctif.
Il se tut. Comme s’il attendait que je fasse pour rire le simulacre de le frapper, il se raisonnait. Il avait fermé les mains pour que ses doigts, à la merci d’un bruit, ne pussent le trahir.
Tant de frayeur enfantine chez un homme m’émut.
— Lucien, viens donc demain déjeuner chez moi. Je parlerai de toi. Je tâcherai de te trouver une place. On arrangera tout cela. Nous serons mieux qu’ici. Tu verras mon amie. Elle est très gentille. Nous habitons quarante-sept rue de Vaugirard.
— Le déjeuner, c’est à midi ?
— Oui, viens un peu après pour que tout soit prêt.
Un sourire rayonna autour de ses lèvres. Ses yeux bleus se posèrent sur moi plus longtemps que de coutume. Il balbutia quelques mots. Un peu de joie se dégageait de lui.
Il était midi et demi. Les cloches sonnaient toujours. J’appelai le garçon. Il ne vint pas. Je dus chercher un canif dans ma poche pour faire assez de bruit.
Lucien s’était levé. Il attendait que je fusse debout pour mettre son chapeau. Il y avait des miettes de croissant dans les revers de son pantalon. Cependant que je comptais ma monnaie il se chauffa à l’un des braseros, le pardessus ouvert pour que la chaleur atteignît plus vite son corps.
Nous fîmes quelques pas sur le boulevard, avec indécision, sans paraître nous connaître, et nous nous arrêtâmes à côté d’un arbre plus jeune que les autres qui, près de nous, eut un peu l’air d’un tiers.
— Alors, Lucien, je te quitte. Tu sais que je compte sur toi pour demain. Viens sûrement.
Il ne répondit pas. Il baissait les yeux, ce qui donnait à son visage, parce que tous les cils se ressemblent, un air de fillette. Il avait espéré beaucoup plus de notre rencontre. Il ne savait sans doute où aller. Je pensai à l’emmener tout de suite chez moi mais, à cause de Jeanne à qui cela aurait déplu, je n’osai le faire.
Je lui tendis la main. Il la prit, la tint comme un vieillard, celle d’un jeune bienfaiteur, sans que son expression changeât, sans que ses pieds se plaçassent l’un devant l’autre.
— Tu t’en vas déjà, Armand ?
Ses yeux me suppliaient de rester.
— Oui. Jeanne m’attend.
Il lâcha ma main. Je lus sur son visage qu’il eût désiré m’accompagner, me voir entrer chez moi, attendre que seule une porte nous séparât.
Quelques secondes s’écoulèrent. Je demeurais indécis. Je comptais qu’il partirait le premier. Patiemment il attendait que je prisse une décision.
De nouveau je lui tendis la main, franchement, pour qu’il me tendît la sienne même de mauvais gré. Il la serra. Ainsi jointes, elles m’apparurent un instant semblables à quelque en-tête symbolique. Puis je le quittai avec netteté, sans me retourner, sans lui parler de loin.
Je pris une direction quelconque. Dans les rues droites, une heure silencieuses, le vent soufflait aussi fort qu’au-dessus des maisons. Quoique j’avançasse, l’ombre des réverbères conservait la même inclinaison. À l’horizon, les nuages de la veille se pressaient les uns contre les autres comme si, sous d’autres cieux, d’autres nuages les empêchaient de passer.
II
Le lendemain, quand je pénétrai dans la salle à manger, Jeanne, hésitante pour les couteaux, mettait le couvert.
Les battants du buffet étaient ouverts, découvrant trop d’assiettes pour nous deux. La pendule qui ne marche pas marquait midi juste afin de tromper le moins possible. Le soleil qui, dans la matinée, avait éclairé la pièce s’en allait, comme si la journée était déjà finie.
Jeanne avait placé des mimosas dans un vase de verre, bien que je n’aimasse point à en voir les tiges, qu’elle choisissait pourtant, qu’il s’agît de roses ou de violettes, très longues.
Elle était vêtue d’un peignoir japonais qu’elle endossait difficilement à cause des manches qu’elle confondait avec les poches.
Elle s’approcha de moi, m’embrassa à plusieurs reprises. Je me vis contre son corps dans une glace. Elle croyait que j’avais fermé les yeux. Je la tenais par la taille. Sa tête s’était penchée sur mon épaule.
Bien que Jeanne soit de la même grandeur que moi, elle s’efforçait toujours de prendre des attitudes de femme petite.
— Jeanne, habille-toi donc, il va arriver.