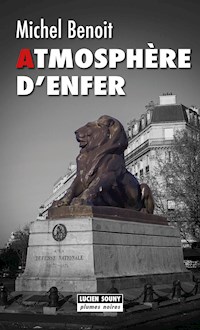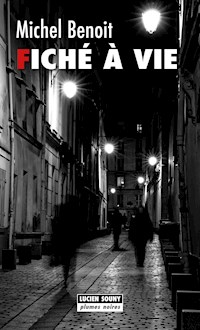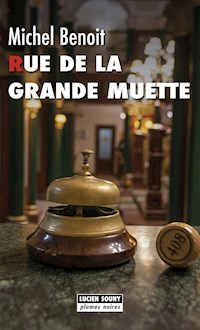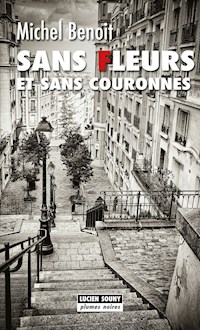Il y a des matins où l’on devrait rester couché. J’aurais dû apprendre par cœur cette maxime depuis mon plus jeune âge, alors que, déjà, portant péniblement mes huit ans, je m’obligeais à me rendre à la communale les jours de composition écrite ! Et puis les années étaient passées et cette devise m’avait prouvé, à chaque occasion, qu’elle n’était pas dénuée de sens et qu’elle méritait qu’on lui consacre toute l’importance qui lui était due. Seulement voilà ! Encore aujourd’hui, les plaisirs de la nuit ne sont pas toujours compatibles avec les
obligations du matin et peuvent très bien nous entraîner dans de drôles de situations.
C’est en sortant de chez une intime connaissance, m’ayant agréablement hébergé l’espace d’une nuit, que je dus en faire, une fois de plus, l’amère expérience. Le lieu : un appartement on ne peut plus bourgeois. La scène : un lit à baldaquin trônant au milieu d’une chambre digne des contes des Mille et une Nuits. Le mobile : la mise en pratique du Kama-sutra en cent vingt leçons, la victime du soir répondant au prénom d’Isabelle – enfin, quelque chose qui ressemblait à ça. Je l’avais rencontrée à la sortie d’un enterrement.
Un vieux copain de la police judiciaire, avec qui j’avais fait les quatre cents coups, avait rejoint saint Pierre, et ce dernier, vu
les bons et loyaux services de mon pote, lui avait volontiers confié les clefs du paradis afin qu’il y retrouve tous les saints du calendrier. Isabelle devait être amie avec la veuve de mon vieux pote. Au premier abord, elle m’avait ému, agenouillée près de l’autel où l’on avait déposé le cercueil. Puis, très vite, j’avais perçu en elle la face cachée de l’iceberg. Et, croyez-moi, je m’y connais assez pour vous assurer que cette fille avait un truc à faire fondre n’importe quel glacier. De quoi me conforter dans l’idée que la religion avait du bon et qu’il était charitable de s’aimer aussi les uns sur les autres.
J’avais toutefois à assurer mon éternelle partie de poker hebdomadaire au Club 500 et je m’y étais rendu, une fois n’est pas coutume, en traînant les pieds. Dans la vie, on ne s’écoute pas assez, et j’aurais dû savoir qu’une partie de poker, quand on n’avait pas un flèche, n’était pas l’idée du siècle. À la sortie, j’étais encore plus endetté et la déprime menaçait sérieusement. Ayant pris soin, tout de même, de demander l’adresse et le numéro de téléphone de celle que je devais appeler plus tard, j’avais tenté ma chance en me présentant sur son palier pour lui faire un brin de causette, histoire de parler du
bon vieux temps.
Il m’arrive, de temps à autre, d’avoir de bonnes idées. Dès que la belle avait ouvert sa porte, j’avais su immédiatement que nous n’allions pas nous contenter de nous regarder dans le blanc des yeux. Certes, la
demoiselle compatissait au deuil de sa brave copine, mais les malheureux s’apaisant souvent en voyant plus désespéré qu’eux, j’avais perçu dans son regard le désir de conjurer la situation et de chasser l’oiseau de mauvais augure qui avait porté ses ailes sur ses proches. C’est ainsi que, durant plusieurs heures, Isabelle s’était donnée sans retenue, comme pour se transformer en offrande à Cupidon et tenter d’oublier que nous n’étions que de pauvres mortels qui, un jour ou l’autre, devraient abandonner, derrière eux, leurs proches, leurs amis, affligés par leur disparition.
Et comme le meilleur moyen de se consoler d’un chagrin est d’en avoir un autre, je l’avais quittée au petit matin pour, certainement, ne jamais la revoir.
C’est en sortant de chez cet ange – ou de ce démon – que je fus accosté par un habitué des lieux, un vieux clochard, lequel, tout affolé, me demanda d’appeler en urgence les archers du roi et les descendants d’Ambroise Paré, dans l’ordre ou le désordre, selon l’humeur. C’était Marcel !
— Il y a un macchabée près du Lion…
Il faisait à peine jour sur la place Denfert-Rochereau et le Lion de Belfort avait fière allure, trônant entre les boulevards Raspail et Arago. Il faut dire que Bartholdi avait mis
tout son cœur à sculpter le roi de la jungle, lequel s’était retrouvé le seigneur de l’un des plus célèbres espaces parisiens. S’il avait dû se sentir quelque peu à l’étroit dans son costume de bronze, alors qu’on l’inaugurait en grande pompe, il avait vite repris du poil de la bête et était redevenu, en quelques dizaines d’années, le roi d’une jungle peuplée de truands de toutes sortes. Il faut bien avouer que le quartier avait bien
changé ces dernières années. L’ombre des fameux apaches de la Belle Époque s’était évanouie, disparue dans la mêlée des deux grandes guerres. Les voyous fréquentant les faubourgs populaires, descendus tout droit des Rocheuses
surplombant Ménilmontant, avaient été remplacés par des malfrats, des malandrins, suivis souvent par des blousons noirs qui
jouaient de la chaîne à vélo faute de tâter du surin. Les petites rues, près des larges artères, débouchant sur la place Denfert-Rochereau, étaient sombres en ce mois de février. Seul l’éclairage de la rue et des vitrines des boutiques donnait un peu de vie à ce quartier où une dangereuse faune s’installait après vingt heures. Passé cette heure, tous les coups étaient permis.
Marcel sentait la vinasse à trois mètres, et bien que je tente de m’écarter de lui pour le laisser délirer, le clochard réussit à m’attraper par la manche d’une main pour mieux désigner le Lion de Belfort de l’autre.
Certes, Marcel était plus qu’alcoolisé, mais mon expérience vécue au 36, quai des Orfèvres m’avait donné pour habitude de vérifier, avant toute chose, les dires de mes interlocuteurs.
— Tu es bien sûr de toi ? Tu ne me racontes pas de salades ?
C’est la main sur le cœur que le clochard me jura, sur la tête de tout ce qui lui était le plus cher, qu’il ne me mentait pas. Ainsi, après avoir traversé la chaussée et nous être avancés sur la grande place, Marcel me désigna quelques sacs en plastique gisant aux côtés d’une longue forme recouverte d’une bâche à carreaux.
— C’est là ! rugit-il.
Debout près du félin de bronze, je ne pouvais que constater qu’à son image, le macchabée qu’on avait déposé à ses pieds n’avait pas l’intention d’aller courir la gueuse… Le type était bel et bien mort !
— Mais enfin, il n’est pas arrivé comme ça au milieu de la place !
— Ça, non ! répondit le clochard. J’ai vu une voiture s’arrêter le long de la place. Un type en est sorti. Il a regardé de gauche à droite, puis, avec un autre, ils ont descendu du véhicule un long paquet, qu’ils ont déposé ici, sur l’un des côtés du Lion. Moi, je m’étais installé à quelques mètres pour passer la nuit.
— Et après ?
— J’ai attendu que la voiture redémarre et je me suis décidé à aller y voir de plus près…
Le clochard semblait sincère. Je le regardais se verser des rasades de vin bon marché dans une timbale en ferraille, qu’il ingurgitait entre deux phrases. Il me raconta la suite sans rechigner un seul
instant, bien trop content d’être la vedette du jour. Pourtant, bien qu’il ait dû en voir de toutes les couleurs dans sa carrière de clochard, il ne se souvenait pas d’avoir été mis en présence d’un tel macchabée, à une heure aussi matinale. Il en était tout chamboulé. Il poursuivit :
— Je jurais par tous les diables quand je me suis aperçu qu’il était vain de vouloir réutiliser le moindre vêtement, tant ceux-ci étaient laminés, voire irrécupérables. Le pauvre type n’avait ni porte-monnaie ni portefeuille ! Pas la moindre pièce dans ses poches ! Rien ! Rien, je vous dis, sauf une carte plastifiée tricolore indiquant qu’il faisait partie de la grande basse-cour. Un flic zigouillé et déposé à deux mètres de mon campement, c’est un truc qui pouvait me coûter cher, ça…
— Tu te souviens des hommes qui l’ont déposé ?
— L’un des deux, je l’ai vu comme je vous vois ! Un grand type noir avec un haut-de-forme et marchant avec une canne ! Je l’ai vu, je vous dis ! s’écria le clochard, toujours affolé par les événements qu’il venait de vivre.
Préférant rester de bronze près de la victime et inspecter les lieux, je demandai à Marcel de téléphoner à la police. Je lui tendis alors quelques pièces en lui précisant de garder la monnaie pour ses faux frais qui, dans son cas, devaient être importants si j’en croyais son haleine. Pas difficile de comprendre que, dans cette situation,
on appelle cela un pourboire ! Le clochard s’éloigna alors en jurant, maudissant les lions, Paris et les condés. Sa voix résonnait autour de la place, couvrant à peine le bruit des pas pressés d’un homme s’appuyant sur une canne et portant un haut-de-forme. Un individu sans visage
venait d’ouvrir, une fois de plus, la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. Il répondait au nom de Baron Samedi.
Un macchabée, enveloppé dans une bâche et jeté sans vergogne, au petit matin, près du Lion de Belfort, à quelques dizaines de mètres de la station de métro Glacière, ça ne s’invente pas. Ça vous glace le sang. Marcel, adopté par les autochtones du quartier, avait fait fissa, et les bleus du commissariat
du XIVe arrondissement ne mirent pas longtemps à arriver sur la place de « l’enfer aux chevaux », comme disait Marcel lorsqu’il avait abusé du Vin des Rochers. Ce n’étaient pas ceux de la brigade de nuit couvrant le secteur – ils étaient sur d’autres missions – qui se présentèrent. Les hommes du commissaire Clérambar avaient été désignés pour établir les premiers constats.
À cinq heures du matin, seuls les livreurs de journaux et de produits laitiers
empruntaient les petites rues du faubourg, et la circulation sur les boulevards
était encore fluide. Tout cela facilita la rapidité de l’intervention des policiers, qui se déployèrent sur la large place, et même au-delà. Ayant déterminé la scène censée être celle du crime, ils la protégèrent en quelques minutes, à la grande fureur de Marcel, qui se retrouvait privé de ses frusques et liquidités, indispensables à sa survie. Menacé d’être emmené au dépôt, il se calma en racontant aux enquêteurs l’aventure peu commune qu’il venait de vivre. Quant à moi, je me demandais ce que je faisais là, au beau milieu de cette effervescence.
Une berline homologuée par la sainte maison poulaga s’arrêta près de la place, toutes sirènes hurlantes. Un quinquagénaire bedonnant en descendit. L’homme s’adressa au chauffeur du véhicule en hurlant à son tour :
— Arrêtez-moi cette sirène qui me casse la tête ! Ma parole, vous voulez réveiller tout le quartier !
Le chauffeur s’exécuta tandis que l’homme s’approchait de moi en écarquillant les yeux.
— Blimiec ? Ici ? Décidément, vous ne pouvez pas vous passer de nous ! lança le commissaire Clérambar en croisant les bras.
Le commissaire Clérambar et moi nous connaissions depuis fort longtemps. Nos premiers contacts
remontaient à mes jeunes années d’inspecteur à la Crim’, alors que j’officiais au premier étage du Quai des Orfèvres. Depuis, nous nous étions revus régulièrement, et le hasard de la vie avait fait que j’avais installé mon agence de détectives dans son secteur d’intervention.
Il poursuivit :
— Je peux savoir ce que vous faites ici à cette heure ?
Que pouvais-je bien répondre ? Que je sortais tout droit du lit d’une jolie blonde dont mon éducation et ma religion m’interdisaient de dévoiler le nom ? La place était truffée de policiers. Je jetai un regard rapide de côté : Marcel était auditionné par l’inspecteur Lafond, la brute épaisse du XIVe, le bourreau de Béthune des salles de garde à vue parisiennes, le Chéri-Bibi des claques et des beignes en tout genre. J’en conclus que l’avenir s’assombrissait : d’ici que mes anciens collègues ne puissent se passer de ma présence auprès d’eux, il n’y avait qu’un pas. Je parle d’anciens collaborateurs, car tous savaient que, dans une autre vie, j’avais opéré, moi aussi, sous l’uniforme avant de rejoindre le Quai des Orfèvres. Puis, finalement écœuré par la bêtise humaine, j’avais jeté insigne, pétard et carte professionnelle aux orties de l’Histoire. J’avais alors ouvert mon propre cabinet de détective, l’agence Mogador, essayant de ne pas trop marcher sur les plates-bandes de la
flicaille. C’est en cela que l’inspecteur Lafond était jaloux, ne supportant pas qu’on puisse être, à plus d’un titre, plus performant que lui. Un tocard de première catégorie qui ne rêvait qu’à une chose : me mettre une bonne fois pour toutes hors d’état de lui nuire.
— Vous entendez, Blimiec ? Que faites-vous ici ? insista le commissaire.
— Je marchais tranquillement pour me dégourdir les jambes ! répondis-je sans trop réfléchir.