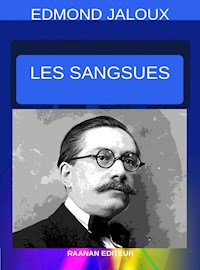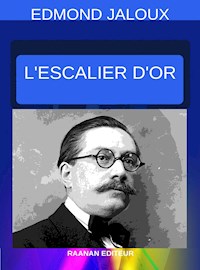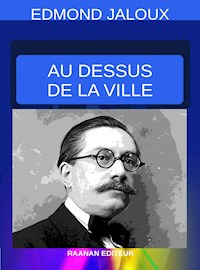
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au dessus de la ville est un roman d'Edmond Jaloux publié en 1927I
Présentation
Extrait
| I
Jusqu’au coucher du soleil, Armand Vautier ne prenait, en somme, qu’une bien faible conscience de sa vie. Il se débattait tout le jour au milieu des soins et des remèdes et n’appartenait qu’aux prescriptions de ses médecins. Mais quand il était couché et qu’il s’enfonçait avec délectation dans les draps froids, sa sœur Constance entrait dans sa chambre et lui faisait la lecture. La fièvre, qui s’allumait alors doucement en lui, donnait en même temps du vague et un certain relief fantastique aux pages qu’il écoutait. Celles qu’il préférait relevaient d’ailleurs des mondes imaginaires. La voix de Constance avait une cadence qui le berçait, et les propres inventions de son cerveau glissaient sur les mots qu’il entendait, comme l’aéroplane sur le sol avant de s’élever. Machinalement, cela l’incitait à faire des projets d’avenir, bien que cet avenir lui fût mesuré. Même par un raffinement de perversité, il s’attribuait moins de mois à vivre que l’état de son mal et la simple logique ne lui en donnaient à première vue. Mais il eût été fâché que sa sœur montrât là-dessus un optimisme qui n’était pas le sien. De mois en mois, à mesure que ses forces déclinaient, il avait fait de sa vie, à la manière des malades, une sorte de religion ; tous les actes y avaient la solennité et l’inflexible retour des rites pieux, et sur chaque sujet un dogme était établi. Sa mort prochaine était un de ces dogmes, comme sa conviction qu’il ne retenait en rien sa sœur auprès de lui, qu’elle demeurait libre, entièrement libre, d’aller et de venir, comme l’idée qu’il n’avait, en tant que poète, qu’un médiocre talent et que c’était une conspiration affectueuse mais inutile, de ses amis, qui tendait à créer autour de lui la légende, sinon d’un génie, du moins d’un grand écrivain, original et personnel en tout. ...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
AU-DESSUS DE LA VILLE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
ÉPILOGUE
EDMOND JALOUX
AU DESSUS DE LA VILLE
ROMAN
Arthème Fayard et Cie, 1927
Raanan Éditeur
Livre 810| édition1
A AUGUSTE BRÉAL
AU-DESSUS DE LA VILLE
I
Jusqu’au coucher du soleil, Armand Vautier ne prenait, en somme, qu’une bien faible conscience de sa vie. Il se débattait tout le jour au milieu des soins et des remèdes et n’appartenait qu’aux prescriptions de ses médecins. Mais quand il était couché et qu’il s’enfonçait avec délectation dans les draps froids, sa sœur Constance entrait dans sa chambre et lui faisait la lecture. La fièvre, qui s’allumait alors doucement en lui, donnait en même temps du vague et un certain relief fantastique aux pages qu’il écoutait. Celles qu’il préférait relevaient d’ailleurs des mondes imaginaires. La voix de Constance avait une cadence qui le berçait, et les propres inventions de son cerveau glissaient sur les mots qu’il entendait, comme l’aéroplane sur le sol avant de s’élever. Machinalement, cela l’incitait à faire des projets d’avenir, bien que cet avenir lui fût mesuré. Même par un raffinement de perversité, il s’attribuait moins de mois à vivre que l’état de son mal et la simple logique ne lui en donnaient à première vue. Mais il eût été fâché que sa sœur montrât là-dessus un optimisme qui n’était pas le sien. De mois en mois, à mesure que ses forces déclinaient, il avait fait de sa vie, à la manière des malades, une sorte de religion ; tous les actes y avaient la solennité et l’inflexible retour des rites pieux, et sur chaque sujet un dogme était établi. Sa mort prochaine était un de ces dogmes, comme sa conviction qu’il ne retenait en rien sa sœur auprès de lui, qu’elle demeurait libre, entièrement libre, d’aller et de venir, comme l’idée qu’il n’avait, en tant que poète, qu’un médiocre talent et que c’était une conspiration affectueuse mais inutile, de ses amis, qui tendait à créer autour de lui la légende, sinon d’un génie, du moins d’un grand écrivain, original et personnel en tout. Sur ces points-là et beaucoup d’autres, aucune discussion n’était possible. Armand tenait toujours prête une bulle d’excommunication majeure à jeter à la tête de tout interlocuteur dissident. Le maintien de ces dogmes ne l’occupait pas moins que les remèdes qu’il absorbait pieusement, mais sans croire à leur efficacité.
La maladie paraît indigne et révoltante à quiconque est arraché brusquement à la pleine santé, mais le mal et Vautier avaient fait connaissance de bonne heure.
Fils d’un homme demeuré veuf encore jeune, et qui nichait, vieillard maussade et tyrannique, dans un château des Ardennes, mi-ferme, mi-gentilhommière, il avait été mis au collège dès sa dixième année. Il s’y était pris d’un tel goût pour l’étude que le travail seul comportait à ses yeux une part de plaisir. A seize ans, comme il le sauvait d’une attaque de grippe, son docteur s’aperçut que, depuis longtemps déjà, sa colonne vertébrale se faussait ; l’omoplate se rabattait lentement sur le poumon gauche, comme le couvercle d’une tabatière. On le renvoya chez lui. Peu après, les premières hémoptysies apparurent, et il lui fallut apprendre dès lors, chaque jour, à se disputer à la mort. Ce marchandage durait depuis des années. Exilé d’abord en Suisse, il y fut pris du dégoût de ces sanatoriums où trente, quarante moribonds réunis regardaient péricliter leurs voisins, et, n’ayant pas la force d’accepter ce voisinage, il commença une vie errante.
A la mort de son père, il découvrit sa sœur, de beaucoup sa cadette et maintenue jusque-là dans un couvent ; belle personne svelte, au teint égal et ivoirin et dont les cheveux gonflaient autour des tempes, comme des grappes de raisins.
Dès leurs premières conversations, il distingua en elle une intelligence encore endormie, à la façon du germe dans le sol, mais toute proche de la sienne. Il se passionna pour cette enfant, non sans l’arrière-pensée, sans doute naturelle aux malades, de se faire aimer d’elle pour la mieux asservir. En même temps, il accomplissait un extravagant périple, séjournant ici ou là, hanté par les illusions des tuberculeux qui croient trouver quelque part un repos nouveau. De Berck à Sils-Maria, de Cannes à Madère, il erra, tantôt plus souffrant, tantôt rebondissant à la vie. Chaque dépaysement lui donnait une amélioration relative, dont il jouissait sans abandonner son cher dogme d’une prompte mort, mais qui ne durait guère et dont il fallait retrouver ailleurs le bien passager. Les médecins avaient renoncé à lui assigner une résidence fixe, le voyant ragaillardi par les sursauts d’une existence qui eût tué tout autre que lui. Sans croire à sa guérison, ils reconnaissaient qu’il administrait très bien sa force vitale, avec une industrieuse sagesse qui les déconcertait.
Cette Constance, enfermée, elle aussi, tout enfant en un cloître, trompant son cœur avec les apprêts du mysticisme, comme on orne de fleurs et de vases d’or un autel vide, n’avait ouvert la porte du monde que pour y connaître un frère en danger. Ses instincts comprimés de dévouement et de tendresse se trouvèrent libérés du coup. Le but que tout être jeune cherche à son incertaine vie fut atteint. Son ardente pitié enveloppa cet être émacié, voûté, demi-bossu, et dont l’intelligence attisait les yeux avides, dans des orbites caves ; mais, en même temps, son propre esprit s’épanouit dans la société d’un homme qui n’était que pensée. Écouter ses remarques, riches de sens, sa conversation, toute en aperçus passionnés et en boutades ; le voir travailler, écrire ses vers ou ses dialogues philosophiques, qu’il recommençait et raturait sans cesse jusqu’à ce qu’il y trouvât cet aigu plaisir personnel, qui était sa mesure de leur perfection ; recopier elle-même ces œuvres rares dont elle attendait le retentissement, dans le cercle très large de lettrés européens, où l’on admirait Vautier ; lui faire la lecture de ses livres préférés, quand le soir venait et, avec lui, la fièvre ; assister aux colloques qu’il avait avec ses amis, écrivains ou érudits, et en particulier avec deux d’entre eux, Pradelle et Bergevin, particulièrement chers à son cœur ; telles étaient les joies de l’austère vie de Constance. Elle n’en eût souhaité aucune autre, n’était l’inquiétude que lui causaient la santé d’Armand et le chagrin de le voir souffrir. Nul des biens de ce monde ne lui semblait avoir le prix de cette existence en commun avec une libre intelligence, qui faisait son miel, à chaque heure, de toutes les fleurs terrestres. L’ivresse de vivre et la peur de mourir donnaient à Vautier une impatience furieuse, qu’il apportait, en quelque sorte, à absorber les éléments de l’univers et à les transformer en substance personnelle ; Constance en recevait l’impression profonde qu’elle vivait double, et triple, tandis qu’elle courait avec son cher malade d’habitacle en habitacle.
La tyrannie se développe comme le lierre ; sitôt un surgeon jeté, en voici un autre, et un autre encore ; elle rampe sournoisement, et sa victime devient pareille à Laocoon, qui ne saurait compter les nœuds qui le privent d’agir. Vautier avait admis une fois pour toutes qu’il respectait et respecterait toujours la liberté de Constance ; ceci dit, nul remords ne troublait sa conscience. Il n’y a pas de vice isolé ; chacun, à peine né, se crée un frère à son image et à l’abri duquel il croît ; cet adjuvant magique, c’est l’hypocrisie. Avez-vous entendu un avare gémir sur son gaspillage ? Il ne gémit que parce qu’il est déjà avare, mais ses plaintes arrivent à le persuader, et il redouble d’avarice. Au surplus, dans le cas qui nous occupe, Constance ne savait point qu’elle était entre les mains d’un despote ; elle appelait sa servitude, dévouement, et tout était prononcé. Un malade a toujours les excuses de ceux qui l’aiment.
Depuis longtemps, les lectures de Vautier l’incitaient à visiter l’Espagne ; son médecin essayait en vain de l’en détourner. Mais il avait constaté, à plusieurs reprises, qu’une déconvenue violente était plus néfaste à Vautier qu’une tentative hasardeuse. Il finit par admettre ce voyage. Un ami andalou dénicha, au-dessus de Grenade, une grande villa à louer, d’où la vue rayonnait sur tout le pays. Armand et sa sœur s’y acheminèrent dans les premiers jours de septembre. Vautier ignorait l’Espagne. En ce pays tout vertèbres, il reconnaissait à chaque coin une figure de Cervantès. Jamais Constance ne l’avait vu aussi content. Pour elle, il faisait miroiter l’orient de son esprit, comme au milieu d’une société de choix. Le pittoresque agissait sur lui à la façon du vin ; il en recevait une chaleur féconde, qui le rendait inventif et gai. Il en oubliait ses fameux dogmes et parlait presque comme chacun de nous, c’est-à-dire comme quelqu’un qui se croit immortel.
Malheureusement, à Grenade, il eut une pleurésie dont il faillit mourir. Il en guérit cependant, mais se trouva de plusieurs degrés descendu plus bas dans l’escalier funeste. Pour la première fois, il se sentit effleuré par l’aile froide, et il eut peur. Il voulut revoir ses manuscrits et décider du choix qu’il y aurait à y faire, posthumement. Il pria donc Constance d’écrire à son meilleur ami, qui devait être son exécuteur testamentaire, de venir le trouver et de passer quelques semaines avec eux à las Delicias.
En l’attendant, ils eurent tout le temps de s’installer dans leur nouvelle demeure. Elle leur avait été cédée par un peintre anglais qui venait de partir pour les Indes. Le confort britannique s’y mêlait à une sorte de luxe espagnol, d’un goût douteux. Située dans un grand jardin, on y dominait Grenade, et l’on s’y sentait très loin de tout, comme s’il n’y avait aucune communication possible entre cette maison isolée et le reste du monde. On y respirait une sorte de repos très noble, mais un peu triste et qui deviendrait vite desséchant.
A peine rétabli, Vautier voulut parcourir le jardin qu’il trouva à son goût, qui mêlait, dans ses arbres, le Nord et le Midi. Mais il ne se montra pas résolu à visiter Grenade.
— Ce que j’en vois me suffit, dit-il à Constance. Je ne veux pas savoir comment bat son cœur, ni comment fonctionnent ses reins.
Cependant, il descendit jusqu’au gâteau de miel de l’Alhambra et parcourut les terrasses et les enclos muets du Généraliffe, tout bruissants de jets d’eau et de feuilles drues. Les images romanesques qu’il rapportait de ces endroits célèbres l’incitaient au travail. Le soir, au lieu d’écouter sa sœur, il lui dicta quelques longues pièces, qui ne contenaient aucune allusion directe à ses visions espagnoles, mais qui leur devaient cependant une sorte de couleur nouvelle. Pour traduire les sentiments de Saint-Just, après la mort de Mlle de Sainte-Amaranthe, ou pour montrer Moïse, au seuil de la Terre Promise, la soupçonnant différente de son rêve, il eut une certaine façon de dépeindre les aspects voluptueux du monde. Constance écoutait avec respect la voix, tantôt bredouillante et tantôt aiguë, de son frère lui confier ces choses, qui lui paraissaient comme engluées encore d’un beau génie natif.
A vrai dire, le choix de Vautier en disait long sur sa volonté de faire dans son œuvre un tri sévère. De tous ses admirateurs, Hugues Pradelle était le plus enthousiaste, le plus juvénile, le moins capable de lui donner un avis impartial. A ses yeux, Vautier n’avait de maîtres et d’émules que parmi les morts ; ici-bas, il rayonnait. Il le voyait pareil au banyan, qui jette ses rameaux jusqu’à terre pour les y enraciner et en faire jaillir une cité de banyans. Vautier, c’était l’avenir. On ne discute pas l’avenir, on protège sa naissance.
Dans son sursaut physique, recevant le souffle pestilentiel du gouffre, Armand n’avait ressenti ni impression de délivrance, ni détachement ; non, bien au contraire, de toutes ses forces il faisait désormais corps avec la vie. Défaillant, il cherchait encore un appui, un excitant à durer. Il n’en connaissait point en ce moment, hors l’admiration d’autrui. Pour obtenir cette admiration, il avait supporté les affres et les privations d’une vie, par bien des côtés, misérable. Elle seule l’avait consolé de tout ; et Constance, comme Pradelle, demeuraient ses encensoirs de choix ; la fumée qu’ils brûlaient devant lui flattait plus doucement ses narines que toute autre. Craignant de mourir, il cherchait confusément ce qui ressemblait le plus à une apothéose, du moins, tant que ses forces physiques l’autoriseraient à se croire un fils de la terre. Car il se doutait bien qu’il toucherait un jour à la zone d’indifférence à la suite de laquelle il n’y a plus rien.