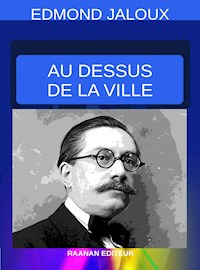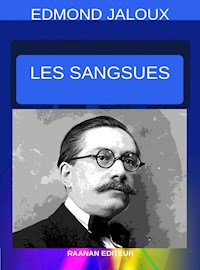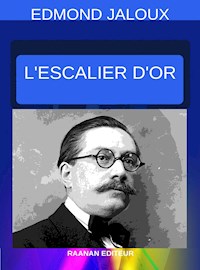1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Reste est silence est un roman d'Edmond Jaloux publié en 1910.
Présentation
Extrait
| I
Je m’en souviens bien, c’était un dimanche. Je n’aimais pas beaucoup ce jour-là ; on me coiffait longuement et minutieusement, on m’habillait avec plus d’élégance que de coutume, et tout cela ne se passait point sans que je fusse un peu bousculé et pas mal grondé. Ensuite, nous allions à la messe, ce qui ne m’amusait pas davantage ; j’avais un livre, et je devais y suivre la cérémonie. Je le revois, ce pauvre livre : il était étroit et long, avec une reliure molle, dont les coins se tordaient et dont la couleur bleue semblait râpée. Je ne savais jamais où en était le prêtre. De temps en temps, je questionnais ma mère ; elle m’indiquait un passage de son doigt ganté, et je lisais, je lisais, avidement, sans aucun souci d’être en rapport avec l’office, puis, quand j’avais une grande avance, je m’arrêtais et tombais dans une méditation profonde. J’étais surtout vexé qu’on me défendît de parler et de tourner la tête quand j’entendais quelqu’un remuer derrière ma chaise.
Mais le plus terrible, le dimanche, c’était l’après-midi. Mon père avait des idées simples ; il voulait que sa femme mît sa plus belle robe et que nous sortissions ensemble. Elle était toute jeune et bien jolie, et il était fier de la montrer à son bras et d’avoir l’air de dire aux gens : « C’est moi, qui suis le mari de cette délicieuse créature… » Mais elle ne prenait pas le même plaisir que lui, elle était loin de partager sur la vie toutes ses opinions, — peut-être même n’en partageait-elle aucune, — et la raison pour laquelle ces deux êtres s’étaient réunis, Dieu seul la sait !...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
LE RESTE EST SILENCE…
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
LE ROI COPHETUA
EDMOND JALOUX
LE RESTE EST SILENCE
ROMAN
P.-V. Stock, éditeur, 1910.
Raanan Éditeur
Livre 809| édition1
LE RESTE EST SILENCE…
I
Je m’en souviens bien, c’était un dimanche. Je n’aimais pas beaucoup ce jour-là ; on me coiffait longuement et minutieusement, on m’habillait avec plus d’élégance que de coutume, et tout cela ne se passait point sans que je fusse un peu bousculé et pas mal grondé. Ensuite, nous allions à la messe, ce qui ne m’amusait pas davantage ; j’avais un livre, et je devais y suivre la cérémonie. Je le revois, ce pauvre livre : il était étroit et long, avec une reliure molle, dont les coins se tordaient et dont la couleur bleue semblait râpée. Je ne savais jamais où en était le prêtre. De temps en temps, je questionnais ma mère ; elle m’indiquait un passage de son doigt ganté, et je lisais, je lisais, avidement, sans aucun souci d’être en rapport avec l’office, puis, quand j’avais une grande avance, je m’arrêtais et tombais dans une méditation profonde. J’étais surtout vexé qu’on me défendît de parler et de tourner la tête quand j’entendais quelqu’un remuer derrière ma chaise.
Mais le plus terrible, le dimanche, c’était l’après-midi. Mon père avait des idées simples ; il voulait que sa femme mît sa plus belle robe et que nous sortissions ensemble. Elle était toute jeune et bien jolie, et il était fier de la montrer à son bras et d’avoir l’air de dire aux gens : « C’est moi, qui suis le mari de cette délicieuse créature… » Mais elle ne prenait pas le même plaisir que lui, elle était loin de partager sur la vie toutes ses opinions, — peut-être même n’en partageait-elle aucune, — et la raison pour laquelle ces deux êtres s’étaient réunis, Dieu seul la sait !
Nous allions donc errer là où les bourgeois du dimanche se réunissent, sous les grands arbres des jardins publics et des boulevards. Je crois que cette lente promenade solennelle m’ennuyait autant que ma mère. En revenant, nous entrions souvent dans un café, — toujours le même. On me donnait un « canard » et je m’amusais longuement de voir le café à la crème creuser un minuscule Maëlström dans le verre de papa, quand on y tournait, très vite, une petite cuiller. Après quoi, mon père tenait à ce que l’on rendît visite à sa sœur. Elle était mariée avec un avoué et avait quatre enfants. C’était une petite femme grosse, rouge, remuante, tracassière, avec une figure large et toujours luisante, comme si on l’huilait chaque matin de peur d’en entendre grincer les articulations. Mais, hélas ! on n’huilait pas de même les ressorts de son caractère, et ils en auraient eu grand besoin. Elle détestait sa belle-sœur ; chaque dimanche, elle lui adressait des paroles désagréables, parce qu’elle était trop élégante, ou parce qu’elle n’avait qu’un fils, ou parce qu’elle était trop jeune, ou bien encore elle établissait des comparaisons fâcheuses entre mon individu et ses quatre rejetons, voyous malpropres, bruyants et grossiers, toujours ivres d’une joie de cannibales et qui me martyrisaient par leurs farces brutales et sournoises. Ma mère et moi, nous nous entendions secrètement dans la même haine et le même mépris de cette famille que mon père adorait. Et le soir, au retour, mes parents se disputaient, maman déclarant que c’était la dernière fois qu’elle mettait les pieds chez sa belle-sœur Irma, qui n’était bonne qu’à la rabrouer, et lui répondant à ma mère qu’elle était d’une susceptibilité ridicule, que sa sœur était excellente et qu’il n’allait pas se fâcher avec elle pour de sottes histoires de femmes… Non, le dimanche n’était pas un jour bien gai…
Mais il y en eut un où tout alla particulièrement mal. Pendant la messe, je me retournai fréquemment pour voir une fillette placée derrière moi et qui avait les plus jolis cheveux du monde, répandus sur ses épaules. Ma mère se pencha plusieurs fois pour me dire : « Si tu ne te tiens pas mieux, tu n’auras pas de dessert… » Le dimanche, mon père portait des gâteaux, et j’étais très gourmand. Mais l’attrait de la désobéissance et celui de la fillette m’incitèrent à ne rien vouloir entendre. Et ma mère déclara : « Tu seras privé de dessert ! » Elle me le dit même beaucoup trop tôt, aussi tournai-je la tête tant que dura la cérémonie.
À la maison, on se mit à table et il y eut une explication orageuse. Ma mère raconta que je m’étais très mal tenu à l’église et que j’étais puni. Je ne disais rien, et regardais mon assiette, d’un air sournois. Mon père me gronda longuement, puis enfin me demanda :
— Tu ne manges pas ?
— Non, je n’ai pas faim.
— Cet enfant est insupportable, s’écria ma mère ; je vous le dis bien, Joseph, il faut l’envoyer à l’école, il en a absolument besoin !
Mon père fit sa plus grosse voix, ce qui avait le don de m’agacer prodigieusement et ne me donnait aucun effroi.
— Écoute, Léon, si tu ne manges pas ta viande, tu ne sortiras pas cet après-midi !
— Je n’ai pas faim, répétai-je obstinément, avec un vif désir, en ne mangeant rien, de punir toute ma famille, coupable de lèse-descendance. J’ajouterai que j’espérais, le repas fini, me rattraper à la cuisine, notre bonne étant toujours prête à favoriser mes pires caprices.
— Tu ne veux pas manger pour nous vexer et parce que tu es privé de dessert. Eh bien, si tu ne finis pas la viande qui est dans ton assiette, je te promets que tu seras également puni, dimanche prochain !
Mais, soudain, ma mère fit une volte-face imprévue.
— Pauvre chéri ! Peut-être bien qu’en effet, il n’a pas faim. Es-tu malade ? Te sens-tu quelque chose ?
— J’ai mal au cœur, déclarai-je, enchanté du tour heureux que prenaient les événements.
— On va te faire du thé, s’écria triomphalement ma mère.
— Quelle bêtise, Jeanne ! Tu vois bien que cet enfant n’a qu’un caprice, et tu vas le prendre au sérieux !
— Mon cher, quand il sera malade, ce n’est pas vous qui le soignerez, n’est-ce pas ? C’est une erreur de toujours croire que les enfants n’ont que des caprices. Ils peuvent être malades aussi, tout comme nous.
Mon père haussa les épaules et continua à manger.
On me servit du thé et j’y trempai quelques galettes. Je regrettais bien les gâteaux, mais j’espérais, au dîner, prendre une éclatante revanche.
Au bout d’une heure, je déclarai aller mieux, et tout le monde s’apaisa. Mon père fumait son cigare, ma mère nous avait quittés pour se recoiffer. Je me glissai à la cuisine, et, comme j’avais grand’faim, je dévorai du pain et du chocolat qu’Élise avait toujours en réserve pour atténuer les incidents de ce genre.
Mon père était dans la chambre de sa femme, quand j’y entrai. Il avait les deux mains dans ses poches et regardait par la fenêtre. Il se retourna lentement et annonça :
— Où irons-nous, cet après-midi ?
Toute la figure de ma mère se plissa, comme si elle éprouvait une grande fatigue et une profonde lassitude.
— Je ne me sens pas bien aujourd’hui, murmura-t-elle. Je crois que je ferais mieux de ne pas sortir…
— Qu’est-ce qui te prend, Jeanne ? Tu ne veux pas sortir ? Est-ce que tu vas avoir des caprices, toi aussi, comme Léon ?
— Je n’ai pas de caprices, mais je suis souffrante, et je trouve plus sage de garder la maison.
Ma mère parlait d’une voix douce et timide, dont l’accent hésitant m’étonnait un peu. Elle affirmait, en général, ses décisions de façon plus catégorique.
— Qu’est-ce que tu feras ?
— Rien, je me reposerai, je lirai…
— Encore un de ces romans imbéciles qui ne sont bons qu’à te fourrer dans la tête des idées fausses ! fit mon père, qui détestait la lecture et abhorrait qu’on ouvrît un livre.
— Comment savez-vous qu’ils contiennent des idées fausses, puisque vous n’en lisez jamais ?
— Tout le monde sait ce qu’il y a dans les romans ! Eh bien, je te le déclare franchement : je trouve mauvais qu’une femme honnête se nourrisse l’esprit d’ouvrages où il n’y a que des événements malhonnêtes !… Alors, c’est décidé, tu restes ?
— Oui.
— Eh bien, je sors, moi. Est-ce que je te laisse Léon ?
— Mais pourquoi ? dit ma mère, avec vivacité. Il faut lui faire prendre l’air à cet enfant.
J’allai m’habiller. J’endossai un petit paletot et je pris une canne que l’on venait de me donner et dont j’étais fier. Elle était faite d’un bambou à gros nœuds saillants, et un sabot de cheval en cuivre argenté la terminait. Au moment de nous embrasser, maman nous demanda, avec une voix qui s’efforçait d’être assurée, mais qui révélait un léger trouble :
— Resterez-vous longtemps dehors ? Irez-vous chez Irma ?
— Sûrement, dit mon père, aussi ne rentrerons-nous pas de bonne heure.
Il prononça cela avec l’assurance triomphante de quelqu’un qui croit vexer profondément son adversaire ; mais il me semble bien maintenant qu’à cette réponse, il y eut sur le visage de sa femme une petite lueur heureuse.
Les paroles échangées à table entre mes parents ne laissaient pas que de m’inquiéter fort. Cette question de ma mise à l’école revenait périodiquement entre eux, pour mon plus grand malheur. J’avais une peur affreuse de tous les collèges. J’étais un petit garçon joli, timide, point vigoureux, et je pensais que ces sortes d’endroits, lycées ou établissements religieux, étaient de sinistres geôles, d’horrifiques bagnes où l’on est harcelé par les professeurs, bousculé par les pions, battu par les élèves, et, lorsque j’y fus plus tard, je ne trouvai pas mes prévisions très exagérées. D’ailleurs, j’avais déjà une certaine expérience de la vie, je connaissais les rapports humains par mes relations avec mes cousins Trémelat de qui j’étais toujours sûr de recevoir quelque mauvais coup. Mon père voulait me garder jusqu’à ma première communion ; on m’enfermerait ensuite dans un collège de jésuites. Ma mère aurait préféré que j’entrasse immédiatement dans un de ces délicieux externats mixtes dirigés par des femmes et où l’on se frotte doucement au monde, tout en travaillant sans fatigue. Elle disait avec sens que la solitude où je vivais finirait par m’ennuyer, et que mon caractère, souvent difficile, émousserait ses angles en se heurtant à d’autres enfants. Papa méprisait des avis si raisonnables et se moquait de ce qu’il appelait « ces marchandes de soupe ». Je crois qu’il désirait surtout occuper ma mère, si jeune et qu’il redoutait de voir désœuvrée. De plus, comme elle possédait tous ses brevets, il n’était pas fâché d’en user un peu. Sans compter la vanité qu’il y a à dire que votre femme est si savante qu’elle instruit elle-même son fils !
Tous les matins, je travaillais donc avec maman, nous faisions ensemble des dictées et des analyses, tant grammaticales que logiques. Elle m’apprenait un peu d’histoire sainte, d’histoire ancienne et de géographie. Les récits de guerre m’enthousiasmaient surtout, comme ils enthousiasment tous les enfants destinés à devenir des hommes pacifiques. J’admirais follement Alexandre, César et Napoléon, et, pendant près d’un an, je fus fou d’Annibal. Je ne sais trop ce qui termina cette passion : ce fut, je crois, d’apprendre qu’il était borgne. Je ne me pus faire à l’idée d’un conquérant ainsi privé d’un œil, et ce fut de ce jour que data ma grande brouille avec lui. J’étudiais aussi le catéchisme et la mythologie, et je dois avouer que celle-ci me passionnait beaucoup plus que celui-là. Je ne me souvenais pas toujours qu’il y eût trois vertus théologales, mais je n’aurais jamais oublié qu’il y avait trois Grâces.
Mon père blâmait fort que l’on m’enseignât une science aussi inutile et, disait-il, aussi frivole, qui ne me serait d’aucun secours dans la vie. Pourtant, j’ai oublié la géométrie, le grec, le latin, la logique et la morale ; il y a des tas de villes et de fleuves que je ne sais où situer, je m’embrouille dans la généalogie des rois de France, peut-être même ne saurais-je faire une division sans faute ; mais je sais qu’Hélène était fille de Léda, Hippolyte, fils d’Antiope, que Pirithoüs voulut aimer Proserpine et que Daphné fut changée en laurier ; et, bien des fois, ces pensées charmantes m’ont donné un doux réconfort. Toutes les arides sciences que j’ai étudiées avec tristesse n’ont déposé dans mon esprit que de sèches et ennuyeuses notions, mais les souvenirs que je conserve des divines légendes de la Grèce ont toujours pour moi la fraîcheur, le mouvement et la réalité de la poésie et de la vie elle-même.
Les aventures de Jupiter et celles d’Hercule, l’enlèvement d’Andromède, la poursuite d’Io, la mort de Phaéton, la métamorphose d’Hyacinthe, tout cela baignait mon esprit d’un délicat enchantement. Heureux les enfants qui, à leur premier pas dans l’instruction, ont été éblouis par le sourire de Vénus et la grâce d’Hélène ! La vie aura pour eux plus de charmes que pour les autres hommes. La mythologie et les contes de fées sont plus nécessaires aux jeunes intelligences que l’orthographe et l’arithmétique.
Peut-être est-ce à cause de l’enseignement de ces dernières, que ces matinées de travail me pesaient si horriblement. J’étais aussi paresseux que gourmand ; il me fallait quitter avec détresse tous mes jeux délicieux, mes forts, mes boîtes de soldats, mes Japonais en terre cuite et mes singes de peluche, pour m’asseoir à une table, écouter des récits et des observations faits le plus souvent d’une voix maussade, respirer la fade odeur de l’encre noire, écrire, lire, ânonner, recevoir de légers coups de règle sur les doigts lorsque je me les fourrais dans le nez ou que je me tirais les cheveux de désespoir. Heureusement pour moi, maman était souvent obligée de sortir le matin. Elle me laissait des devoirs, mais je ne faisais rien, et elle ne me grondait pas en rentrant, parce qu’elle me défendait de dire à papa que, ce jour-là, il n’y avait pas eu de classe. Et, depuis quelque temps, il faut avouer que ces sorties matinales se faisaient de plus en plus fréquentes.
Je n’étais point fort satisfait quand nous descendîmes la rue, mon père et moi, lui tenant entre ses gros doigts nus ma petite main gantée de filoselle blanche. Je voyais passer devant moi l’ombre écrasante du collège, et cela ne me séduisait guère. Je crois qu’il faisait un temps clair de février, mais le dimanche pesait lourdement sur la ville, et les magasins fermés donnaient un air lugubre aux longues rues. Mon père réfléchissait et ne disait rien ; il s’occupait si peu de moi qu’il marchait très vite et que j’avais toutes les peines du monde à ne pas rester en arrière. Nous suivions le chemin coutumier de nos promenades hebdomadaires, machinalement, comme les chevaux d’omnibus, au retour, continuent leur route vers la remise, sans y être dirigés par le cocher.
Nous atteignîmes ainsi des allées plantées de gros arbres, et toutes nues, en ce transparent hiver. Des vieillards se chauffaient au soleil pâle qui déclinait, des gens entouraient un kiosque d’où s’échappaient des bouffées bruyantes de musique militaire. Des nourrices promenaient, en se dandinant, des rubans interminables et de prétentieuses coiffures. Nous entrâmes dans notre café habituel, où maman faisait toujours la moue quand il lui fallait y pénétrer. Mon père y demanda, comme toujours, un café-crème, et l’Illustration pour moi.
Assis sur la banquette de moleskine, devant le vaste journal relié de cuir noir, je m’absorbai dans la contemplation des derniers accidents et des carnages les plus actuels. J’obtins un « canard », du temps passa, j’avais achevé de regarder l’Illustration, et j’attendais, en balançant mes jambes qui pendaient de la banquette trop haute, que mon père eût fini sa pipe. Une horloge sonna. Il sortit la monnaie de sa poche, appela le garçon, et nous nous en allâmes.
Dehors, il tombait une brume fondante et bleue, et, à me sentir loin de maman, dans la rue froide où les becs de gaz avaient des halos d’or, il me vint une de ces profondes tristesses d’enfant que les grandes personnes ne comprennent point. Il me semblait voir dans le brouillard s’ouvrir le porche béant de cet apocalyptique collège où ma famille rêvait de m’engouffrer. J’eus envie de pleurer, et, crispant ma faible menotte en filoselle sur la solide poigne de mon père, je demandai, d’une voix implorante :
— Dis, papa, tu ne me mettras pas au collège ?
— Pourquoi ? répondit-il, d’une voix un peu rude.
— Oh ! je ne veux pas y aller encore !
— Ça dépendra de toi, mon gaillard : si tu es bien sage, bien obéissant, si tu n’as pas de caprices comme tu en as eus à midi, si tu manges ta viande et que tu travailles bien, tu n’iras pas… Sinon, tu auras beau m’implorer, ça ne traînera pas ! Cric, crac…
Il imita de la main le geste que l’on fait en cadenassant une porte. Je compris, je ne sais trop à quoi, que mon père n’était pas décidé à se séparer de moi, et je pensai que c’était par rancune contre maman, qui n’avait pas voulu sortir avec lui… C’était là le seul point de corrélation que je visse entre ces deux incidents…
Nous montions par une rue étroite et grimpante vers le quartier où demeurait ma tante Trémelat. On se serait cru dans une ville abandonnée : personne sur les portes, point de passants, pas même cet étrange magicien qu’est l’allumeur de réverbères, qui s’en va, à la nuit tombante, emportant ce qui reste de jour dans une petite cage de verre où la lumière sursaute et palpite, à chaque pas, comme un papillon à l’agonie. Mon père m’interrogeait sur mes études, et de là, sans qu’il s’en doutât peut-être, ses questions glissaient aux occupations de sa femme.
— Tu travailles bien tous les matins ? Ta mère prend assez de peine pour t’instruire…
— Oui, papa…
Je me gardai bien de faire allusion aux heureuses matinées où maman sortant, je jouais tout à mon aise.
— Il faudrait qu’à partir de maintenant tu t’occupes aussi, après le déjeuner. On travaille, l’après-midi, dans les collèges.
Je hasardai :
— Mais maman n’aura peut-être pas le temps de s’occuper de moi, l’après-midi.
Il répliqua avec brusquerie :
— Pourquoi ? Qu’a-t-elle tant à faire ?
— Mais je ne sais pas, moi…
— Que faites-vous quand vous êtes ensemble ?
— Nous allons dans les magasins ou bien faire des visites aux amies de maman.
— Ah !… Et tu ne vois jamais de petits camarades ?
— Il y a le petit de madame de Thieulles et puis ceux de madame Féline.
— Il n’y a jamais de messieurs chez ces dames, quand vous y allez ?
— Non, papa.
— Et dans la rue, non plus, ni dans les magasins ?… Vous n’en rencontrez jamais ?
Pourquoi tremblait-elle, la voix de mon père, en me faisant des questions aussi bêtes ? Il n’y avait vraiment pas de quoi !
— Non, jamais… Ah ! si ! Nous avons rencontré l’autre jour l’oncle Trémelat, en sortant d’un bazar.
La main de mon père avait fait un soubresaut dans la mienne, au commencement de cette phrase ; puis cela s’était calmé tout-à-coup. Il insista :