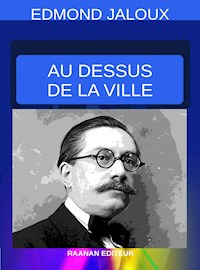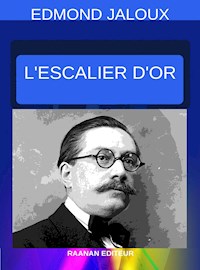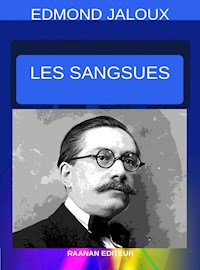
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Sangsues est un roman d'Edmond Jaloux publié en 1901.
Présentation
Extrait
|Le dernier jeudi de chaque mois, M. l’abbé Théodore Barbaroux, directeur de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, réunissait ses professeurs pour causer avec eux de l’avenir de sa maison et de la conduite des élèves.
L’abbé Barbaroux était un petit homme maigre et sec, nerveux et remuant. Il avait le front haut, sous une flottante chevelure grise, où la tonsure grandissait de jour en jour, le nez osseux et envahissant, les joues creusées, la bouche grande et mince, peu de lèvres, un menton de galoche et quelque chose d’ascétique dans toute sa figure austère et labourée de rides. Mais l’expression de loyauté et de franchise, qui sortait de cette physionomie, en corrigeait la rudesse ; et sous d’épais sourcils broussailleux, ses yeux bleus, ingénus, très clairs, gardaient un peu de la confiance et de la droiture d’un regard d’enfant, — lorsque la colère ou une surprise scandalisée n’en faisaient pas deux fontaines d’éclairs. De même, sa voix éclatante conservait un ton jovial, plein de vigueur et d’entrain ; ou bien, elle devenait si sévère que sa sonorité grave et caverneuse et ses accents pathétiquement indignés intimidaient ses auditeurs...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I OÙ LE LECTEUR FERA CONNAISSANCE AVEC L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
II L’ABBÉ THÉODORE BARBAROUX
III L’ENGRENAGE
IV QUI SE TERMINE PAR UN DOUBLE ESPOIR
V UN JEU DE BONNE SOCIÉTÉ
VI COMMENT SE FAIT UN MARIAGE
VII OÙ LES EAUX DORMANTES SE RÉVEILLENT
VIII MADAME PIOUTTE PREND SA FILLE AU PIÈGE
IX UNE NOCE BOURGEOISE
X LE DIGNE MONSIEUR AUGULANTY
XI OÙ LE LECTEUR NE POURRA QU’APPLAUDIR À LA DÉCONVENUE D’UN PERSONNAGE
XII CHAQUE ARAIGNÉE FAIT SA TOILE
XIII OÙ LA VERTU DE MONSIEUR AUGULANTY TRIOMPHE
XIV QUI MONTRE L’UTILITÉ DE LA LOGIQUE
XV ÊTRE OU NE PAS ÊTRE !
XVI DANS LEQUEL MATHENOT EST AIDÉ PAR SA CHANCE, LE HASARD OU LA PROVIDENCE, SELON LA CONVICTION DU LECTEUR
XVII CE QU’IGNORAIT MONSIEUR AUGULANTY
XVIII LES NOUVEAUX FILETS DE MADAME PIOUTTE
XIX CONFLIT DES RÉALITÉS ET DES RÊVES
XX LA PREMIÈRE GORGÉE DU CALICE
XXI L’ABBÉ BONSIGNOUR
XXII OÙ LE LECTEUR EST PRIÉ DE SE RENDRE À L’ENTERREMENT DE COMBETTE
XXIII LES RÉVOLTÉS
XXIV DANS LEQUEL MADAME PIOUTTE TRAVAILLE POUR SON FILS
XXV PRENEZ
XXVI L’OURS ET L’AMATEUR DES JARDINS
XXVII LA JOURNÉE DES DUPES
XXVIII L’ENLÈVEMENT
XXIX LE FRÈRE ET LA SŒUR
XXX L’ŒUVRE DES SANGSUES
EDMOND JALOUX
LES SANGSUES
ROMAN
Plon-Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs
1901
Raanan Éditeur
Livre 808| édition1
IOÙ LE LECTEUR FERA CONNAISSANCE AVEC L’ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Le dernier jeudi de chaque mois, M. l’abbé Théodore Barbaroux, directeur de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, réunissait ses professeurs pour causer avec eux de l’avenir de sa maison et de la conduite des élèves.
L’abbé Barbaroux était un petit homme maigre et sec, nerveux et remuant. Il avait le front haut, sous une flottante chevelure grise, où la tonsure grandissait de jour en jour, le nez osseux et envahissant, les joues creusées, la bouche grande et mince, peu de lèvres, un menton de galoche et quelque chose d’ascétique dans toute sa figure austère et labourée de rides. Mais l’expression de loyauté et de franchise, qui sortait de cette physionomie, en corrigeait la rudesse ; et sous d’épais sourcils broussailleux, ses yeux bleus, ingénus, très clairs, gardaient un peu de la confiance et de la droiture d’un regard d’enfant, — lorsque la colère ou une surprise scandalisée n’en faisaient pas deux fontaines d’éclairs. De même, sa voix éclatante conservait un ton jovial, plein de vigueur et d’entrain ; ou bien, elle devenait si sévère que sa sonorité grave et caverneuse et ses accents pathétiquement indignés intimidaient ses auditeurs. Ce que M. Barbaroux persistait à montrer de toujours jeune, malgré la fatigue et l’usure de l’âge, dans sa personne physique son esprit en témoignait davantage encore. Son enthousiasme, l’ardeur de ses convictions, son optimisme généreux le préservaient de la vieillesse intérieure. Et sa vie, enclose de tous côtés par la foi, qui la garantissait d’une connaissance plus douloureuse et plus réelle du monde, se continuait, intègre, nette et pure, sans hésitation ni défaillance, en sorte qu’il avait, à soixante-sept ans, la même âme sincère et affectueuse, le même culte du devoir et de l’honneur, le même dévouement à ce qu’il nommait le Bien que lorsque, à peine âgé de vingt ans, il entrait à l’École normale.
Ce dernier jeudi de janvier, les professeurs, en arrivant, glacés par la bise, remarquèrent l’air affecté et sombre du vieux prêtre, qui causait avec M. Augulanty, économe de l’établissement, et, pour ainsi dire, son sous-directeur. Le visage grave de l’abbé se contractait et se renfrognait sous l’influence d’un violent chagrin. M. Augulanty, qui faisait toujours de sa figure un reflet de celle du maître, étalait une face inquiète et bouleversée, qui parodiait l’abbé Barbaroux.
Les professeurs entrèrent, par petits groupes, dans la salle d’études du premier étage où ils se réunissaient. Ils saluèrent le directeur, serrèrent la main moite et glissante de M. Augulanty et prirent place autour d’une longue table, creusée et minée par l’ingéniosité des écoliers, qui combattent, comme chacun sait, leur paresse naturelle en exécutant dans le bois des pupitres les travaux les plus pénibles et les plus absorbants.
Après avoir récité trois Pater, trois Ave et un Souvenez-vous, l’abbé Barbaroux donna la parole à ses collaborateurs pour qu’ils lui communiquassent leurs réflexions sur les élèves. Il interrogea successivement M. Bermès, qui faisait la rhétorique, ancien professeur au collège Stanislas et ancien journaliste, un petit homme bavard et gai, potinier et content de soi, puis M. Niolon, rêveur et distrait, au visage pâle, encadré d’une longue chevelure blonde, M. Serpieri, un Corse au visage tanné, colérique et rébarbatif, M. Inart, chargé du cours de mathématiques, et M. Peloutier, poète à ses moments perdus et qui essayait, en les enseignant, d’apprendre les langues vivantes.
Puis on consulta l’abbé Mathenot, qui dirigeait la sixième. Rien n’était plus antipathique à voir que ce grand diable sombre, chafouin, avec sa large figure vulgaire, convertie en passoire par la petite vérole. Sa voix rauque et sourde, ses yeux défiants, sournois, soupçonneux, la maladresse de ses gestes heurtés, tout avait chez lui le même caractère désagréable. Il affichait ce catholicisme haineux, qui semble s’être introduit en France avec le protestantisme. Il ne voyait en tout qu’une occasion de blâme et d’indignation. Mais, détestant surtout les femmes, il en poursuivait partout, avec des diatribes et des invectives, l’odieux souvenir.
Il ne fut pas tendre pour ses élèves. Leur précocité l’effrayait, Il les croyait attirés par les séductions du monde, les attraits du mal, toutes les pompes de Satan.
L’abbé Barbaroux hochait la tête, d’un air désolé. M. Niolon rêvait. M. Peloutier griffonnait des vers sur une carte de visite. M. Augulanty prit la parole. Il s’exprimait avec une voix douce, mellifflue, presque sirupeuse. Il vantait la piété des enfants qui lui étaient confiés ou blâmait leur indifférence religieuse. Il ne soufflait mot ni de leurs travaux, ni de leur intelligence, il ne prenait souci que de leurs âmes.
L’abbé Barbaroux éçoutait avec satisfaction cet archipatelin. Il le préférait visiblement à ses confrères. Et Mathenot reconnut une fois de plus qu’Augulanty plaisait davantage à son directeur en peignant ses élèves comme de beaux petits saints qu’il ne savait le faire en insistant sur leur dépravation et leur précocité. Mais, quoiqu’il détestât Augulanty et voulût le supplanter dans l’esprit de M. Barbaroux, il avait un caractère trop fougueux et trop cassant pour déguiser sa pensée.
Quand la séance fut à peu près finie, l’abbé Barbaroux se leva et, d’une voix étranglée, commença à parler en ces termes :
— Messieurs, j’ai à vous faire une communication si douloureuse pour moi que j’ai à peine la force de vous la confier…
Tous écoutaient. L’étrangeté de ce début confirmait les troubles secrets nés à la vue de l’abbé et de son économe. Théodore Barbaroux continua :
— Messieurs, j’ai le regret de vous apprendre qu’il va se passer ici… un fait… unique… et qui… qui n’était jamais arrivé… à l’école Saint-Louis-de-Gonzague. Après-demain, je vous prie de ne point vous présenter à la caisse. Ce mois-ci, beaucoup d’élèves n’ont pas payé, j’ai eu à régler des notes en retard. Bref, je ne pourrai vous donner ce qui vous est dû… Je ne peux vous exprimer combien je suis peiné… de vous prier d’attendre la fin de février, pour recevoir ce qui vous revient… Messieurs, acheva l’abbé d’une voix plus forte, offrons ce sacrifice au Seigneur !
Il récita les prières habituelles. Les professeurs se retirèrent dans un morne silence. Ils descendirent la rue Saint-Savournin. Le vent glacé courait entre les vieilles maisons.
— Brrr ! qu’il fait froid ! dit M. Bermès en frottant ses mains l’une contre l’autre.
On ne répondit point. Chacun se taisait, n’osant pas, le premier, réveiller une angoisse qui taraudait secrètement chacun. Enfin, le fougueux Serpieri se décida à rompre les chiens.
— Eh bien, messieurs, cria-t-il, que dites-vous de cela ? Il en parle bien à son aise, le patron ! Offrir ce sacrifice au Seigneur ! Ça nous est moins facile qu’à lui. Il faut manger !
Ce mot lui remplissait la bouche, il en avait les joues gonflées et la salive aux lèvres. Il semblait le mâcher et l’avaler, comme une nourriture.
M. Niolon s’étonna que la caisse du directeur fût à ce point vidée. Il croyait l’abbé Barbaroux assez riche pour ne jamais se trouver à court.
— Ce qui est arrivé, ce mois-ci, expliqua M. Bermès, c’est que le patron a été obligé de payer une ou deux notes, faites par Mme Pioutte, sa chère sœur, et par ses nièces, qui ont les goûts dispendieux que vous leur connaissez. Ce qui fait, messieurs, permettez-moi de vous le dire, que vos appointements ont été dépensés pour solder les robes, les chapeaux et les petits fours de Mlles Cécile et Virginie Pioutte…
— Hein ? c’est raide, tout de même, cria furieusement Serpieri.
— Quand une femme entre quelque part, l’Esprit du Mal y entre avec elle, dit Mathenot. Et la ruine la suit, non seulement la ruine morale, mais encore la ruine matérielle.
— C’était un négociant, ce Pioutte ? interrogea M. Inart.
— C’était plutôt un brasseur d’affaires, expliqua M. Bermès, et vous savez que qui trop embrasse manque le train. À force de gagner énormément et de dépenser plus encore, il a fini par mourir de chagrin, ou de travail, ou d’apoplexie, ne laissant à sa famille que des yeux pour pleurer. Ce qui fait que la mère Pioutte, Charles et ses deux filles sont tombés sur les bras de ce pauvre Barbaroux, dont les affaires n’étaient pas déjà si brillantes…
— Quand on est à la charge de quelqu’un, on y met de la discrétion, grogna Serpieri, qui avait le don des réalités et n’exprimait jamais que des vérités d’un ordre inférieur, quand on vous nourrit par charité, on ne mange pas tout…
— La famille Pioutte, déclara Mathenot, d’une voix sombre, ruinera l’école Saint-Louis-de-Gonzague, et l’abbé Barbaroux finira par être sur la paille.
Il n’ajoutait pas qu’en ce cas il espérait lui succéder et qu’il comptait relever le pensionnat de son éphémère déchéance en lui donnant, grâce à son autorité et à son intransigeance, un lustre nouveau. Il ne disait pas, non plus, qu’il soupçonnait Augulanty de former le même plan que lui et qu’il voyait avec une secrète horreur grandir l’ascendant de l’économe sur l’esprit du directeur.
En arrivant aux allées de Meilhan, les professeurs se séparèrent, mais s’ils prirent des directions différentes, leur esprit ne cessa point de scruter le même problème douloureux : l’alimentation du mois.
IIL’ABBÉ THÉODORE BARBAROUX
Théodore Barbaroux appartenait à une vieille famille provençale. Son père, avoué médiocre, le voyant studieux et intelligent, voulut en faire un professeur ; sa mère aurait préféré qu’il fût prêtre. Docile et soumis, aussi travailleur que dévot, l’enfant s’achemina en même temps vers cette carrière et vers cette vocation. Il acheva brillamment ses études et, reçu à l’École normale, il en sortait avec le titre de professeur au lycée de Marseille. Il comptait exercer cet emploi quelques années, afin de se rompre à l’enseignement, puis se vouer à la théologie et entrer dans les ordres. Les événements disposèrent autrement de son sort. Ses parents moururent, à trois mois de distance l’un de l’autre. Il demeura seul au monde avec sa sœur Gaudentie, qui avait treize ans de moins que lui. Il se consacra à elle.
Elle fut l’unique joie de sa vie solitaire. Il s’efforça de lui donner un caractère ferme et généreux, il mit toute son ardeur à cette formation d’une âme. Pendant cinq années, il n’eut de pensées que pour elle, sa piété le tenant fort éloigné des femmes ; elle lui constitua, à elle seule, un intérieur et un foyer.
Un jour, il fallut songer à la marier. Gaudentie était alors jeune, jolie et fraîche. Silencieuse et renfermée, elle révélait peu de son caractère. Un vieux prêtre s’occupa d’elle, il lui trouva un prétendant, ambitieux et finaud, pressé de faire fortune. Il était employé dans une maison de commerce et s’appelait Marius Pioutte. Gaudentie eut en dot la totalité de l’héritage laissé par ses parents, et, de plus, Théodore s’engagea à faire sur ses appointements une rente au jeune ménage.
Aidé par cette mise de fonds, Pioutte gagna de l’argent dans le courtage. On était alors dans une époque très favorable aux affaires. Adroit et rusé, il devint assez vite négociant, et l’un des plus gros brasseurs d’entreprises de la place.
Pendant ce temps, Théodore Barbaroux modifiait toute sa situation. L’Université se montrant fort libérale en matière philosophique, le professeur fut mal noté pour son catholicisme intolérant et surtout pour les virulentes sorties qu’il se permettait en pleine classe contre ceux qui ne partageaient point ses convictions. On lui donna de discrets avis. Il n’en tint aucun compte. On lui adressa des reproches sévères. Il se fâcha alors, étant fort entier et cassant de caractère, et, donnant brusquement sa démission, quitta le lycée.
Les raisons de ce départ furent connues. Quelques familles bien pensantes tinrent à retirer également leurs enfants, par protestation contre l’enseignement voltairien. Barbaroux fonda une école libre. Un ancien clerc de M. Barbaroux, homme pratique et d’intelligence nette dans les choses de la vie courante, lui servit d’économe, et contribua au succès du nouveau pensionnat. Il eut l’idée de mettre le prix de la pension à cent francs par mois, ce qui attira un grand nombre d’enfants. On y prenait ainsi, dans la ville, par le seul fait d’y être élevé, comme un brevet de richesse, d’aristocratie et de bon esprit. Il n’y avait pas de classes primaires. M. Barbaroux n’avait pour adjoints qu’un professeur de langues étrangères, celui de mathématiques, et un surveillant. Il possédait un local étroit et mal placé qui lui coûtait peu. Il ne dépensait presque rien, sobre, économe et chaste comme il l’était. En vingt ans, il plaça plus de cent mille francs. Quand la guerre de 1870 éclata, il licencia son école et alla se battre, quoique déjà âgé, dans une compagnie de francs-tireurs. Il fut blessé, se réfugia en Suisse et revint à Marseille, après la signature de la paix. Alors il songea à réaliser le grand souhait de toute sa vie. Il partit pour Rome, y resta cinq ans et revint avec la soutane.
Il y avait longtemps que les Pioutte se passaient de lui. M. Pioutte gagnait énormément d’argent, il menait une vie luxueuse et dépensière qui effrayait un peu la simplicité de M. Barbaroux. Gaudentie avait eu quatre enfants ; l’aîné étant mort, il lui restait un fils et deux filles.
Ce fut alors l’époque des fameux décrets. On ferma plusieurs couvents, et des religieux allèrent loger en ville. Plusieurs familles catholiques vinrent demander à l’abbé Barbaroux de rouvrir son pensionnat. Il obéit par devoir. Mais il voulut consacrer toute sa vie à cette œuvre, qu’il souhaita immense et propre à restaurer la foi dans les nouvelles générations. Il eut l’imprudence de faire de grands frais. Il acheta, rue Saint-Savournin, une vaste maison, qui appartenait à des religieuses et qu’il paya fort cher. Il consacra vingt mille francs à l’édification d’une chapelle, dans la cour, afin de satisfaire un de ses rêves les plus longuement caressés.
La nouvelle école profita d’abord de la réputation de l’ancienne. Mais l’abbé Barbaroux eut le tort de vouloir y appliquer pratiquement plusieurs principes chrétiens. C’est ainsi qu’il accepta un grand nombre d’écoliers pauvres, dont la mauvaise éducation se communiquait peu à peu à tous les élèves. Beaucoup de parents retirèrent leurs enfants, et le pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague périclita.
L’ancien économe étant mort dans l’intervalle, l’abbé Barbaroux choisit, pour le seconder, un très brave homme, extrêmement religieux, mais aussi chimérique que son patron. À eux deux, ces idéalistes commirent fautes sur fautes, et l’administration générale de la maison s’en ressentit.
Dix ans après la fondation du nouvel établissement, il arriva une catastrophe qui ébranla toute la famille. M. Pioutte mourut brusquement, d’une attaque d’apoplexie. La hardiesse de ses spéculations et l’exagération toujours croissante de ses dépenses l’avaient conduit à la ruine. De cette colossale fortune, aussi vite écoulée que rapidement construite, il ne restait que des dettes. L’abbé Barbaroux en paya la plus grande partie, puis il prit à sa charge sa sœur et ses neveux. Charles avait alors vingt ans, Cécile dix-neuf et Virginie, quinze.
Le nouvel économe mourut peu après et M. Augulanty le remplaça. La situation de l’abbé commençait à ne pas être brillante. Il dépensait beaucoup, son pensionnat baissait insensiblement, et il ne lui restait de tout son capital péniblement amassé qu’une quarantaine de mille francs sur lesquels il prélevait une somme à la fin de chaque période scolaire.
Pendant quelque temps, il tint bon. Mme Pioutte s’occupait du ménage, Charles étudiait la peinture à Paris, Cécile et Virginie, ne se contraignant de rien, vidaient la poche de l’abbé, pour subvenir à leurs frais de toilettes, de promenades en voiture, et de distractions. Mais les premiers symptômes de ruine dans la maison furent surtout visibles, le fameux jeudi où l’abbé Barbaroux pria ses collaborateurs de ne point passer à la caisse.
IIIL’ENGRENAGE
Quatre jours après la réunion mensuelle des professeurs, Mme Gaudentie Pioutte avait avec Charles une discussion assez vive.
Elle venait d’apprendre, par une amie qui passait ses hivers à Paris et qu’elle chargeait de surveiller de loin son fils, que celui-ci y vivait avec une maîtresse que l’on disait même enceinte de ses œuvres. Une telle révélation bouleversa Mme Pioutte. Elle vit du premier coup le sinistre collage tant redouté de toutes les mères, la situation détruite, l’avenir perdu ; cette nouvelle fauchait impitoyablement ses rêves les plus chers ; il fallait renoncer au mariage riche et à la brillante position mondaine qu’elle ambitionnait pour le futur peintre. À cela, s’ajoutait la terreur que l’abbé Barbaroux apprît la conduite de son neveu ; elle connaissait Théodore, il ne l’excuserait jamais, et la généreuse protection qu’il accordait à Charles disparaîtrait avec sa confiance. Il était donc indispensable d’éviter au plus tôt ces funestes conséquences, et de détacher le jeune homme de la femme qui l’avait captivé et qui le tenait en esclavage, car Mme Pioutte ne doutait pas que Charles fût un brave enfant, trop naïf et trop inexpérimenté, pour se défier des ruses d’une dangereuse sirène. Elle lui envoya de l’argent afin qu’il vînt passer quelques semaines auprès d’elle. Charles arriva sans méfiance. Le soir même de son retour, sa mère l’entreprit sur le chapitre de ses mœurs avec une redoutable violence. Elle s’emporta, elle cria, elle pleura. Mais Pioutte opposait à ses reproches, à sa colère et à ses larmes une sereine indifférence et des plaisanteries moqueuses. Il inventa d’ailleurs, pour s’excuser, tout un fabuleux roman, transforma sa maîtresse, en réalité modèle fort vulgaire, en une belle jeune fille de bonne famille qui s’était enfuie de chez elle, où elle était malheureuse, battue même par une marâtre, évidemment empruntée à quelque mélodrame, et il déclara qu’il ne l’abandonnerait jamais. Sa mère crut à ce conte. Il flattait sa vanité et son admiration pour Charles. Elle se tut. Puis, un matin, où le peintre causait avec Mme Pioutte dans sa chambre, la discussion recommença :
— Avec tout ce que j’ai fait pour toi, Charles, voilà comment tu m’en récompenses !
Mme Pioutte se tenait assise auprès de son lit, petite, vive, l’œil gris, rusé et fin, la figure osseuse, le teint jauni, la peau serrée sur les os. Elle avait la forte mâchoire et le grand nez en bec de vautour de son frère, mais l’air défiant et dissimulé.
— Non, mais c’est inimaginable, à la fin, s’écria Charles. — Ce que j’ai fait, ce que j’ai fait ! On dirait que j’ai tué quelqu’un ! Tout ça, parce que j’ai une maîtresse !
— Malheureux ! mais si ton oncle le savait !
Charles éclata de rire.
— Ah ! oui, je crois que si mon oncle le savait, il en ferait une fière maladie ! Tout le monde ne peut pas vivre comme lui. Je ne suis pas un anachorète, moi !
— Ton enfant naîtra-t-il bientôt ? demanda madame Pioutte, après un moment de silence.
— Dans cinq mois.
— Vois-tu, mon petit, si ton oncle savait tout cela, il serait capable de tout, il te supprimerait peut-être même ta pension ! Et alors qu’est-ce que tu deviendrais ?
— Le fait est que ça ne serait pas rigolo, déclara Charles.
— Tu as fait une bêtise, Charles, répare-la.
La proposition était si inattendue que Charles vira prestement sur ses talons.
— Qu’est-ce que tu me chantes là ? grommela-t-il.
Mme Pioutte ne songeait qu’à interrompre une situation qui pouvait brouiller son fils avec son frère. Puisqu’il se refusait à abandonner sa maîtresse, il ne lui restait plus qu’à l’épouser.
— Marie-toi, fit-elle. Tu m’as dit toi-même que tu le ferais volontiers, Mlle Jouve étant…
Elle s’arrêta devant l’ahurissement du peintre :
— Est-ce que ce n’est pas une jeune fille de bonne bourgeoisie, obligée de devenir institutrice et que tu as rencontrée chez des amis…
— Oui, oui, s’écria Charles, qui se rappela à temps le formidable récit qu’il avait raconté à sa mère et déjà oublié.
— Épouse-la donc, répliqua Mme Pioutte.
Tout en causant, l’ingénieux Charles entrevoyait peu à peu les lignes d’un plan machiavélique. Il souffrait de sa misère, des besoins sans nombre le poursuivaient, il désirait une installation plus luxueuse que le garni où il logeait, les créanciers le harcelaient, et il n’apercevait, dans le cruel souci de sa mère, que le moyen de lui tirer une nouvelle et colossale carotte.
Il s’écria donc avec amertume :
— Comment veux-tu que nous nous mariions ? Il faut de l’argent pour cela ! Ce n’est pas toi qui nous en fournira… Nous sommes des sacrifiés, il faut bien accepter avec résignation la douloureuse existence des sacrifiés.
— Ne dis pas cela, Charles !
— Pourquoi ? C’est la vérité. C’est bon pour les riches de se marier. Ah ! si mon oncle, au lieu de dépenser tant d’argent pour ses coûteuses fantaisies, en avait gardé un peu plus pour nous, nous n’aurions pas une si misérable situation ! Crois-tu que ce soit gai d’être avec une femme qui n’est pas la vôtre, renié des siens, ne pouvant voir personne, hors de l’Église et de la Société ? Tout cela parce qu’on n’est pas riche et qu’on a cependant du cœur ! Et quand mon enfant naîtra, il n’aura même pas de nom. Ce sera un enfant naturel. Ton premier petit-fils, maman, sera un enfant naturel.
Mme Pioutte, touchée au vif, se mit à pleurer.
— Mais enfin, il ne faut pas tant d’argent pour se marier ?
— J’admets qu’il en faille peu, ce peu, est-ce toi qui nous le donnera ?
— On pourrait peut-être le trouver. Voyons, Charles, combien te faut-il ?
— Vingt mille francs ! déclara Charles Pioutte, avec aplomb.
Il pensait que, s’il réussissait seulement à obtenir le quart de cette somme, il réaliserait une fameuse affaire.
Mme Pioutte sursauta.
— Vingt mille francs ! Tu es fou. Il ne faut pas tant que ça…
— Tu vois bien, dit-il placidement, qu’il est inutile d’y songer.
— Mais vingt mille francs ! Y penses-tu ?
— Je n’ai pas une autre idée en tête !
— Vingt mille francs ! Sais-tu que c’est une somme ?
— Je le sais. C’est vingt mille francs, deux fois dix mille, quatre fois cinq mille…
— Ne te moque pas de moi, fit Mme Pioutte, courroucée, et qui, au son métallique de ces mots retrouvait beaucoup de son caractère et un peu de sa lucidité. Je sais ce qu’est la vie. Jamais tu ne me feras croire qu’il faut vingt mille francs…
— Je ne te force pas à le croire, dit Charles avec indifférence.
— Du moins, explique-moi ce que tu comptes faire d’une telle somme.
— N’en parlons plus !
— Établis-moi le montant de ces dépenses, si tu veux que je te croie. As-tu des dettes ?
— Parlons d’autre chose !
— Certes, je reconnais que la vie est chère. Nulle ne le sait mieux que moi. Veux-tu avoir des provisions, devant toi, pour l’avenir ?
— Je ne veux rien, je ne demande rien, — sinon qu’on me fiche la paix. Quant à mon mariage, zut, n’est-ce pas ?
Il y eut un silence, Mme Pioutte pleurait à petits coups comme une gargouille qui se déverse. Charles mangeait la moitié d’un croissant qu’il venait de trouver sur la commode.
— Si ton oncle apprend cela, tu n’auras plus un sou !
— Et alors, dit brusquement Charles, comme je n’ai de goût que pour la peinture, et que, pour vivre, il faut au moins se donner la peine de vivre avec agrément, je me débarrasserai au plus tôt de ces soucis, une balle de revolver est vite reçue !
Mme Pioutte frémit de terreur et vit, dans son imagination affolée, un Charles étendu sur un lit, le front troué d’une blessure rouge, près d’une jeune fille de bonne maison, qui joignait ses mains aristocratiques et pleurait sur les draps sanglants.
— Tu ne ferais pas cela, s’écria-t-elle, en pâlissant.
— Plus souvent que je me gênerais ! répondit Charles.
— Tu ferais ça, toi, toi… Toi que j’ai élevé chrétiennement, tu me laisserais…
— Que je meure de faim, ou autrement, pour toi, le résultat est le même !
— Tu n’as pas de cœur, tu es cruel, injuste, égoïste… Tu n’as pas pitié de moi, ta mère…
— Allons, nous y voici, recommence à faire des phrases !
— Mais enfin, pourquoi te faut-il vingt mille francs ! s’écria Mme Pioutte, éperdue, explique-moi au moins ce que tu veux faire de tant d’argent !
— Sapristi, maman, ne comprends-tu pas qu’avec les deux cents francs que je reçois de mon oncle il m’est impossible de vivre avec Clémentine…
— Tu le fais bien maintenant…
— Maintenant, je vis en concubinage, comme tu le dis si bien. Sais-tu que nous logeons en garni ? Avec cet argent nous serions chez nous, nous pourrions avoir confiance dans l’avenir. D’ailleurs, si je n’ai rien, Clémentine sera forcée d’aller faire ses couches à l’hôpital. Comment veux-tu que je paye un docteur, une garde, avec ces pauvres dix louis ? Maman, ajouta-t-il, comme s’il trouvait cette idée prodigieusement drôle, ton premier petit-fils naîtra à l’hôpital !
Mme Gaudentie Pioutte, tout en pleurant, réfléchissait. Elle ne voyait nulle part l’Eldorado, la Terre Promise, le Klondyke où elle puisse découvrir cette somme mythologique de vingt mille francs. À tout hasard, elle tenta cependant de faire baisser les prétentions de son fils.
— Avec dix mille francs tu en aurais bien assez !
Une lueur de convoitise passa dans les gros yeux bleus de Charles.
— Les aurais-tu, par hasard ?
— Non, fit-elle, mais c’est plus facile à trouver que vingt.
— Tu es bête, maman, dit-il assez vexé de cette déception.
Mme Pioutte se mit à gémir. Elle n’avait rien à elle. Elle n’arrivait qu’avec beaucoup de peine à faire marcher la pension. Et elle énumérait ses griefs, d’une voix sourde et monotone, comme l’on débite un chapelet. Il interrompit :
— Alors, maman, c’est entendu, tu me trouveras ces argents.
— Non, mon cher, je t’assure, n’y compte pas.
— Si, j’y compte. Tu ne veux pas en avoir l’air, mais tu me les trouveras. Tu es habile, tu sais où le diable a fait feu. Et puis t’as du cœur, t’es une bonne vieille bête de mère dévouée qui ne voudra pas que son fils bien-aimé, son Charlot, continue à offenser le Bon Dieu et que son petit-fils naisse à l’hôpital.
Il s’approcha de sa mère, posa sur ses joues deux baisers retentissants et prit un feutre noir à larges bords qu’il avait jeté sur le lit défait.
— Et n’oublie pas que j’attends les vingt mille balles pour la noce, dit-il à voix basse.
Repliant à demi un bras qu’il rapprocha de sa poitrine, il exécuta, de l’autre, sur sa manche, le mouvement d’un archet qui va et vient contre les cordes d’un violon, puis, avec une dernière grimace, il enfonça son feutre crasseux sur sa tête chevelue et descendit quatre à quatre l’escalier.
IVQUI SE TERMINE PAR UN DOUBLE ESPOIR
Mme Gaudentie Pioutte, restée seule, et tout en trottinant dans sa chambre, rêvait à ces vingt mille francs, mais sans doute, à peu près, comme Silvio Pellico et Christophe Colomb durent rêver, l’un, à sa liberté perdue, l’autre, aux grandes Indes qu’il voyait, avant son premier départ, miroiter dans son imagination. Le feu d’un désir presque irréalisable brûlait son âme avide et fiévreuse, qui se débattait sous l’angoisse d’une inéluctable nécessité. Cet or, qui contient toutes les puissances et tous les plaisirs, cet or qui est devenu le but presque unique de la vie humaine, elle ne l’avait jamais souhaité pour elle-même avec une telle frénésie. Mais la pauvreté de son fils torturait comme avec des tenailles de fer rouge son cœur maternel. Parfois, pourtant, elle avait des accès de révolte subite contre Charles, il lui paraissait tout à coup égoïste, injuste, noceur, puis, l’instant d’après, elle se calmait, oubliait, cherchait vingt raisons de l’excuser et en trouvait cinquante, s’attendrissant alors sur lui et s’expliquant avec tant d’indulgence qu’il eût une maîtresse !
— Pouvait-il demeurer seul, loin de sa famille, dans cet immense Paris, lui qui redoutait la solitude et ne se sentait heureux que lorsqu’il était entouré, cajolé, chéri ?
Elle avait toujours considéré Charles comme un tendre, et elle ne voyait que désirs affectueux dans son continuel besoin de société.
L’amour s’augmente de ce qu’il donne, et Mme Pioutte, en se souvenant des années d’enfance de son fils, laissait déborder encore d’elle tout ce trésor d’affection dont elle l’avait gorgé.
Quand on lui reprochait ses faiblesses envers lui, elle répondait :
— Que voulez-vous ? C’est mon seul garçon.
Elle préféra toujours à ses filles, avec une partialité visible, cet enfant gai, paresseux, indolent et câlin, un peu cynique, sans grande intelligence, ni beaucoup de cœur. Comme toutes les mères, dès la naissance de son fils, elle avait aveuglément cru à une supériorité éclatante qu’il montrerait bientôt en quelque chose. Mais cette supériorité attendue demeura longtemps négative. Charles se révéla nul en littérature, nul en latin, en grec, en mathématiques, irréparablement nul en toute chose, si ce n’est au jeu de barres et aux billes. Et Théodore Barbaroux disait à sa sœur :
— Ton fils est un cancre, Gaudentie !
Le jour où l’enfant exhiba devant sa mère ses premiers dessins, elle exulta. Elle distingua aussitôt, dans les hiéroglyphes de ces gribouillages, les signes indubitables d’un grand talent, et elle poussa Charles de toutes ses forces vers cette vocation qu’elle appelait pour lui et où elle donnait rendez-vous à la fortune et à la gloire. Elle plaça sur cet avenir tous les vœux qu’avaient déçus les déboires de sa propre existence. Charles Pioutte serait un Raphaël, un David, un Meissonier. Elle crut à son génie comme s’il l’avait déjà. Elle fit des merveilles d’éloquence pour obtenir de Théodore qu’il envoyât son neveu à Paris. Elle visita ses anciennes amies, intrigua dans plusieurs salons, obtint des recommandations en sollicitant de tous côtés. Cette petite femme maussade et sèche, souvent cassante, assez sotte, se montra affable, cordiale, intelligente ; elle sut flatter, s’abaisser, jouer la comédie. Enfin elle parla si bien que Charles partit.
Et voici que tout cela allait s’anéantir si l’abbé Barbaroux apprenait la conduite de son neveu, voici que la plus inattendue catastrophe allait faire avorter misérablement le fruit de tant d’efforts, de tant de prières et de tant de promesses. Ah ! que le sort était donc injuste, cruel et sournois, en ses complots malveillants ! Et Mme Pioutte se rabâchait les raisons trop véritables de son effroi. L’abbé ne transigeait jamais. On pouvait tout obtenir de lui, mais à condition de ne pas choquer ses principes religieux. Or, pour M. Barbaroux, un homme capable de vivre avec une maîtresse, sans souci de l’offense qu’il fait à Dieu, du péché mortel où il s’obstine, est un être sans foi, c’est-à-dire perdu et presque criminel. Il n’autoriserait pas plus longtemps son neveu à habiter Paris et à continuer une existence à laquelle sont attachées de telles tentations. Cette promiscuité des modèles fut le plus sérieux argument opposé par le prêtre au projet de Gaudentie, lorsqu’elle le lui confia. Mme Pioutte entendait encore la grosse voix, alors bourrue, de son frère retentir à son oreille :
— Je crains beaucoup pour Charles cette vie d’artiste et de bohème. Et puis il y a là un danger permanent. Ces jeunes gens ont des modèles, des femmes qui osent se déshabiller devant eux. On dit que c’est pour l’art ! Mais l’art n’excuse pas tout. L’art ne doit pas passer avant la morale et la pudeur. Les peintres ont la manie de représenter des femmes nues. Je n’ai jamais compris pourquoi. De tels spectacles ne sont bons pour personne. On est obligé de les interdire à une jeune fille, les jeunes gens y puisent de mauvaises pensées, les honnêtes femmes baissent les yeux devant. Je n’entends pas que Charles devienne ainsi un homme sans décence qui peigne de mauvaises choses. Et, dans ce milieu corrompu, un jeune homme est bien vite perdu, s’il n’a pas des principes solides.
Et Mme Pioutte n’avait réussi à vaincre cette résistance qu’en déclarant à son frère que Charles ne suivrait pas les cours de nudités, mais se consacrerait aux tableaux religieux. Et sachant le culte de l’abbé pour sa chapelle, elle fit briller à ses yeux l’espoir d’avoir de grandes et belles peintures à y mettre, qui représenteraient tous ses saints de prédilection, et Notre-Dame-de-Lourdes.
Et par le résultat de ses réflexions, Mme Pioutte songeait à ces vingt mille francs comme au seul moyen d’éviter la débâcle. Dans son aveuglement maternel, elle trouvait bonnes toutes les raisons qui empêchaient Charles de se marier tant qu’il ne posséderait pas cette somme. Et sa désolation augmentait à mesure qu’elle voyait moins de possibilités de la découvrir. Elle s’exaspérait à la pensée que son frère les avait, ces vingt mille francs, qu’il pourrait les lui donner, s’il voulait, et qu’il n’en ferait rien, elle pensait à lui avec haine, elle éprouvait cette frénésie de désir, cette convoitise brûlante qui fait que des femmes volent dans les magasins et que tant d’êtres assassinent pour palper de leurs mains sanglantes un peu du prodigieux métal. Son esprit et son corps se tendaient et se contractaient dans la soif affreuse de cet argent, qui devenait pour elle la condition unique de l’avenir, de la réussite et de la gloire de son fils bien-aimé.
Mais rien ne forcerait un peu de cet or à tomber dans ses mains ! Il avait beau en circuler autour d’elle, elle n’en toucherait nulle part ! Charles ne se marierait pas ; son petit-fils serait un bâtard, et un jour, l’abbé Barbaroux, apprenant tout, chasserait le pauvre peintre et l’abandonnerait à son sort ! Comment cacher longtemps ces hontes aux yeux du vénérable prêtre ? Il avait lui-même chargé un de ses camarades, l’abbé Thomas Trenquier, de lui envoyer de loin en loin quelques renseignements sur son neveu. L’abbé Trenquier ignorait jusqu’ici ce qu’avait si finement découvert l’amie de Mme Pioutte, il finirait tout de même par le savoir et l’écrire à Théodore. Et alors ce serait la catastrophe !
À ce moment, Rosita, la bonne, une brunette, jolie et fraîche, vint annoncer que Mme Maubernard attendait Madame dans le salon du rez-de-chaussée.
Mme Maubernard avait quelques années de plus que Gaudentie. C’était une femme assez grande, qui avait été fort grosse et qu’une maladie d’estomac avait extrêmement maigrie. Sa peau, ayant eu beaucoup de graisse à retenir, s’était mal habituée à se vider ainsi ; les dimensions en demeuraient, mais non point ce qui les avait remplies, de telle sorte que Mme Maubernard donnait l’impression d’une baudruche dégonflée. Ses joues longues pendaient, avec des plis tombants qui communiquaient à ses traits quelque chose de pleurard. De larges fanons réunissaient son menton flasque à son cou ridé. Elle avait le nez long et pointu des personnes qui aiment à le mettre partout où il n’a que faire, la bouche boudeuse et saillante, des yeux petits, mobiles, vifs et malicieux.
Mme Maubernard, veuve, sans enfants, brouillée avec toute sa famille, qui se composait de trois frères, et possédant une rente viagère de cinq mille francs, vivait en compagnie d’une bonne, dans une petite maison de la rue des Cyprès. Comme elle n’avait plus rien à mettre dans sa vie, elle se mêlait à celle des autres. Elle avait conservé de nombreux amis à qui elle rendait de menus services, en remerciement des nombreux repas qu’elle prenait chez eux. Elle s’effaçait aux jours prospères pour reparaître aux moments de deuil et de malheur. Elle arrivait immanquablement avec la maladie, la ruine et la mort, comme les corbeaux avec la guerre. Cela la faisait considérer comme une amie dévouée et sincère. Dans les maisons éprouvées, elle devenait prépondérante. Et, sans cesser de s’occuper d’un procès qu’elle avait avec les siens, elle emmanchait des mariages, aidait à des réconciliations, prêchait la concorde et la paix, raccommodait des parents brouillés entre eux. Beaucoup de gens la considéraient comme le bon ange de leur foyer. Elle ne trouvait d’ailleurs à cela aucun intérêt pratique, mais elle y satisfaisait son unique passion.
Mme Pioutte avait toujours été liée avec Mme Maubernard, mais celle-ci était devenue son intime après la ruine et le trépas subit de M. Pioutte. Gaudentie, très abandonnée, alors, par ses amis, gardait beaucoup de reconnaissance à Mme Maubernard de ne l’avoir pas lâchée comme les autres.
Mme Pioutte entra dans le salon où l’on recevait d’habitude les parents des élèves. Cette grande pièce sévère et glacée s’ouvrait par trois fenêtres sur la rue Saint- Savournin. À trois heures, en hiver, il fallait allumer les lampes ; on n’y faisait jamais de feu. Le long des murs, des fauteuils et des chaises de velours rouge étaient rangés, avec la mine rogue et hargneuse d’un tribunal de professeurs qui va examiner des enfants.
Mme Maubernard s’était avancée à la rencontre de son amie, et elle l’embrassait cordialement. Puis elle se mit aussitôt à parler.
— Comment allez-vous, chère petite ? Toujours bien, je vois. Ma parole, vous rajeunissez ! Voilà ce que c’est que de vivre en famille, au milieu de l’affection des siens. Tandis que moi… Oh ! ne protestez pas ! Je sais bien ce que je dis. J’ai eu encore deux crises d’estomac, cette semaine-ci. Que voulez-vous ? C’est notre lot. Nous sommes sur la terre pour souffrir. Et ce bon abbé ? Comment va-t-il ? Toujours à l’œuvre ? Quel saint homme ! Je ne verrai pas vos filles aujourd’hui ? Quel dommage ! À mon âge, chère petite, il est reposant et agréable de voir de jolis visages. Ah ! si j’avais seulement une fille comme votre Cécile, je ne me plaindrais pas !
Elle soupira, se rassit et se mit à parler. Quand elle avait commencé, rien n’aurait pu l’arrêter. Elle semblait toujours avoir une revanche à prendre sur de longues années de silence. D’une maison à l’autre, elle colportait des nouvelles et des potins. Mais elle était très discrète et ne répétait jamais ce qu’elle apprenait des affaires de ses amies.
— Vous ne savez pas pourquoi je suis venue, aujourd’hui, déclara-t-elle, en se carrant dans son fauteuil, non, vous n’en avez pas la moindre idée !
— Mais, fit Mme Pioutte, avec un sourire malin, c’est parce que vous désirez me voir, je suppose.
— Oui, c’est pour cela, évidemment, mais pour autre chose encore.
— Et pourquoi donc, ma chère amie ?
— Ma chère Gaudentie, fit Mme Maubernard, sans répondre directement, et avec quelque solennité, vous savez combien j’aime vos enfants. Vous savez comment mes parents se sont conduits avec moi et pourquoi j’ai entièrement cessé de les voir ; et vous savez aussi que, privée des joies pures de l’intimité et du foyer, j’ai fini par me considérer presque dans ma famille, quand je me trouve au milieu de mes amis, et il n’en est point que j’aime autant que vous…
Il ne faut pas se dissimuler que Mme Maubernard avait déjà fait cette dernière déclaration dans toutes les maisons où elle se rendait fréquemment. Mais quoi, ne convient-il pas d’user d’indulgence envers qui ne cherche qu’à plaire à chacun, par un tel aveu de préférence ?
— Croyez bien que cette affection vous est rendue par nous, fit Mme Pioutte.
— Je le sais, chère petite, je le sais, répondit la vieille dame, en pressant dans la sienne une des mains osseuses de son amie. Je vous parle ainsi pour que vous compreniez la raison qui me pousse à me mêler de ceci. C’est une véritable tristesse pour moi que de voir des jeunes filles aussi parfaites que Cécile et Virginie ne pas se marier, parce qu’elles ne sont pas riches… Ah ! dans quel temps vivons-nous, Seigneur ! Quand j’étais jeune, il suffisait qu’une jeune fille eût des principes, fût élevée au ménage, avec ordre et économie, pour qu’on la demandât. Aujourd’hui, il faut de l’argent, rien que de l’argent ! Je sais, chère petite, combien la situation de vos filles vous préoccupe.
Mme Pioutte fit un geste d’orgueilleuse protestation,
— Oh ! ne niez pas, Gaudentie ! Je sais que vous avez du courage et de la dignité. Mais on ne cache pas aux yeux clairvoyants et affectueux d’une amie de trente ans ce qu’on dissimule si facilement aux autres. Par conséquent, ne vous froissez pas de ce que je vais vous dire et écoutez-moi en silence.
Il était, certes, bien difficile d’écouter autrement Mme Maubernard, et Gaudentie ne s’avisa pas de l’essayer. Mais s’approchant de son amie et enfonçant ses coudes pointus dans les accoudoirs du fauteuil, elle suivit avec circonspection les labyrinthes de phrases où s’engageait la visiteuse. Le sens des paroles vagues qu’elle avait d’abord prononcées se précisait peu à peu. Mme Pioutte attendait, non sans quelque impatience, qu’après tant de précautions oratoires Mme Maubernard en vînt à l’objet réel de sa visite. Cela ne tarda pas trop.
— Je n’y vais pas par quatre chemins, continua la vieille dame, je dis les choses comme elles sont. C’est pour cela que j’ai voulu vous assurer d’abord que j’agis dans l’intérêt de vos filles, avec tout l’empressement et la sympathie qu’elles méritent. Enfin, voici la chose. Dernièrement, ma chère petite, j’ai vu chez mon amie, Mme Hampy, son neveu, M. Caillandre, un jeune homme bien distingué. Sa tante m’a avoué qu’il cherchait à se marier et qu’ayant peu de connaissances il la chargeait de lui trouver une femme. J’ai aussitôt pensé à vos filles. Ce M. Caillandre a trente-cinq ans, il est caissier au Crédit Parisien, où il gagne six mille francs par an. Son père avait cet emploi avant lui. Il voudrait une jeune fille bien élevée et qui ait des principes. Et, chose à signaler, il ne tient pas à l’argent, il ne demanderait pas de dot, si la jeune fille lui convenait sous tous les autres rapports. Enfin, j’ai cru comprendre qu’il ne lui déplairait pas d’avoir une jolie femme. Je dois avouer qu’il n’est pas beau…
— La beauté ne fait pas le bonheur, déclara doucement Mme Pioutte.