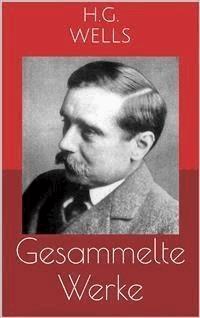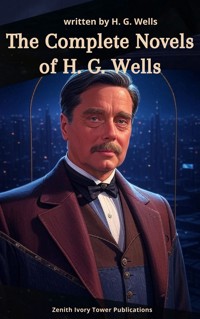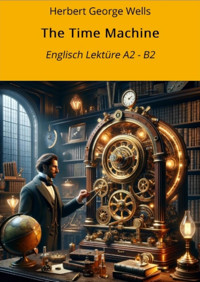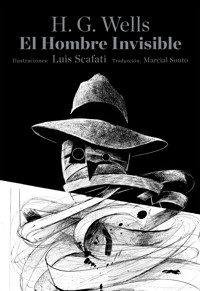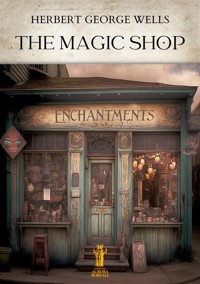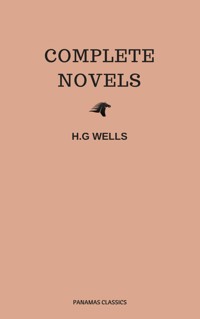3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Ou de l'influence de certains phénomènes célestes sur les sentiments humains. Willie et Nettie font l'expérience d'une rencontre éphémère entre notre terre et une comète. Mais comment évolueront-ils, ainsi que la société qui les entoure, à la curieuse métamorphose qui en résulte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Au temps de la Comète
Au temps de la ComètePROLOGUE. L'HOMME QUI ÉCRIVAIT DANS LA TOURLIVRE PREMIER. LA COMÈTECHAPITRE PREMIER. LA POUSSIÈRE DANS LES OMBRESCHAPITRE II. NETTIECHAPITRE III. LE REVOLVERCHAPITRE IV. LA GUERRECHAPITRE V. À LA POURSUITE DES AMANTSLIVRE II. LES BROUILLARDS VERTSCHAPITRE PREMIER. LE CHANGEMENTCHAPITRE II. LE RÉVEILCHAPITRE III. LE CONSEIL DE CABINETLIVRE III. LES TEMPS NOUVEAUXCHAPITRE PREMIER. L'AMOUR APRÈS LE CHANGEMENTCHAPITRE II. LES DERNIERS JOURS DE MA MÈRECHAPITRE III. BELTAINE ET LA VEILLE DU JOUR DE L'ANÉPILOGUE. LA FENÊTRE DE LA TOURPage de copyrightAu temps de la Comète
Herbert George Wells
PROLOGUE. L'HOMME QUI ÉCRIVAIT DANS LA TOUR
Je vis un homme à cheveux blancs, image même de l'extrême vieillesse, assis devant un pupitre, et qui écrivait.
Ce devait être dans quelque appartement d'une tour très élevée, car, par la haute fenêtre, à droite, on n'apercevait que des lointains : un horizon de mer, un promontoire, et cette buée lumineuse du soleil couchant qui signale la présence d'une ville. Tous les aménagements de la pièce respiraient l'ordre et la beauté, – et je ne sais quoi de subtil, et de mal défini, l’inattendu de tel détail, me donnait une sensation de nouveau et d'étrange. Je ne reconnaissais aucun style spécial, et le costume simple de l'homme assis ne suggérait l'idée d'aucune époque ni d'aucun pays. Peut-être, pensai-je, suis-je au pays de l'« heureux avenir, au pays d'Utopie » ou des « rêves simples » ? Une phrase d'Henry James : « Le lieu du grand repos », me traversa la mémoire, glissa comme une lueur sur mon esprit, et s'éteignit sans m'éclairer.
L'homme écrivait avec un stylet assez semblable à notre porte-plume réservoir, et ce détail bien moderne m’interdisait toute pensée rétrospective. De temps à autre, il ajoutait la feuille qu'il venait de couvrir d'une écriture courante et facile à des feuilles entassées sur une gracieuse petite table, placée devant la fenêtre, à portée de sa main. Les derniers feuillets gisaient épars, recouvrant à demi les autres réunis en fascicules par des attaches.
Évidemment, il était inconscient de ma présence, et je restai là à attendre que l'écrivain s'interrompît ; tout vieux qu'il fût, il traçait les signes d'une main ferme.
Je m'aperçus qu'un miroir concave, légèrement penché, était suspendu au-dessus de sa tête ; un mouvement de cet appareil fixa vivement mon attention, et, en levant les yeux, je vis, déformée et fantastique mais lumineuse et admirable de coloris, l'image magnifiée, reflétée et atténuée d'un palais, d'une terrasse, avec la perspective d'une vaste avenue fourmillante de passants, grandis, rendus bizarres par la concavité du miroir, dans leur va-et-vient continu. Je détournai vivement mon regard pour voir tout cela plus distinctement à travers la fenêtre derrière moi, mais elle était trop haute pour que je pusse distinguer l'horizon, et j'en revins au miroir déformateur.
Cependant l'écrivain, adossé dans son fauteuil, posa son stylet et poussa un soupir de regret.
– Ah ! ce travail ! – murmura-t-il, de la voix de tout homme qui vient d'écrire pour son plaisir,
– Quelle satisfaction, mais quelle fatigue aussi !
– Quel est cet endroit ? – demandai-je, – et qui êtes vous ?
Il se tourna vers moi dans un vif mouvement de surprise.
– Quel est cet endroit, – repris-je, – et pourquoi y suis-je ?
Il me fixa pendant un instant, sous le froncement de son front ridé, et puis sa physionomie s'adoucit jusqu'au sourire ; du doigt, il m'indiqua un siège près de la table.
– J'écris, – dit-il.
– Sur quel sujet ?
– Sur le Changement.
Je m'assis ; le siège était confortable et bien placé par rapport à la lumière de la fenêtre.
– Si vous voulez lire, – proposa-t-il.
Je fis un geste vers le manuscrit.
– Ceci m'expliquera ?… – questionnai-je.
– Ceci vous expliquera, – répondit-il.
Il déposa devant lui une nouvelle feuille de papier tout en me regardant. Je parcourus des yeux son appartement, et revins à la petite table ; un fascicule marqué très distinctement du chiffre un attira mon attention ; je le pris, et je souris en réponse au regard amical du vieillard.
– Très bien, – dis-je, soudain mis à mon aise.
Il fit un signe de la tête et se reprit à écrire, cependant que moi, dans un état d’âme où la confiance se mêlait à la curiosité, je commençais à lire.
Voici l'histoire que ce vieillard à l'air actif et heureux avait écrite en ce lieu agréable.
LIVRE PREMIER. LA COMÈTE
CHAPITRE PREMIER. LA POUSSIÈRE DANS LES OMBRES
I
J'ai entrepris de relater l'histoire du Grand Changement, pour autant qu'il a influencé ma vie et celle d'une ou deux personnes qui m'intéressent de près, et ceci pour mon plaisir personnel.
Il y a longtemps, aux jours de ma jeunesse, rude et sans bonheur, j'avais conçu le désir d'écrire un livre. Ce fut une de mes distractions les plus chères de griffonner en secret et de rêver la gloire littéraire ; je lisais, pris d'une envie sympathique, tout ce que je pouvais trouver concernant la littérature et la vie des hommes de lettres, et c'est quelque chose, vraiment, même au sein de ce bonheur qui nous environne, de trouver le loisir et l'occasion de reprendre et de réaliser ne serait-ce qu'un peu de ces vieux rêves sans cesse déçus. S'il n'y avait que cela, néanmoins, dans un monde où tant d'occupations intenses et toujours plus intéressantes s'offrent à l'activité même d'un vieillard, ce n'aurait pas suffi, je crois, pour me décider à m'asseoir devant ce pupitre. Il y a plus ; car je trouve qu'il devient nécessaire, comme je l'entreprends, d'établir cette récapitulation de mon passé, afin d'affermir ma continuité mentale. Les années mènent l'homme au dernier stage rétrospectif, et, à soixante-douze ans, notre jeunesse nous est d'une autre importance qu'elle ne le fut pour notre quarantaine. Nous avons perdu contact, ma jeunesse et moi ; la vieille vie semble à ce point disjointe de la nouvelle, si étrangère et si peu raisonnable, qu'elle m'apparaît, parfois, presque incroyable. Les dorées en sont disparues, les monuments, les lieux mêmes ne sont plus. Je me suis arrêté court, l'autre jour, dans ma promenade d'après-midi, à travers la varenne où jadis la triste banlieue de Swathinglea s'éparpillait vers Leet, et je me demandais : « Est-ce vraiment ici que je me suis tapi parmi les mauvaises herbes, les ordures et les débris de vaisselle, et que j'ai chargé mon revolver, prêt pour un meurtre ? Est-ce qu'un pareil état d'âme, de pensée et d'intention, fut jamais possible en moi ? N'est-ce pas plutôt que je suis victime de quelque cauchemar qui a peuplé de pseudo-souvenirs la mémoire de ma vie d'autrefois ? » Certes, il doit exister bien d'autres hommes qui restent ainsi perplexes devant leurs souvenirs de jeunesse. Je pense aussi que ceux qui grandissent, prêts à prendre notre place et à assumer notre travail dans la vaste entreprise humaine, auront besoin de narrations comme la mienne pour concevoir, fût-ce bien imparfaitement, ce vieux monde des ombres qui précéda notre époque. Le hasard a voulu que mon cas fût typique et illustrât le Changement. Je fus saisi à mi-chemin dans un tourbillon passionnel, et un accident singulier me plaça, pour quelque temps, au nœud même de l'ordre nouveau…
Ma mémoire me ramène, par-delà un intervalle de cinquante années, dans une petite chambre mal éclairée dont la fenêtre à guillotine s'ouvrait sur un ciel d'étoiles ; et aussitôt me revient le relent spécial de cette mansarde, l'odeur pénétrante d'une lampe mal mouchée où brûlait un pétrole peu raffiné. L'éclairage à l'électricité avait atteint sa perfection depuis plus de quinze ans déjà, que l'usage de ces quinquets était encore courant dans la plus grande partie du monde, et la scène que je vais conter sera toujours imprégnée pour moi et comme pénétrée de cette sensation olfactive. C'était l'odeur que la pièce dégageait le soir ; de jour, le relent en était plus subtil : une odeur de renfermé, légèrement âcre, qui, je ne sais trop pourquoi, me fait penser à l'odeur de la poussière.
Mais que je vous décrive cette pièce en détail : elle avait comme dimensions huit pieds sur sept, et elle était plus haute que longue ; le plafond de plâtre, fendillé et boursouflé par endroits, avait emprunté une teinte grise à la fumée de la lampe et s'était décoloré dans un angle sous l'influence d'infiltrations que trahissaient des taches vert olive et jaunes. Les murs étaient tapissés d'un papier couleur tan, sur lequel avait été imprimée en rouge la répétition diagonale d'un dessin évoquant vaguement une plume d'autruche ou quelque fleur d'acanthe ; cet ornement, dans les coins où il était visible encore, affectait je ne sais quelle terne gaieté. La tenture portait plusieurs blessures, aux lèvres desquelles le plâtre apparaissait, trace des vains efforts tentés pour y planter des clous ; un de ces clous, par hasard, était enfoncé solidement entre deux briques ; aussi portait-il, suspendu par une corde à store, noueuse et d'une résistance incertaine, le casier à livres de Parload : c'étaient des planches barbouillées d'une peinture émail mal appliquée et décorée par surcroît d'une frange américaine à peine fixée par quelques semences espacées ; au-dessous de ce casier une petite table ruait à tout mouvement brusque fait pour s'y installer ; elle était recouverte d'une étoffe dont le dessin rouge et noir avait vu corriger sa monotonie par les débordements fréquents de l'encrier de Parload, et là se dressait, « leitmotiv » de tout cet ensemble, la lampe nauséabonde. Il faut concevoir que cette lampe était d'une matière blanchâtre et translucide, ni porcelaine ni verre ; un abat-jour de la même matière la surmontait, qui ne protégeait en rien les yeux du lecteur, et toute son apparence semblait combinée pour souligner ce fait qu'après l'avoir mouchée une main généreuse jusqu'à la prodigalité l'avait badigeonnée d'un mélange de poussière et de pétrole. Le plancher inégal avait été recouvert aussi d'une peinture émail, couleur chocolat, éraillée par places, et un archipel de morceaux de tapis s'éparpillait sur la poussière et dans les coins obscurs. Une grille minuscule, coulée d'une pièce, un garde-feu en bronze encore plus lilliputien, n'arrivaient pas à cacher la pierre grisâtre du foyer ; nul feu n'était préparé et, à travers la grille, on n'apercevait que quelques papiers déchirés et le fourneau brisé d'une pipe en maïs ; une boite à charbon en fausse laque dont la charnière pendait avait été repoussée dans un angle. C'était l'habitude, en ce temps-là, de chauffer chaque pièce par le moyen d'une cheminée qui lui était propre et qui prodiguait plus de saleté que de chaleur : quant à la ventilation, on comptait que la croisée mal ajustée s'entendrait avec la petite cheminée et la porte mal close pour y pourvoir naturellement. Dans un coin de la pièce, le lit de Parload dissimulait ses draps grisâtres sous une vieille courtepointe de fantaisie et logeait sous son sommier des malles et autres objets hétéroclites. Encombrant l'encoignure de la fenêtre, la toilette étalait ses simples accessoires ; cette toilette devait son existence à quelque ébéniste pressé qui avait cherché à masquer ses malfaçons sous une profusion d'ornements faciles. Le meuble était ensuite tombé de toute évidence aux mains d'une personne favorisée par les loisirs et qui, munie d'un pot d'ocre, d'une bouteille de vernis et d'un jeu de peignes, s'était appliquée à la peindre puis à la vernir, et, enfin, au moyen des peignes, à simuler grossièrement les veines d'un bois imaginaire. Une fois établie, cette toilette avait fourni une carrière utile et tumultueuse : on l'avait éraflée, cognée, entamée, heurtée, tachée, échaudée, martelée, mouillée, séchée et salie ; elle avait, à la vérité, enduré toutes les tribulations possibles, hormis un incendie ou un nettoyage sérieux, avant d'avoir trouvé refuge dans la mansarde de Parload où elle suffisait au service très simplifié que la propreté personnelle de son dernier propriétaire réclamait de sa vieille expérience. Au résumé, elle supportait une cuvette, un pot à eau et abritait un seau ; un pain de savon jaune voisinait avec une brosse à dents et une savonnette à barbe en queue de rat ; une serviette et quelques autres objets complétaient l'installation. À cette époque, seules les personnes aisées disposaient de plus de luxe, et il est à noter que chaque goutte d'eau dont Parload faisait usage devait être montée, par une fille de service, du sous-sol jusqu'à la mansarde, et redescendue de même. Nous commençons à oublier combien la propreté personnelle est une invention moderne. De fait, Parload ne s'était jamais déshabillé pour un plongeon ; il n'avait jamais, depuis son enfance, baigné simultanément toutes les parties de son corps ; je puis dire que pas un sur cinquante d'entre nous, en ces temps-là, n'avait connu le luxe d'un bain complet.
Aussi bizarrement décorée que la toilette, une commode en faux noyer, munie de quatre tiroirs, deux grands et deux petits, contenait la provision de linge de Parload, et des champignons fixés à la porte complétaient le mobilier de cette chambre à coucher-salon telle que je l'ai connue avant le Changement. J'oublie : – il y avait encore une chaise pourvue d'un fond en bois perforé remplaçant l'osier qui avait cédé à l'usage. Mon oubli s'explique du fait que j'étais précisément assis sur la chaise au moment où commence cette histoire.
Si j'ai décrit avec autant de minutie la chambre de Parload, c'est pour établir le ton de ces premiers chapitres et vous les rendre plus compréhensibles ; mais n'allez pas vous imaginer qu'à ce moment cet ameublement baroque ou le relent de la lampe ait absorbé le moins du monde mon attention. J'acceptais tout ce manque sordide de confort comme le cadre le plus naturel à mon existence d'homme. C'était le cadre de la vie matérielle, tel que je le connaissais. Mon esprit était préoccupé d'une affaire autrement importante et d'un plus haut intérêt, et ce n'est que de loin et rétrospectivement que ces détails prennent du relief, s'affirment comme significatifs, et comme les manifestations caractéristiques de ce vieux monde et de ses désordres.
II
Parload se tenait debout devant la fenêtre ouverte, une jumelle de théâtre à la main, cherchant, trouvant, perdant de vue la nouvelle comète.
Cette comète me semblait alors bien importune, car j'avais hâte d'aborder un autre sujet. Mais Parload était tout à son observation. J'avais le sang à la tête, des ennuis compliqués d'amertume me donnaient la fièvre : je voulais lui ouvrir mon cœur. Je souhaitais tout au moins me soulager par quelque confidence romanesque, si bien que je prêtais peu d'attention aux choses qu'il me disait. C'était la première fois que j'entendais parler de ce nouveau point entre les mille autres points du firmament, et je me fusse peu soucié de n'en entendre jamais plus parler.
Nous étions à peu près du même âge ; Parload, de huit mois mon aîné, avait vingt-deux ans. Il était deuxième clerc dans une petite étude d'Overcastle, cependant que je faisais figure de deuxième commis à la manufacture Rawdon, à Clayton. Nous nous étions rencontrés à la conférence de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens de Swathinglea ; il se trouvait que, le soir, nous fréquentions, aux mêmes heures, des cours, lui de science, moi de sténographie, à Overcastle, et nous prîmes l'habitude de rentrer ensemble, à pied, ce qui nous lia bientôt d'amitié. (Swathinglea, Clayton et Overcastle formaient une agglomération dans la région industrielle du Centre.) Nous nous étions confié nos doutes religieux et avoué l'intérêt que nous portions aux problèmes du socialisme ; il avait soupé par deux fois chez ma mère, le dimanche, et il m'accueillait en familier dans son logement. Parload était en ce temps-là un grand jeune homme blondasse, d'allures gauches, au cou et aux poignets démesurés, capable au surplus de tous les enthousiasmes. Il consacrait deux soirées par semaine à l'école des sciences d'Overcastle. La cosmographie était son sujet favori, et, par la brèche que l'étude de cette science ouvrit dans son esprit, les merveilles de l'espace avaient insidieusement pris possession de son âme. D'un séjour chez son oncle, qui exploitait une ferme à Leet, par-delà les landes, il avait rapporté une vieille jumelle ; en outre, il s'était procuré un planisphère céleste et l'almanach astronomique de Whitaker, et, pendant une période de son existence, l'éclat du soleil et le clair de la lune ne l'affectèrent que pour autant qu'ils interrompaient le cours normal de sa vie nocturne de chercheur d'étoiles. Son être se sentait capturé par l'abîme céleste, les immensités, les possibilités mystérieuses qui flottaient dans les ténèbres de ces profondeurs inviolées. À force de travail et grâce à une étude très précise lue dans le Ciel, petite revue mensuelle rédigée à l'intention de ceux que hantait une obsession semblable, il tenait enfin au bout de sa jumelle la nouvelle visiteuse de notre système planétaire. Il contemplait, dans une sorte de ravissement, la petite lueur vacillante, découverte parmi les têtes d'épingle scintillantes de la pelote céleste. Il restait là, en contemplation, et se souciait vraiment peu de mes misères.
– Quelle merveille ! – soupira-t-il, et puis, comme si l'emphase de sa voix lui eût paru trop modeste pour son émotion, il répéta sur un ton plus pompeux : – Quelle merveille !… Veux-tu la voir ? – fit-il en se tournant vers moi.
Je dus regarder dans la jumelle, puis il me fallut écouter ses explications : comment cette intruse imperceptible allait grandir, serait bientôt une des plus grandes comètes que le monde eût connues ; comment sa trajectoire l'amènerait à près de… qui sait combien de milliers de lieues de notre terre ! – à un pas de nous, quoi ! semblait dire Parload ; comment, de plus, le spectroscope était en voie d'analyser ses secrets chimiques, intrigué par une bande verte, ornement sans précédent dans la toilette des comètes ; comment, en ce moment même, elle posait devant les objectifs braqués sur l'éploiement d'une traîne insolite dirigée vers le soleil, traîne qu'elle ramassa bientôt du geste aisé d'une mondaine. Et cependant, à part moi et comme à voix basse, ma pensée me parlait de Nettie Stuart et de la lettre que je venais de recevoir d'elle ; puis de la figure haïssable du vieux Rawdon, telle que je l'avais contemplée cet après-midi. J'imaginais tantôt des réponses à Nettie, tantôt quelque réplique pour mon patron, mais Nettie, toujours et encore, se dessinait en lumière sur le fond de ma rêverie.
Nettie Stuart était la fille du jardinier-chef de Mme Verrall, veuve très riche. Nettie et moi, nous avions échangé des baisers et des serments avant notre dix-huitième année. Ma mère et la sienne étaient cousines issues de germains et compagnes d'école, et, bien que ma mère, restée veuve très jeune à la suite d'un accident de chemin de fer, eût dû se mettre logeuse (le vicaire de Clayton était son pensionnaire), bien que sa situation fût jugée inférieure à celle de Mme Stuart, on se voyait encore, et des visites espacées au cottage du jardinier à Checkshill Towers empêchaient qu'on se perdît de vue. D'ordinaire, j'étais de la partie, – et je me souviens, ce fut par un clair crépuscule de juillet, une de ces longues soirées d'or qui cèdent moins le pas à la nuit qu'elles n'accueillent, semble-t-il, par gracieuseté, la lune et son scintillant cortège d'étoiles, – Nettie et moi, près de la pièce d'eau où convergent les charmilles, échangeâmes le premier aveu timide des amants. Je me remémore, – et quelque chose, à ce souvenir, s'agitera toujours en mon âme, – l'émoi tremblant de l'aventure. Elle était toute en blanc, sa chevelure se séparait en deux vagues de ténèbres au-dessus de ses yeux noirs, un petit collier de perles encerclait son cou gracile et potelé, et l'éclat d'une médaille se blottissait vers sa gorge émue : ma lèvre se scella sur sa lèvre mal défendue – et durant trois ans de ma vie, durant toute ma vie, je crois, j'aurais à tout instant offert de mourir pour elle.
Il faut savoir comprendre – car chaque année ces choses se font plus inintelligibles – combien ce monde différait du nôtre. C'était un monde obscur, plein de désordres qu'on eût pu redresser, de maladies qu'on eût pu prévenir, de douleurs qu'on eût pu éviter, de craintes stupides autant qu'involontaires, de duretés inconscientes… Pourtant, du fait peut-être de l'obscurité universelle, il y eut des moments de rare beauté éphémère qui ne semble plus possible désormais. Le grand Changement est venu pour jamais, le bonheur et la beauté sont notre atmosphère même, – il y a paix sur la terre et bonne volonté envers tous. – Nul homme n'oserait former le rêve de revenir aux tristesses des temps antérieurs… Toutefois, cette grande misère était traversée, sans cesse, de part en part, le rideau grisaille de sa pénombre était troué par des joies d'une intensité, par des sensations d'une finesse telles qu'il me semble que la vie n'en connaît plus désormais d'analogues. Est-ce le Changement qui a retranché de la vie ses extrêmes de joies et de tristesses, ou, plus simplement, ne serait-ce pas que la jeunesse m'a quitté, – entraînant avec elle ses désespoirs et ses ravissements, – me laissant peut-être un jugement sain, des émotions sympathiques, des souvenirs ?
Je n'en sais rien. Il faudrait être jeune aujourd'hui et avoir été jeune jadis pour résoudre cet insoluble problème.
Il se peut qu'un spectateur impartial, même en ces jours d'autrefois, n'eût trouvé que peu de beauté à notre groupement. J'ai, ici, sous la main, dans ce secrétaire, deux photographies : – j'y figure un jeune garçon gauche, en complet mal ajusté, et Nettie – de fait, Nettie est tristement fagotée et sa tenue est incontestablement raide ; mais je puis la voir à travers cette image, et sa vivacité, son entrain et quelque chose du charme mystérieux qu'elle eut pour moi me reviennent à la pensée. Sa figure a triomphé du photographe – sans quoi j'eusse, dès longtemps, jeté ce portrait.
La réalité de la beauté ne se prête pas à l'expression verbale. Comme je voudrais être maître de l'expression graphique et pouvoir dessiner, en marge de mon manuscrit, ce quelque chose dont la description défie les mots. Il y avait dans son regard une sorte de gravité ; sur sa lèvre supérieure close un rien voltigeait, un peu d'ombre qui s'épanouissait en sourire – oh ! ce sourire grave et doux !
Après avoir échangé un baiser et convenu de ne pas encore parler à nos parents du choix irrévocable que nous avions fait l'un de l'autre, le moment vint de nous séparer, timidement et devant le monde. Je repartis avec ma mère à travers le parc baigné de clair de lune (des chevreuils effarouchés faisaient bruire les taillis) jusqu'à la gare de Checkshill, et nous regagnâmes ainsi notre sombre sous-sol de Clayton… et je ne revis plus Nettie, si ce n'est en pensée, pendant presque une année. À notre second rendez-vous, au bout de ce temps, il fut décidé que nous nous écririons, ce que nous fîmes après avoir tout combiné pour sauvegarder notre secret ; car Nettie ne voulut prendre personne de chez elle, pas même sa sœur unique, pour confidente de ses amours. Je devais donc lui faire parvenir ma précieuse correspondance, sous enveloppe cachetée, par l'intermédiaire d'une compagne de pension, son amie intime, qui demeurait près de Londres ; je pourrais encore dire cette adresse, bien que la maison, la rue et le faubourg aient aujourd'hui disparu sans laisser de trace.
De cet échange de lettres que date le commencement de notre séparation, parce que nous entrions pour la première fois en relation intellectuelle et que nos esprits cherchèrent à se formuler.
Il est nécessaire de bien comprendre que le monde de la pensée se trouvait, en ces jours-là, dans un état des plus singuliers : tout encombré de formules vieillies et inadéquates, embrouillé et embrumé de raisons secondes, d'adaptations, de suppressions, de conventions et de subterfuges. Un apriorisme abject ternissait la vérité sur les lèvres de tous. Je fus élevé par ma mère dans une foi bizarre, archaïque et étroite, acceptant certaines formules religieuses, certaines règles de conduite, certaines conceptions de l'ordre social et politique, absolument sans rapport avec les réalités et les besoins de la vie quotidienne contemporaine. Sa religion sentait la lavande ; le dimanche, elle écartait toute la réalité, le vêtement et même l'ameublement de tous les jours, cachait ses mains noueuses, et parfois gercées par le travail, dans des gants noirs soigneusement reprisés, revêtait sa vieille robe de soie noire, son chapeau d'apparat, et, requinquée et radieuse, m'emmenait à l'église. Là nous chantions, nous nous inclinions, nous écoutions de bruyantes prières, unissions nos voix dans de sonores répons, et nous nous relevions, dans un soupir unanime, quand le début de la doxologie : À la gloire de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils…, annonçait la fin du sermon. Il y avait, dans cette religion de ma mère, un enfer à la chevelure de flamme, un enfer qui avait jadis répandu la terreur ; il y avait aussi un diable qui était en même temps l'ennemi officiel du roi d'Angleterre, et on y vitupérait abondamment et sempiternellement les « désirs mauvais de la chair » ; on voulait nous faire croire que la plus grande partie de notre humanité malheureuse devait racheter ses misères et ses tourments quotidiens en souffrant à jamais d'indicibles tortures dans un monde futur et éternel, amen. Mais, de fait, ces flammes en tire-bouchon avaient un air amusant, et toute l'histoire avait fini par mûrir et se faner, comme une vieille fresque légendaire, bien avant mon temps. Provoquait-il même, cet enfer, de la terreur aux années de mon enfance ? Je ne puis m'en souvenir, mais certainement ce n'était pas aussi terrible que l'Ogre du Petit Poucet, et tout cela se résume à présent pour moi dans l'expression du visage de ma pauvre vieille mère, aux traits usés et ridés, et je l'aime encore comme une partie d'elle. M. Gabbitas, notre locataire, petit, gros et replet, étrangement transformé sous ses vêtements cultuels, élevant sa voix jusqu'aux mâles accents des prières du temps d'Elisabeth, éveillait, je crois, en ma mère une sympathie toute spéciale et comme personnelle pour Dieu. Son Dieu, ma mère l'illuminait des rayons tremblants de sa propre douceur, elle le rachetait des calomnieuses vengeances où l'impliquaient les théologiens. Elle était elle-même, – que ne l'ai-je perçu alors, – l'exemple de tout ce qu'elle aurait voulu m'enseigner.
Je vois cela sous cet aspect aujourd'hui, mais l'ardeur confiante de la jeunesse est impitoyable. Ayant d'abord pris toutes ces choses au sérieux, – l'enfer de flammes et le Dieu qui châtie pour la moindre négligence, – comme si elles eussent été aussi matériellement réelles que les hauts fourneaux de Bladden ou la manufacture de Rawdon, je les rejetai soudain de mon esprit avec un sérieux égal.
C'est que M. Gabbitas s'était parfois, comme on dit, intéressé à moi ; il m'avait engagé à continuer à lire après ma sortie de l'école et, avec les meilleures intentions du monde, dans le but de m'inculquer, par anticipation, un antidote contre le poison intellectuel de l'époque, il m'avait mis entre les mains le Scepticisme réfuté, de Burble, et m'avait indiqué les ressources qu'offrait la bibliothèque de l'Union Chrétienne, de Clayton.
La lecture de Burble me causa une grande commotion morale. Il ressortait clairement, de ses réponses mêmes au scepticisme, que la cause de l'orthodoxie doctrinale avec toute cette histoire d'un monde futur, légendaire et très peu terrifiant, que j'avais acceptée comme on accepte le soleil, était une cause indéfendable. Le hasard me confirma dans ces conclusions : le premier livre que je pris à la bibliothèque fut une édition américaine des œuvres complètes de Shelley, contenant sa prose vaporeuse et ses vers aériens. Je fus bientôt mûr pour l'incrédulité. À l'Union Chrétienne de Jeunes Gens, je fis, sur ces entrefaites, la connaissance de Parload qui me confia, sous le sceau du secret le plus absolu, qu'il était « socialiste à fond ». Il me prêta plusieurs numéros d'un périodique au titre retentissant : le Clairon, qui précisément commençait une campagne contre l'Église établie. Les années adolescentes de tout homme d'intelligence moyenne sont ouvertes, et seront toujours ouvertes, à la saine contagion du doute philosophique, au sens du ridicule, aux idées nouvelles. Je subis fortement cette crise. Le doute, dis-je ? Ce n'était pas tant le doute que l'étonnement et la plus violente négation. « Ai-je pu croire à ceci ? » Il faut aussi vous rappeler que je commençais alors ma correspondance amoureuse avec Nettie.
Nous vivons, aujourd'hui que le Grand Changement s'est accompli, à une époque où chacun est élevé dans une sorte de douceur intellectuelle, une bienveillance qui n'enlève rien de sa vigueur à l'esprit ; aussi est-il difficile de concevoir l'atmosphère étouffée où se débattait la pensée des jeunes gens de ma condition. Le fait seul de penser à certaines questions était en soi un acte de rébellion qui vous mettait aussitôt dans un état de déséquilibre mental, entre la timidité et le défi. On commence généralement à trouver Shelley, malgré toute la musique de ses vers, un peu bien bruyant et malappris, maintenant que ses « Anarchs » ont disparu ; il fut une époque, toutefois, où la pensée neuve devait assumer ce ton de casseur de vitres. Il devient malaisé de se figurer l'effervescence des esprits, le besoin qu'on éprouvait de crier « Hou ! Hou ! » au passage de l'autorité constituée, le ton provocateur où se montaient nos jeunes négations. Je me mis à lire avidement les écrits que Carlyle, Browning et Heine ont légués à la perplexité des générations, – non seulement à les lire, mais à les admirer et à les imiter. Mes lettres à Nettie, après deux ou trois manifestations sincères d'une passion surchauffée, se corsèrent de théologie, de sociologie, et revêtirent le Cosmos de leur phraséologie emphatique. Il est indubitable qu'elles durent l'intriguer au plus haut point.
Je garde la plus vive sympathie et je ne sais quel sentiment d'envie à ma jeunesse envolée ; néanmoins, il me serait difficile de contredire quiconque prétendrait que je fus tel que me montre ma photographie un grand gamin fort sot, fort poseur et fort sentimental. Et quand je m'efforce de reconstituer ce que pouvait être le fruit de mes efforts pour établir une lettre vraiment belle à l'intention de ma bien-aimée, je le confesse, j'en ai le frisson, – et pourtant je souhaiterais qu'elles n'eussent pas toutes été détruites.
Les lettres qu'elle m'écrivait étaient assez simplettes ; l'écriture en était ronde, mal formée et le style peu fleuri. Les deux ou trois premières témoignaient d'un plaisir timide à employer les mots « mon chéri », et je me souviens d'avoir été intrigué puis charmé, quand je sus le sens du petit mot français « adoré » qu'elle accolait à mon nom. Mais, à partir du jour où je donnai cours à mon effervescence intellectuelle, ses réponses continrent moins de joie.
Je ne vous ennuierai pas avec le récit détaillé de notre querelle puérile, de ma visite inattendue à Checkshill, le dimanche suivant, qui gâta tout, de la lettre que j'écrivis ensuite, qu'elle trouva ravissante et qui nous raccommoda. Je ne vous dirai rien non plus de toutes les fluctuations de nos méprises réciproques. Toujours je fus l'offenseur et c'est moi qui, en fin de compte, venais demander pardon, jusqu'à cette dernière affaire qui commençait ; entre-temps, nous eûmes des moments tendrement intimes, et je l'aimais vraiment beaucoup. Le malheur était que, dans l'obscurité et seul, je pensais à elle avec intensité, à ses yeux, au contact de sa main, à sa douce et adorable présence ; mais lorsque je m'attablais pour lui écrire, je ne pensais qu'à Shelley, à Burns, à moi-même et à tels autres sujets aussi peu de circonstance. Quand on est amoureux comme je l'étais, à l'état, dirai-je, effervescent, il est plus difficile de faire sa cour et de parler d'amour, que lorsqu'on n'aime pas. Quant à Nettie, elle aimait, je sais, non pas moi, mais tout cet appareil de joli mystère. Ce n'est pas ma voix qui devait éveiller ses rêves à la passion…
Aussi bien notre correspondance continuait sans harmonie. Un beau jour, elle m'écrivit qu'elle doutait de pouvoir jamais aimer un socialiste qui ne croyait pas à l'Église, et, suivant de près, une autre lettre arriva, formulée dans un style tout nouveau. Elle estimait, disait-elle, que nous n'étions pas assortis l'un à l'autre, que nous différions de goûts et d'idées, que depuis longtemps elle songeait à me relever de mes engagements et à me rendre ma parole. Bref, et bien que je ne l'eusse pas compris tout d'abord, au premier choc, c'était mon congé. Sa lettre m'avait été remise comme je rentrais à la maison, le jour même où le vieux Rawdon avait refusé d'augmenter mes appointements. Ce soir-là donc, où débute ma narration, je me trouvais en face de deux faits presque écrasants et auxquels j'essayais fiévreusement de m'adapter : je n'étais indispensable ni à Nettie ni à Rawdon… Je me souciais bien de la Comète !
Où en étais-je arrivé et pour quoi comptais-je ? J'avais si bien pris l'habitude de considérer Nettie comme indissolublement mienne, – toute la tradition du « véritable amour » m'y poussait, – que de la voir me tourner le dos avec ces phrases précises et nettes, et m'abandonner, moi dont les lèvres s'étaient unies aux siennes, moi à qui elle avait permis les familiarités risquées et délicieuses coutumières aux amants, me scandalisait par-delà toute mesure. Moi ! Moi !… ! Et Rawdon ne me trouvait pas davantage indispensable… Je me sentis soudain comme rejeté par l'univers, menacé d'annihilation, au point qu'il me parut urgent d'affirmer ma personnalité de quelque façon positive et emphatique. Ni dans la religion où on m'avait instruit, ni dans l'irréligion que je m'étais faite, il n'existait de baume consolateur pour l'amour-propre blessé.
Allais-je lâcher ma place chez Rawdon et, de quelque manière extraordinaire et prompte, faire la fortune de son voisin et concurrent Frobisher ?
La première partie de ce programme était en tout cas facilement réalisable : aller trouver Rawdon et lui dire : « Vous aurez de mes nouvelles, monsieur ! » Quant à la seconde, Frobisher pourrait ne pas s'y prêter. Cela toutefois était chose secondaire. L'affaire Nettie dominait la situation. Mon cerveau s'encombrait de fragments de rhétorique utilisables pour la lettre que je préméditais ; méprisant, ironique, tendre, quel ton choisirais-je ?
– Zut ! – fit Parload tout à coup.
– Qu'est-ce qu'il y a ? – m'informai-je.
– On charge les fours aux aciéries de Bladden, et la fumée vient tout juste voiler mon coin de ciel.
L'interruption arrivait au moment précis où j'allais déverser en son sein ma pensée trop lourde.
– Parload, – dis-je, – il est vraisemblable que je vais quitter tout ceci ; le vieux Rawdon m'a refusé une augmentation, et maintenant que la demande a été faite, je ne crois pas qu'il me soit possible de continuer aux mêmes appointements, n'est-ce pas ? Donc, il va falloir lâcher Clayton pour de bon.
III
Du coup, Parload posa sa lorgnette et me dévisagea.
– C'est un mauvais moment pour changer, – déclara-t-il, après une pause.
Rawdon m'en avait dit autant, bien moins aimablement. Mais, en face de Parload, je me sentais toujours porté à prendre le ton héroïque.
– J'en ai assez, de me tuer le tempérament au service des autres ! – m'écriai-je. – Autant s'affamer le corps en quittant ma place, que s'affamer l'âme en y restant.
– Je ne suis pas tout à fait de cet avis, – dit Parload, lentement.
Ce fut le début d'une de nos interminables conversations, – d'un de ces bavardages erratiques, diffus, généralisants et personnels à la fois, qui seront chers au cœur des jeunes gens intelligents tant qu'il y aura une jeunesse. Le Changement n'aura pas aboli cela, en tout cas.
Ce serait un incroyable tour de force que de raviver aujourd'hui ce brouillard de paroles ; de fait, je ne me souviens de rien, bien que le détail de la scène et du décor forment un tableau précis dans ma mémoire. Je « posais », suivant mon habitude, et me comportais fort sottement, en égoïste blessé au vif, sans doute ; et, de son côté, Parload dut jouer son rôle de philosophe préoccupé des abîmes célestes.
Bientôt, nous fûmes dehors, déambulant dans la chaude nuit d'été, et causant d'autant plus à notre aise. Je me souviens d'une phrase que je débitai :
– Je souhaiterais, parfois, – dis-je en montrant le ciel, – que ta comète, ou quelque autre astre, anéantît cette terre, et, comme des chiffres sur un tableau, nous effaçât tous, supprimant, du même coup, grèves, guerres, bagarres, amours, jalousies et toutes les misères de la vie.
– Ah ! – fit Parload, que cette idée parut étonner. – Cela ne ferait qu'ajouter aux misères de l'existence – reprit-il quelques instants plus tard, alors que je lui parlais déjà d'autre chose.
– Cela, quoi ?
– Une collision avec la Comète. Cela ne ferait que tout reculer. Ce qui resterait de la vie redeviendrait plus sauvage que la vie présente.
– Mais serait-il nécessaire qu'il restât quoi que ce soit ? – demandai-je, d'un ton sarcastique, tandis que nous suivions côte à côte une rue étroite qui longeait sa maison, se coupait de marches, devenait sentier et nous emmenait vers Clayton Crest et la grande route.
Mais le souvenir de cet endroit est encore si vivant en moi que j'en oublie qu'aujourd'hui tout cela est changé et méconnaissable, et que la rue étroite, l'escalier, et la vue qu'on avait du haut de Clayton Crest, aussi bien que le monde où je fus élevé, se sont évanouis hors de l'espace et du temps, sont inimaginables pour la génération qui me suit. Vous ne pouvez pas voir, comme je le revois, le sombre espace entre les maisons, la rue obscure que laisse dans l'ombre un terne réverbère à gaz, placé au carrefour ; vous ne pouvez pas sentir encore sous vos pas, à travers de mauvaises chaussures, le dur carrelage des pavés, ni remarquer les rares fenêtres faiblement éclairées çà et là, dans les ténèbres, ni, par les jalousies disjointes, entrevoir la silhouette des êtres claquemurés là-dedans. Vous ne sauriez, en imagination, traverser la brusque lueur que projette la devanture du cabaret, ni aspirer malgré vous une bouffée de son atmosphère viciée, ni entendre la bordée de grossièretés jaillie de la porte, ni voir fuir cette ombre penchée de quelque précoce vaurien, qui vient de nous frôler sur les marches.
Nous traversâmes une rue plus longue, que remontait bruyamment un encombrant tramway à vapeur, vomissant la fumée et les étincelles, une rue que bordait la perspective huileuse des devantures, avec, çà et là, la voiture à bras des petits marchands, éclairée par un flambeau à pétrole d'où tombaient dans la nuit des flammèches. Une cohue confuse coulait et refluait entre les trottoirs, et on entendait la voix d'un prêcheur ambulant, réfugié dans un terrain vague, entre les maisons. Vous ne pouvez voir ces choses comme je les revois, non plus que vous ne pouvez les imaginer, à moins que vous ne connaissiez les tableaux qu'a laissés le grand peintre Hyde. Vous ne pouvez vous figurer la haute palissade sur laquelle, d'en bas, les becs de gaz projetaient leurs reflets dansants, et qui s'élevait jusqu'à découper dans le ciel pâle une arête vive et noire.
Ces palissades, c'était ce qu'il y avait de plus coloré dans notre monde évanoui. Sur elles, en couches successives de colle et de papier, toute la grossière activité de ces temps se mêlait en dissonances chromatiques : pilules, théâtres, conférences religieuses, bals de charité, savons merveilleux, conserves étonnantes, machines à écrire ou à coudre, se heurtaient en une sorte de clameur visuelle. Plus loin, une ruelle boueuse, empierrée de mâchefer et d'escarbilles, une ruelle sans une lumière, dont les flaques empruntaient au ciel le reflet d'une étoile… Nous allions, pataugeant au hasard, tout à notre conversation.
À travers les terrains divisés en lots, désert planté de choux, et dépassant de sinistres masures et une fabrique abandonnée, nous parvînmes jusqu'au grand chemin. Flanqué de constructions clairsemées, il montait en tournant, de sorte qu'on jouissait du panorama circulaire de la vallée où s'aggloméraient quatre villes industrielles.
Je veux bien qu'avec le crépuscule tout ce paysage urbain se soit vêtu d'une étrange magnificence qui l'enveloppa jusqu'à l'aube. Un voile était jeté sur toute la mesquinerie de ces détails, sur les masures qui figurent les homes, sur l'arroi innombrable des cheminées, sur les tristes taches de végétation poussant à contrecœur entre les clôtures faites de fil de fer et de douves de tonneaux ; voilées, les blessures de rouille entamant les collines d'où l'on extrayait le minerai de fer ; voilés, les amas énormes des scories que rejetaient les fourneaux ; transfigurées par le prestige nocturne, les fumées rouges et ardentes que vomissaient les fonderies aux halos de poussières enflammées, les moufles, les bessemers… Tout était atténué et assimilé par la nuit. L'atmosphère, grisâtre, alourdie de mille atomes, et qui, de jour, était comme une oppression, se colorait, dès le soleil couché, d'un mystère polychrome et translucide de bleus et de pourpres, d'incarnats sourds, de victorieux vermillons, et, sur tout cela montant vers le ciel plus sombre, une clarté diffuse d'émeraude et de safran. Chaque cheminée fanfaronne, quand le soleil-monarque était parti, se couronnait de flammes ; les amoncellements de scories se mettaient à scintiller de mille feux, et chaque usine proclamait sa rébellion en arborant ce diadème volcanique de lumière : l'empire du jour se démembrait en une multitude de fiefs embrasés.
Les petites rues transversales, qui coupaient la vallée, se dessinaient en pointes de feu, en réverbères d'un jaune amorti, qui se rejoignaient, s'intensifiaient à chaque carrefour, mêlés à l'éclat livide des buissons de becs incandescents et à l'éblouissement glacial des lampes à arc. Les voies ferrées entrelaçaient leurs signaux lumineux, étoiles rouges ou vertes, groupées en constellations rectangulaires, et les trains hâtifs simulaient des serpents noirs et souples crachant le feu.
Sur tout cela, bien haut, comme une chose placée hors d'atteinte et presque oubliée, Parload s'était avisé de redécouvrir une région que ne gouvernaient ni le soleil ni les hauts fourneaux, – l'univers infini des astres.
Tel fut le cadre de maintes conversations, et si, dans la journée, nous dépassions la crête des collines, nous contemplions, vers l'ouest, un pays de cultures, semé de parcs et de châteaux, et, là-bas, la flèche aérienne d'une cathédrale ; parfois, alors qu'avant la pluie l'atmosphère se faisait transparente, nous découvrions un horizon de montagnes suspendu contre le ciel. Par-delà encore, et hors de toute vision, il y avait Checkshill ; la nuit, je me sentais plus que de jour proche de Checkshill et de Nettie.
Il nous semblait, à nous deux qui déroulions en causant nos heures de jeunesse, le long du sentier d'escarbilles qui bordait les ornières du chemin, que, de ces crêtes, nos yeux contemplaient le monde entier en raccourci.
Oui, à notre droite, dans l'ombre, se blottissait, autour des hideuses fabriques, le troupeau des ouvriers mal vêtus, mal nourris, croupissant dans l'ignorance, mal servis dans tous les détails de l'existence et vivant coûteusement, au jour le jour, sans garantie du lendemain, cependant que – comme sur un fumier les champignons – surgissaient, disproportionnés, parmi ces misérables demeures, les chapelles, les églises, les débits de boissons et les établissements de plaisir. À notre gauche, au large, entourés d'espace, de liberté, de dignité humaine, insoucieux des quelques cottages bondés et pittoresques où s'entassaient les laboureurs, – séjournaient les grands propriétaires et les maîtres, les possesseurs de la manufacture, de la forge, du champ et de la mine. Et tout là-bas, très loin, belle, idéale, surgie d'entre les devantures de bouquinistes et les demeures ecclésiastiques, les auberges et autres détails d'une vieille ville à marchés et foires tombée en décadence, c'était la cathédrale de Lowchester montrant, de sa flèche admirable et discrète, on ne sait quel Paradis céleste, vague et incroyable.
Ainsi, toute la vie du monde se résumait pour nous dans ces juvéniles impressions.
Nous voyions toutes choses simplement, schématiquement, comme c'est le propre de la jeunesse. Nous avions pour tous les maux sociaux quelque solution irritée et téméraire ; et quiconque nous contredisait était pour nous un partisan des voleurs. Le vol nous apparaissait manifeste. Le détrousseur, embusqué dans ces vastes demeures, c'était le Propriétaire, le Capitaliste, flanqué de son valet, le Magistrat, et de son imposteur le Prêtre… ! Et nous tous, nous étions les victimes de ces infamies préméditées. Sans doute, ils clignaient des yeux et ricanaient entre eux, devant leurs coupes de champagne, affalés parmi leurs femmes éblouissantes dans la livrée du vice, et ils complotaient de nouvelles exactions contre le pauvre. De l'autre côté, au milieu de toute l'affreuse misère, dans la brutalité, l'ignorance, la crapule, gisait, selon nous, leur victime innocente et innombrable, l'Ouvrier. Maintenant que nous avions découvert tout cela, à première vue, il ne restait plus qu'à dénouer la situation en phrases sonores et véhémentes, pour changer la face du monde. L'Ouvrier, alors, se lèverait, se grouperait en Parti du Travail, avec, pour le représenter, des jeunes gens comme Parload et moi… Il reprendrait possession de son bien, et alors ?…
Oh ! Alors, les voleurs en verraient de chaudes, et tout serait pour le mieux.
Si ma mémoire ne me trompe étrangement, c'est là le résumé assez exact de la théorie et de l'action sociale que nous considérions, Parload et moi, comme le fin mot de la raison humaine. Notre foi était ardente, et nous rejetions avec violence les objections les plus plausibles. Parfois, au cours de nos grandes discussions, nous éprouvions l'inébranlable certitude que nos convictions triompheraient, mais, le plus souvent, nous épanchions une indignation virulente contre la malveillance et la stupidité qui osaient retarder l'accomplissement de ce plan si simple de reconstruction du monde. Nous nous révoltions à cette pensée, et songions aux barricades et à l'action directe. Je fus particulièrement amer, ce soir-là, je me souviens, et le capitalisme hideux et tyrannique assumait pour moi les traits du vieux Rawdon et le sourire avec lequel il m'avait refusé d'augmenter mes pauvres vingt shillings d'appointements hebdomadaires.
J'ambitionnais de sauvegarder mon amour-propre par quelque acte de vengeance, et, si ma vengeance exigeait l'extermination de l'Hydre-Capital, je pourrais traîner la carcasse du monstre jusqu'aux pieds de Nettie, et régler du même coup ce second différend.
– Eh bien ! Nettie, m'apprécies-tu, maintenant, à ma valeur ?
Voilà, à peu près, mon état d'esprit d'alors, d'après lequel vous pouvez vous figurer l'ardeur de mes gestes et de mon éloquence. Représentez-vous deux petites silhouettes noires, aux lignes peu esthétiques, perdues dans ces noirceurs désolées d'industrialisme flamboyant, et ma faible voix enflée de rhétorique, protestant et revendiquant…
Ces idées de ma jeunesse vous sembleront, sans doute, un piètre amalgame de sottise et de violence, surtout si vous êtes né depuis le Changement. De nos jours, tout le monde pense clairement, posément, et les pensées sont d'évidentes certitudes ; il est bien difficile de s'imaginer des cerveaux fonctionnant comme jadis les nôtres. Permettez-moi de vous aider à vous mettre quelque peu dans l'état mental et moral où nous étions alors. D'abord, il faudrait vous abîmer la santé en mangeant et en buvant sans mesure, vous ankyloser les membres en négligeant tout exercice ; puis, vous efforcer de vous créer de terribles tracas, cultiver l'inquiétude et vous habituer au manque de confort ; à cela, ajoutez un travail quotidien pendant de longues heures, travail, au surplus, trop mesquin pour intéresser, trop complexe pour qu'il se puisse faire mécaniquement, et n'ayant aucun rapport direct ou indirect avec vos aspirations ou vos intérêts personnels. Cela fait, rendez-vous aussitôt dans une pièce sans ventilation aucune, dont l'air est déjà nauséabond, et occupez-vous à résoudre quelque problème difficile. Vous ne tarderez pas à ressentir une fatigue intellectuelle ; vous serez agacé, impatient, cherchant à comprendre l'évidence, et bientôt acceptant et rejetant au hasard des solutions contradictoires. Essayez de jouer aux échecs dans de pareilles conditions : vous jouerez comme un idiot et vous céderez vite à la colère.
Eh bien ! tout le genre humain, avant le Changement, était de la sorte malade et fiévreux ; les soucis, le surmenage, les questions à élucider qui ne se posaient jamais simplement, mais qui modifiaient sans cesse leurs données et fuyaient toute solution, voilà ce qui créait pour les hommes une atmosphère suffocante, corrompue par la respiration des siècles. Il n'existait pas au monde un seul cerveau fonctionnant dans un calme normal. Il n'y avait dans l'esprit des hommes que demi-vérités, conclusions hâtives, hallucinations, émotions… le vide.
Je sais que tout ceci paraît incroyable, et que déjà la jeunesse commence à mettre en doute que le Changement ait été si radical ; mais lisez, je vous en prie, les journaux de ce temps-là. Chaque époque s'atténue, s'estompe et s'ennoblit un peu à mesure qu'elle recule dans le passé. À ceux qui, comme moi, sont à même de narrer des histoires vécues, il appartient de fournir, par un effort de scrupuleux réalisme intellectuel, l'antidote de ce mirage.
IV
Avec Parload, c'était toujours moi qui, comme on dit, tenais le crachoir.
Je me vois à cet âge comme un étranger ; tout a tellement changé depuis lors, que je suis devenu un autre être, qui n'a presque plus rien de commun avec le jeune homme vantard et sot dont je détaille les misères. Je le revois, théâtral et vulgaire, prétentieux, sans sincérité, et, à la vérité, je ne l'aimerais guère, n'était cette sorte de sympathie inconsciente et comme matérielle qui résulte d'une longue intimité. Comme ce jeune homme était moi, il se peut que je sois à même de pénétrer et de décrire les mobiles de certaines actions qui ne lui mériteront pas la sympathie du lecteur ; mais pourquoi pallier ou défendre les défauts de son caractère ?
Donc, c'est moi qui prenais et gardais la parole, et j'eusse été bien étonné d'entendre mettre en doute que, des deux, je fusse le plus intelligent dans ces duels verbaux. Parload était un garçon paisible, réticent et guindé en toutes choses, cependant que je possédais le don suprême pour un jeune homme et pour les démocraties, le « bagou », la parole facile. Dans mon for intérieur, je considérais Parload comme un peu stupide. Il posait au silencieux entendu, me disais-je, et « il le faisait » à la circonspection scientifique. Je n'avais pas remarqué qu'alors que mes mains n'étaient bonnes qu'à gesticuler ou à tenir une plume, les mains de Parload étaient habiles à cent besognes, et je n'en avais pu conclure, à plus forte raison, que les nerfs moteurs de ses doigts devaient être commandés par quelque chose comme un cerveau bien réglé. Et, encore que je me vantasse de ma sténographie, de ma littérature et de la part qui me revenait dans la prospérité de la maison Rawdon, Parload, lui, n'insista jamais sur les sections coniques, le calcul différentiel et tout ce qu'il s'était assimilé à l'École Supérieure des Sciences. Parload est aujourd'hui fameux, grande figure d'une grande époque, ses travaux sur les radiations intersectrices ont élargi à jamais l'horizon de l'humanité, et moi, qui ne suis au mieux qu'un bûcheron intellectuel, je souris, – et il peut sourire avec moi, – à me rappeler comment je jouais avec lui à la supériorité, posant, et l'accablant de ma faconde, dans ces jours de ténèbres.