
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
"Le livre ""Aventures merveilleuses mais authentiques du Capitaine Corcoran"" de Alfred Assollant est un véritable trésor de la littérature d'aventure. Plongez dans l'univers captivant du Capitaine Corcoran, un héros intrépide et charismatique, prêt à tout pour défendre la justice et l'honneur.
Ce récit palpitant vous transporte à travers des contrées lointaines et mystérieuses, où se mêlent pirates redoutables, trésors cachés et batailles épiques. Accompagnez le Capitaine Corcoran dans ses péripéties, des mers tumultueuses aux jungles impénétrables, en passant par des villes exotiques et des îles désertes.
L'auteur, Alfred Assollant, maître du genre de la littérature d'aventure, nous offre un récit riche en rebondissements et en émotions. Son style fluide et envoûtant nous plonge au cœur de l'action, nous faisant vivre chaque instant aux côtés du Capitaine Corcoran.
""Les Aventures merveilleuses mais authentiques du Capitaine Corcoran"" est un livre qui ravira les amateurs d'aventure, de suspense et de voyages extraordinaires. Préparez-vous à embarquer pour une aventure inoubliable, où le courage et la loyauté sont mis à l'épreuve, et où les héros se révèlent dans les moments les plus périlleux.
Plongez dans ce récit captivant et laissez-vous emporter par les exploits du Capitaine Corcoran, un personnage hors du commun qui ne manquera pas de vous fasciner. Une lecture qui vous transportera aux confins du monde, où l'imagination et l'aventure se rencontrent pour créer un véritable chef-d'œuvre littéraire.
Extrait : ""Six mois après les combats dont on a vu le récit dans la première partie de cette véridique histoire, le capitaine Corcoran, devenu maharajah du pays des Mahrattes, jouissait en paix du fruit de sa sagesse et de ses victoires."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Six mois après les combats dont on a vu le récit dans la première partie de cette véridique histoire, le capitaine Corcoran, devenu maharajah du pays des Mahrattes, jouissait en paix du fruit de sa sagesse et de ses victoires. Au reste, rien ne fera mieux juger de son bonheur que la lettre suivante, qu’il écrivit vers ce temps-là à M. le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences (de Lyon), pour lui rendre compte des courses qu’il avait faites dans les montagnes des Ghâtes et dans les vallées de la Nerbuddah et du Godavéry, à la recherche du fameux Gouroukaramta.
LE MAHARAJAH CORCORAN 1er
A M. le Président de l’Académie des sciences(de Lyon).
Bhagavapour, le 11 octobre 1858
L’an deuxième de notre règne et le quatre cent trente-trois mille sept cent dix-neuvième de la huitième incarnation de Vichnou.
Monsieur,
Je prie l’illustre Académie d’excuser le retard que j’ai mis à lui communiquer le résultat des recherches qu’elle a bien voulu me confier. Le Gouroukaramta est enfin retrouvé, et j’ai le plaisir de vous envoyer aujourd’hui une copie exacte de ce fameux manuscrit dont l’existence, au dire des plus savants brahmines, remonte à vingt-cinq mille ans avant l’ère chrétienne. Pour moi, sans vouloir imposer au public mon propre sentiment, j’ai de fortes raisons de croire qu’il est antérieur de huit cents ans au déluge et qu’il fut déposé par Noé, dans son tiroir, au moment où le saint patriarche emballait à la hâte, dans l’Arche, ses habits, sa femme, ses fils, ses filles et un couple de tous les animaux qui vivaient en ce temps-là sur la terre.
Diverses circonstances ont retardé de quelques mois la découverte et l’envoi du Gouroukaramta ; – une entre autres, qui peut-être ne vous paraîtra pas indigne d’intérêt, car elle me permet de servir désormais plus puissamment les intérêts de la science.
Il a plu à l’Éternel de faire de moi un pasteur des peuples. À coup sûr, rien n’était plus loin de moi que la pensée de gouverner qui que ce soit, excepté mon équipage et mon brick ; mais Dieu ne m’a laissé de choix qu’entre ces deux extrémités : régner sur les Mahrattes ou me faire fusiller par les Anglais. L’Académie comprendra que je ne pouvais pas hésiter, et j’ai la confiance qu’elle approuvera ma conduite. De mon côté, je mets à son service quinze mille fantassins, douze mille cavaliers, douze cents canons et un budget qui montait à quatre cents millions de francs sous mon prédécesseur, et que j’ai réduit à cent vingt millions (malgré cette réduction, je fais des économies sur mon budget, comme M. Gladstone sur le sien).
L’Académie, j’ose l’espérer, sera bien aise d’apprendre que mon amie Louison, dont l’intelligence, le courage, les dents et les griffes m’ont tiré plus d’une fois du péril, vit aujourd’hui bien portante et gaie dans mon palais. Vous lirez dans le Moniteur de Bhagavapour (dont j’ai l’honneur de vous adresser la collection) l’histoire de ses exploits héroïques et de l’intrépidité sans égale qu’elle montra le jour du dernier assaut. Monsieur Horatius Cocles n’a rien fait de plus beau lorsqu’il arrêta les Étrusques à l’entrée du pont du Tibre.
Je serais heureux, monsieur le président, si vous vouliez bien accepter les insignes de l’ordre de la Tigresse, que j’ai institué pour perpétuer la mémoire de Louison. Ces insignes sont une croix enrichie de diamants et un ruban bleu, que je vous envoie sous ce pli. Les diamants n’ont pas grande valeur : – sept cent mille francs tout au plus ; – mais je sais, monsieur, que vous attachez plus de prix à cette marque de l’estime de ma chère Louison qu’à des pierreries. Un philosophe tel que vous ne doit pas être traité comme un prince ou un banquier.
Le second du brick le Fils de la Tempête, que j’ai fait amiral de la flotte mahratte, est chargé de vous raconter de vive voix toutes nos aventures. Ce n’est pas un savant homme et je ne crois pas qu’il connaisse grand-chose en dehors de la lecture, de l’écriture, du sextant et de la boussole ; mais pour la manœuvre il n’a pas son pareil, et si quelqu’un des membres de l’Académie voulait me faire l’honneur de visiter mes États, Kaï Kermadeuc a ordre de le prendre à son bord et de le traiter comme moi-même.
Veuillez agréer, monsieur le président, et communiquer à messieurs les académiciens l’expression de la respectueuse admiration de votre tout dévoué,
Corcoran Ier, Empereur de la Confédération mahratte,
P.S. Louison, à qui je viens de lire ces quelques lignes, me charge de la rappeler à votre souvenir.
Cette lettre fut remise au président de l’Académie pendant la séance, et il se hâta d’en donner connaissance au public et de faire appeler Kai Kermadeuc, le commandant du Fils de la Tempête.
Celui-ci s’avança en se dandinant sur ses jambes, comme un pommier agité par le vent. C’était un vieux marin, basané, goudronné, qui avait doublé trois fois le cap Horn et neuf fois le cap de Bonne-Espérance, et qui avait horreur de la terre autant que les chats ont horreur de l’eau froide.
Comme il roulait son chapeau dans ses doigts de l’air embarrassé d’un écolier qui sait mal sa leçon, le président crut devoir venir à son secours.
« Rassurez-vous, mon brave homme, dit-il avec bonté, et expliquez-nous, s’il vous plaît, les commissions dont Sa Majesté le maharajah des Mahrattes vous a chargé pour l’Académie.
– Pour lors, dit Kermadeuc d’une voix tonnante qui fit trembler les vitres, pour lors, voici la question. Mon capitaine, qui est l’empereur dont vous parlez, étant parti sur son brick le Fils de la Tempête qui file dix-huit nœuds à l’heure par un temps calme, arriva, cinq semaines après, dans le pays du seigneur Holkar, un particulier fort âgé et plein de roupies, qui avait querelle avec les Anglais pour la raison de ce qu’il refusait de leur donner sa fille et ses roupies. Pour lors, le capitaine Corcoran regarde la fille, qui était belle comme une sainte vierge, et dit : Je suis français ! Pour lors, il prend sa cravache et tape sur les Anglais pendant que sa Louison (sa tigresse, messieurs, sauf votre respect) leur tordait le cou comme à des canards. Voyant cela, l’homme âgé meurt, laissant sa fille, son royaume, ses roupies et ses moricauds au capitaine qui, du coup devient empereur. N’est-ce pas ce qu’il pouvait faire de mieux ? »
Tous les assistants convinrent que Corcoran avait, en effet, pris le meilleur parti, et le secrétaire perpétuel, qui était curieux, demanda de quelle manière avait été conquis le fameux Gouroukaramta.
« Pour lors, répliqua Kermadeuc, c’est bien simple. Quand le capitaine fut devenu majesté, et riche, et marié à son goût, il commença à s’ennuyer. – Je lui dis : Capitaine, vous n’êtes pas heureux. Est-ce que ce serait la faute à madame Sita ? (Vous savez, messieurs, le mariage ne réussit pas à tout le monde, et moi qui vous parle, quand madame Kermadeuc n’est pas contente, j’ouvre la porte et je file vivement, oh ! mais vivement, et sans chercher mon chapeau.) Mais il paraît que je m’étais trompé, car il me répondit : « Kermadeuc, mon vieux camarade, Sita est une femme qui n’a pas sa pareille au monde, ni dans la lune, ni dans le pays du Turc et du Moscovite… – C’est égal, capitaine, vous aviez tout à l’heure votre figure vent debout ; je m’y connais, ça n’est pas naturel. » Il me tourna le dos sans rien dire, preuve que j’avais touché juste. Mais dix jours plus tard tout était changé. Il me fit venir un matin. – On vient de m’avertir que le Gouroukaramta est caché dans le temple de Pandara. Veux-tu remonter la rivière avec moi ? – Quand vous voudrez, mon capitaine. Et, sans vous commander, aurons-nous beaucoup de passagers sur mon brick ? – Deux seulement, Louison, que tu connais, et moi. – C’est dit. Nous partons le soir même, et nous remontons le long des monts Vindhya. À droite et à gauche de la rivière on ne voyait plus que de noires forêts. De temps en temps on entendait le rugissement des tigres, le pas lourd des éléphants ou le sifflement du cobra capello. Pour vous consoler, le soleil vous rôtit pendant le jour et les moustiques vous mordent pendant la nuit. Le matin j’avais les lèvres enflées comme des boudins, et mon nez ressemblait à une vitelotte. Enfin, suffit ; nous arrivons dans un village où l’on ne voyait que des fakirs. Le fakir, messieurs, vous savez ce que c’est : – un particulier qui a fait vœu de ne se laver et de ne se brosser jamais.
Pour lors, tous ces fakirs étaient accroupis autour de leur temple lorsque nous arrivâmes. Pas un d’eux ne leva la tête et ne dit un mot de politesse. Voyant ça, le capitaine siffla Louison, qui sauta légèrement à terre, comme une jolie fille qui va au bal. Au premier bond de la tigresse, qui pourtant ne fit de mal à personne, tous ces endormis se réveillèrent, et furent debout en un clin d’œil, – où je vis bien qu’aucun d’eux n’était paralytique, car ils se sauvèrent tous ensemble dans le temple en criant : Voici Baber Sahib (voici le seigneur Tigre) ! et en implorant Siva.
Louison allait les suivre, mais le capitaine la retint, pour ne pas les effrayer davantage, et alla droit au plus fakir de la bande, c’est-à-dire au plus sale et au plus déguenillé. C’était un vieux à barbe blanche, qui paraissait très respecté de tous les autres. Pour lors, le capitaine se met à lui parler dans son patois, qui est, à ce qu’on m’a dit depuis, une très belle langue et faite pour les savants. Ce qu’ils se dirent, je ne l’ai pas entendu ; mais j’ai vu les gestes. Le capitaine insistait toujours pour avoir son Gouroukaramta ; l’autre refusait toujours. Tout à coup voilà Louison qui s’impatiente, se dresse debout sur ses pattes de derrière et appuie ses pattes de devant sur les épaules de Corcoran ; histoire de se faire caresser, la câline. Voyant ça, le fakir tombe à genoux, s’écrie que la volonté de Dieu se déclare, que le capitaine est la dixième incarnation de Vichnou, qu’il est prédit dans ses livres que Vichnou doit venir sur la terre avec un tigre apprivoisé ; puis il va chercher son manuscrit et le met dans les mains du capitaine, qui le regardait sans sourciller et sans paraître étonné, comme s’il eût fait le Vichnou toute sa vie. »
Ce récit naïf eut le plus grand succès ; le président félicita Kermadeuc de la part qu’il avait prise à cette glorieuse expédition, et trois jours après on lisait le récit de la séance dans tous les grands journaux de Paris.
En revanche, les journaux anglais déclarèrent unanimement que ce Corcoran était un misérable aventurier, bandit de profession, qu’il avait dérobé le précieux manuscrit du Gouroukaramta à un voyageur anglais dans les montagnes des Ghâtes, et qu’il avait fait alliance avec Nana-Sahib pour assassiner tous les Anglais de l’Inde.
Les journaux allemands se partagèrent entre deux camps. Les uns assurèrent que la découverte du Gouroukaramta n’était pas nouvelle ; à les entendre, ce livre était depuis longtemps publié ; le docteur Cornelius Gunker, de Berlin, l’avait eu dans les mains ; le docteur Hauffert, de Gœttingue, en préparait depuis longtemps une traduction ; le professeur Spellart, d’Iéna, écrivait un commentaire sur son origine probable. L’autre camp déclara nettement que le manuscrit était faux, que la copie envoyée par Corcoran était l’œuvre de son imagination ; qu’il n’avait lui-même jamais vu ni le Gouroukaramta, ni l’Inde ; que les philologues français étaient faits tout au plus pour nouer et dénouer les cordons des souliers des philologues allemands ; que cette nation vaniteuse et légère qui habite entre le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et l’océan Atlantique, était incapable de rien écrire ou dire qui fût utile et bon ; qu’elle ne saurait jamais que danser et faire l’exercice à feu ; que si par hasard quelqu’un de ses citoyens avait un peu plus de sens et de jugement que les autres, il le devait à son origine germanique, étant nécessairement né en Lorraine ou en Alsace ; qu’il fallait, par conséquent, reprendre ces deux provinces allemandes, frauduleusement détachées de la grande patrie d’Arminius, et qu’enfin le sabre allemand, la pensée allemande, la critique allemande, la sagesse allemande et la choucroute allemande (bien entourée de saucisses) étaient au-dessus de tout.
À quoi un journal français très connu répliqua en prenant à témoin les immortels principes de 1789, et un autre en profita pour réclamer la liberté des mers et la « neutralisation des détroits, » ce qui acheva d’éclaircir la question si vivement controversée de l’origine du Gouroukaramta.
Pendant ce temps, Corcoran vivait heureux à Bhagavapour et gouvernait paisiblement ses peuples ; mais un évènement imprévu troubla sa vie et, comme on le verra dans le prochain chapitre, altéra la tendre amitié qui l’unissait à Louison.
Un matin, Corcoran était assis dans le parc à l’ombre des palmiers. C’est là qu’il tenait son conseil et qu’il rendait la justice aux Mahrattes, comme saint Louis à Vincennes ou Déjocès le Mède en son palais d’Ecbatane. Près de lui, la belle Sita lisait et commentait les divins préceptes du Gouroukaramta.
Tout à coup Sougriva parut. On n’a pas oublié sans doute que Sougriva était ce courageux brahmine qui avait aidé si puissamment Corcoran à vaincre les Anglais. En récompense, il était devenu son premier ministre.
Sougriva se prosterna devant son maître et devant Sita en élevant ses mains en forme de coupe vers le ciel ; puis, avec la permission de Corcoran, il s’assit sur un tapis de Perse, attendant qu’on le questionnât.
« Eh bien, quelles nouvelles ? demanda Corcoran.
– Seigneur, répondit Sougriva, l’empire est tranquille. Voici les journaux anglais de Bombay. Ils disent de vous tout le mal possible.
– Bons Anglais ! Ils veulent me faire une réputation. Voyons le Bombay Times. »
Il déplia le journal et lut ce qui suit :
« Maintenant que la révolte des cipayes touche à sa fin, il serait peut-être temps de rétablir l’ordre dans le pays des Mahrattes et d’infliger à cet aventurier français le châtiment qu’il mérite.
« On nous apprend que ce vil chef de brigands, soutenu par une bande d’assassins de toutes les nations, l’écume de la terre habitable, commence à s’établir solidement à Bhagavapour et aux environs. Non content d’avoir, par un crime atroce, ôté son royaume et la vie au vieil Holkar, il a, dit-on, eu l’effronterie d’épouser sa fille Sita, la dernière descendante des plus anciens rois de l’Inde, et cette malheureuse femme, qui tremble de subir un jour le funeste sort de son père, est forcée de partager le trône avec le meurtrier d’Holkar. »
– Bravo ! très bien ! s’écria Corcoran. Cet Anglais débute d’une façon admirable. Ah ! ah ! il paraît qu’en effet ils se croient déjà les plus forts, puisqu’ils commencent à m’insulter… Voyons la suite.
« … Ce n’est pas tout. Ce misérable, qui s’est échappé, dit-on, du pénitencier de Cayenne, où il était enfermé avec quelques milliers de ses pareils, a mis tout le pays des Mahrattes en coupe réglée. Suivi d’une armée nombreuse, il parcourt, pille et rançonne, l’une après l’autre, toutes les provinces du royaume d’Holkar, mettant à feu et à sang tout ce qui ose résister… »
Corcoran jeta le journal.
« Voilà, dit-il, comme on écrit l’histoire. C’est par ces mensonges que lord Braddock, le gouverneur général de l’Inde, se prépare à m’attaquer.
– Seigneur, dit Sougriva, que comptez-vous faire ?
– Moi ! rien du tout. Si lord Braddock était homme à mettre habit bas et à s’aligner avec moi sur le terrain, l’épée à la main, je lui couperais la gorge comme il faut ; mais ce gros milord ne voudra jamais risquer sa peau de seigneur… Il faut le payer de même monnaie. C’est mon Moniteur de Bhagavapour qui sera chargé de répliquer.
– Cher seigneur, interrompit Sita, voudriez-vous descendre à vous justifier ?
– Qui ? Moi ! Que Vichnou m’en préserve ! Est-ce qu’on se justifie lorsqu’on est accusé d’avoir tué père et mère ? Mon Moniteur dira que Barclay est un âne que j’ai étrillé durement, que le gouverneur de Bombay est un drôle et un va-nu-pieds, que lord Braddock est un bandit qu’on devrait empaler, et que tous trois tremblent devant moi comme le chevreuil devant le tigre. Qu’il orne ces belles choses de son style indien et qu’il y ajoute tout ce que son imagination lui offrira de plus mortifiant pour ces trois grands personnages. Puisque la presse est libre dans mes États, c’est bien le moins qu’elle me serve à quelque chose contre mes ennemis.
– À ce propos, seigneur, reprit Sougriva, les journaux de Bhagavapour, profitant de la liberté que vous leur laissez, crient tous les jours contre vous.
– Ah ! ah ! Et que disent-ils ?
– Que vous êtes un aventurier, capable de tous les crimes, que vous opprimez le peuple mahratte, et qu’il faut vous jeter par terre.
– Laisse-les dire. Puisque je suis leur maître, il faut bien qu’ils médisent de moi.
– Mais, seigneur, si l’on se révolte ?
– Et pourquoi se révolteraient-ils ? Où trouveraient-ils un meilleur maître ?
– Mais enfin, seigneur, insista Sougriva, s’ils prennent les armes ?
– S’ils prennent les armes, ils violent la loi. S’ils violent la loi, je les ferai fusiller.
– Quoi ! ne ferez-vous aucune grâce ? demanda Sita.
– Aucune pour les chefs. Quand un homme libre viole la loi qui assure sa liberté et celle d’autrui, il est sans excuse, et mérite qu’on en finisse avec lui par la corde, la mitraille ou l’exil. »
Tout à coup Corcoran interrompit la conversation, et, se tournant vers Louison, qui était nonchalamment couchée sur le tapis à côté de Sita :
« Qu’en penses-tu, ma chérie ? » dit-il.
Louison ne répondit pas. Elle ne parut même pas avoir entendu la question. Son regard, d’ordinaire si fin, si intelligent et si gai, errait dans le vide et paraissait distrait.
« Louison est malade, » dit Sita.
Corcoran frappa sur un gong. Aussitôt Ali s’avança. C’était, on s’en souvient, le plus brave et le plus fidèle des serviteurs d’Holkar, et c’est à lui qu’était confiée la garde de Louison.
« Ali, demanda Corcoran, est-ce que Louison a perdu l’appétit ?
– Non, seigneur.
– Quelqu’un l’a-t-il maltraitée.
– Seigneur, personne n’oserait.
D’où vient donc sa distraction ? »
Ali répondit :
« Seigneur, elle sort, depuis trois jours du palais dès que le soleil se couche, et elle va errer toute seule dans le parc au clair de la lune.
– Et à quelle heure rentre-t-elle ?
– Quand le soleil se lève. Le premier soir, je voulais tenir les portes fermées, mais elle a commencé à rugir si fortement, que j’ai eu peur qu’elle ne voulût me dévorer, et, par Siva ! je ne suis pas encore las de vivre.
– Au clair de la lune ! dit Corcoran, tout pensif.
– Seigneur, reprit Ali, elle n’est pas tout à fait seule.
– Ah ! ah ! Est-ce que tu vas lui tenir compagnie ?
– Moi ! seigneur, je m’en garderais bien. J’ai voulu la suivre hier au soir ; mais elle n’aime pas qu’on la surveille. Elle s’est retournée si brusquement vers moi, que j’ai couru jusqu’au palais sans m’arrêter.
– Mais enfin, comment sais-tu qu’elle n’était pas seule ?
– À peine rentré dans le palais, je montai sur le toit en terrasse, et, grâce au clair de lune, j’aperçus la tigresse qui était étendue sur le mur du parc et qui avait l’air d’écouter un discours… Tout à coup, celui que je ne voyais pas prit son élan et sauta sur le mur. Je vis sa tête et ses griffes, car c’était un grand et fort tigre d’une beauté admirable ; mais Louison fut sans doute mécontente, car d’un coup de griffe elle le repoussa et le fit dégringoler dans le fossé. Il ne se tint pas pour battu et continua son discours ; mais il n’osa pas renouveler l’assaut, car le mur a plus de trente pieds de haut, et il avait dû se fouler au moins une patte. Enfin, il se retira en rugissant.
– Ma foi, dit Corcoran, il faudra que je voie cela. »
Dès le soir même, vers six heures Corcoran se mit à l’affût dans le parc. Par précaution et de peur d’avoir à lutter contre le compagnon de Louison, il prit un revolver.
Il avait tort. Il ne faut jamais se mêler, sans nécessité, des affaires de son prochain, et même de ses plus intimes amis ; au reste, Corcoran fut sévèrement puni de sa curiosité, ainsi qu’on le verra bientôt.
Vers six heures un quart, assis sur le mur, à quelques pas de l’endroit désigné, il entendit un grand bruit de feuilles froissées. C’était l’étranger qui se rendait à son poste, dans le fossé, au pied du mur, et qui annonça tout d’abord sa présence par un rugissement voilé, comme s’il eût voulu (et c’était, en effet, son intention) n’être entendu que de Louison. Celle-ci ne se fit pas attendre. Elle s’élança d’un bond sur le mur, jeta un regard distrait dans le fossé et, sans s’émouvoir de la présence de Corcoran, qu’elle voyait très bien, écouta le discours du grand tigre.
Il a été longtemps à la mode de croire que les animaux n’avaient qu’un vague instinct et qu’ils ne raisonnaient ni ne sentaient. Descartes l’a dit ; Malebranche l’a confirmé ; tous deux se sont appuyés sur le témoignage de plusieurs illustres philosophes : – ce qui prouve que les savants n’ont pas le sens commun.
Que Malebranche m’explique, si c’est possible, pourquoi le tigre venait régulièrement tous les soirs faire visite à Louison, et quel scrupule de délicatesse empêchait celle-ci de le suivre au fond des bois et de reprendre sa liberté. C’était (qui pourrait en douter ?) l’amitié de Corcoran qui la retenait à Bhagavapour. Ils se connaissaient et s’aimaient depuis si longtemps, que rien ne semblait plus pouvoir les séparer.
Ils se séparèrent pourtant.
La conversation du grand tigre et de Louison devait être intéressante, car elle était fort animée. Corcoran, qui prêtait l’oreille et qui entendait la langue des tigres aussi bien que le japonais et le mandchou, la traduisit à peu près ainsi :
« Ô ma chère sœur aux yeux fauves, qui brillent dans la nuit sombre comme les étoiles du ciel, disait le tigre, viens à moi et quitte cet odieux séjour. Laisse là ces lambris dorés et ce palais magnifique. Souviens-toi de Java, cette belle et chère patrie, où nous avons passé ensemble notre première enfance. C’est de là que je suis venu en nageant d’île en île jusqu’à Singapour, et redemandant ma sœur à tous les tigres de l’Asie. J’ai parcouru depuis trois ans Java, Sumatra, Bornéo. J’ai fouillé toute la presqu’île de Malacca, j’ai interrogé tous ceux du royaume de Siam, dont le pelage est si soyeux et si lustré, tous ceux d’Ava et de Rangoun, dont la voix retentit comme un éclat de tonnerre, tous ceux de la vallée du Gange, qui règnent sur le plus beau pays de la terre. Enfin je te retrouve ! Viens au bord du fleuve limpide, au milieu des vertes forêts. Mon palais, à moi, c’est la vallée immense, c’est la montagne qui se perd dans les nuages, le Gaurisankar, dont nul pied humain n’a foulé les neiges éternelles. Le monde entier est à nous, comme il est à toutes les créatures qui veulent vivre librement sous les regards de Dieu. Nous chasserons ensemble le daim et la gazelle, nous étranglerons le lion orgueilleux et nous braverons le lourd éléphant, ce misérable esclave de l’homme. Notre tapis sera l’herbe fraîche et parfumée de la vallée, notre toit sera la voûte céleste. Viens avec moi. »
En même temps une mélodie étrange, qui avait l’apparence d’un rugissement sauvage, roulait dans son gosier en escades sonores.
Louison ne se laissa pas émouvoir. D’un coup d’œil expressif elle lui montra Corcoran, ce qui, dans la langue des tigres, signifiait assez clairement : « Mon cher frère à la robe tachetée, j’écoute avec plaisir tes discours, mais il y a des témoins. »
Les yeux du tigre se tournèrent aussitôt vers le Malouin et exprimèrent la plus terrible férocité, ce qui signifiait évidemment :
« N’est-ce que cet importun qui te gêne ? Sois tranquille, je vais t’en débarrasser sur-le-champ. »
Déjà il se ramassait pour prendre son élan et sauter sur le mur. De son côté, Corcoran s’apprêtait à le recevoir avec son revolver…
Au moment même où le grand tigre s’élançait, un autre tigre, que personne n’avait vu ni entendu jusque-là, bondit sur lui, le saisit à la gorge et le fit rouler sur l’herbe. Le premier se releva aussitôt et, d’un coup de sa griffe puissante, entama les entrailles de son ennemi en poussant un rugissement de fureur. Le combat fut quelques instants douteux. Le frère de Louison, quoique surpris, se défendait vaillamment. Leurs forces étaient à peu près égales, et une haine pareille les animait l’un contre l’autre.
Louison les regardait tranquillement, quoiqu’elle ne fût pas indifférente à la querelle ; mais elle avait trop l’orgueil de sa race et de sa famille pour craindre que son frère pût être vaincu et qu’un tigre du Bengale l’emportât sur un tigre de Java.
Cependant la victoire parut se décider contre le frère de Louison. Il roula sur le gazon et poussa un cri de détresse. À ce cri, les yeux de Louison étincelèrent de mépris. Elle poussa un sourd rugissement qui semblait dire.
« Malheureux ! tu fais honte à ta race. »
Ce rugissement rendit la force et le courage au malheureux tigre. Il regarda une dernière fois Louison, donna un coup de dents désespéré à son adversaire et s’élança, en grimpant avec la rapidité de l’éclair, sur un chêne voisin, dans les branches duquel il parut chercher un asile.
L’autre, se croyant maître du champ de bataille, entonna, d’une voix qui ressemblait à un tonnerre lointain, son chant de triomphe.
Mais ce chant fut aussi court que sa victoire. Le vaincu, se glissant d’arbre en arbre jusqu’à un sycomore dont les branches pendaient à peu de distance du vainqueur, bondit tout à coup sur lui, et d’un effort désespéré le saisit à la gorge et l’étrangla net.
Celle fois, la bataille était terminée, et le grand tigre parut attendre les félicitations de Louison. Celle-ci, charmée du courage de son frère, se décida enfin à sauter à bas du mur et disparut dans les ténèbres.
Corcoran eut d’abord envie de la suivre, mais il réfléchit que la nuit était obscure et pleine de pièges, et qu’il valait mieux attendre le lever du jour. Il rentra donc, très affligé de la perte de Louison, et s’endormit bientôt, mais d’un sommeil agité.
Le matin, au moment où il sortait du palais, décidé à lui donner la chasse, il la vit revenir d’un air aussi gai et d’un cœur aussi content que si elle n’avait rien eu à se reprocher.
À cette vue, le Malouin ne fut pas maître de sa colère, et il alla chercher Sifflante, sa fameuse cravache.
Louison demeura stupéfaite. Elle était allée se promener ; quoi de plus naturel ? N’était-elle pas née dans les bois, au bord des grands fleuves ? Avait-elle perdu le droit imprescriptible, antérieur et supérieur, d’aller et de venir ? Elle avait suivi Corcoran comme un ami ; devait-elle le considérer désormais comme un maître ?
Voilà ce que disaient les yeux de la tigresse ; mais le Malouin ne réfléchissait pas que lui-même, en épousant Sita et en la préférant à tout, avait fait quelque chose de semblable et manqué aux devoirs de l’amitié ; il ne songeait, comme c’est l’usage de tous les hommes, qu’aux torts de son amie, et il leva Sifflante sur les épaules de Louison.
Ce geste la remplit d’indignation. Quoi ! c’est ainsi qu’il la traitait ! Le cœur de Louison se gonfla, ses yeux se remplirent de larmes ; elle se rejeta en arrière par un bond si brusque, qu’il fut impossible à Corcoran de la retenir.
Il sentit alors sa faute et voulut la réparer. Il jeta au loin la cravache et voulut prendre la tigresse par la douceur ; il lui fit les appels les plus touchants et protesta que jamais il ne lui infligerait l’odieux châtiment dont elle avait été menacée un instant.
Elle s’approcha, se laissa caresser, écouta en silence les discours de Corcoran, alla baiser la main de Sita et parut avoir tout oublié ; mais il vit bien que quelque chose s’était rompu entre eux, et que la première fleur de leur amitié réciproque était flétrie et desséchée. Il résolut donc de la surveiller plus que jamais et de ne plus la laisser sortir sans lui.
Vers cinq heures du soir, au moment où Louison se préparait à recommencer sa promenade, Corcoran l’enferma dans la grande salle du palais d’Holkar, située au premier étage et qui dominait le parc d’une hauteur de trente pieds. Pour plus de sûreté, il mit le gros éléphant Scindiah en embuscade sous les fenêtres. La jalousie qui animait Scindiah contre Louison (tous deux se disputaient les bonnes grâces de Sita) répondait à Corcoran de sa fidélité.
Rien ne saurait peindre l’indignation de Louison, quand elle se vit enfermée et traitée en prisonnière de guerre. Elle rugissait si terriblement, que le palais en trembla sur sa base, et que les habitants de Bhagavapour se cachèrent dans leurs caves.
Corcoran l’entendit et en eut pitié. Sita même implora la grâce de Louison, et ses principaux serviteurs, qui craignaient d’être mis en pièces par la redoutable tigresse, se jetèrent aux pieds du maître pour demander sa liberté.
« Maharajah, dit Ali, seigneur du Bundelkund et de Goualier, cousin germain du soleil et de la lune, neveu des étoiles, favori du tout-puissant Indra qui éclaire les mondes, daigne ordonner que Louison soit relâchée, ou nous sommes perdus. »

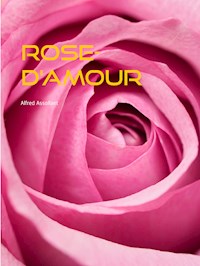














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












