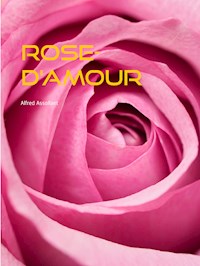Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce jour-là, 28 mai 1822, c'était au Palais-Royal la fête de Proserpine. Tout Paris connaît Proserpine ou devrait la connaître. C'est la demoiselle de comptoir de ce brillant café Lemblin, qui sert de rendez-vous à tous les braves en demi-solde de l'armée de Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération helvétique, plus grand par ses victoires qu'Alexandre, César et Pompée."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce jour-là, 28 mai 1822, c’était au Palais-Royal la fête de Proserpine.
Tout Paris connaît Proserpine ou devrait la connaître. C’est la demoiselle de comptoir de ce brillant café Lemblin, qui sert de rendez-vous à tous les braves en demi-solde de l’armée du grand Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération helvétique, plus grand par ses victoires qu’Alexandre, César et Pompée, plus illustre que Charlemagne par ses codes et ses institutions, et qui mourut l’an dernier à Sainte-Hélène, martyr d’Hudson Lowe et de la perfide Albion.
Des cheveux noirs, presque bleus, des yeux bruns et brillants qui portent tantôt la vie, tantôt la mort dans les cœurs, suivant qu’ils s’adoucissent comme ceux des gazelles, ou qu’ils s’irritent comme ceux des panthères ; un joli nez grec droit comme un I, et à demi retroussé comme le jupon de dentelles d’une jeune marquise qui traverse le trottoir en temps de pluie ; un menton à fossette (ah ! quelle fossette !) ; une bouche aimable et délicieuse quand elle sourit et reçoit des compliments, mais impérieuse et ferme quand elle commande : « Garçon ! voyez à l’as ! » des épaules admirables, plus blanches que de l’albâtre, plus solides que le bronze et modelées comme celles de Vénus Anadyomène, que sais-je encore ? La statue tout entière est digne de ce buste merveilleux.
Mais c’est surtout la démarche qu’il faut voir, pleine de grâce, de majesté, de noblesse, d’éclat, de splendeur, une démarche semblable à celle de Junon sur les nuées, et telle que jamais ni duchesse, ni reine, ni impératrice, n’en eut de pareille pour se montrer à son peuple, et que j’ai vu des colonels, des maréchaux, qui avaient bravé le feu de l’artillerie dans cent batailles, se troubler à son aspect. Le plus terrible de ces fameux survivants de la Convention qui coupèrent la tête à Louis XVI aussi aisément qu’un enfant cueille une noisette sur un noisetier, s’agenouilla devant elle comme un païen devant les idoles.
Il est vrai, car je ne dois rien cacher, que cela se passa dans un couloir obscur, et que le farouche régicide ne croyait être vu de personne, si ce n’est de la déesse ; mais un des garçons, qui sans doute admirait Proserpine pour son propre compte, l’aperçut et m’appela comme le plus vieil habitué du café Lemblin, pour être témoin de ce spectacle nouveau.
Ah ! l’empire de la beauté ! quel empire ! et qui n’est pas son sujet sur cette terre ? Et qui sera jamais plus digne que cette adorable femme d’en porter la couronne resplendissante ?…
Je dis bien : adorable, car Proserpine l’était de tous points, et sa beauté pouvait passer pour le moindre de ses mérites. Elle était bonne comme le pain de pur froment d’Emmaüs, dont se nourrissait autrefois le roi Salomon. Elle était généreuse comme saint Martin, qui, n’ayant qu’une chemise, la coupa par le milieu pour en donner la moitié à un pauvre. De l’esprit, elle en avait à revendre, et de la coquetterie, à rendre jalouse la reine Cléopâtre. Quant à la vertu, pas une demoiselle de comptoir dans tout le Palais-Royal n’aurait pu piger avec elle, suivant la belle expression du lieutenant Brossard, du 15e de ligne, aujourd’hui en garnison à Besançon, et pour preuve, il ajoutait : « On n’a jamais entendu parler d’elle qu’avec le colonel Crabanac, des cuirassiers de la garde impériale, présentement en demi-solde. »
C’était vrai, et quoiqu’on n’eût parlé que de Crabanac, je n’étais pas plus satisfait, moi qui vous fais ce récit, que s’il avait été question d’un millier d’autres braves : car vous devinez bien, au portrait que je viens d’en faire, que j’étais, comme tout le monde, follement amoureux de la belle Proserpine.
C’est ici le moment de parler de moi-même.
Je suis né, il y a cinquante-huit ans, le 15 avril 1764, au quatrième étage de la maison 24 de la rue Richelieu, à quelques pas du Palais-Royal, et je fus baptisé à Saint-Roch du nom de Pierre-Georges Denisot. Mon père travaillait dans les bureaux de M. le duc de la Vrillière, qui était en ce temps-là le plus puissant seigneur de France, plus puissant que le roi Louis XV lui-même, car c’est lui qui signait les lettres de cachet.
Je reçus, – sans me vanter, – la meilleure éducation du monde. J’appris de bonne heure à copier, récoler, confronter, rédiger toutes sortes de rapports et de mémoires secrets ou publics qu’on enfouissait dans des multitudes de cartons pour qu’ils devinssent la proie des rats et des vers. De temps en temps Son Excellence en faisait jeter au feu les trois quarts sans les lire. C’est ce qu’elle appelait mettre les affaires au courant, et ce que le public bonasse appelait et appelle encore aujourd’hui administrer.
Cela dura jusqu’en 1789, où l’Assemblée constituante donna un si furieux coup de balai dans la fourmilière que tout l’édifice administratif en fut réduit en poussière, et qu’on craignit un moment de ne pouvoir jamais le reconstruire. Sous la Convention surtout, ce fut un tapage à ne plus pouvoir s’entendre.
Lorsque le grand Napoléon rétablit l’ordre au 18 brumaire, je criai plus fort que tous les autres : Vive le premier consul ! et plus tard : Vive l’empereur ! On m’en a su gré après Marengo, et l’on m’a donné de l’avancement. Franchement je l’avais bien mérité, car mes cris partaient d’un cœur sincère. C’est comme si j’avais dit : Vive ce grand homme qui va nous donner des loisirs, qui nous payera bien, qui nous décorera, qui nous engraissera, qui… Ah ! certes, oui, je l’ai aimé, et je l’aime encore, ce grand Napoléon !
Et cependant, il avait gardé quelque chose, lui aussi, de la fièvre révolutionnaire ; par moments il se démenait comme un diable dans un bénitier, et nous faisait travailler comme des nègres sous le fouet. Il avait toujours à la bouche ce mot terrible : « J’organise ! organisons ! organisez ! » Si l’on avait voulu le croire, il aurait de ses lois, de ses décrets, de ses ordonnances, rempli trente bibliothèques. Heureusement ses ministres étaient de braves gens, des hommes d’ordre, de paix et de tranquillité, qui n’avaient pas comme lui la fureur de tout changer, de tout légiférer, et de courir à cheval d’un bout de l’Europe à l’autre, en semant partout des obus, de la mitraille, des règlements et des codes. Ils rédigeaient et signaient des circulaires de temps en temps, parce qu’il faut bien rédiger et signer pour vivre, quand on est dans notre État ; mais au fond, ils ne nous pressaient pas et se pressaient encore moins. Plusieurs même, depuis que les Bourbons sont revenus, se vantent de n’avoir rien fait que préparer, sous l’usurpateur, le retour de la monarchie légitime.
Et, ma foi, c’est bien possible.
Quant à moi, j’ai toujours joué franc-jeu, et l’on ne me reprochera pas d’avoir trahi mon serment.
J’aimais Napoléon, et je l’aime encore. Il est bien vrai qu’en 1814 je l’aurais lâché, comme ils disent, pour les Bourbons, s’ils avaient voulu me maintenir dans mon emploi.
Mais au moment où j’allais proclamer de bon cœur le gouvernement de nos rois légitimes, M. l’abbé de Montesquiou, ministre de Louis XVIII, me révoqua net et m’offrit pour tout potage deux mille francs de pension, qui, joints à six mille livres de rente que mon père m’avait léguées, ont fait de moi un rentier très présentable. Dès lors, à quoi bon travailler davantage, compulser des dossiers, entasser des écritures ? N’étais-je pas assez riche pour vivre seul, moi qui ne dépense jamais par an plus de mille écus, et qui n’ai que deux passions au monde : – un amour heureux pour les dominos et un amour malheureux pour la belle Proserpine ?
J’avais bien pensé quelquefois à me marier comme tout le monde et à faire souche de petits Denisot. Mais Véturie n’a jamais voulu.
(Véturie, c’est ma vieille servante.)
Voici son raisonnement :
– À quoi pensez-vous, monsieur ? À prendre femme ?… À votre âge, êtes-vous fou ? Vous avez soixante ans passés…
– Cinquante-huit, Véturie ! Cinquante-huit !
– Cinquante-huit ! Soixante-huit ! Qu’est-ce que ça fait ? Quelle différence y a-t-il ? Nous n’allons pas nous chamailler pour ça ! Vous avez donc soixante ans, et vous les portez bien, je vous assure ! On vous en donnerait plutôt cinq ou six par-dessus le marché quand vous n’avez pas fait votre barbe, qui est grise comme si vous l’aviez traînée toute la nuit dans les cendres… Et vos cheveux, sont-ils assez jolis, les pauvres chérubins, quand vous les avez ramassés tous les six pour les faire bouffer sur votre front !
– Véturie !
– Ah ! monsieur, ce n’est pas la peine de vous fâcher. Après trente ans de service, Seigneur Dieu, on a bien le droit de vous dire vos vérités !… Autrement, ça serait pire ici que chez les Cafres. Et avec ça, vous croyez avoir le nez bien fait. Certainement, il est bien fait, si les plus beaux nez sont faits sur le modèle des vitelottes !… Et rouge comme un homard cuit, encore !…
– Véturie ! Véturie ! Je vais me fâcher tout de bon !
– Fâchez-vous, monsieur, tant que vous voudrez, j’ai des choses de bon sens à dire, moi, et je les dirai quand même vous feriez vos gros yeux !
… Monsieur, quand on est petit, gros, laid et vieux comme vous l’êtes, on ferait mieux de se tenir tranquille que de songer au mariage.
– Véturie, je vous chasse !
Cette fois, j’étais vraiment en colère.
– Ah ! vous me chassez ! dit-elle. Eh bien ! tant mieux. Voici mon tablier : je vous le rends…
En effet, elle le jeta à mes pieds, et continua :
… C’est vous qui ferez votre pot-au-feu dorénavant. Nous verrons comment vous vous en tirerez. C’est vous qui raccommoderez vos habits, qui repriserez vos bas, qui recoudrez vos boutons, qui descendrez à la cave deux fois par jour pour avoir du vin frais, car vous êtes un peu porté sur votre bouche, mon bon monsieur, vous aimez le poisson quand il est frais, le vin quand il est bon, et la volaille quand elle est grasse, sans compter les primeurs au printemps… Et qui vous les choisira mieux que moi ?
À ce souvenir, je sentis mon cœur se troubler.
– Voyons, Véturie, un peu de bon sens, au nom du ciel, un peu de bon sens, si c’est possible !
– Mais, monsieur, c’est ce que je me tue de vous crier depuis un quart d’heure ! Un peu de bon sens ! Apprenez à vous connaître et à ne pas vous prendre, vieux et cassé comme vous êtes, pour ce que vous n’êtes pas, pour un amoureux de vingt ans et pour un débrideur de filles !…
… Allons, bon, voilà que vous allez vous fâcher encore et me dire des injures ! Qui est-ce qui vous a fourré ces idées de mariage dans la tête ? C’est la Proserpine, sans doute ? Après qu’elle a fini de bien faire, elle ne serait pas fâchée de s’appeler madame Denisot, n’est-ce pas ?
Je fis signe de la tête que ce n’était pas Proserpine, quoique, au fond, je n’eusse pas d’autre pensée, car on devine bien qu’un ancien chef de bureau du ministère de l’intérieur, chevalier de la Légion d’honneur et riche, jouissant à Paris des avantages et des honneurs que comporte le célibat, n’allait pas se marier avec la première venue, simplement pour faire pièce à des héritiers éloignés, et qu’il devait avoir en vue une personne particulière… Or, cette personne, l’insupportable Véturie ne l’avait que trop bien deviné, c’était ma chère, mon incomparable Proserpine.
Malheureusement, la vieille femme ne se laissait pas prendre à mes dénégations. Éclairée par ce terrible instinct de conservation qui est pour les êtres inférieurs de la création un guide plus sûr que le raisonnement pour nous, elle devinait son ennemi sans le connaître et le frappait à coups redoublés.
Mais ce qui est pire, c’est que chaque coup, avant d’atteindre Proserpine, me perçait le cœur.
– Tenez, monsieur, reprit-elle, ne mentons pas ; aussi bien la fille n’en vaut pas la peine. Ce que je vous dis là, vous croyez que c’est par intérêt, parce que je veux garder les clefs de la maison que j’ai depuis vingt ans, et que votre pauvre sainte mère dont l’âme est au ciel me mit dans les mains avant de mourir ! (Pauvre chère femme du bon Dieu ! qu’est-ce qu’elle dirait si elle voyait celle que vous voulez mettre à sa place ?) Eh bien, vous vous trompez, monsieur ; vous n’y connaissez rien, je n’ai pas besoin de vous pour vivre, monsieur Denisot ! Je suis riche, moi !
– Ah !
– Ne faites pas « ah ! » comme si vous aviez avalé de la bouillie trop chaude. Ce n’est pas de votre argent que je suis riche, Dieu merci !
– Je vous crois, Véturie, je vous crois !
– Et personne ne dira, monsieur Denisot, qu’on peut s’enrichir au service d’un vieux garçon, en faisant des économies sur quatre-vingts francs par an… (Votre sainte mère me donnait au moins ses vieilles robes ; mais vous, qu’est-ce que je ferais de vos culottes reprisées et de vos chapeaux retapés ?) Non, monsieur, si je suis riche, c’est d’un héritage que mon frère m’a laissé.
– Quel frère ?
– Mon frère Savinien qui était cantinier à la grande armée en 1806, et qui fit de bonnes affaires en Prusse après Iéna, oui, de bonnes affaires, je vous en réponds ; à preuve qu’il prit sa retraite l’année suivante, qu’il acheta un cabaret près d’Issoudun, et qu’il m’a laissé après sa mort six mille francs. Pauvre Savinien !…
Ici elle ramassa son tablier pour essuyer une larme en l’honneur de ce frère bien-aimé. Puis elle poussa un profond soupir et reprit :
–… Pauvre Savinien ! C’est lui qui ne m’aurait pas laissé insulter s’il vous avait entendu dire, comme tout à l’heure : « Véturie, je vous chasse ! » Il avait un sabre, monsieur Denisot, un sabre et des pistolets, – et il savait s’en servir !
– Mais, Véturie, je ne vous insulte pas ; au contraire, je ne demande qu’à vivre en paix.
– Ah ! oui, je sais bien, vivre en paix et mener mademoiselle Proserpine devant M. le maire, n’est-ce pas ?… La connaissez-vous seulement, cette demoiselle adorée ? Savez-vous d’où elle sort ?
Je levai les épaules.
– Qu’est-ce que cela me fait, puisque je ne l’épouse pas ?
Au fond, je ne m’y intéressais que trop, et Véturie s’en aperçut aisément au son adouci de ma voix.
– Eh bien, je le sais, moi… Ça vous étonne ?
En effet, j’étais très étonné, et j’essayais en vain de dissimuler.
– Oui, reprit Véturie, je le sais. J’ai pris des renseignements, monsieur Denisot, quand j’ai vu que vous alliez faire cette bêtise. Votre pauvre défunte mère me l’avait bien recommandé à son lit de mort. Elle m’avait dit : « Véturie, si mon fils veut jamais se marier, c’est à toi de veiller au grain. Pierre n’est pas capable de se garantir lui-même. Le premier cotillon venu lui tournera la tête. » Elle avait bien raison, la chère femme ! Mais je fis serment de vous avertir, et je le tiendrai ; oui, je le tiendrai, quand je devrais ne plus remettre les pieds dans cette maison où j’avais compté finir mes jours !
Elle fit une pause et reprit :
– D’abord, elle ne s’appelle pas plus Proserpine que vous et moi.
– Je le sais.
– Elle s’appelle Céline Alavoine, fille naturelle de Marie Alavoine, qui a fait parler d’elle, sous le Directoire, à l’armée d’Italie. Sa mère était une pas grand-chose qui vivait matin et soir sans travailler de ses dix doigts, et son père était un rien du tout, peut-être un général, peut-être un maréchal des logis chef… Tant y a qu’elle revint en France après avoir fait le tour de l’Italie, de l’Égypte et des îles, et qu’elle en rapporta l’enfant.
Je voulus l’interrompre.
– Eh bien ! oui, et la mère est morte en 1814 ; et la fille, qu’on élevait chez des religieuses, ne pouvant plus payer sa pension, a été renvoyée à l’âge de seize ans. Puis, comme elle était brune et belle, les autres petites filles, ses camarades, l’appelèrent Proserpine ; et comme elle vit que le nom de sa mère ne lui ferait pas grand honneur dans le monde, elle garda celui-là qu’elle s’était laissé donner par plaisanterie, et elle entra comme demoiselle de comptoir au café Lemblin, à l’âge de dix-sept ans, en 1815.
– Eh ! mon Dieu ! elle m’a dit tout cela.
– Ah ! vous voyez donc bien que vous l’aimez, s’écria Véturie triomphante.
– Que je l’aime ou que je ne l’aime pas, ça ne regarde personne, et si vous voulez rester ici, Véturie, vous ne m’en parlerez plus jamais, et vous reprendrez votre tablier.
– C’est bien, monsieur. On s’y conformera, puisque c’est l’ordre. On obtempérera, comme disait le roi Murat quand l’empereur lui commanda de prendre la grande redoute de la Moskowa.
Et en effet, elle obtempérait depuis six mois quand arriva le jour de la fête de Proserpine, mais tout en obtempérant elle grognait, signe certain qu’elle ne renonçait pas à son idée.
J’allai donc ce jour-là, suivant mon habitude, prendre ma place au café Lemblin, car je suis un homme réglé en tout, dans mes mœurs, dans mes occupations, dans mes promenades, et je fais tous les jours la même chose à la même heure. C’est le moyen de ne pas se fatiguer à prendre continuellement des résolutions nouvelles et par conséquent de sentir moins la pesanteur de la vie. Au reste, voulez-vous savoir à quoi je passe mon temps ?
Je me lève à huit heures, je fais ma barbe, je tisonne en hiver et je me promène en été jusqu’au déjeuner, c’est-à-dire jusqu’à dix heures.
Comme la divine Providence, j’émiette du pain pour les petits oiseaux dans le jardin des Tuileries, je rentre chez moi, je déjeune, je bois deux carafons de vin, – jamais davantage – et je discute avec Véturie ses propres affaires, les miennes et celles du voisinage ; je fais quatre ou cinq tours de promenade au Palais-Royal, dans les galeries quand il pleut, dans le jardin quand il fait beau ; je cause avec les marchandes ; elles m’accueillent toujours bien à cause de ma redingote boutonnée jusqu’au collet et de mon ruban rouge qui me donne l’air d’un vieux brave ; je tiens ma canne la pointe en avant, comme si j’avais contracté depuis longtemps l’habitude de charger les Autrichiens et les Prussiens, et je siffle de temps en temps l’air d’une chanson de Béranger, ce qui me fait suivre avec respect par les gamins (hier encore, l’un d’eux disait à ses camarades qu’il m’avait reconnu, que j’étais le fameux général Chose, et je ne l’ai pas contredit ; après tout, le général Chose n’a peut-être pas meilleure mine que moi) ; ensuite j’entre au café, pour lire les journaux, – le Constitutionnel d’abord, qui est mon favori, et après le Constitutionnel tout ce qui se trouve sous ma main.
Comme je suis un habitué, et surtout comme, par politique, je ne ménage pas les pourboires, on me garde ma place dans le coin de la fenêtre du rez-de-chaussée à gauche du comptoir de Proserpine, et l’on me sert ma demi-tasse sans attendre que je la demande.
De ce poste rapproché, commode et sûr, et d’où l’on me délogerait plus difficilement que les Anglais de Gibraltar, je vois en un clin d’œil tout ce qui se passe dans la salle, et j’observe les manœuvres des amoureux de Proserpine. L’un s’avance d’un air timide, guette un coup d’œil et attrape un sourire à la volée, destiné peut-être à son voisin. Voilà du bonheur pour toute la journée.
Un autre, plus hardi, pour attirer l’attention, frappe à grand bruit sur la table, appelle les garçons, jure et sacre, commande un déjeuner pour quatre et lève la tête avec fierté en regardant le comptoir.
Un troisième s’avance en se dandinant d’un air vainqueur… Que sais-je ? Chacun a sa manière de se faire remarquer ; mais le seul qu’elle remarque, je ne le sais que trop, le vainqueur des vainqueurs, c’est mon propre neveu, je veux dire le mari de ma nièce ; c’est le brillant colonel du 3e cuirassiers de Waterloo, le terrible Crabanac. Celui-là n’a plus rien à désirer. Je le vois. Les garçons du café le disent tout haut. Le patron le sait, et tout le Palais-Royal aussi, et tout le monde envie son bonheur ; mais personne n’ose le regarder de travers, de peur d’être sabré.
À trois heures je quitte ma place et je vais me promener jusqu’à six heures. Je dîne sous le regard de Véturie, je reviens au café, je fais une partie de dominos avec le premier venu, lieutenant, capitaine ou colonel à demi-solde. Je gagne ma demi-tasse trois fois sur cinq pendant qu’autour de moi les politiques discutent avec chaleur la révolution espagnole ou napolitaine, qu’on vante les discours du général Foy, de Manuel ou de Benjamin Constant, qu’on maudit les Bourbons, les jésuites, les traîtres et les calotins, qu’on raconte tout bas, de bouche à oreille, – que Napoléon n’est pas mort, que sir Hudson Lowe n’a fait enterrer qu’un mannequin de paille, que l’empereur s’est échappé, qu’il est aux États-Unis, qu’il va revenir, qu’on l’attend d’un instant à l’autre à Rochefort…
Quand j’ai entendu tous ces récits et toutes ces confidences pour la millième fois, je dis bonsoir à Proserpine qui me sourit gracieusement, et je vais me coucher.
Voilà une journée bien employée, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est ainsi qu’elles le sont toutes.
Je dis toutes. Il faut pourtant en excepter une, et c’est justement celle où commença l’histoire qu’on va lire :
Il était huit heures du soir, et je venais de prendre ma place accoutumée à trois pas du comptoir de Proserpine.
Le café Lemblin tout entier était en fête. Comme on n’y voyait guère que des officiers à demi-solde ou en retrait d’emploi, – tous frères d’armes malgré la différence des grades, – et trois ou quatre bourgeois bonapartistes, mais aussi paisibles que moi, la fête de Proserpine devait être célébrée en famille par un punch gigantesque auquel tous les habitués avaient souscrit de bon cœur. Il était convenu sans qu’on l’eût dit, de peur de blesser l’amour-propre de ceux dont la bourse était vide, que les riches payeraient pour leurs camarades moins heureux, et chacun, en entrant, déposait dans un tronc son offrande, qui vingt francs, qui vingt centimes, suivant ses moyens.
De tous côtés des fleurs rares. Les murs en étaient tapissés, les corniches en étaient surchargées, le comptoir en était couvert et ressemblait à un autel qui n’attendait plus que sa déesse.
Tous les officiers étaient en grand uniforme comme aux jours de parade. Quelques-uns de ces uniformes, autrefois si brillants et si hardiment portés dans la bataille, dataient de 1814. Tel venait de Montmirail, tel de Brienne ou de Laon. Les plus neufs et les mieux conservés avaient paru à Waterloo. Mais tous étaient soigneusement brossés et astiqués comme si l’on avait dû entrer en campagne sur-le-champ.
Les fenêtres et les portes du café étaient ouvertes à cause de la saison, et deux ou trois mille Parisiens, hommes, femmes et enfants, rangés en demi-cercle, regardaient avec étonnement un orchestre composé de cent musiciens qui avaient tous appartenu aux régiments de l’ancienne armée et de la garde impériale, et qui, en grand uniforme comme leurs officiers, n’attendaient dans la galerie qu’un signal pour commencer la sérénade.
Car c’était bien une sérénade qu’on avait voulu donner à la belle Proserpine pour sa fête. L’idée venait du colonel Crabanac, mais tout le monde l’avait adoptée avec enthousiasme. Il ne s’agissait pas seulement de rendre, comme disait Rossignol, ancien capitaine du 6e léger, l’hommage que Mars dut toujours à Vénus, le dieu de la guerre à la déesse des amours ; on voulait aussi, grâce au punch, se compter entre amis et peut-être ébaucher quelque conspiration contre les Bourbons… Je le dis, mais je n’en suis pas sûr ; on ne confiait pas des secrets pareils à des pékins
Cependant l’heure avançait, et le colonel Crabanac, plus communément appelé le Tigre, directeur officiel de la fête, tardait à se montrer. On commençait à former des groupes et à murmurer.
Je me penchai vers mon voisin de gauche, un grand Corse, noir et maigre, ancien lieutenant au 6e dragons, et qui passait pour le confident et le meilleur ami de Crabanac, et je demandai à demi-voix :
– Où donc est le Tigre ? Est-ce qu’il oublie maintenant les rendez-vous qu’il donne ?
Le Tigre, c’était le nom d’amitié qu’on donnait à Crabanac dans le café Lemblin, et si l’on songe qu’il avait percé, sabré, espadonné ou tué en duel à coups de pistolet une douzaine d’officiers des gardes du corps et de la garde suisse ou de bourgeois royalistes, qu’il était si impétueux, qu’au premier mot il prenait feu, qu’au second il saisissait son interlocuteur à la cravate, qu’il l’étranglait presque au troisième, qu’il offrait de lui couper la gorge au quatrième, et qu’il la coupait effectivement presque toujours, ce surnom ne paraîtra pas trop déplacé.
Angeli répondit :
– Le Tigre n’oublie rien.
– Mais alors ?…
– Eh bien, alors, il a des affaires ; voilà tout. Est-ce qu’on ne peut plus avoir des affaires, à cette heure ?
Il me fit cette question d’un air si terrible ou, pour mieux dire, si parfaitement sinistre que je n’osai répliquer. On aurait dit le sifflement d’une vipère dont on a par malheur écrasé la queue. Ce Corse avait toujours l’air de vouloir égorger ou empoisonner quelqu’un. On racontait de lui, quand il avait le dos tourné, des histoires de Peau-Rouge égaré dans un maquis de la Corse. On disait qu’il avait tué, quinze ans auparavant, à deux lieues de Sartène, le père de sa maîtresse, puis trois mois après sa maîtresse elle-même, qui, se voyant enceinte, voulait se faire épouser ; puis le maire de la commune qui avait essayé de l’arrêter, et deux ou trois bourgeois notables qui voulaient arrêter ce carnage.
Tous ces coups de fusil, malgré le retentissement de ceux d’Iéna et de Friedland, firent tant de bruit en Corse que le grand Napoléon, qui cherchait partout des hommes de main et d’exécution, et qui n’était pas difficile sur le choix, lui fit offrir, soit pour en délivrer la Corse, soit pour l’attacher à sa personne, sa grâce complète, mille écus et le grade de maréchal des logis dans les dragons de la garde. Le préfet ajouta tout bas qu’Angeli aurait un avancement rapide et des gratifications, pourvu qu’il voulût rendre compte à qui de droit de tout ce qui se disait parmi ses nouveaux camarades contre la personne de l’empereur et son auguste dynastie.
Angeli accepta et fut employé à diverses missions secrètes. On crut même qu’il avait trempé dans la mort mystérieuse du colonel républicain Oudet, le célèbre chef des Philadelphes. Mais tout cela ne fut connu que plus tard.
En 1822, le Corse passait pour un soldat intrépide, – et il l’était en effet, l’ayant montré en plusieurs occasions, – et pour un bonapartiste irréconciliable, car il avait conspiré quatre ou cinq fois contre les Bourbons ; mais par un bonheur étrange qu’on ne remarqua pas d’abord, et que je m’explique trop facilement aujourd’hui, quoique toujours prompt à s’élancer au premier rang, il échappa toujours à la police de Louis XVIII. Un jour même, quelqu’un de ses anciens camarades l’en félicita tout haut d’un air assez équivoque, à quoi le Corse répondit avec indifférence qu’il était cousin par sa mère de plusieurs chefs de l’armée royale, et que ses parents étaient intervenus en sa faveur. L’autre le crut ou feignit de le croire ; mais un mois plus tard on le repêcha au fond de la Seine, frappé de cinq coups de poignard et noyé.
La réputation d’Angeli n’en devint pas meilleure, mais on se garda d’en médire, et les plus circonspects se bornèrent à parler le moins possible de lui et devant lui. Un seul, parmi ces braves officiers, lui témoignait une confiance et une amitié sans bornes. C’était le colonel Cabranac. Mais il faut avouer que le Tigre, toute opinion politique à part, et pourvu qu’on ne parlât ni de sa femme qu’il aimait tendrement, ni de sa maîtresse qu’il adorait follement, ni de Napoléon qui était Dieu, ni des Prussiens qu’il méprisait, ni des Anglais qu’il détestait, ni d’Hudson Lowe qu’il traitait de bourreau, ni de Marmont qu’il appelait traître, ni de vingt autres personnages connus qu’il coiffait des noms les plus différents : héros, gredins, canailles, sauveurs de la France, emplâtres et rossards ; le Tigre, dis-je, était l’homme du monde le plus paisible, le plus doux, le plus franc, le plus affectueux, le plus cordial, le plus confiant, le meilleur camarade qui fût jamais… Seulement, il ne fallait pas toucher à ses dieux, ou sinon… au bout de l’épaule était un bras, au bout du bras une main, au bout de la main un sabre, au bout du sabre la mort ! D’un revers il vous aurait fait voler la tête, ne vous laissant que le temps de vous mettre en garde, de riposter et de filer droit.
Un peu vif, si vous voulez, mais respecté de tous les hommes et adoré de toutes les femmes. C’est l’essentiel, n’est-ce pas ?
Le Tigre, ainsi fait, avait donc pour ami intime et particulier cet Angeli.
Cette amitié s’expliquait de plusieurs façons. D’abord le Tigre, qui aurait tué trente mille hommes à coups de sabre plutôt que de commettre une seule action basse ou vile, était incapable de soupçonner dans le cœur d’autrui des sentiments qui ne seraient jamais entrés dans le sien.
Ensuite, le lieutenant Angeli protestait de son amitié pour le colonel avec tant de chaleur, soutenait ses intérêts avec une ardeur si grande, et même en son absence aurait si facilement dégainé en l’honneur de son chef et de son ami, que personne ne pouvait douter de son dévouement absolu.
Enfin, il avait reçu de tels services du Tigre qu’il aurait été le dernier des hommes s’il avait pu les oublier un instant. Le premier de tous était que le colonel Crabanac, dans l’une des fameuses charges qui furent faites à la Moskowa, le voyant blessé et engagé sous son cheval mort, quand l’escadron à moitié détruit se retirait sous la mitraille des Russes, l’avait enlevé lui-même et transporté dans nos rangs, ce qui lui sauva la vie. Le second était que Crabanac, fils d’un vieil Auvergnat qui avait fait fortune dans les fers et les chaudrons, plus riche par conséquent que la plupart de ses camarades, avait ouvert sa bourse au Corse, sans compter, comme si tous les biens de la terre étaient communs à tous les hommes ; et pour dire la vérité, ce service-là valait deux fois plus que le précédent, car, suivant une belle pensée du sage Confucius :
Mourir vaut mieux que vivre misérable.
Voilà, certes, de bien fortes raisons, qui devraient attacher le lieutenant Angeli au colonel Crabanac ; mais je n’ai pas dit la meilleure de toutes, celle qu’il n’avouait pas.
Lorsque le colonel Crabanac (Martin) épousa, en 1820, Sylvie Denisot, ma nièce, fille de ma belle-sœur Eulalie, Angeli fut choisi pour témoin, et parut si frappé de la beauté de la jeune mariée (peut-être l’était-il aussi de la dot) que j’en conçus dès ce jour-là un désagréable augure. Il est bien vrai que ni le marié ni la mariée ne firent la moindre attention à lui, et que ni par la beauté, ni par la force, ni par la réputation, ni par la fortune, ni par le grade, ni même par l’âge, il ne pouvait être l’égal du brillant colonel. Mais le soleil ne voit pas tous les pucerons, et tous les pucerons voient le soleil.
De sorte que, sous divers prétextes, comme ami, comme compagnon d’armes, comme subordonné, comme intendant, Angeli s’insinua dans la maison, porta aux nues Crabanac, admira silencieusement la jeune dame, flatta madame Eulalie Denisot, la belle-mère, la trouva belle, gracieuse, intéressante, touchante, ravissante, lui fit raconter ses succès d’autrefois, écouta la description des robes qu’elle portait lors du couronnement de l’impératrice Joséphine, le compliment un peu cavalier (mais qui la chatouillait doucement) du général Lasalle, tué à Wagram avec la réputation du premier des hussards de l’Europe, et lui fit croire qu’elle était belle encore, ce qui ne fut pas difficile, car la bonne dame était crédule en tout, et particulièrement sur le chapitre de sa beauté !
D’où il résulta qu’Angeli devint bientôt nécessaire à toute la famille, excepté à moi, qui ne mis plus que rarement les pieds chez madame Denisot, rue de Vaugirard, 35, quoique je fusse son plus proche parent et le subrogé tuteur de sa fille. Mais j’avais eu l’imprudence de blâmer une robe rose que ma belle-sœur Eulalie venait d’adopter.
La dame me regarda d’un air pincé et dit :
– Mon ami, vous n’y connaissez rien. M. Angeli la trouve charmante et tout à fait assortie à mon teint.
À quoi je répliquai :
– Angeli est un intrigant qui vous flatte.
– Pourquoi me flatterait-il, s’il vous plaît, beau-frère ?
– Est-ce que je sais, moi ?
– Si vous ne savez pas, il ne faut point parler. Il n’y a qu’un sot qui…
Sur ce mot, de peur de répondre avec trop de vivacité, je pris ma canne et mon chapeau, et j’allai faire un tour de promenade, laissant la place au lieutenant Angeli, qui sonnait à la porte, juste comme j’allais sortir. – Lui, du reste, me salua profondément, comme si j’avais été son ami le plus cher.
Voilà quel était le Corse auquel je venais de demander des nouvelles du colonel Crabanac, et de qui j’avais reçu la réponse si peu polie qu’on a lue plus haut.
Je ne me décourageai pourtant pas, et je demandai encore :
– Quelles affaires ? Un duel, peut-être.
Angeli alluma sa pipe, en tira deux ou trois bouffées, et répondit gravement :
– Probable !
– Avec qui ?
Au même instant, cinq ou six officiers s’approchèrent de nous et demandèrent aussi :
– Oui, avec qui ?
Angeli tira une quatrième bouffée de sa pipe, et répondit plus gravement encore que la première fois :
– C’est son secret.
– Mais, mille tonnerres ! reprit un des assistants, il s’est battu vingt fois sans manquer l’heure de la demi-tasse.
Le Corse prit alors son parti :
– Vous voulez le savoir ?
– Nous le voulons.
– Vous ne le répéterez pas !
– Pour qui nous prends-tu ? demanda l’autre.
– Pour des amis ; voyez-vous, si le Tigre venait à savoir que j’ai parlé de ses affaires en plein café, il ne me le pardonnerait jamais.
– On se taira. Parle.
– Voici.
Et Angeli se pencha vers ceux qui l’écoutaient, comme pour leur recommander la discrétion… C’est à cause de sa femme que le Tigre s’est battu ce matin.
On l’interrompit de tous côtés.
– Ah bah !
– Pas possible !
– C’est la première fois.
– Et ce sera la dernière, je pense, dit le Corse ; car je ne crois pas que quelqu’un ait jamais envie de l’agacer là-dessus.
– Comment ! c’est pour cette petite femme si gentille, si gracieuse et si modeste qu’on lui donnerait le bon Dieu sans confession, qu’il s’est battu ce matin ?… À qui se fier, Seigneur, à qui se fier maintenant ?
Angeli reprit d’un air sombre :
– Ce n’est pas la faute de madame Crabanac, et le premier qui voudrait dire quelque chose contre elle…
– C’est bon, c’est bon ; ne tire pas ton sabre ; nous sommes ici entre amis. Dis-nous seulement ce qui s’est passé.
– Eh bien, nous étions hier soir, le colonel, madame Crabanac, sa mère madame Eulalie et moi, dans une loge du théâtre des Variétés. On jouait une pièce d’un nommé Scribe, un pékin qui a bien de l’esprit et qui nous faisait tantôt rire comme des bienheureux, tantôt pleurer comme des infortunés. La jeune dame surtout pleurait comme une Madeleine. Quant au Tigre, vous le connaissez ; sur le champ de bataille, il verrait tuer dix mille hommes sans broncher ; mais au spectacle, si une petite fille se met à crier tout à coup : Ô ma mère ! et à tomber dans les bras d’une vieille dame qu’elle n’a pas vue depuis cinquante ans, v’lan, voilà que ça l’attrape et qu’on voit des larmes couler sur sa moustache. Ça, c’est une particularité de son tempérament. On ne peut pas se refaire, n’est-ce pas ?
– C’est vrai, dit l’autre ; d’autant mieux que le Tigre ne s’est pas fait lui-même.
– Voilà donc que ça durait depuis plus d’une heure et qu’on était au second acte, lorsque le Tigre, en regardant dans la salle, s’aperçoit qu’un jeune pékin à moustaches lorgnait sa femme, oh ! mais la lorgnait solidement, je vous en réponds.
– Ah ! c’est qu’elle est jolie, la colonelle ! interrompit un officier d’un air de connaisseur. Jolis yeux, belles dents, sourire gracieux, ma foi, tout y est.
Angeli fronça le sourcil.
– Oui, tout y est ; mais le Tigre n’aime pas ça, et le pékin aurait mieux fait de mettre la lorgnette dans son étui et l’étui dans sa poche. Après ça, il y a des imbéciles partout, et il y en avait un fameux dans la chemise de ce pékin-là, c’est moi qui vous le garantis. Le Tigre avait beau le regarder bien en face, faisant ses yeux terribles comme pour l’avertir de se tourner vers la scène et les acteurs, et non vers sa femme, l’autre ne bougeait pas plus qu’un terme et lorgnait de toutes ses forces.
Moi, voyant ça, je me dis : Il y aura du grabuge avant un quart d’heure, et, pour l’empêcher, je veux sortir et prendre les devants ; le Tigre, qui me devine, me saisit le bras et me souffle tout bas :
– Si tu passes avant moi, Angeli, nous sommes brouillés à mort !
– Qu’est-ce que vous auriez fait à ma place ? Il est mon ami, il est mon colonel, il m’a sauvé la vie à la Moskova, il est le mari de madame Crabanac ; ma foi, il a tous les droits possibles de prendre l’affaire en main. Je reste donc en place, mais je pense à part moi : Toi, pékin, tu passeras demain un mauvais quart d’heure !
– Et dans l’entracte, demanda l’un des officiers, le Tigre est allé souffleter le pékin ?
– Pas du tout, répondit Angeli. C’est bien autre chose. Vous allez voir.
Le colonel, quand on a baissé la toile, dit à sa femme :
– Tu dois avoir chaud, ma chérie ?
– Moi, pas du tout, qu’elle lui réplique.
– Si, si, tu as chaud, je le vois bien. Tu veux te rafraîchir. Je vais chercher des oranges.
Et il ouvre lentement la porte, puis la referme avec soin comme s’il avait peur des courants d’air pour sa petite femme chérie. Mais, à peine dans le corridor, je le vois descendre comme une tempête dans l’escalier, bousculant tout le monde à droite et à gauche. Je me doute qu’il allait attendre son homme à la porte de l’orchestre, et je dis à la colonelle :
– Madame, si vous n’avez pas besoin de moi, je vais chercher le journal du soir.
Elle me laisse aller. Je cours après le colonel, et j’arrive juste à temps pour voir la plus drôle de chose… Vous ne devineriez jamais !
Le pékin, moins pressé que nous, d’ailleurs gêné par ses voisins de l’orchestre qui sortaient à petits pas de leurs places, arrivait juste à l’entrée du corridor, lorsqu’un jeune homme qui le suivait lui donne exprès un grand coup de coude dans la poitrine et lui crie :
– Faites donc attention, animal !
Le pékin se retourne et veut lui envoyer une gifle. L’autre lui saisit le bras et le retient en lui disant :
– Voici ma carte. Nous nous expliquerons demain matin à Vincennes.
Le pékin, un peu étourdi de l’aventure, mais faisant bonne contenance, allait la prendre, lorsque voilà mon colonel qui s’avance et qui crie :
– Ce n’est pas tout ça, pékin ! c’est à moi que tu auras affaire, et non pas à monsieur.
– Pardonnez-moi, interrompt le jeune homme. Je ne sais pas si vous avez affaire ensemble, mais c’est moi qui dois passer le premier.
Vous voyez d’ici la figure du Tigre :
– Monsieur, dit-il, je vous défends de toucher à la peau de ce pékin. Elle m’appartient. Elle est à moi. Je la veux !
– Et de quel droit ? demanda l’autre.
– Oui, de quel droit ? demanda aussi le pékin, qui commençait à rire et qui est d’ailleurs un joli garçon, habillé comme un prince… Au reste, vous le verrez un jour ou l’autre si l’on parvient à le retrouver.
– Comment ! demanda l’un des assistants. Il est donc perdu, maintenant ?
– Si bien perdu que le Tigre le cherche depuis vingt-quatre heures… Mais vous allez voir la suite.
Mon colonel, comprenant qu’on lui dispute le droit de couper la gorge au pékin, s’écrie d’une voix terrible, vous savez, sa voix de commandement :
– Monsieur, je suis le mari de cette dame que ce pékin a lorgnée tout à l’heure.
– Le mari ! reprend le jeune homme. Comment ! vous êtes le mari de ma tante Eulalie ! Dans ce cas, vous êtes mon oncle ! Ma foi je ne savais pas qu’elle était remariée.
Vous connaissez le Tigre. Il crut que l’autre voulait se moquer de lui.
– Ah çà ! dit-il, est-ce que vous me prenez pour un bisaïeul, vous ?… Est-ce que je ne suis pas bon pour les nièces ?… Est-ce que vous allez me mettre votre tante sur le dos ?… Est-ce que ce n’est pas assez qu’elle soit ma belle-mère ?… Est-ce que vous vous moquez du monde, vous, mon neveu, que je ne connais pas, et qui seriez tout au plus mon cousin par alliance ?… Mais d’abord et avant tout, neveu, cousin, père ou grand-père, comment vous appelez-vous, jeune homme ?
L’autre, qui pâlissait en l’écoutant, mais j’avais bien vu que ce n’était pas de crainte, lui répondit en poussant un soupir :
– Mon nom est Charles Fortin.
– Le cousin de ma femme, alors ? dit le Tigre en lui tendant la main. Touchez là, mon cousin, car c’est votre cousine que j’ai épousée, et non pas votre tante, Dieu merci ! quoiqu’elle ait encore de beaux restes, demandez plutôt à Angeli qui les contemple la moitié du jour avec admiration, comme faisait le consul Marius pour les ruines de Carthage…
(Vous savez, c’est la plaisanterie favorite du colonel de dire que je suis amoureux de sa belle-mère, et je le laisse dire parce que ça ne fait de mal à personne et qu’il faut bien supporter quelque chose de ses amis.)
Puis il ajouta :
– Je vous connais maintenant ; c’est vous Charles Fortin, celui qui est parti en 1818, il y a quatre ans, pour l’île de France, et qui s’est noyé sur la côte de Madagascar ou de Coromandel.
– De Madagascar, dit le jeune homme. C’est moi, le noyé, et j’aurais bien mieux fait de me noyer, en effet, que de revenir si mal à propos à Paris.
– Pourquoi mal à propos ?
– Pour rien.
– Est-ce que vous n’avez pas fait fortune aux îles ?… Dans ce cas, soyez tranquille, votre cousine et moi nous vous trouverons quelque chose.
– Au contraire, répliqua le noyé, je rapporte un million.
– De Madagascar ?
– Oh ! non. De Madagascar, je n’ai rapporté que des coups, trois blessures de flèches et le souvenir d’une fièvre de marais où j’ai failli rester. Mais le million me vient d’un oncle que j’avais à l’île de France, et qui est mort l’année dernière, trois mois après mon arrivée. J’ai vendu sa plantation, et je reviens.
Toute cette conversation se tenait dans le corridor, comme je vous l’ai dit, en face du pékin qui écoutait d’un air aimable et sans remuer ni pied ni patte.
– Voyons, messieurs, dit-il enfin, toutes ces histoires de famille m’intéressent, mais j’ai affaire ailleurs. Avec qui vais-je croiser le fer demain matin ?
Le Tigre lui répliqua :
– Avec moi, s’il vous plaît, mon petit monsieur. Voici ma carte.
L’autre la prit assez négligemment et lut tout haut :
« Le colonel Martin Crabanac. »
– Ah ! ah ! dit-il. C’est à monsieur le colonel…
– Crabanac, oui, monsieur.
–… que j’ai l’honneur de parler…
– Oui, monsieur, et qui aura demain l’honneur de vous couper la gorge.
– Nous verrons bien, reprit le pékin d’un ton assez crâne, quoiqu’il connût le Tigre de réputation.
– Et vous, monsieur ? demanda le Tigre.
– Moi, colonel, oh ! je ne suis pas aussi célèbre que vous, mais enfin j’espère soutenir comme il faut l’honneur de mon uniforme. Je suis le marquis Armand de Vilpatour, sous-lieutenant aux gardes du corps. Au revoir, colonel.
– Au revoir, marquis.
– Où, colonel ?
– Demain matin à dix heures, à la porte Saint-Mandé.
Là-dessus on se sépara. Le colonel voulut présenter Charles Fortin à sa cousine, mais l’autre s’excusa, disant qu’il était arrivé le matin même de l’île de France, qu’il était fatigué d’une si longue course, et surtout qu’il était trop mal vêtu pour se présenter devant les dames.
En revanche, il offrit comme parent et ami, intéressé à l’honneur de la famille, de servir de témoin au colonel, ce qui fut accepté sur-le-champ.
– Et tu ne les as pas revus ce matin ? demanda un officier.
– Ni l’un ni l’autre, répondit Angeli. Quand je suis allé chez le Tigre, il était déjà sorti, et le jeune homme n’était pas venu.
Après ce récit, tout le monde fit ses réflexions, les uns tout haut, les autres à demi-voix, et moi en silence.
Je connaissais mieux que personne tous ceux dont le Corse avait parlé, et en particulier Charles Fortin, le nouveau venu, qui était mon propre neveu, fils de ma sœur aînée. C’était, en 1815, un jeune et joli garçon de dix-neuf ans à peine, frais comme une rose, doux comme un petit agneau, intrépide pourtant, et qui, l’année précédente, le jour de la bataille de Paris, avait fait vaillamment le coup de feu contre les armées alliées dans la plaine Saint-Denis et sur les hauteurs de Montmartre. Sa mère, ma chère sœur, qui vivait encore en ce temps-là, voulait en faire un surnuméraire, puis un employé, un chef de bureau, un chef de division, que sais-je ? peut-être un ministre, et comptait sur moi pour l’appuyer. Malheureusement, comme je l’ai déjà dit, Napoléon s’en alla à l’île d’Elbe, puis revint, puis fut mis à Sainte-Hélène, et ma protection, qui peut-être ne valait pas grand-chose auparavant, ne valut bientôt après rien du tout. J’en fus fâché, car j’aimais beaucoup ce garçon, et je comptais en faire mon héritier, – vingt ou vingt-cinq ans plus tard, bien entendu.
Par précaution, et pour ne pas lui fournir l’occasion de se consoler trop vite de ma mort, je l’avais averti, lui et tout le reste de la famille, que tout mon bien était en viager, de sorte que tout le monde avait intérêt à me voir vivant et bien portant, car sur mes économies je faisais de temps en temps quelque présent, à celui-ci cent francs, à celle-là une robe de soie, ou une loge au théâtre, ou une partie de campagne.
De cette façon, j’étais pour tout le monde le frère chéri, l’oncle adoré, et j’offre ma méthode à qui voudra s’en servir pour être heureux, choyé, respecté et, ce qui est plus difficile, regretté. Je l’offre, mais je sais qu’on n’en usera pas, mes contemporains des deux sexes n’ayant pas d’autre joie que d’amasser pour eux-mêmes ce que, après tout, ils ne pourront jamais emporter dans la tombe.