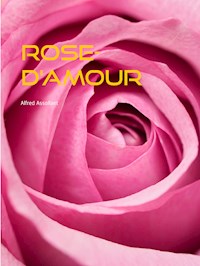
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Marie, dite Rose-d'Amour, appelée ainsi pour sa gentillesse, est vouée aux malheurs de la terre... Sauvée par Bernard, dit Vire-Loup, de l'attaque d'un loup, elle lui en sera reconnaissante. Il deviendra son meilleur ami, puis son amoureux, Bernard doit partir faire son service militaire, mais ne reviendra que dans 7 ans: Rose d'Amour lui promet de l'attendre fidèlement. Elle écrit régulièrement à Bernard, sans jamais recevoir de réponse, pourquoi? L'a-t-il oublié? Marie finit par ne plus croire au retour de son amant qui, avant de partir, lui a laissé un cadeau, une charmante petite fille nommée Bernardine. Plus de mariage, les voisins, les amis l'abandonnent, qu'a-t-elle donc fait pour mériter un tel Destin?...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rose-D'amour
Rose-D'amourI.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.Page de copyrightRose-D'amour
Alfred Assollant
I.
J’avais à peu près dix ans quand je fis connaissance avec Bernard…
Mais avant tout, madame, il faut que je vous parle un peu de ma famille.
Mon père était charpentier, et ma mère blanchisseuse. Ils n’avaient pour tout bien que cinq filles dont je suis la plus jeune, et une maison que mon père bâtit lui-même, sans l’aide de personne, et sans qu’il lui en coûtât un centime. Elle était perchée sur la pointe d’un rocher qu’on s’attendait tous les jours à voir rouler au fond de la vallée, et qui, pour cette raison, n’avait pas trouvé de propriétaire. Quand j’étais enfant, j’allais m’asseoir à l’extrémité du rocher, sur une petite marche en pierre, d’où l’on pouvait voir, à trois cents pieds au-dessous du sol, la plus grande partie de la ville.
Mon père, après sa journée finie, venait s’asseoir à côté de moi. Son plaisir était de me prendre dans ses bras et de regarder le ciel, sans rien dire, pendant des heures entières. Il ne parlait, du reste, à personne, excepté à ma mère, et encore bien rarement, soit qu’il fût fatigué du travail, – car la hache et la scie sont de durs outils, – soit qu’il pensât, comme je l’ai cru souvent, à des choses que nous ne pouvions pas comprendre. C’était, du reste, un très-bon ouvrier, très-doux, très-exact et qui n’allait pas au cabaret trois fois par an.
Si mon père était silencieux, ma mère en revanche parlait pour lui, pour elle, et pour toute la famille. Comme elle avait le verbe haut et la voix forte, on l’entendait de tout le voisinage ; mais ses gestes étaient encore plus prompts que ses paroles, et d’un revers de main elle rétablissait partout l’ordre et la paix. Sa main était, révérence parler, comme un vrai magasin de tapes, et la clef était toujours sur la porte du magasin. Au premier mot que nous disions de travers, mes sœurs et moi, la pauvre chère femme (que le bon Dieu ait son âme en son saint paradis !) nous choisissait l’une de ses plus belles gifles et nous l’appliquait sur la joue.
Et croyez bien, madame, que nous n’avions pas envie de rire, car ses mains, endurcies par le travail, avaient la pesanteur de deux battoirs. Du reste, bonne femme, qui pleurait comme une Madeleine les jours d’enterrement, et qui aurait donné pour mon père et pour nous son sang et sa vie ; mais quant à crier, battre et se disputer avec ses voisins, elle n’y aurait pas renoncé pour un empire.
Mon père, qui était la bonté même, voyait et entendait tout sans se plaindre, se contentait de lever quelquefois les épaules, – ce qui ne le sauvait même pas de tout reproche. Mais il était dur à la peine. Il disait souvent : « Nous ne sommes pas en ce monde pour avoir nos aises ; et, puisque nous ne pouvons pas avoir d’enfants sans nos femmes, il faut savoir supporter nos femmes. » On l’appelait le vieux Sans-Souci, parce que jamais personne n’avait pu le mettre en colère, ni homme, ni enfant, ni créature vivante, et qu’il n’aurait pas donné une chiquenaude, même à un chien, excepté pour se défendre de la mort.
Un jour, en revenant du lavoir, ma mère se sentit fort altérée et toute en sueur. Elle but un grand verre d’eau froide, tomba malade et mourut la semaine suivante. Mon père la mena au cimetière sans pleurer, et revint à la maison avec mes sœurs et moi. Il nous embrassa toutes, donna les clefs de ma mère à ma sœur aînée, qui avait déjà dix-huit ans, s’assit dans le coin de la cheminée, et mit sa tête entre ses mains. À dater de ce jour-là, le vieux Sans-Souci, qui n’avait guère parlé jusque-là, ne parla plus du tout : il avait l’air de rêver nuit et jour, et nous-mêmes, intimidées par son silence, nous ne parlions plus qu’à voix basse pour ne pas l’interrompre dans ses rêves.
Cependant mes sœurs se marièrent l’une après l’autre, quand l’âge fut venu, et laissèrent là mon père, avec qui je restai bientôt seule. J’avais alors dix ans, et ce fut vers ce temps-là, comme je vous le disais en commençant, que je fis pour la première fois connaissance avec Bernard, dit l’Éveillé et le Vire-Loup. Car vous savez, madame, que c’est assez la coutume chez nous de donner des surnoms aux garçons comme aux filles, et que ces surnoms font souvent oublier le nom que nous a donné notre père. Moi, par exemple, quoiqu’à l’église et à la mairie l’on m’ait appelée Marie, je n’ai jamais, depuis l’âge de douze ans, répondu qu’au nom de Rose-d’Amour, que les filles de mon âge me donnaient par dérision, et que les garçons répétaient par habitude.
Car il faut vous dire, madame, et vous devez le voir aujourd’hui, que je n’ai jamais été jolie, même au temps où l’on dit communément que toutes les filles le sont, c’est-à-dire entre seize et dix-huit ans. J’avais les cheveux noirs, naturellement, les yeux bleus et assez doux, à ce que disait quelquefois mon père, qui ne pouvait pas se lasser de me regarder ; mais tout le reste de la figure était fort ordinaire, et si j’ajoute que je n’étais ni boiteuse, ni manchotte, ni malade, ni mal conformée, que j’avais des dents assez blanches, et que je riais toute la journée, vous aurez tout mon portrait.
Du reste, on m’aimait assez dans le voisinage, parce que je n’avais jamais fait un mauvais tour ni donné un coup de langue à personne, ce qui est rare parmi les pauvres gens, et plus rare encore, dit-on, chez les riches.
Il ne faudrait pas croire que je fusse le moins du monde malheureuse de vivre avec mon père, quoiqu’il ne me dit pas six paroles par jour, si ce n’est pour les soins du ménage, et que nous n’eussions pas toujours de quoi vivre. Les gens qui se portent bien et qui travaillent n’ont pas de très-grands besoins : un petit écu leur suffit pour la moitié d’une semaine, et s’il ne suffit pas, ils prennent patience, sachant bien que la vie est courte, que la bonne conscience est mère de la bonne humeur, et que la gaîté vaut tous les autres biens.
Tous les soirs, après souper, dans la belle saison, j’allais me promener avec mon père et quelques voisins dans la campagne ; nous montions dans ce bois de châtaigniers que vous connaissez et qui est sur la hauteur, à une demi-lieue de la ville. Là, mon père se couchait sur le gazon, les yeux tournés vers les étoiles, et moi je courais autour de lui avec les enfants de mon âge. L’hiver, nous restions au coin du feu, tantôt chez nous, tantôt chez le père Bernard, dit Tape-à-l’Œil, afin de ménager le bois, qui ne se donne pas dans notre pays, et qui coûte aussi cher que le pain.
Un soir, c’était au mois d’avril, mon père ne voulut pas venir avec nous, et me laissa aller au bois avec plusieurs autres garçons et filles sous la conduite de la mère Bernard, qui était une femme très-respectable et âgée. Tout en courant, je m’égarai un peu dans le bois qui n’était pas toujours sûr ; les loups y venaient quelquefois de la grande forêt de la Renarderie, qui n’est qu’à six lieues de là. Justement, ce jour-là des chasseurs avaient fait une battue dans la forêt, et un vieux loup, pour échapper aux chiens, s’étant jeté dans la campagne, avait cherché un asile dans le bois où je courais.
J’étais seule, avec un jeune garçon plus âgé que moi de trois ans, qu’on appelait Bernard l’Éveillé, lorsqu’au détour du sentier je vois venir à moi le loup, une grande et énorme bête, avec une gueule écumante et des yeux étincelants que je vois encore. Je pousse des cris affreux et je veux fuir : mais le loup, qui peut-être ne songeait pas à moi, courait pourtant de mon côté et allait m’atteindre ; j’entendais déjà le bruit de ses pattes qui retombaient lourdement sur la terre et froissaient les feuilles des arbres dont les chemins étaient couverts depuis l’hiver, lorsque tout à coup Bernard l’Éveillé se jette au-devant de lui. Comme il n’avait ni arme ni bâton, il quitte sa veste, attend le loup, et, le voyant à portée, la lui jette sur la tête pour l’étouffer.
En même temps il m’appelle à son secours ; mais j’étais bien embarrassée, et pendant qu’avec les manches de sa veste il cherchait à étouffer le loup, je poussais des cris effrayants au lieu de l’aider. Le loup, tout enveloppé dans la veste de Bernard, poussait de sourds hurlements, se dressait contre lui, et cherchait à le mordre et à le déchirer. Je ne sais pas comment l’affaire aurait fini, si les chasseurs et les chiens qui le poursuivaient depuis plusieurs lieues n’étaient pas arrivés en ce moment pour délivrer Bernard. Le loup fut tué d’un coup de couteau de chasse, les chasseurs firent de grands compliments à Bernard pour son courage, et l’on nous remit tous deux dans notre chemin. Madame, cette petite aventure a décidé de ma vie.
Vous devinez aisément comment Bernard fut reçu par mon père lorsqu’il eut appris mon danger, et la manière dont il m’en avait tirée. De ce jour-là, Bernard devint notre ami le plus cher et ne nous quitta plus, surtout le dimanche. Il perdit son surnom de l’Éveillé pour celui de Vire-Loup, qui rappelait son courage, et mon père ne fit plus une partie de campagne sans y inviter Bernard, qui, de son côté, ne se fit pas prier, et ne me quittait pas plus que mon ombre.
II.
À parler sincèrement, madame, je crois que les belles demoiselles des villes qui ont des chapeaux de velours, des crinolines, des robes de soie, des écharpes, des cachemires, des bagues, des bracelets, et généralement tout ce qui leur plaît et tout ce qui coûte cher, ne sont pas moitié si heureuses que nous avant leur mariage, ni peut-être même quand elles sont mariées ; et je vais vous en dire la raison.
S’il leur prend fantaisie d’avoir un amoureux et de courir les champs avec lui (en tout bien tout honneur s’entend), et d’admirer la lune, et l’herbe verte des prés, et la hauteur des arbres, et la beauté du ciel, et les étoiles qui ressemblent à des clous d’or, et qui font rêver si longtemps à des pays inconnus et magnifiques, on les enferme dans leurs chambres, on tourne la clef à double tour, et on les engage à lire l’Écriture sainte, qui est une très-bonne lecture, ou l’Imitation de Jésus-Christ.
Et si l’on veut agir plus doucement avec elles, on leur fait de beaux et longs sermons qui durent trois heures ou trois quarts d’heure, sur la manière de penser, de parler, de s’asseoir, de regarder les jeunes gens du coin de l’œil sans en faire semblant, et d’attendre après sur des chaises qu’ils viennent les chercher, soit pour la danse, soit pour le mariage, et de ne pas écouter un mot de ces beaux jeunes gens si bien gantés, cirés, frisés et pommadés, à moins que les parents n’aient connu d’abord s’ils sont riches ou s’ils sont pauvres, s’ils ont des places ou s’ils n’en ont pas, si la famille est convenable, et plusieurs autres belles choses qui sont sagement inventées pour refroidir l’inclination naturelle des deux sexes à s’aimer l’un l’autre et à se le dire.
Tout cela, madame, est sans doute très-juste, très-bien arrangé et très-nécessaire pour sauver de toute atteinte la fragilité des demoiselles ; mais il faut dire aussi que ce serait à les faire périr d’ennui si elles n’avaient la consolation de penser que leurs mères se sont ennuyées de la même façon et n’en sont pas mortes, et qu’étant aussi bien constituées que leurs mères, elles n’en mourront sans doute pas davantage.
Cependant une Anglaise qui travaillait dans le même atelier que moi m’a souvent assuré que les demoiselles de son pays n’étaient pas plus surveillées que nos ouvrières, qu’elles couraient les champs avec les jeunes gens, qu’elles faisaient des parties de plaisir, et que cela ne les empêchait pas de se bien conduire et de se bien marier. Mais, comme vous savez, madame, chacun est juge de ses affaires, et si l’on a décidé qu’en France les demoiselles baisseraient toujours les yeux, tiendraient les coudes attachés au corps, ne parleraient que pour répondre et jamais pour interroger, c’est leur affaire et non la mienne.
Permettez-moi seulement de dire que j’aime mieux, toute pauvre qu’elle est, la condition d’une ouvrière qui fait sa volonté matin et soir, que celle d’une demoiselle qui aurait en dot des terres, des prés, des châteaux, des fabriques et des billets de banque, et qui obéit toute sa vie, – fille à son père, et femme à son mari.
Pour moi, qui avais le bonheur de n’être pas gardée à vue, et tenue dans une chambre comme une demoiselle, et surveillée à tout instant, et écartée de la compagnie des garçons, ni d’aucune compagnie plaisante et agréable, je n’attendis pas quinze ans pour avoir mon amoureux en titre, qui, fut, comme vous pensez bien, Bernard l’Éveillé, Bernard le Vire-Loup, mon sauveur Bernard.
Je ne vous apprendrai rien, je crois, madame, en vous disant que nos amours étaient la plus innocente chose du monde, et que la sainte Vierge et les saints pouvaient les regarder du haut du Paradis, sans rougir. Bernard avait dix-sept ans, et j’en avais quatorze. Nos amours consistaient surtout à nous promener ensemble, le dimanche, à cueillir des églantines le long des haies ou des noisettes et des mûres dans les buissons, ou encore dans les grands jours, – jours de fête, ceux-là ! – à boire du lait chaud dans les villages voisins.





























