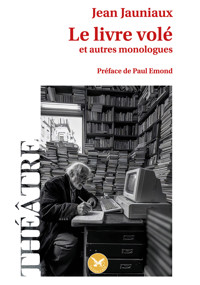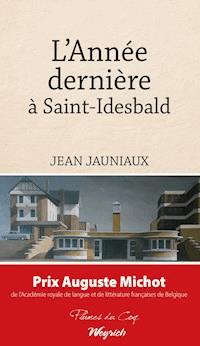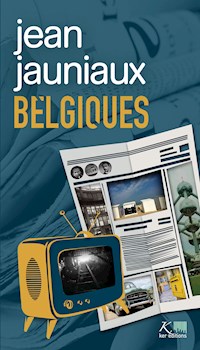
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Belgique dépeinte avec talent par Jean Jauniaux !
Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages, des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique, des langues… Tantôt humoristiques, tantôt doux-amers, chacun de ces tableaux impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur.
Découvrez la Belgique sous différentes facettes grâce à cette palette de nouvelles riches et variées !
EXTRAIT
En se rendant au Trappiste où il avait donné rendez-vous à quelques amis pour leur raconter de vive voix son voyage manqué, il se souvint de la phrase de Jacques Brel qu’il avait mise en pratique, de manière involontaire : Aller en Chine, c’est simple. Le plus difficile, c’est de quitter Vilvoorde.
Il essaya de se faire pardonner sa supercherie en évoquant les grands voyages imaginaires d’Hergé, qui avait emmené Tintin en Chine sans jamais, lui-même, y avoir mis les pieds. Il évoqua aussi les pages de son blog où il avait relaté la construction de la ligne de chemin de fer Beijing-Hankou et évoqué son ancêtre Jules Morrel que l’on peut apercevoir aux côtés de l’ingénieur Jean Jadot. Sans doute Jules fut-il un protagoniste de ce chantier inouï que les Belges menèrent à bien malgré les guerres et les assauts du climat, reliant la capitale impériale à la ville de Hankou au confluent de la rivière Han et du Yangzi Jiang.
Les amis d’Albert, hypnotisés par le babil de l’infatigable fabulateur, oublièrent qu’ils avaient été dupes. Ils furent vite convaincus de la véracité de cet ancêtre, Jules Morrel, dont ils entendaient parler pour la première fois, en voyant un cliché qu’Albert leur décrivit avec force détails, s’inventant une nouvelle lignée et un aïeul aventurier.
Ils furent convaincus davantage encore de sa bonne foi lorsqu’Albert exhiba le billet de chemin de fer qui aurait dû lui permettre d’aller à Hankou à bord du TGV qui avait remplacé les locomotives à vapeur sur la ligne inaugurée, en grande pompe, en 1905. Si ce n’avait été pour rendre hommage à cet aïeul, quelle raison aurait eu Albert de se rendre à Hankou ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Jauniaux est né dans le Hainaut, travaille à Bruxelles et apprécie la Flandre, en particulier la station balnéaire de Saint-Idesbald, près de la frontière française. Ces lieux lui ont inspiré des romans et nouvelles dont la critique a salué l’ironie douce, la souriante nostalgie et l’empathie. Le réel et l’imaginaire se confondent dans les destins de ses personnages. Ce volume de
Belgiques ne fait pas exception…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Nathalie.
Une journée hors norme
Tendu, angoissé, cet autodidacte qui professe qu’un journaliste « ne doit pas savoir, mais comprendre », décortique les dossiers, accumule les sources et les références, et s’informe avec acharnement et modestie, avant d’informer. (…) usant de toutes les potentialités de la radio, il se révèle un formidable « monteur » qui coupe et colle avec virtuosité, mélange les mots et les sons d’ambiance et télescope, comme autant de fragments réactifs, des bribes d’interviews et des commentaires acides.
Yvon Toussaint, article consacré à Armand Bachelier dans La nouvelle biographie nationale, tome VII, 2003
1830. C’était en 1830.
Ou du moins dans le 1830 que la télévision belge avait décidé de commémorer 150 ans plus tard. Tous les vendredis soir de septembre 1980, un « faux » plateau de télévision, animé par le journaliste-vedette-présentateur du JT de l’époque, rendait compte des événements qui avaient secoué les Provinces Unies du Sud. Une série de troubles éclatent à Bruxelles, à la sortie d’une représentation de l’opéra La Muette de Portici et déclenchent un effet domino qui conduira à la création du Royaume de Belgique et à la prestation de serment du Roi Léopold 1er, un an plus tard, le 21 juillet 1831.
En 1978, j’achevais dix mois de service militaire, une prestation obligatoire à laquelle je n’avais pas pu me dérober à la fin de mes études. Mon seul acte de rébellion contre cette servitude fut de m’organiser pour ne pas porter les armes, mais pour offrir à la patrie mes récentes compétences de réalisateur de cinéma et de télévision acquises à l’INSAS, une des quatre écoles de cinéma que comptait la Belgique à l’époque. Les avantages de cette affectation étaient multiples : le « Service cinéma de la force terrestre », mon régiment en quelque sorte, se trouvait à Bruxelles. Il ne fonctionnait que cinq jours sur sept, aux heures de bureau, et libérait ainsi son personnel, y compris les « miliciens » comme moi, suivant des horaires qui n’avaient rien de comparable avec l’enfermement d’autres obligés de la nation envoyés dans de lointaines casernes belges en Allemagne de l’Ouest.
Seul inconvénient : les septante-cinq francs quotidiens alloués pendant ces dix mois ne me permettaient pas de subvenir aux charges dont j’aurais été exempté si j’avais été caserné : loyer, chauffage, électricité, alimentation, etc. Une fois libéré de mes obligations militaires, je me retrouvai dans un état de quasi-pauvreté et obligé de trouver au plus tôt un emploi, quel qu’il fût.
C’est là que surgit dans ma vie le miracle de la Révolution de 1830. Comme si le fait d’avoir donné le meilleur de moi aux forces armées m’avait valu une récompense, et avait inspiré à la patrie une manière de manifester sa gratitude de façon efficace, utile et concrète. À Jean Jauniaux la patrie reconnaissante, aurait-on pu graver sur le calendrier de cette année-là, le jour où…
Le téléphone sonna. Un de ces lourds téléphones à disque dont l’utilisation se limitait aux échanges vocaux entre deux interlocuteurs. Je bénis encore le fait d’avoir été présent dans le minuscule appartement que je fuyais en général durant la journée, tant son exiguïté me rendait neurasthénique.
— Jean Jauniaux ? Jean Brismée à l’appareil…
M’appelait un de mes professeurs de l’INSAS que j’avais quitté dix mois plus tôt. Un de ces enseignants à l’ancienne : rigoureux, sévère, impressionnant. Il surjouait de cette austérité janséniste dans les classes peuplées de jeunes gens chevelus et imbus d’eux-mêmes auxquels il enseignait les matières arides, aux yeux de ces futurs génies du septième art, que sont la physique, l’optique et la chimie. Au fil des mois, pourtant, il révélait ce qui constituait sa vraie nature : la générosité, l’empathie et l’attention à l’autre. Je découvris en lui un de ces piliers de résilience qui ont balisé les étapes les plus difficiles de ma vie et leur ont donné une impulsion nouvelle.
— Un de mes amis, Jacques Cogniaux, m’a demandé de lui présenter un ancien étudiant qui pourrait s’intéresser au projet sur lequel il travaille… J’ai pensé à vous.
Jean Brismée vouvoyait ses étudiants.
— Oui, bien sûr ! Merci d’avoir pensé à moi…
Il coupa court aux remerciements.
— Il prépare une série d’émissions consacrées à la Révolution de 1830. Voici son numéro de téléphone. Il attend votre appel. Tenez-moi au courant.
Avant que je n’aie eu le temps de le remercier, ou de lui demander des détails, il avait raccroché. Il venait d’enclencher les deux plus belles années de ma vie professionnelle. Non seulement il me sauvait du chômage auquel j’avais fini par me résigner, mais il allait me permettre de participer à une de ces grandes émissions historiques que l’on attend de la télévision de service public. Il m’offrait surtout de rencontrer et de travailler avec une des personnalités les plus attachantes de la télévision : Jacques Cogniaux. Il y dirigeait à l’époque le service « Histoire ». On lui devait des évocations de la Grande Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Après 1830, il réalisa encore des émissions sur l’extrême droite et Rex, sur Degrelle. Ses émissions lui valurent des récompenses saluant le talent de celui qui avait rejoint les rangs de la télévision belge naissante lors de l’Exposition universelle de 1958.
Il me reçut dans le bureau qu’il occupait dans les locaux de la RTB, au boulevard Reyers. Je dus bien lui dissimuler le peu de confiance que j’avais en moi, la panique même qui me gagnait à l’idée de ne pas le convaincre de me recruter. Entre le coup de fil de Jean Brismée et mon rendez-vous avec Jacques Cogniaux, je m’étais installé à la bibliothèque de ma commune et j’avais épluché tous les livres consacrés à la Révolution belge qui m’étaient accessibles. Avant l’ère des moteurs de recherche, la recherche documentaire était un exercice intellectuel certes, mais surtout physique. Le transport sur des chariots des sept volumes reliés de l’Histoire de Belgique de Pirenne, de revues d’histoire et d’autres ouvrages de référence exigeait autant de capacité musculaire qu’intellectuelle ensuite pour les lire et les résumer. Le prix des photocopies était tel que je préférais utiliser le Bic et le cahier Atoma pour conserver la trace de mes lectures.
Je n’eus ni le temps ni le besoin de faire étalage de ma récente et superficielle expertise de l’histoire belge lors de ce premier entretien. Jean Brismée, secondé par Jean-Jacques Péché, un autre de mes professeurs à l’INSAS, avait déjà convaincu le responsable du service de me recruter sans plus attendre. Lors de cette entrevue, Jacques Cogniaux me proposa d’aller à la rencontre de quelques collègues qui allaient aussi participer à l’aventure de cette « Chronique imaginaire d’une révolution ». Il me présenta ainsi comme « nouveau confrère » à quelques-unes des figures emblématiques de la télévision d’alors, que je saluais d’un air faussement détaché. Les Pierre Delrock, Jacques Bredael, Françoise Van de Moortel, Élisabeth Burdot, Philippe Dasnoy, Georges Konen, Jean Antoine et d’autres encore dont l’image (en noir et blanc) et la voix m’étaient si familières. Je me souviens avec un bonheur infini de ces instants de grâce où je signai mon premier contrat d’emploi et pris possession d’une carte d’accès aux bâtiments de la radio-télévision. De retour dans notre bureau du quatrième étage, Jacques – il m’avait demandé de le tutoyer et de l’appeler par son prénom dorénavant – me tendit le scénario des cinq émissions qui devaient être sur antenne deux ans plus tard, en septembre 1980.
— Bon. Il faut y aller, maintenant… Le budget qui nous est alloué ne nous permettra pas de reconstituer la Révolution ! Ne rêvons pas. Mais quel meilleur moyen de stimuler l’hémisphère gauche de nos cerveaux que d’être dépourvu de trop de ressources, n’est-ce pas ?
J’acquiesçai en parcourant les premières pages du synopsis de La Révolution de 1830.
— Le principe est simple : chaque vendredi de septembre, Jacques Bredael anime en studio la grande émission de la soirée. Il y reçoit des invités en (faux) direct et donne l’antenne à différents correspondants de la télévision qui se trouvent sur les lieux des événements. Il faut jouer en permanence sur l’anachronisme entre les moyens d’information et les journalistes de 1980, partis en reportage sur les lieux actuels des événements de 1830 où se trouvent les protagonistes d’alors, vêtus de costumes d’époque…
— Ce qui est formidable, c’est que chaque journaliste se retrouve dans sa spécialité : économie, international, culture…
— Exactement !
— Et au générique de ces cinq soirées, le public retrouvera les visages familiers des journalistes interviewant des personnages historiques joués par des comédiens belges… Quel casting ! m’exclamai-je, ne pouvant dissimuler mon exaltation à la navigation joyeuse sur le petit nuage dont je ne descendais plus.
— Il y aura du beau monde ! Et pas que des Belges. Guillaume d’Orange viendra inspecter ses Provinces du Sud, Quentin Dickinson, le correspondant de France Inter à Bruxelles l’interviewera au soir d’une visite peu appréciée de la population…
— Du côté français, je vois aussi que Talleyrand viendra mettre son grain de sel dans l’analyse de ces turbulences belges. J’imagine qu’il faudra un journaliste de haut vol pour affronter une telle personnalité.
— Tu as raison, Jean ! Et là, je ne suis pas peu fier d’avoir convaincu Armand Bachelier de jouer son rôle de correspondant de la radio belge à Paris ! Il était enchanté, d’ailleurs… sourit Jacques dans sa barbe.
Pendant plusieurs mois, nous avons mis au point les duos de journaliste contemporain et personnage historique-comédien. Notre duo à nous, Jacques et moi, s’était élargi et accueillait « la » scripte que tout le monde s’arrachait à la télévision lorsqu’il s’agissait de réaliser des fictions, et notre projet en faisait partie. Marianne Nihon avait rejoint notre bureau de production ainsi que les lieux de tournage et les salles de montage où nous avions finalisé notre Révolution.
Impossible de citer tous les noms des uns, les journalistes, et des autres, les protagonistes de l’histoire. Il me suffit de pianoter sur un moteur de recherche pour retrouver les plus importants ou les plus mémorables, comme Charlier Jambe de Bois. Ce survivant des guerres napoléoniennes s’était rendu à Bruxelles pour donner du canon sur les troupes hollandaises (14 000 hommes !) qui avaient fait leur entrée à Bruxelles le 23 septembre. Quatre jours plus tard, les Hollandais, qui avaient réussi à pénétrer dans la ville et s’étaient fait piéger dans le Parc de Bruxelles, prenaient la poudre d’escampette en pleine nuit. Les insurgés emportaient ainsi la victoire qui conduirait à l’indépendance.
Le tournage des séquences historiques nous occupa plusieurs semaines. Les badauds qui nous croisaient dans les rues de Bruxelles se souviennent sans doute d’avoir été surpris d’apercevoir dans la cour de l’Hôtel de Ville le baron Emmanuel Van der Linden d’Hooghvorst ou, à Liège cette fois, Charles Rogier, ou encore Alexandre Gendebien et Édouard Ducpétiaux. Sans doute la journée du 25 août fut-elle la plus chaude ! Ce soir-là, en 1830, les spectateurs de la Monnaie sortent à l’entracte et appellent à l’insurrection. Le journaliste culturel de la télévision est là bien sûr pour recueillir à chaud quelques réactions du public. Et en studio, Jacques Bredael lance sur antenne un extrait de La Muette de Portici, l’air Amour sacré de la patrie qui a mis le feu aux poudres :
Amour sacré de la patrie,Rends-nous l’audace et la fierté !À mon pays, je dois la vie,Il me devra sa liberté
Pendant des semaines, nous avons ainsi sillonné les rues de Bruxelles en compagnie des insurgés, puis assemblé ces images pour en faire une émission à la fois inventive, distrayante et inattaquable au niveau historique.
Je ne sais aujourd’hui, à l’approche des 190 ans de la Belgique, s’il reste des archives de cette aventure hors norme de la télévision de service public. Il me reste une multitude de souvenirs que parfois j’évoque avec l’un ou l’autre qui y a participé et à qui j’aime dire : « Nous nous connaissons depuis 1830 ! »
Il y a ceux à qui je ne pourrai plus le dire, comme Jacques Cogniaux qu’un cancer emporta avant qu’il atteigne la soixantaine ou Armand Bachelier, terrassé trois ans après le tournage par une crise cardiaque. Il avait 55 ans.
J’avais été chargé de l’accueillir le matin du tournage et de le conduire au château du Roeulx où nous allions filmer sa rencontre avec Talleyrand, joué par Claude Volter. Sur le quai de la gare du Midi, je guettais la silhouette trapue du correspondant de la RTB à Paris, dont j’allais entendre enfin, en direct, la voix si particulière qui m’impressionnait au-delà du raisonnable. Je n’avais pas encore, à cette époque, rencontré assez de personnalités pour savoir que les plus grands sont souvent les plus accessibles. En l’attendant, je pensais à ce que je savais de lui : son vrai nom, Nathan Seifman, son enfance à la Dickens, le seul diplôme qu’il avait, celui de l’école primaire, ce pseudonyme qu’il avait choisi, « Bachelier, parce que je ne le suis pas… », mais surtout sa voix typée et sa manière de composer des billets courts, enregistrés sur le Nagra qui ne le quittait jamais, et qu’il travaillait comme autant de créations radiophoniques de 120 secondes.
Je l’aperçois. Je me présente à lui. Il me serre la main et puis redresse la tête comme s’il allait éternuer. « Laissez-moi, un instant, humer à ma guise ce qui fait de cette gare un lieu inouï. Sentez ! Sentez ! L’arôme du chocolat… »
Je l’emmène dans ma petite voiture rouge vers Woluwe-Saint-Pierre où nous avons rendez-vous avec Volter. Celui-ci nous attend sur le seuil de son théâtre, déjà en costume de scène. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord salue d’un geste de la main Armand Bachelier, assis à l’arrière de la voiture. Je prends le volant. Sans se concerter, les deux hommes se placent d’emblée chacun dans leur rôle. Pendant que je conduis, je m’en veux de ne pas avoir emporté de quoi les enregistrer, devisant de l’état du monde tel qu’il leur apparaît en ces journées de… septembre 1830.
De temps à autre, le « Diable boiteux » salue d’un geste souverain par la fenêtre de ma Fiat 127 les véhicules que nous dépassons sur l’autoroute. Sidérés ou amusés, les automobilistes et camionneurs saluent à leur tour celui qui est alors ambassadeur de France à Londres.
Le tournage achevé, les décors rangés, les costumes des figurants repliés, le matériel technique remis en caisse, il ne me reste plus qu’à reconduire mes hôtes. Armand Bachelier est déjà dans la voiture. Claude Volter apparaît au sommet de l’escalier monumental du château et lance à la cantonade : « Revenez quand vous voulez, mes bien chers amis… »
Il n’avait quitté ni son costume, ni son personnage.
Armand Bachelier souriait dans sa barbe. Il avait passé, me dit-il lorsque nous prenons congé l’un de l’autre dans les effluves du Côte d’Or, une journée comme il les aime, « hors norme ».
Plisnier en 1967
Et dressé il demeure le vivant souvenir de cet homme debout le matin de sa mort.
Philippe Jones
Des six années de mes études secondaires à l’athénée de Mons de 1964 à 1970, je n’ai conservé aucun souvenir précis. Seules des sensations parfois, au gré des événements de la vie, me reviennent, sollicitées par la résonance particulière d’une voix, un accent du Hainaut, une musique d’alors, des palettes de couleurs, le bleu gris profond du petit granit rainuré sous la pluie, l’acier noir des ponts de chemin de fer, des effleurements de sentiments, l’angoisse d’être en retard ou d’avoir oublié quelque chose.
Je ne m’y suis fait aucun ami. Les noms de mes camarades de classe ont disparu de ma mémoire. De l’un ou l’autre, je conserve le stigmate des humiliations qu’involontairement ils m’ont fait subir ; je me souviens de leur volonté sournoise de me mettre à l’écart des complicités qu’ils nouaient à l’intérieur de cercles d’affinités dans lesquels j’essayais désespérément de pénétrer. Aujourd’hui, un demi-siècle après ma « rhétorique », je sais que je ne peux pas leur en vouloir. Ce sont les circonstances particulières de ma scolarité qui m’ont exclu pendant six ans de ce qui faisait leur vie, en dehors des heures partagées en classe.