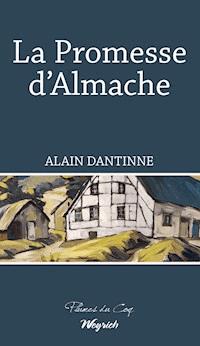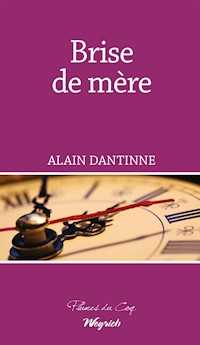
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une femme dans son siècle, née à la fin de la Première Guerre mondiale. Une vie dans l’ombre de son mari, de ses quatre enfants, en un temps où le patriarcat imposait renoncements et soumission aux mères. Le dernier de ses fils l’accompagne jusqu’aux portes de la mort et raconte…
Un récit riche de révoltes instinctives et d’attachement viscéral, d’incompréhensions générationnelles et de rendez-vous parfois manqués, de colères et de tendresse. Une histoire d’amours, toujours recommencées.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Dantinne est né en 1951, il vit dans le Namurois. Professeur de lettres et de philosophie, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages : poèmes, carnets de voyage ou écrits intimistes. Il a osé un pastiche,
Hygiène de l’intestin (Labor), et commis un
Petit catéchisme à l’usage des désenchantés (Finitude).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brise de mère
À l’enfant sauvage qui crie dans la cave
Ce livre a déjà été écrit par ma mère
jusqu’à la dernière ligne.
Tandis que je le recopie
voilà qu’il s’écrit autrement,
s’éloigne malgré moi
de la nudité maternelle,
perd de la sainteté,
et nous n’y pouvons rien.
Hélène Cixous
Homère est morte…
Empreintes
Avant de naître, j’existais. Dans un en deçà de la conscience, dans un projet informel, une succession de projets, un terreau qui laisse des sédiments se propager, se mêler, former un humus compact, une marne épaisse. Agrégat de tendresse et d’oubli, de rudesse, de déni. Crues et crises, glissements et dépressions vinrent éroder cette tourbe d’amour ou de haine. Ce composite est devenu une île, une solitude.
La mémoire nous taraude, nous sommes mémoire et projet, projet de mémoire ; le jeu de l’écriture fait surgir la mémoire dans l’échancrure des lendemains. Nous ne nous souvenons pas seulement de ce que nous avons vécu ou de ce que nous sommes persuadés d’avoir vécu, nous gardons l’empreinte dece qui fonde ces événements passés, ce substrat existentiel que nous partageons avec nos frères. Nous sommes issus de l’absence qui demeure, du manque qui précède chacun de nos pas.
« La fin est l’endroit d’où nous partons », disait T. S. Eliot. J’appelle des figures anciennes, les amène un instant à l’avant-plan pour les replacer ensuite dans le fond de la toile, recomposant ainsi un décor, fine encoche d’un segment infinitésimal d’éternité que constitue une existence. Notre histoire se perd dans l’Histoire, et je ne peux ne pas penser ici à la « grande hache » de Georges Perec. La mort comme une entaille, tantôt cicatrice, tantôt lever de rideau, ouverture qui permet de franchir les portes qui s’étaient refermées sur les vanités de nos ego et la peur de disparaître.
Écrire, c’est scruter le visible pour entendre l’invisible.
Le café
Je suis un enfant. Un enfant déguisé en adulte. Un enfant qui revient boire le café chez sa mère presque tous les jours. J’observe ses gestes, ses manies, écoute ce que son babil acerbe veut bien me dire. Je trie parmi ses récits pour déchiffrer une vérité qu’altère sa mémoire, toujours vivace pour évoquer son passé lointain, mais usée pour parler d’événements plus récents et, quelquefois, défaillante. Je voudrais tant retrouver dans son murmure traces de rares moments de bonheur. Depuis une dizaine d’années, elle s’est retirée dans une maison de repos où elle ressasse les saisons d’une vie banale et grise, une vie laborieuse, envahie, comme toute existence, d’épisodes plus ou moins romanesques. L’écriture est ce tamis qui arrête des mouvements anciens pour n’en retenir que quelques miettes échappées des paraboles avant qu’elles ne retombent, balayées par l’oubli ou la confusion de l’époque, dans un néant ordinaire.
Ma mère est née dans les derniers mois du premier conflit mondial et traversa le second en se coltinant les rationnements du quotidien, sans trop maîtriser le sens géo-planétaire du conflit. Mon enfance fut ainsi marquée par les usages de l’après-guerre. Il fallait économiser la viande, racler le gras du papier beurre, il était interdit de jeter du pain, de jouer avec la nourriture, bref de gaspiller ce qui avait tant manqué autrefois. À chaque risque de conflit, je la voyais, inquiète, constituer dans un recoin de la cave des provisions de café, d’huile ou de sucre. Je baignais dans cette atmosphère doloriste qui, sans qu’on le veuille, inculquait une vision apeurée du monde. Ma jeunesse, celle de la fratrie, fut donc étriquée, nous formions une famille de la classe moyenne, simple et – chance ! – sans grandes ressources financières.
Toutes pensées politiques, toutes réflexions rationnelles lui sont étrangères, maman n’argumente jamais, elle se fie à son intuition, à son flair improbable qui lui permet, avec une mauvaise foi avérée, d’affirmer des certitudes invraisemblables, d’énoncer des vérités qui se révèlent assez souvent exactes. À chaque élection, elle apporte sa voix au parti « chrétien », devenu aujourd’hui « humaniste », suivant en cela les instructions que lui donnait naguère son mari qui, lui, s’était engagé jeune dans cette organisation catholique, par conviction d’abord, avec la « reconnaissance du ventre » ensuite. Homme de confiance de ce parti qui présidait la ville depuis des lustres, mon père, au milieu de la cinquantaine, fut choisi pour occuper la fonction de receveur communal. Une promotion qui ne changea en rien le rituel de la maison. Bien sûr, mes parents ne connurent plus la gêne des fins de mois, ils n’éprouvèrent pas non plus la tentation du luxe, à l’image de la petite Coccinelle beige dans laquelle mon père parcourait les rues de la cité. Discret, papa, un employé modèle, se mit à faire des économies… pour ses enfants.
Peur
Ce que j’ai peur de perdre, c’est l’enfance. Mes frères et sœur oubliés dans leurs pensionnats et papa demeurant au bureau, nous nous retrouvions, seuls, pour le repas de midi. Tu me demandais ce que je voulais manger, « une omelette au sucre », répondais-je un jour sur deux, et chaque semaine tu battais des blancs en neige, me gâtais d’œufs boursouflés. Ce que j’ai peur de perdre, c’est une connivence, une intimité. Même quand je ne parlais pas, que je ne voulais rien t’avouer, tu avais déjà deviné. Ton départ m’imposera de quitter cette enfance, définitivement, d’oublier l’imprévisible tendresse que je connus quand nous habitions la petite maison de la rue de la Colline, entre les messes que je servais à la paroisse, les réunions de louveteaux du dimanche après-midi, les parties de football au Pré Motet, terrain vague et fangeux dont je revenais tout crotté, et tu te fâchais car tu venais de nettoyer la maison, les vélos que je transformais en machines de cyclo-cross et que je ramenais avec un pneu crevé ou la fourche pliée, l’école primaire où, les matins d’hiver, j’aidais Jean – celui que j’avais élu pour être mon meilleur ami – à raviver les poêles dans les classes du vieux bâtiment, de gros monstres gris en fonte de la marque Ciney. Oui, j’ai peur de perdre cette douceur quand je venais me réfugier sur tes genoux en étant la risée de tous, frères, sœur, cousins et cousines, peur de perdre le souvenir même de cette insouciance.
Peur de perdre ce que j’ai déjà, à tout jamais, perdu.
Refus
Aujourd’hui, quiconque accompagne un proche vers la grande sortie doit éprouver un tel sentiment, il m’arrive de souhaiter que tu partes, que tu disparaisses doucement, maman, sans souffrance, que tu entres dans la nuit de ta vie au milieu d’un sommeil apaisé, toi qui le fus si peu souvent. Que tout cela finisse au plus vite ! Il m’arrive de le rêver.
Tout en moi dit le contraire. Comme le crie Pier Paolo Pasolini, Ti supplico, ah, ti supplico : non volermorire, je t’en supplie de ne pas vouloir mourir. Les mots, les gestes, les caresses, les baisers, tout l’enfant que je fus t’adjure : « Reste ! », si tu t’en vas, je me sentirai seul, perdu, orphelin.
Ressac
Va !
et chaque nuit deviendra
battue
par des ressacs inouïs
une île perdue
dans cette bruine infinie
tu aboliras
les rivages de l’innocence
les amours s’estomperont
entre faille et faillite
je rejoindrai vite
le petit sauvage de l’Aveyron
si tu effaces
ces traces d’enfance
alors sache
rien n’aura plus de sens
comme tournesols
pris dans le vent
de Vincent
danseront
les silences
racines et corolles
des souffrances
dans la ronde
des tourments
de l’absence
I
Dire avec des mots de fils
È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.
Il est difficile de dire avec des mots de fils
ce qui dans mon cœur me ressemble bien peu.
Pier Paolo Pasolini
Supplica a mia madre
Quatre filles de notaire
Après le décès prématuré d’une sœur aînée, les filles du notaire de Jambes se sont éparpillées dans les remous de l’après-guerre. La plus âgée n’a jamais travaillé et vécut somptueusement sur le compte d’un amant généreux. La plus jeune se maria avec un homme d’affaires ; sans enfant, elle travailla peu et demeura, mélancolique, dans l’oisiveté d’un confort suranné. Ma mère, femme au foyer, sans jamais connaître l’aisance, dut élever quatre moutards et veiller à l’entretien d’une famille nombreuse. Elle bénéficie cependant d’une pension de survie qui lui permet de s’ennuyer délicatement dans une seigneurie. La dernière besogna hargneusement comme dactylo dans un cabinet d’avocats, elle continua une dizaine d’années après l’âge légal de la retraite. Épuisée, elle s’est retirée dans un petit appartement de la banlieue bruxelloise et se débrouille avec une minuscule allocation. Quatre parcours qui débouchèrent sur des situations financières exactement inverses à l’investissement de chacune de ces femmes dans la société. Prodige du libéralisme !
L’époque avait le sens du devoir, beaucoup d’hommes combattirent brièvement pour la patrie, cet engagement allait de soi. Pour les filles, il n’était pas question d’entreprendre des études ou de travailler, et si on occupait un petit boulot – ma mère avait terminé ses trois moyennes et donnait des coups de main dans l’étude notariale –, il fallait le quitter le jour de son mariage. Des lois tacites s’imposaient aux femmes de son milieu : être aux petits soins pour le mari nourricier, assurer l’éducation des petits. Surtout, ne pas divorcer ! J’ai toujours connu la certitude du couple de mes parents. Lors de leurs disputes acerbes ou criardes, jamais je n’ai éprouvé la crainte d’une séparation. Jamais je n’ai ressenti la peur de voir, rentrant de l’école, la maison à moitié vide, la famille dévastée.
Dialogue dans la nuit
« Je suis bien triste de la vie que mène Betty ! » Voilà ce qu’en fin de nuit me confia Dydie, la plus jeune sœur de maman. Sans le vouloir, je venais de lui dépeindre une femme triste, accablée d’insatisfaction, peu reconnue, dépressive. Je regrettais d’avoir livré pareil tableau, de larges aplats de chagrin sans échappées de lumière. Mais c’était ainsi, c’était maman telle que je la voyais au quotidien. Ma tante me raconta leur jeunesse, me fit découvrir une mère inconnue : indisciplinée, espiègle, très différente de ce que je pouvais imaginer. Je découvrais une jeune fille qui adorait se moquer, taquiner les siens, une jeune femme rieuse qui traversait la vie pleine d’entrain. De cette enfance, elle a gardé un humour vif, une verve sarcastique qui peut virer à l’amertume ou à la rancœur.
Cette tante sans enfant a longtemps vécu à Bruxelles avant de s’installer dans les Ardennes. Au temps de mon adolescence, quand l’atmosphère devenait trop lourde en famille, je me réfugiais chez elle dans son appartement de la capitale. Après son veuvage, elle choisit une vie complètement opposée à sa nature affable : elle s’est enfermée dans une ancienne hostellerie à la campagne et vécut rattachée au monde par son seul poste de radio. Isolée, elle s’accrocha au jeune prof que j’étais, nous passions des nuits à rabâcheren trinquant au champagne. Au cours de ces palabres nocturnes, j’appris que maman n’avait pu mener à terme deux grossesses. Sans ces fausses couches, serais-je ici ? De quel magma de tristesse surgit donc mon histoire ?
Un voisin est mort
L’heure des repas était sacrée dans la famille de maman, et la présence de tous exigée. Or, ma mère, volontiers récalcitrante sans doute, affectionnait d’être en retard. Un jour où le délai atteignit les limites de l’insupportable pour son père, elle arriva et, d’une voix essoufflée, lança :
— Malengreau est mort !
Stupeur autour de la table ! Car le distingué monsieur était une figure marquante du quartier, un vieux jeune homme, comme on disait à l’époque, qui vivait de ses rentes et se promenait la journée, toujours prêt à rendre un service, surtout aux petites jeunes filles, ajoutaient quelques langues vipérines. Malengreau, c’était la mémoire de la rue, du quartier, du bourg, de Jambes et même de Namur, la ville voisine. La retardataire n’eut même pas l’ombre d’une réprimande tant l’émotion et la tristesse s’emparèrent des convives qui finirent le repas dans un silence inhabituel. Sauf que l’honorable Malengreau fut aperçu vers les trois heures de l’après-midi, poursuivant son chien comme à l’accoutumée. Une sœur courut annoncer la nouvelle de la résurrection à la famille. Mais la polissonne avait disparu. Le soir, elle fut sommée de s’expliquer, cependant le courroux paternel était retombé, la colère s’était muée en irritation transformant un bel orage en désaveu, en réprobation contenue.
Maman a reporté sur ses enfants l’exigence d’être présents, à l’heure précise, aux repas. Règle à laquelle je ne pus jamais me plier. Un midi, alors qu’elle me reprochait une nouvelle arrivée tardive, je lui répondis tout de go : « Malengreau est mort ! »
Elle resta interdite avant d’éclater de rire.
Exode
Maman avait vingt-deuxans le 10 mai 1940, elle vivait chez ses parents comme toute jeune fille non mariée dans la bourgeoisie de l’époque. Moins de trois jours après le début de la guerre, les Allemands s’annonçaient déjà aux portes de Namur. Le souvenir de 14 était tenace, la peur régnait ; la famille, originaire de Dinant, avait connu les atrocités que vécut cette ville. Aussi, un matin, au milieu du petit-déjeuner, le pater familias ordonna le départ immédiat de la smala. Vers où ? Il n’en savait fichtrement rien, on suivrait, on verrait… La tribu quitta la demeure, se dirigea cahin-caha vers la gare de Namur à pied, les plus jeunes sœurs emportant leur vélo. Le premier train les avança laborieusement de vingt kilomètres avant de s’arrêter sans raison dans une station de la Basse-Sambre. Dans la cohue et la panique, les vélos se perdirent, trouvèrent d’autres fugitifs plus allègres. Dans le Nord de la France, on leur conseilla de se diriger vers l’ouest, d’aller revoir la Normandie, mais finalement, tant bien que mal, ils s’installèrent dans un village de l’Aude, près de Limoux. Après quelques mois, le père de ma mère – j’ai du mal à dire mon grand-père, ma grand-mère, pour évoquer des personnes que je n’ai jamais connues, je ne les vois qu’en frac et robe longue sur une photo écornée datée du 15 avril 1942, jour du mariage de mes parents –, le tabellion, donc, envoya l’aîné des fils, notaire lui-même, pour se rendre compte dela situation en Belgique occupée. Il découvrit la maison familiale telle qu’ils l’avaient quittée, le café refroidi du petit-déjeuner semblait attendre les convives sur la table de la salle à manger. La famille rentra quelques semaines plus tard, la vie reprit son cours sous les hauts plafonds de l’étude provinciale.
Résistance
Dans les derniers mois du conflit, mon père dut se cacher dans une ferme près d’Éghezée avant de se faire oublier dans l’appartement d’une de ses tantes à Bruxelles. Jeune mariée, ma mère n’hésitait pas à prendre des risques et enfourcher un vélo pour lui rendre visite, il fit de même pour venir voir sa fille à la maternité en juillet 44. Maman me raconta l’irruption de la Gestapo dans la maison qu’ils louaient à La Plante dans les premiers mois de leur mariage. Seule dans la demeure, elle aperçut la petite Volkswagen jaune de la police allemande se garer devant ses fenêtres. Elle garda son calme, sortit dans le jardin et passa la clôture pour se retrouver dans le salon de coiffure de la voisine. Celle-ci eut la présence d’esprit de la placer sous un casque et quand les officiers entrèrent dans la boutique pour soutirer quelque information, la coiffeuse leur expliqua simplement que les nouveaux locataires, un brin nomades, étaient régulièrement absents. Je ne sais si l’anecdote ainsi contée correspond exactement aux faits, elle participe de la mythologie familiale. Mes parents, peu enclins aux épanchements, demeurèrent toujours discrets sur leur jeunesse et les années de guerre.
Aujourd’hui, il arrive qu’en découvrant une notice nécrologique publiée dans le journal local, le faire-part d’une personne qu’elle avait croisée ou connue autrefois, péremptoire, maman ponctue : « Celui-là, c’est un incivique ! »
La Libération
Lors de la libération de Namur en septembre 44, mon père se cachait toujours. Jeune mère de famille, maman s’était réfugiée chez ses parents à Jambes. Quand la rumeur annonça l’arrivée des Américains, transgressant toutes les consignes de prudence, Dydie entraîna ses sœurs et les jeunes femmes se ruèrent en direction du parc de La Plante où les premiers chars défilaient dans une atmosphère de liesse. Écervelées, elles s’élancèrent avec quelques compagnons de leur âge sur l’étroit ponton qui surplombait l’écluse pour traverser la Meuse. Tout à coup, la joyeuse bande essuya le tir lointain des derniers Allemands déboussolés, planqués dans les coteaux jambois. Les jeunes gens insouciants ressentirent brusquement la peur du maquisard, ils purent néanmoins rejoindre les libérateurs, grimper sur leurs chars, fumer leurs cigarettes si ce n’est, pour quelques délurées, les embrasser. Je n’ai jamais connu telle frivolité chez ma mère. La vie de couple et les maternités qui s’en suivirent la plongèrent dans la résignation et le ruminement.
L’aliénation
Fille de notaire, ma mère épousa le fils d’un notable namurois. Ils furent mariés pour la vie puisqu’il était impensable dans cette bourgeoisie catholique de mettre fin à l’union bénie par le Seigneur. D’une foi profonde, mes parents ne remirent jamais en cause ce précepte qui, dès leur plus jeune âge, fut imprimé dans leur âme déserte. Mon père étudia l’économie pendant deux ans à Anvers, mais n’acheva pas ses études supérieures, il travailla dans une banque avant de devenir commis, puis rédacteur à l’hôtel de ville de Namur. Employé irréprochable, certes, mais dont le traitement était loin d’être mirobolant. Ma mère, comme toutes les femmes de son rang, avait donc pour vocation de pondre des enfants, de les élever tant bien que mal et d’entretenir son homme. Trois chérubins, une fille suivie de deux garçons, participèrent à la reconstruction de l’après-guerre, à l’envolée des espoirs de la nation. À ce moment, pour des raisons économiques, je suppose, la tribu vint habiter chez le père de mon père. Et là, quatre ans après la naissance du deuxième fils, maman se retrouva enceinte d’un raculot. Papa souhaitait ardemment une fille. Baby boom ! Je suis arrivé. Il en fut profondément déçu.
Des années durant, ma mère dut assumer le birbe grincheux et son propre foyer, préposée au service de tous. Ni plaisir, ni déplaisir, les loisirs se résumaient à deux soirées de cartes en semaine, à quelques bridges avec des oncles et tantes le dimanche en fin d’après-midi. Le notariat vola en éclats peu après la mort de son père. À la suite d’une mauvaise gestion de la succession, un risque de faillite entraîna la vente rapide de l’étude, priva les héritiers de leur part du gâteau. Cette mésaventure renforça son sentiment d’infériorité par rapport au clan paternel. Certaines âmes bien nées s’y entendaient pour le lui rappeler. Elle subissait ces brimades avec tristesse ; la nostalgie mêlée à un ressentiment tenace durcissait son cœur de femme. Il n’y avait que peu d’espace pour glisser les mots de la révolte. Elle se tourna vers son benjamin, s’accrocha au mioche pour noyer ses désillusions, sa défaite.
Rue de la Colline
Le lieu de l’enfance, de la complicité avec la mère, c’est la maison de la rue de la Colline. J’y suis arrivé à l’âge de deux ans et demi et j’y ai vécu huit ans. Petite rue escarpée, forcément, où ne passaient, à la fin des années cinquante, que peu de voitures ; nous cessions nos matchs de foot pour laisser le véhicule poursuivre sa route vers la citadelle de Namur, avant de reprendre de plus belle nos parties acharnées qui firent voler en éclats bien des carreaux. Les ménagères ulcérées sortaient, vociférant de malveillantes imprécations, nous ordonnant de cesser nos ébats sportifs. Mais dès le lendemain, nous nous retrouvions pour jouer la revanche. J’étais le bambin non seulement de la fratrie, mais aussi de tous les gamins de la rue, je devais me battre pour trouver ma place et rivaliser avec les grands. Le jour où cette bande d’ados organisa un cyclo-cross, où les prétendus champions, que j’admirais, bichonnaient leur vélo et fixaient des guidons de moto sur leur machine, j’enrageai de ne pouvoir participer avec eux à cette partie de casse-bécane. Un de mes frères arriva second, j’en fus néanmoins très fier… La partie de manivelle eut lieu dans ce terrain vague, le Pré Motet, où nous allions aussi fumer nos premières cigarettes, celles de nos dix ans, des Laurens 48filtre, les moins chères du marché. Nous les achetions bien loin, de l’autre côté de la ville, car l’épicière du quartier, Louise, aurait refusé de nous les vendreet notre mère en eût été avertie le jour même. Rien ne se passait dans le coin sans que tout se sache et moi, le petit, par ma gouaille, j’avais mes entrées dans presque toutes les maisons. Il n’était pas rare qu’une dame plus âgée m’appelle et me gave de sucreries ou qu’un ménage me retienne pour un repas ou un dessert. Parmi mes adresses, il y avait les Dogot, un couple de retraités habitant en face de chez nous. Toute la rue se retrouvait chez eux pour la retransmission télévisée des matchs de football. Leur salon se transformait en agora dès que l’hymne baroque et pompeux de l’Eurovision résonnait pour annoncer le début de la retransmission. Et si le Standard de Liège jouait, il fallait venir avec sa chaise pour s’asseoir entre deux commentaires. Je subis donc la cuisante défaite dans l’inénarrable demi-finale de la Coupe d’Europe 59 contre le Stade de Reims de Just Fontaine et Roger Piantoni.