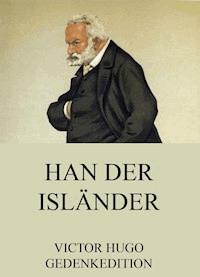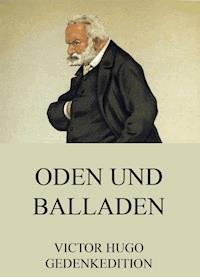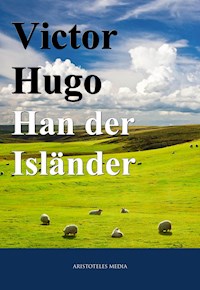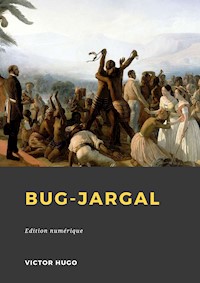
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pierrot, qui bientôt sera Bug-Jargal, un Noir, esclave d'un riche colon de Saint-Domingue, ose porter ses regards sur Marie, la fille de son maître, qui révèle le fait à son fiancé, Léopold d'Auverney. Pierrot se cache, mais veille sur Marie et la sauve alors qu'elle allait devenir la proie d'un crocodile.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 (7 ventôse an X) à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle.
Comme romancier, il a rencontré un grand succès populaire, d'abord avec
Notre-Dame de Paris en 1831, et plus encore avec
Les Misérables en 1862.
Son œuvre multiple comprend aussi des écrits et discours politiques, des récits de voyages, des recueils de notes et de mémoires, des commentaires littéraires, une correspondance abondante, près de quatre mille dessins dont la plupart réalisés à l'encre, ainsi que la conception de décors intérieurs et une contribution à la photographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
BUG-JARGAL
– 1826 –
PRÉFACE DE L'ÉDITION ORIGINALE
L'épisode qu'on va lire, et dont le fond est emprunté à la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791, a un air de circonstance qui eût suffi pour empêcher l'auteur de le publier. Cependant une ébauche de cet opuscule ayant été déjà imprimée et distribuée à un nombre restreint d'exemplaires, en 1820, à une époque où la politique du jour s'occupait fort peu d'Haïti, il est évident que si le sujet qu'il traite a pris depuis un nouveau degré d'intérêt, ce n'est pas la faute de l'auteur. Ce sont les événements qui se sont arrangés pour le livre, et non le livre pour les événements.
Quoi qu'il en soit, l'auteur ne songeait pas à tirer cet ouvrage de l'espèce de demi-jour où il était comme enseveli ; mais, averti qu'un libraire de la capitale se proposait de réimprimer son esquisse anonyme, il a cru devoir prévenir cette réimpression en mettant lui-même au jour son travail revu et en quelque sorte refait, précaution qui épargne un ennui à son amour-propre d'auteur, et au libraire susdit une mauvaise spéculation.
Plusieurs personnes distinguées qui, soit comme colons, soit comme fonctionnaires, ont été mêlées aux troubles de Saint-Domingue, ayant appris la prochaine publication de cet épisode, ont bien voulu communiquer spontanément à l'auteur des matériaux d'autant plus précieux qu'ils sont presque tous inédits, l'auteur leur en témoigne ici sa vive reconnaissance. Ces documents lui ont été singulièrement utiles pour rectifier ce que le récit du capitaine d'Auverney présentait d'incomplet sous le rapport de la couleur locale, et d'incertain relativement à la vérité historique.
Enfin, il doit encore prévenir les lecteurs que l'histoire de Bug-Jargal n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus étendu, qui devait être composé avec le titre de Contes sous la tente. L'auteur suppose que, pendant les guerres de la révolution, plusieurs officiers français conviennent entre eux d'occuper chacun à leur tour la longueur des nuits du bivouac par le récit de quelqu'une de leurs aventures. L'épisode que l'on publie ici faisait partie de cette série de narrations ; il peut en être détaché sans inconvénient ; et d'ailleurs l'ouvrage dont il devrait faire partie n'est point fini, ne le sera jamais, et ne vaut pas la peine de l'être.
Janvier 1826.
PRÉFACE DE 1832
En 1818, l'auteur de ce livre avait seize ans ; il paria qu'il écrirait un volume en quinze jours. Il fit Bug-Jargal. Seize ans, c'est l'âge où l'on parie pour tout et où l'on improvise sur tout.
Ce livre a donc été écrit deux ans avant Han d'Islande. Et quoique, sept ans plus tard, en 1825, l'auteur l'ait remanié et récrit en grande partie, il n'en est pas moins, et par le fond et par beaucoup de détails, le premier ouvrage de l'auteur.
Il demande pardon à ses lecteurs de les entretenir de détails si peu importants ; mais il a cru que le petit nombre de personnes qui aiment à classer par rang de taille et par ordre de naissance les œuvres d'un poète, si obscur qu'il soit, ne lui sauraient pas mauvais gré de leur donner l'âge de Bug-Jargal ; et, quant à lui, comme ces voyageurs qui se retournent au milieu de leur chemin et cherchent à découvrir encore dans les plis brumeux de l'horizon le lieu d'où ils sont partis, il a voulu donner ici un souvenir à cette époque de sérénité, d'audace et de confiance, où il abordait de front un si immense sujet, la révolte des noirs de Saint-Domingue en 1791, lutte de géants, trois mondes intéressés dans la question, l'Europe et l'Afrique pour combattants, l'Amérique pour champ de bataille.
24 mars 1832.
I
Quand vint le tour du capitaine Léopold d'Auverney, il ouvrit de grands yeux et avoua à ces messieurs qu'il ne connaissait réellement aucun événement de sa vie qui méritât de fixer leur attention.
– Mais, capitaine, lui dit le lieutenant Henri, vous avez pourtant, dit-on, voyagé et vu le monde. N'avez-vous pas visité les Antilles, l'Afrique et l'Italie, l'Espagne ? Ah ! capitaine, votre chien boiteux !
D'Auverney tressaillit, laissa tomber son cigare, et se retourna brusquement vers l'entrée de la tente, au moment ou un chien énorme accourait en boitant vers lui.
Le chien écrasa en passant le cigare du capitaine ; le capitaine n'y fit nulle attention.
Le chien lui lécha les pieds, le flatta avec sa queue, jappa, gambada de son mieux, puis vint se coucher devant lui. Le capitaine, ému, oppressé, le caressait machinalement de la main gauche, en détachant de l'autre la mentonnière de son casque, et répétait de temps en temps : – Te voilà. Rask ! te voilà ! – Enfin il s'écria : – Mais qui donc t'a ramené ?
– Avec votre permission, mon capitaine…
Depuis quelques minutes, le sergent Thadée avait soulevé le rideau de la tente, et se tenait debout, le bras droit enveloppé dans sa redingote, les larmes aux yeux, et contemplant en silence le dénouement de l'odyssée. Il hasarda à la fin ces paroles : Avec votre permission. mon capitaine… D'Auverney leva les yeux.
– C'est toi, Thad ; et comment diable as-tu pu ?… Pauvre chien ! je le croyais dans le camp anglais. Où donc l'as-tu trouvé ?
– Dieu merci ! vous m'en voyez, mon capitaine, aussi joyeux que monsieur votre neveu, quand vous lui faisiez décliner cornu, la corne ; cornu, de la corne…
– Mais dis-moi donc où tu l'as trouvé ?
– Je ne l'ai pas trouvé, mon capitaine, j'ai bien été le chercher.
Le capitaine se leva, et tendit la main au sergent ; mais la main du sergent resta enveloppée dans sa redingote. Le capitaine n'y prit point garde.
– C'est que, voyez-vous, mon capitaine, depuis que ce pauvre Rask s'est perdu, je me suis bien aperçu, avec votre permission, s'il vous plaît, qu'il vous manquait quelque chose. Pour tout vous dire, je crois que le soir où il ne vint pas, comme à l'ordinaire, partager mon pain de munition, peu s'en fallut que le vieux Thad ne se prît à pleurer comme un enfant. Mais non, Dieu merci, je n'ai pleuré que deux fois dans ma vie : la première, quand… le jour où… – Et le sergent regardait son maître avec inquiétude. – La seconde, lorsqu'il prit l'idée à ce drôle de Balthazar, caporal dans la septième demi-brigade, de me faire éplucher une botte d'oignons.
– Il me semble, Thadée, s'écria en riant Henri, que vous ne dites pas à quelle occasion vous pleurâtes pour la première fois.
– C'est sans doute, mon vieux, quand tu reçus l'accolade de La Tour d'Auvergne, premier grenadier de France ? demanda avec affection le capitaine, continuant à caresser le chien.
– Non, mon capitaine ; si le sergent Thadée a pu pleurer, ce n'a pu être, et vous en conviendrez, que le jour où il a crié feu sur Bug-Jargal, autrement dit Pierrot.
Un nuage se répandit sur tous les traits de d'Auverney. Il s'approcha vivement du sergent, et voulut lui serrer la main ; mais malgré un tel excès d'honneur, le vieux Thadée la retint sous sa capote.
– Oui, mon capitaine, continua Thadée, en reculant de quelques pas, tandis que d'Auverney fixait sur lui des regards plans d'une expression pénible ; oui, j'ai pleuré cette fois-là ; aussi, vraiment, il le méritait bien ! Il était noir, cela est vrai mais la poudre à canon est noire aussi, et…, et…
Le bon sergent aurait bien voulu achever honorablement sa bizarre comparaison. Il y avait peut-être quelque chose dans ce rapprochement qui plaisait à sa pensée ; mais il essaya inutilement de l'exprimer ; et après avoir plusieurs fois attaqué, pour ainsi dire, son idée dans tous les sens, comme un général d'armée qui échoue contre une place forte, il en leva brusquement le siège, et poursuivit sans prendre garde au sourire des jeunes officiers qui l'écoutaient :
– Dites, mon capitaine, vous souvient-il de ce pauvre nègre ; quand il arriva tout essoufflé, à l'instant même où ses dix camarades étaient là ? Vraiment, il avait bien fallu les lier. – C'était moi qui commandais. Et quand il les détacha lui-même pour reprendre leur place, quoiqu'ils ne le voulussent pas. Mais il fut inflexible. Oh ! quel homme ! c'était un vrai Gibraltar. Et puis, dites, mon capitaine ? quand il se tenait là, droit comme s'il allait entrer en danse, et son chien, le même Rask qui est ici, qui comprit ce qu'on allait lui faire, et qui me sauta à la gorge…
– Ordinairement, Thad, interrompit le capitaine, tu ne laissais point passer cet endroit de ton récit sans faire quelques caresses à Rask ; vois comme il te regarde.
– Vous avez raison, dit Thadée avec embarras ; il me regarde, ce pauvre Rask ; mais… la vieille Malagrida m'a dit que caresser de la main gauche porte malheur.
– Et pourquoi pas la main droite ? demanda d'Auverney avec surprise, et remarquant pour la première fois la main enveloppée dans la redingote, et la pâleur répandue sur le visage de Thad.
Le trouble du sergent parut redoubler.
– Avec votre permission, mon capitaine, c'est que… vous avez déjà un chien boiteux, je crains que vous ne finissiez par avoir aussi un sergent manchot.
Le capitaine s'élança de son siège.
– Comment ? quoi ? que dis-tu, mon vieux Thadée ? manchot ! – Voyons ton bras. Manchot, grand Dieu !
D'Auverney tremblait ; le sergent déroula lentement son manteau, et offrit aux yeux de son chef son bras enveloppé d'un mouchoir ensanglanté.
– Hé ! mon Dieu ! murmura le capitaine en soulevant le linge avec précaution. Mais dis-moi donc, mon ancien ?…
– Oh ! la chose est toute simple. Je vous ai dit que j'avais remarqué votre chagrin depuis que ces maudits Anglais nous avaient enlevé votre beau chien, ce pauvre Rask, le dogue de Bug… Il suffit. Je résolus aujourd'hui de le ramener, dût-il m'en coûter la vie, afin de souper ce soir de bon appétit. C'est pourquoi, après avoir recommandé à Mathelet, votre soldat, de bien brosser votre grand uniforme, parce que c'est demain jour de bataille. Je me suis esquivé tout doucement du camp, armé seulement de mon sabre ; et j'ai pris à travers les haies pour être plus tôt au camp des Anglais. Je n'étais pas encore aux premiers retranchements quand, avec votre permission, mon capitaine, dans un petit bois sur la gauche, j'ai vu un grand attroupement de soldats rouges. Je me suis avancé pour flairer ce que c'était, et, comme ils ne prenaient pas garde à moi, j'ai aperçu au milieu d'eux Rask attaché à un arbre, tandis que deux milords, nus jusqu'ici comme des païens, se donnaient sur les os de grands coups de poing qui faisaient autant de bruit que la grosse caisse d'une demi-brigade. C'étaient deux particuliers anglais, s'il vous plaît, qui se battaient en duel pour votre chien. Mais voilà Rask qui me voit, et qui donne un tel coup de collier que la corde casse, et que le drôle est en un clin d'œil sur mes trousses. Vous pensez bien que toute l'autre bande ne reste pas en arrière. Je m'enfonce dans le bois. Rask me suit. Plusieurs balles sifflent à mes oreilles. Rask aboyait ; mais heureusement ils ne pouvaient l'entendre à cause de leurs cris de French dog ! French dog ! comme si votre chien n'était pas un beau et bon chien de Saint-Domingue. N'importe, je traverse le hallier, et j'étais près d'en sortir quand deux rouges se présentent devant moi. Mon sabre me débarrasse de l'un, et m'aurait sans doute délivré de l'autre. si son pistolet n'eût été chargé à balle. Vous voyez mon bras droit. – N'importe ! French dog lui a sauté au cou, comme une ancienne connaissance, et je vous réponds que l'embrassement a été rude… l'Anglais est tombé étranglé. – Aussi pourquoi ce diable d'homme s'acharnait-il après moi, comme un pauvre après un séminariste ! Enfin, Thad est de retour au camp, et Rask aussi. Mon seul regret, c'est que le Bon Dieu n'ait pas voulu m'envoyer plutôt cela à la bataille de demain. – Voilà !
Les traits du vieux sergent s'étaient rembrunis à l'idée de n'avoir point eu sa blessure dans une bataille.
– Thadée !… cria le capitaine d'un ton irrité. Puis il ajouta plus doucement : – Comment es-tu fou à ce point de t'exposer ainsi. – pour un chien ?
– Ce n'était pas pour un chien, mon capitaine, c'était pour Rask.
Le visage de d'Auverney se radoucit tout à fait. Le sergent continua :
– Pour Rask, le dogue de Bug…
– Assez ! assez ! mon vieux Thad, cria le capitaine en mettant la main sur ses yeux. – Allons, ajouta-t-il après un court silence, appuie-toi sur moi, et viens à l'ambulance.
Thadée obéit après une résistance respectueuse. Le chien qui, pendant cette scène, avait à moitié rongé de joie la belle peau d'ours de son maître, se leva et les suivit tous deux.
II
Cet épisode avait vivement excité l'attention et la curiosité des joyeux conteurs. Le capitaine Léopold d'Auverney était un de ces hommes qui, sur quelque échelon que le hasard de la nature et le mouvement de la société les aient placés, inspirent toujours un certain respect mêlé d'intérêt. Il n'avait cependant peut-être rien de frappant au premier abord ; ses manières étaient froides, son regard indifférent. Le soleil des tropiques, en brunissant son visage, ne lui avait point donné cette vivacité de geste et de parole qui s'unit chez les créoles à une nonchalance souvent pleine de grâce. D'Auverney parlait peu, écoutait rarement, et se montrait sans cesse prêt à agir. Toujours le premier à cheval et le dernier sous la tente, il semblait chercher dans les fatigues corporelles une distraction à ses pensées. Ces pensées, qui avaient gravé leur triste sévérité dans les rides précoces de son front, n'étaient pas de celles dont on se débarrasse en les communiquant, ni de celles qui, dans une conversation frivole, se mêlent volontiers aux idées d'autrui. Léopold d'Auverney, dont les travaux de la guerre ne pouvaient rompre le corps, paraissait éprouver une fatigue insupportable dans ce que nous appelons les luttes d'esprit. Il fuyait les discussions comme il cherchait les batailles. Si quelquefois il se laissait entraîner à un débat de paroles, il prononçait trois ou quatre mots pleins de sens et de haute raison, puis, au moment de convaincre son adversaire, il s'arrêtait tout court, en disant : À quoi bon ? et sortait pour demander au commandant ce qu'on pourrait faire en attendant l'heure de la charge ou de l'assaut.
Ses camarades excusaient ses habitudes froides, réservées et taciturnes, parce qu'en toute occasion ils le trouvaient brave, bon et bienveillant. Il avait sauvé la vie de plusieurs d'entre eux au risque de la sienne, et l'on savait que s'il ouvrait rarement la bouche, sa bourse du moins n'était jamais fermée. On l'aimait dans l'armée, et on lui pardonnait même de se faire en quelque sorte vénérer.
Cependant il était jeune. On lui eût donné trente ans, et il était loin encore de les avoir. Quoiqu'il combattît déjà depuis un certain temps dans les rangs républicains, on ignorait ses aventures. Le seul être qui, avec Rask, pût lui arracher quelque vive démonstration d'attachement, le bon vieux sergent Thadée, qui était entré avec lui au corps, et ne le quittait pas, contait parfois vaguement quelques circonstances de sa vie. On savait que d'Auverney avait éprouvé de grands malheurs en Amérique ; que, s'étant marié à Saint-Domingue, il avait perdu sa femme et toute sa famille au milieu des massacres qui avaient marqué l'invasion de la révolution dans cette magnifique colonie. À cette époque de notre histoire, les infortunes de ce genre étaient si communes, qu'il s'était formé pour elles une espèce de pitié générale dans laquelle chacun prenait et apportait sa part. On plaignait donc le capitaine d'Auverney, moins pour les pertes qu'il avait souffertes que pour sa manière de les souffrir. C'est qu'en effet, à travers son indifférence glaciale, on voyait quelquefois les tressaillements d'une plaie incurable et intérieure.
Dès qu'une bataille commençait, son front redevenait serein. Il se montrait intrépide dans l'action comme s'il eût cherché à devenir général, et modeste après la victoire comme s'il n'eût voulu être que simple soldat. Ses camarades, en lui voyant ce dédain des honneurs et des grades ne comprenaient pas pourquoi, avant le combat il paraissait espérer quelque chose, et ne devinaient point que d'Auverney, de toutes les chances de la guerre, ne désirait que la mort.
Les représentants du peuple en mission à l'armée le nommèrent un jour chef de brigade sur le champ de bataille ; il refusa, parce qu'en ce séparant de la compagnie il aurait fallu quitter le sergent Thadée. Quelques jours après, il s'offrit pour conduire une expédition hasardeuse, et en revint, contre l'attente générale et contre son espérance. On l'entendit alors regretter le grade qu'il avait refusé : – Car, disait-il, puisque le canon ennemi m'épargne toujours, la guillotine, qui frappe tous ceux qui s'élèvent aurait peut-être voulu de moi.
III
Tel était l'homme sur le compte duquel s'engagea la conversation suivante quand il fut sorti de la tente.
– Je parierais, s'écria le lieutenant Henri en essuyant sa botte rouge, sur laquelle le chien avait laissé en passant une large tache de boue, je parierais que le capitaine ne donnerait pas la patte cassée de son chien pour ces dix paniers de madère que nous entrevîmes l'autre jour dans le grand fourgon du général.
– Chut ! chut ! dit gaiement l'aide de camp Paschal, ce serait un mauvais marché. Les paniers sont à présent vides, j'en sais quelque chose ; et, ajouta-t-il d'un air sérieux, trente bouteilles décachetées ne valent certainement pas, vous en conviendrez, lieutenant, la patte de ce pauvre chien, patte dont on pourrait, après tout, faire une poignée de sonnette.
L'assemblée se mit à rire du ton grave dont l'aide de camp prononçait ces dernières paroles. Le jeune officier des hussards basques, Alfred, qui seul n'avait pas ri, prit un air mécontent.
– Je ne vois pas, messieurs, ce qui peut prêter à la raillerie dans ce qui vient de se passer. Ce chien et ce sergent, que j'ai toujours vus auprès de d'Auverney depuis que je le connais, me semblent plutôt susceptibles de faire naître quelque intérêt. Enfin, cette scène…
Paschal, piqué et du mécontentement d'Alfred et de la bonne humeur des autres, l'interrompit.
– Cette scène est très sentimentale. Comment donc ! un chien retrouvé et un bras cassé !
– Capitaine Paschal, vous avez tort, dit Henri en jetant hors de la tente la bouteille qu'il venait de vider, ce Bug, autrement dit Pierrot, pique singulièrement ma curiosité.
Paschal, prêt à se fâcher, s'apaisa en remarquant que son verre, qu'il croyait vide, était plein. D'Auverney rentra ; il alla se rasseoir à sa place sans prononcer une parole. Son air était pensif, mais son visage était plus calme. Il paraissait si préoccupé, qu'il n'entendait rien de ce qui se disait autour de lui. Rask, qui l'avait suivi, se coucha à ses pieds en le regardant d'un air inquiet.
– Votre verre, capitaine d'Auverney. Goûtez de celui-ci.
– Oh ! grâce à Dieu, dit le capitaine, croyant répondre à la question de Paschal, la blessure n'est pas dangereuse, le bras n'est pas cassé.
Le respect involontaire que le capitaine inspirait à tous ses compagnons d'armes contint seul l'éclat de rire prêt à éclore sur les lèvres de Henri.
– Puisque vous n'êtes plus aussi inquiet de Thadée, dit-il, et que nous sommes convenus de raconter chacun une de nos aventures pour abréger cette nuit de bivouac, j'espère, mon cher ami, que vous voudrez bien remplir votre engagement, en nous disant l'histoire de votre chien boiteux et de Bug… je ne sais comment, autrement dit Pierrot, ce vrai Gibraltar !
À cette question, faite d'un ton moitié sérieux, moitié plaisant, d'Auverney n'aurait rien répondu, si tous n'eussent joint leurs instances à celles du lieutenant.
Il céda enfin à leurs prières.
– Je vais vous satisfaire, messieurs ; mais n'attendez que le récit d'une anecdote toute simple, dans laquelle je ne joue qu'un rôle très secondaire. Si l'attachement qui existe entre Thadée, Rask et moi vous a fait espérer quelque chose d'extraordinaire, je vous préviens que vous vous trompez. Je commence.
Alors il se fit un grand silence. Paschal vida d'un trait sa gourde d'eau-de-vie, et Henri s'enveloppa de la peau d'ours à demi rongée, pour se garantir du frais de la nuit, tandis qu'Alfred achevait de fredonner l'air galicien de mata-perros.
D'Auverney resta un moment rêveur, comme pour rappeler à son souvenir des événements depuis longtemps remplacés par d'autres ; enfin il prit la parole, lentement, presque à voix basse et avec des pauses fréquentes.
IV
Quoique né en France, j'ai été envoyé de bonne heure à Saint-Domingue, chez un de mes oncles, colon très riche, dont je devais épouser la fille.
Les habitations de mon oncle étaient voisines du fort Galifet, et ses plantations occupaient la majeure partie des plaines de l'Acul.
Cette malheureuse position, dont le détail vous semble sans doute offrir peu d'intérêt, a été l'une des premières causes des désastres et de la ruine totale de ma famille.
Huit cents nègres cultivaient les immenses domaines de mon oncle. Je vous avouerai que la triste condition des esclaves était encore aggravée par l'insensibilité de leur maître. Mon oncle était du nombre, heureusement assez restreint, de ces planteurs dont une longue habitude de despotisme absolu avait endurci le cœur. Accoutumé à se voir obéi au premier coup d'œil, la moindre hésitation de la part d'un esclave était punie des plus mauvais traitements, et souvent l'intercession de ses enfants ne servait qu'à accroître sa colère. Nous étions donc le plus souvent obligés de nous borner à soulager en secret des maux que nous ne pouvions prévenir.
– Comment ! mais voilà des phrases ! dit Henri à demi-voix, en se penchant vers son voisin. Allons, j'espère que le capitaine ne laissera point passer les malheurs des ci-devant noirs sans quelque petite dissertation sur les devoirs qu'impose l'humanité, et caetera. On n'en eût pas été quitte à moins au club Massiac.[1]
– Je vous remercie, Henri, de m'épargner un ridicule, dit froidement d'Auverney, qui l'avait entendu.
Il poursuivit.
– Entre tous ces esclaves, un seul avait trouvé grâce devant mon oncle. C'était un nain espagnol, griffe[2]de couleur, qui lui avait été donné comme un sapajou par lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque. Mon oncle, qui, ayant longtemps résidé au Brésil, y avait contracté les habitudes du faste portugais, aimait à s'environner chez lui d'un appareil qui répondît à sa richesse. De nombreux esclaves, dressés au service comme des domestiques européens, donnaient à sa maison un éclat en quelque sorte seigneurial. Pour que rien n'y manquât, il avait fait de l'esclave de lord Effingham son fou, à l'imitation de ces anciens princes féodaux qui avaient des bouffons dans leurs cours. Il faut dire que le choix était singulièrement heureux, le griffe Habibrah (c'était son nom) était un de ces êtres dont la conformation physique est si étrange qu'ils paraîtraient des monstres, s'ils ne faisaient rire. Ce nain hideux était gros, court, ventru, et se mouvait avec une rapidité singulière sur deux jambes grêles et fluettes, qui, lorsqu'il s'asseyait, se repliaient sous lui comme les bras d'une araignée. Sa tête énorme. lourdement enfoncée entre ses épaules, hérissée d'une laine rousse et crépue, était accompagnée de deux oreilles si larges, que ses camarades avaient coutume de dire qu'Habibrah s'en servait pour essuyer ses yeux quand il pleurait. Son visage était toujours une grimace, et n'était jamais la même ; bizarre mobilité des traits, qui du moins donnait à sa laideur l'avantage de la variété. Mon oncle l'aimait à cause de sa difformité rare et de sa gaieté inaltérable. Habibrah était son favori. Tandis que les autres esclaves étaient rudement accablés de travail, Habibrah n'avait d'autre soin que de porter derrière le maître un large éventail de plumes d'oiseaux de paradis, pour chasser les moustiques et les bigailles. Mon oncle le faisait manger à ses pieds sur une natte de jonc, et lui donnait toujours sur sa propre assiette quelque reste de son mets de prédilection. Aussi Habibrah se montrait-il reconnaissant de tant de bontés ; il n'usait de ses privilèges de bouffon, de son droit de tout faire et de tout dire, que pour divertir son maître par mille folles paroles entremêlées de contorsions, et au moindre signe de mon oncle il accourait avec l'agilité d'un singe et la soumission d'un chien.
Je n'aimais pas cet esclave. Il y avait quelque chose de trop rampant dans sa servilité ; et si l'esclavage ne déshonore pas, la domesticité avilit. J'éprouvais un sentiment de pitié bienveillante pour ces malheureux nègres que je voyais travailler tout le jour sans que presque aucun vêtement cachât leur chaîne ; mais ce baladin difforme, cet esclave fainéant, avec ses ridicules habits bariolés de galons et semés de grelots, ne m'inspirait que du mépris. D'ailleurs le nain n'usait pas en bon frère du crédit que ses bassesses lui avaient donné sur le patron commun. Jamais il n'avait demandé une grâce à un maître qui infligeait si souvent des châtiments ; et on l'entendit même un jour, se croyant seul avec mon oncle, l'exhorter à redoubler de sévérité envers ces infortunés camarades. Les autres esclaves cependant, qui auraient dû le voir avec défiance et jalousie, ne paraissaient pas le haïr. Il leur inspirait une sorte de crainte respectueuse qui ne ressemblait point à de l'amitié ; et quand ils le voyaient passer au milieu de leurs cases avec son grand bonnet pointu orné de sonnettes, sur lequel il avait tracé des figures bizarres en encre rouge, ils se disaient entre eux à voix basse : C'est un obi[3] !
Ces détails, sur lesquels j'arrête en ce moment votre attention, messieurs, m'occupaient fort peu alors. Tout entier aux pures émotions d'un amour que rien ne semblait devoir traverser, d'un amour éprouvé et partagé depuis l'enfance par la femme qui m'était destinée, je n'accordais que des regards fort distraits à tout ce qui n'était pas Marie. Accoutumé dès l'âge le plus tendre à considérer comme ma future épouse celle qui était déjà en quelque sorte ma sœur, il s'était formé entre nous une tendresse dont on ne comprendrait pas encore la nature, si je disais que notre amour était un mélange de dévouement fraternel, d'exaltation passionnée et de confiance conjugale. Peu d'hommes ont coulé plus heureusement que moi leurs premières années ; peu d'hommes ont senti leur âme s'épanouir à la vie sous un plus beau ciel, dans un accord plus délicieux de bonheur pour le présent et d'espérance pour l'avenir. Entouré presque en naissant de tous les contentements de la richesse, de tous les privilèges du rang dans un pays où la couleur suffisait pour le donner, passant mes journées près de l'être qui avait tout mon amour, voyant cet amour favorisé de nos parents, qui seuls auraient pu l'entraver, et tout cela dans l'âge où le sang bouillonne, dans une contrée où l'été est éternel, où la nature est admirable ; en fallait-il plus pour me donner une foi aveugle dans mon heureuse étoile ? En faut-il plus pour me donner le droit de dire que peu d'hommes ont coulé plus heureusement que moi leurs premières années ?
Le capitaine s'arrêta un moment, comme si la voix lui eût manqué pour ces souvenirs de bonheur. Puis il poursuivit avec un accent profondément triste :
– Il est vrai que j'ai maintenant de plus le droit d'ajouter que nul ne coulera plus déplorablement ses derniers jours.
Et comme s'il eût repris de la force dans le sentiment de son malheur, il continua d'une voix assurée.
V
C'est au milieu de ces illusions et de ces espérances aveugles que j'atteignais ma vingtième année. Elle devait être accomplie au mois d'août 1791, et mon oncle avait fixé cette époque pour mon union avec Marie. Vous comprenez aisément que la pensée d'un honneur si prochain absorbait toutes mes facultés, et combien doit être vague le souvenir qui me reste des débats politiques dont à cette époque la colonie était déjà agitée depuis deux ans. Je ne vous entretiendrai donc ni du comte de Peinier, ni de M. de Blanchelande, ni de ce malheureux colonel de Mauduit dont la fin fut si tragique. Je ne vous peindrai point les rivalités de l'assemblée provinciale du nord, et de cette assemblée coloniale qui prit le titre d'assemblée générale, trouvant que le mot coloniale sentait l'esclavage. Ces misères, qui ont bouleversé alors tous les esprits, n'offrent plus maintenant d'intérêt que par les désastres qu'elles ont produits. Pour moi, dans cette jalousie mutuelle qui divisait le Cap et le Port-au-Prince, si j'avais une opinion, ce devait être nécessairement en faveur du Cap, dont nous habitions le territoire, et de l'assemblée provinciale, dont mon oncle était membre.
Il m'arriva une seule fois de prendre une part un peu vive à un débat sur les affaires du jour. C'était à l'occasion de ce désastreux décret du 15 mai 1791, par lequel l'Assemblée nationale de France admettait les hommes de couleur libres à l'égal partage des droits politiques avec les blancs. Dans un bal donné à la ville du Cap par le gouverneur, plusieurs jeunes colons parlaient avec véhémence sur cette loi, qui blessait si cruellement l'amour-propre, peut-être fondé, des blancs. Je ne m'étais point encore mêlé à la conversation, lorsque je vis s'approcher du groupe un riche planteur que les blancs admettaient difficilement parmi eux, et dont la couleur équivoque faisait suspecter l'origine. Je m'avançai brusquement vers cet homme en lui disant à voix haute : – Passez outre, monsieur ; il se dit ici des choses désagréables pour vous, qui avez du sang mêlé dans les veines. – Cette imputation l'irrita au point qu'il m'appela en duel. Nous fûmes tous deux blessés. J'avais eu tort, je l'avoue, de le provoquer ; mais il est probable que ce qu'on appelle le préjugé de la couleur n'eût pas suffi seul pour m'y pousser ; cet homme avait depuis quelque temps l'audace de lever les yeux jusqu'à ma cousine, et au moment où je l'humiliai d'une manière si inattendue, il venait de danser avec elle.
Quoi qu'il en fût, je voyais s'avancer avec ivresse le moment où je posséderais Marie, et je demeurais étranger à l'effervescence toujours croissante qui faisait bouillonner toutes les têtes autour de moi. Les yeux fixés sur mon bonheur qui s'approchait, je n'apercevais pas le nuage effrayant qui déjà couvrait presque tous les points de notre horizon politique, et qui devait, en éclatant, déraciner toutes les existences. Ce n'est pas que les esprits même les plus prompts à s'alarmer, s'attendissent sérieusement dès lors à la révolte des esclaves, on méprisait trop cette classe pour la craindre ; mais il existait seulement entre les blancs et les mulâtres libres assez de haine pour que ce volcan si longtemps comprimé bouleversât toute la colonie au moment redouté où il se déchirerait.
Dans les premiers jours de ce mois d'août, si ardemment appelé de tous mes vœux, un incident étrange vint mêler une inquiétude imprévue à mes tranquilles espérances.
VI
Mon oncle avait fait construire, sur les bords d'une jolie rivière qui baignait ses plantations, un petit pavillon de branchages, entouré d'un massif d'arbres épais, où Marie venait tous les jours respirer la douceur de ces brises de mer qui, pendant les mois les plus brûlants de l'année, soufflent régulièrement à Saint-Domingue, depuis le matin jusqu'au soir, et dont la fraîcheur augmente ou diminue avec la chaleur même du jour.
J'avais soin d'orner moi-même tous les matins cette retraite des plus belles fleurs que je pouvais cueillir.
Un jour Marie accourt à moi tout effrayée. Elle était entrée comme de coutume dans son cabinet de verdure, et là elle avait vu, avec une surprise mêlée de terreur, toutes les fleurs dont je l'avais tapissé le matin arrachées et foulées aux pieds ; un bouquet de soucis sauvages fraîchement cueillis était déposé à la place où elle avait coutume de s'asseoir. Elle n'était pas encore revenue de sa stupeur, qu'elle avait entendu les sons d'une guitare sortir du milieu du taillis même qui environnait le pavillon ; puis une voix, qui n'était pas la mienne, avait commencé à chanter doucement une chanson qui lui avait paru espagnole, et dans laquelle son trouble, et sans doute aussi quelque pudeur de vierge, l'avaient empêchée de comprendre autre chose que son nom, fréquemment répété. Alors elle avait eu recours à une fuite précipitée, à laquelle heureusement il n'avait point été mis d'obstacle.
Ce récit me transporta d'indignation et de jalousie. Mes premières conjectures s'arrêtèrent sur le sang-mêlé libre avec qui j'avais eu récemment une altercation ; mais, dans la perplexité où j'étais jeté, je résolus de ne rien faire légèrement. Je rassurai la pauvre Marie, et je me promis de veiller sans relâche sur elle, jusqu'au moment prochain où il me serait permis de la protéger encore de plus près.