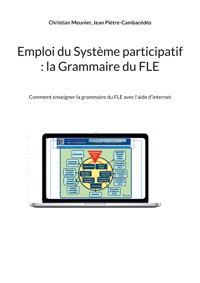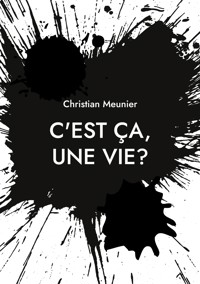
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un jour, un grand coup de pied vous jette dans la vie, et alors, il ne vous reste plus qu'à vous débrouiller pour vivre, parfois survivre. Pour moi, c'est le 8 juin 1947 que tout a commencé. Me voilà maintenant âgé de 76 ans. Je ne sais pas combien de temps me reste à vivre sur cette terre qui se déglingue.. Sans avoir mené une vie comme Napoléon, ni comme Landru, ou Monsieur Duchmol, j'estime avoir vécu de quoi intéresser une lectrice ou un lecteur, d'abord les membres de ma famille, mais aussi tous mes collègues, étudiantes et étudiants qui ont eu affaire à moi, et m'ont apprécié, ou détesté, qui sait? Et peut-être vous ? Oui, vous! Sans être une vie aventureuse, ce fut une suite d'événements pleins de surprises. Si vous voulez savoir lesquels, suivez-moi. A la fin, vous vous demandez sans doute vous aussi: "C'est ça, une vie?" Et vous pourrez bien sûr la comparer à la vôtre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des Matières
1 Paris juin 1947
1.1 Il est né le divin enfant !
1.2 Où ai-je donc atterri ?
1.3 Les deux familles d’origine
1.4 Retrouvons le jeune couple à Paris
2 Nice 1947
2.1 L’hôtel de la rue Reine Jeanne
3 Rasta! 1954
3.1 Rasta# : allons occuper l’Allemagne
4 Nice, deuxième épisode
4.1 Retour à Nice
4.2 Les vacances
4.3 Départ pour l’Algérie
5 Alger la blanche
5.1 Tous à Alger !
5.2 La villa 3 rue Mozart
5.3 L’école de la rue Darwin
5.4 L’année scolaire 1956-1957
5.5 L’Année 1957 / 1958
5.5.1 Monsieur Riche
5.5.2 Saint-Paul, Sainte Rita
5.5.3 Et encore un garçon
5.5.4 La place de l’église Saint-Paul / Sainte-Rita
5.6 Le 13 mai 1958
5.6.1 Les événements
5.6.2 Le Général de Gaulle à Alger : « Je vous ai compris !»
5.7 La communion solennelle
5.8 Vacances à Nice
5.9 L’année de la sixième
5.9.1 Le Champ de Manœuvre
5.9.2 Madame Tonnelier
5.9.3 La Machine à Laver Bendix
5.9.4 Madame Post
5.9.5 Fin de l’année scolaire 1958 - 1959
5.10 Philippe nous quitte
5.11 Notre dernière année en Algérie
5.11.1 Les événements
5.11.2 Nous, dans la tourmente
5.11.3 l’El-Djezaïr, de la Compagnie de Navigation Mixte
6 Aix-en-Provence
6.1 Le Dauphin
6.2 L’École Militaire Préparatoire d’Aix-en-Provence
6.2.1 Origine des élèves
6.2.2 L’organisation des cours
6.2.3 Occuper les élèves
6.3 La classe de quatrième
6.3.1 Les enseignants
6.3.2 Les faits marquants
6.3.3 Les événements extra-scolaires
6.4 Les vacances à Nice
6.4.1 L’aller vers Nice
6.4.2 Le retour à Aix-en-Provence
6.5 L’année scolaire 1961 / 62
6.5.1 Le corps enseignant
6.5.2 Mon premier diplôme
6.5.3 En dehors du cours
6.5.4 La fin de la guerre d’Algérie
6.5.5 Les vacances
6.6 L’année scolaire 1962 / 1963
6.6.1 Le corps enseignant
6.6.2 Les événements parallèles
6.6.3 Et revoici les vacances : le camp de la Coume-Ouarnède
6.6.3.1 L’œuvre de René Bonnardel
6.6.3.2 Le camp de base situé au cœur du massif d’Arbois
6.6.3.3 L’expédition
6.6.3.4 Les dangers qui nous guettent
6.6.4 Et maintenant, les vacances en famille
6.7 L’année scolaire 1963 / 1964
6.7.1 Le personnel enseignant
6.7.2 Les faits marquants
6.7.2.1 L’arrivée du colonel Chevillote
6.7.2.2 Villelaure
6.7.2.1 Le dernier premier bac
6.7.3 La deuxième expédition de la Coume-Ouarnède
6.7.3.1 Une amitié se construit
6.7.3.2 Un journaliste en difficultés
6.7.3.3 Faire pipi, c’est dangereux
6.7.3.4 Résultats de la campagne
6.7.4 Les vacances dans la famille, à Nice
6.8 L’année scolaire 1964 / 1965
6.8.1 Le personnel enseignant
6.8.2 Les événements principaux
6.8.2.1 Histoires de grades
6.8.2.2 Le travail scolaire
6.8.3 L’arrivée des filles
6.9 Fin de l’épisode de l’EMP
7 L’Université AIX-MARSEILLE I
7.1 Premiers contacts avec l’Université Aix-Marseille I
8 L’inscription comme étudiant en lettres modernes
8.1.1 Les bâtiments de la fac
8.1.2 Les étudiantes et étudiants
8.1.3 Les enseignantes et enseignants
8.1.4 Les examens
8.1.5 Les vacances
8.2 La première année de licence d’allemand (1966/67)
8.2.1 Les cours
8.2.2 Séjour travaillé en Allemagne
8.2.3 Les vraies vacances
8.3 La deuxième année de licence d’allemand (1967/68)
8.3.1 La routine des cours
8.3.2 Le jumelage Aix-en-Provence / Tübingen
8.3.3 Francis en chasse
8.3.4 L’année terrible 1967/1968
8.3.5 Le voyage des potes
8.3.6 Tübingen
8.3.7 Retour à Aix
8.3.8 Amis pour la vie ?
8.3.9 Amour, toujours
8.3.10 Comment on devient licencié d’allemand
8.4 Nous voilà lecteurs de français en Allemagne
8.4.1 Trèves / Sarrebruck
8.4.2 La ville de Trèves
8.4.3 La ville de Sarrebruck
8.4.4 Patatras !
8.4.5 Les vacances de Noël
8.4.6 Carnaval à Sarrebruck
8.4.6.1 A la recherche de partenaires
8.4.6.2 A la découverte de Maria
8.4.6.3 La famille P*** de Bad-Münstereifel
8.4.6.4 L’emploi du temps de la famille
8.4.6.5 La fin du séjour
8.4.7 Le Retour à Aix
8.4.7.1 Le travail à la poste
8.4.7.2 De la poste à l’université
8.4.7.3 Maria à Aix-en-Provence
8.4.7.4 La maîtrise
9 L’épisode de Frévent
9.1 L’installation chez Madame Lambert
9.2 Le collège de Frévent
9.3 La vie en dehors du travail
9.4 Préparons notre avenir
9.5 Adieu Frévent !
9.6 L’hôtel de la rue Lauriston
10 Et un séjour au Tchad
10.1 Changement de décor
10.2 Le lycée Ahmed Mangué
10.2.1 Les bâtiments
10.2.2 Les collègues
10.2.3 Les élèves
10.2.4 Transformation de la bibliothèque des enseignants
10.2.5 L’importance d’un boy
10.2.6 Contacts entre collègues
10.3 L’emploi du temps quotidien
10.4 Les vacances à Bangui
10.4.1 Voyage Sarh / Bangui
10.4.2 Allons voir les Pygmées
10.4.3 Rencontre avec la voiture de Bokassa
10.5 Les grandes vacances 1972
11 Et une nouvelle année au Tchad
11.1 Les modifications de la deuxième année
11.2 Quelques expériences pédagogiques
11.3 Les vacances de Noël 1973
11.3.1 La deux chevaux
11.3.2 Le voyage au Nord-Cameroun
11.3.3 Les problèmes de santé des Tchadiens
11.3.3.1 Les Tchadiens souffrent de plusieurs sortes de maladies
11.3.3.2 Que faire en cas de maladie ?
11.3.3.3 La fin de l’année scolaire
12 Bocholt / Rhede
12.1 Josef P***
12.2 Le lycée Euregio
12.2.1 Les élèves
12.2.2 Les collègues
12.2.2.1 Les deux bonnes-sœurs
12.2.2.2 Les collègues enseignants de français
12.2.2.3 Le pauvre Monsieur Beron
12.2.2.4 Notre directeur : Monsieur Schneider
12.2.3 Les principaux événements de l’année 1973 / 1974
12.2.3.1 Le travail avec les élèves
12.2.3.2 Création d’une bibliothèque
12.2.3.3 Voyage de classe
12.2.3.4 La descendance montre le bout de son nez
12.2.3.5 Les vacances
12.2.3.6 Nous devenons parents
12.2.3.7 Les vacances 1975
12.2.3.8 Préparons-nous à quitter Bocholt / Rhede
13 Berlin
13.1 Le nouvel appartement
13.2 Maria et les problèmes de nationalité
13.3 Mes débuts à l’université
13.4 Comment faire partie d’une famille
13.5 J’obtiens un poste définitif
13.6 En quoi consiste notre travail
13.7 Voilà Dominique
13.8 Je deviens Allemand
13.9 Les choses se gâtent
13.10 Le retour
13.11 L’accident de Papa
13.12 Retour à Berlin. Le divorce
13.13 Bilan du temps avec Maria
14 Sabine
14.1 La famille H***
14.2 Les débuts du couple
14.3 La naissance de Stefanie
14.4 Schönhauser-Straße 21
14.5 L’accident : 10 décembre 1984
14.6 Mon père nous quitte
14.7 Le mariage avec Sabine
14.8 Montons dans le bateau
14.8.1 L’école de voile
14.8.2 Un petit tour avec l’UCPA
14.8.3 Le permis pour bateau à moteur
14.8.4 Vacances et plongée
14.9 Pratiquons le sport
14.9.1 Faisons du judo
14.9.2 Marathons
14.10 Mon travail à l’université
14.11 Notre vie
14.12 Oma (=Mémé) H***
14.12.1 Ses origines
14.12.2 Ses débuts à Berlin
14.12.3 L’Opération
14.12.4 L’espoir d’amélioration
14.13 Sauve qui peut ! Voilà la Cosaque
14.13.1 La Préhistoire
14.13.2 La fin du couple
14.13.3 Le jugement
14.13.4 Après le jugement
14.13.5 Conquête de la rue et d’endroits stratégique
14.13.6 Premiers signes tangibles de la maladie
14.13.7 La maladie progresse
14.13.8 L’université est sollicitée
14.13.9 La crise
14.13.10 Dernière incursion en territoire ennemi
14.13.11 La fin de mon mariage
14.13.12 La chute
14.13.12.1 Les causes de la maladie d’après les médecins indépendants
14.13.12.2 La maladie pour Barmenia
14.13.12.3 La maladie pour la BfA
14.13.13 Le sursaut
15 Marie-Françoise : retour en Provence
15.1 Mes trois enfants
15.2 Nos mères
15.2.1 Suzanne
15.2.1.1 Suzanne se casse la jambe
15.2.1.2 Bilan d’une expérience avec quelques hôpitaux marseillais
15.2.2 Joséphine
15.2.2.1 Les débuts du problème
15.2.2.2 Le déménagement
15.2.2.3 L’entrée à Bonneveine
15.2.2.4 Enfin, la nouvelle résidence
15.2.2.4.1 La nouvelle chambre dans la nouvelle résidence
15.2.2.4.2 Libérer l’appartement
15.2.2.4.3 La journée type à la maison de retraite
15.2.2.4.4 Le personnel
15.2.2.4.5 Le trou de la sécu
15.2.2.4.6 Les résidentes et leur famille
15.2.2.4.7 Chute et col du fémur
15.2.2.4.8 Le stimulateur cardiaque
15.2.2.4.9 Les derniers jours
15.2.2.4.10 L’empreinte de Maman
16 Après la tempête
16.1 Les dernières vagues
16.2 Les débuts de la retraite
16.2.1 Les livres de grammaire
16.2.2 Les romans
16.3 Les voyages
16.4 On déménage
16.5 La maladie
16.5.1 L’opération du Dr Laurans Renaud 16/04/2010
16.5.2 L’opération de CLAIRVAL (du 20/06 au 01/07/2017)
16.5.2.1 Les faits :
16.5.2.2 Quelques dates et documents
17 La fin des haricots
17.1 La situation actuelle
17.2 Où va-t-on ?
17.3 Que faire, alors ?
18 Conclusion
19 Table des Matières
1 Paris juin 1947
1.1 Il est né le divin enfant !
Imaginez un instant que nous sommes le huit juin 1947, et que vous êtes installé, bien tranquillement, au chaud dans le ventre de votre mère. C’est justement ce qui m’est arrivé, à moi. La scène se passe dans une salle d’accouchement de l’Hôpital Boucicaut, dans le 15ème arrondissement de Paris, un service qui a été fermé en 2000, ses services ayant été intégrés à l'Hôpital européen Georges-Pompidou. Il est 18h30, la journée tire à sa fin, et puis voilà que l’on essaie tout à coup, par surprise, de m’expulser de mon paradis. J’ai fait des pieds et des mains pour me cramponner à cette enveloppe dans laquelle je baignais depuis plusieurs mois.
Les gens qui s’affairent à l’extérieur, et qui essaient de provoquer ma sortie, s’il le faut contre ma volonté, ont fini par en avoir assez de ma résistance. Je ne suis encore personne, comme qui dirait un « non-encore-né », et j’essaie d’échapper à ces spécialistes de l’expulsion par des moyens médicaux, des gens rompus à toutes sortes de techniques. Bien sûr, je n’ai aucune expérience, et je ne fais pas le poids face à ces gens qui non seulement connaissent tous les trucs, mais ont en outre la supériorité du nombre. Et de plus, ils disposent d’un nombre imposant d’outils et de produits dont ils vont faire usage pour m’obliger à sortir du ventre qui m’abrite.
Ce n’est pas comme à Tahiti, où les voyageurs qui arrivent en avion sont accueillis par de jolies femmes chantant des airs accueillants, ce qui fait qu’ils sentent qu’ils sont les bienvenus.
En revanche, ici, le comité d’accueil ne me donne pas envie de sortir. Et comme les opérateurs en ont assez d’être nargués par un nourrisson, lequel ne veut pas comprendre que c’est tellement mieux d’être dehors, ils vont se résoudre à utiliser des outils pour augmenter leurs chances d’aller me chercher. Et si on utilisait des forceps, une ventouse, une cuillère, voire une spatule pour aider à l’expulsion ? Ce jour-là, les spécialistes se sont décidés pour les forceps et, saisissant délicatement mon crâne de rebelle, le spécialiste réussit à m’extraire de force. Sur mon crâne, à hauteur du front, au-dessus de mon œil gauche, on sent encore, et cela plus de 75 ans après, lorsque l’on passe l’index dessus, la présence d’une trace : une légère rainure dans l’os du front, au-dessus de l’œil gauche dirigée de haut en bas, due à l’intervention un tantinet brutale du spécialiste, qui témoigne de cette opération mémorable aujourd’hui encore.
C’est alors que peut commencer la deuxième phase du spectacle : voilà bébé dehors. La maman va pouvoir le prendre dans ses bras, les larmes d’émotion vont pouvoir couler.
Le père n’est pas encore là car à cette époque, les paternels n’étaient pas admis dans la salle d’accouchement. Il faut dire que bon nombre d’entre eux avaient eu la mauvaise idée, dans des cas où l’accouchement avait lieu sur le chemin de l’hôpital dans le taxi, de s’évanouir. Et donc, lorsque le taxi arrivait à la maternité, le chauffeur se retrouvait avec une parturiente à peine libérée, un bébé dont il fallait s’occuper et, en outre, un jeune père dans un état lamentable. Pour s’éviter tout problème supplémentaire, les équipes chargées de l’accouchement préfèrent donc renoncer à la présence douteuse du père capable de s’écrouler à tout moment.
Enfin, me voilà maintenant investi du titre de numéro 1 de ma génération, premier (et pour l’instant seul) héritier des titulaires du nom de Meunier de la nichée à venir.
1.2 Où ai-je donc atterri ?
Lorsqu’un enfant débarque en ce bas monde, surtout s’il est le premier de la couvée, il déclenche un certain nombre de réactions. D’abord, tout le monde se déplace d’un cran sur l’arbre généalogique : une femme devient mère, un homme prend le titre de père. Quant à leurs parents respectifs, ils deviennent grands-parents. Certains prennent ce titre pour la première fois, d’autres ne font qu’ajouter un bâton dans une liste qui en comporte déjà un certain nombre.
Pour mes parents, qui viennent d’obtenir ce statut par ma naissance, c’est une forme de révolution qui les a unis encore plus, rendus fiers, qui leur a donné de l’importance puisqu’ils sont désormais responsables en commun d’un petit être sans défense, et qui ne sait encore rien faire sinon téter sa mère et faire dans ses couches. On peut s’interroger sur le potentiel qui repose encore dans ce petit garçon, car je dispose d’un sexe, même si on n’en n’a pas encore parlé. A priori, quand on pense à tout ce que peut encore devenir un nouveau-né, rien ne semble impossible. Nul ne sait encore si je vais devenir un artiste, un savant, un sombre crétin, un tueur en série ou un enseignant à l’Université libre de Berlin, ce qui sera un jour vraiment mon cas (les autres possibilités, je les ai ignorées).
Mes parents, Joséphine Pisoni et Roger Meunier, s’étaient mariés en juillet 1946, après la fin de la guerre. Ma mère travaillait alors comme vendeuse dans une parfumerie située en face du lycée Masséna, celui-là même où mon père avait fait ses études secondaires. C’est en traversant la rue, en tant qu’élève cherchant un cadeau pour l’anniversaire de sa mère, Lucie Meunier née Maublanc, qu’il avait remarqué cette jeune fille brune et ma foi jolie, et qu’il était tombé amoureux. Apparemment, il ne l’avait pas laissée indifférente, puisque Cupidon décocha une deuxième flèche qui fit mouche, elle aussi.
Ils auraient pu se marier peu de temps après si la guerre ne s’était pas abattue sur eux et sur le reste de l’Europe avant qu’ils aient eu le temps de réaliser les projets de rapprochement dont ils avaient rêvé.
1.3 Les deux familles d’origine
Les deux amoureux venaient de deux familles tout-à-fait différentes. Chez Roger, il était le seul enfant. Son père, Georges, était commandant, plus exactement, Chef de Bataillon. Il avait participé à la première guerre mondiale, avait été blessé deux fois à la tête en 1914, mais il était retourné chaque fois au combat dès qu’il l’avait pu. A cette époque, les gens faisaient leur devoir, malgré les obus, balles et autres projectiles. On ne cherchait pas à rendre visite à des psychologues, on ne souffrait pas de burn-out. Ou alors, on ne savait pas que l’on souffrait d’une telle maladie, ignorant son existence. Mon grand-père, devenu tel par ma naissance, parut prendre ses nouvelles fonctions avec plaisir. On le voit sur les photos de l’époque toujours digne, à côté de sa belle-fille pour laquelle il semble avoir des sentiments paternels. En revanche, la belle-mère, devenue ma grand-mère, ne semblait pas aussi satisfaite, ni du mariage, ni de ma naissance non plus.
Elle avait souffert de la première guerre mondiale d’une autre façon. Elle venait à peine de se marier en 1914 avec le capitaine Maurice Croin, instituteur dans le civil, lorsque celui-ci n’avait rien trouvé de mieux que d’aller se faire occire par les Allemands.
La jeune veuve de guerre éplorée avait en 1919 épousé le capitaine Georges Meunier, héros blessé et plusieurs fois décoré. Et neuf mois après, les deux jeunes-mariés purent cueillir le fruit de leur nuit de noces : la naissance de Roger. Il faut dire que Lucie avait mis plusieurs semaines à récupérer de cette nuit mémorable, si bien qu’elle décida de ne plus jamais tomber enceinte, une décision qui fut respectée à la lettre. Mais il y avait encore une autre personne importante : mon arrière-grandmère, Rosalie Louise Bottard, épouse Maublanc, née le 12 juin 1874, plus connue dans la famille sous le nom de « Mémé de Paris ». Elle habitait à l’époque de ma naissance dans un appartement de la rue de Javel, dans le XVème arrondissement de la capitale. Elle avait été, avec son mari Edmond Lucien Maublanc, à la tête d’une droguerie située au 54 rue Galande, dans le cinquième arrondissement. Elle avait essayé de s’installer à Nice pour voir plus souvent sa fille. Cependant, celle-ci montrant très peu d’enthousiasme à son égard, elle reprit le chemin de Paris, plus précisément de la rue de Javel. Elle put donc, à ma naissance, faire connaissance avec son premier arrière-petit-fils, avec moi, donc.
La famille de ma mère était tout-à-fait différente. Mes deux grands-parents, Laurent Pisoni et Catherine-Antoinette Cossu épouse Pisoni, venaient tous les deux de Sardaigne. Laurent venait de la capitale sarde, Cagliari. Orphelin de père et de mère dès son enfance, il avait été recueilli par l’église catholique locale et placé dans un orphelinat. Sa femme, qui était née à Sassari un 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, était le quinzième enfant de ses parents. Le père exerçait la profession de carabinier, et il avait du mal à remplir tous ces ventres affamés. A l’âge de 16 ans, elle prit avec un de ses frères plus âgé le bateau pour Nice pour tenter sa chance dans un pays plus riche. Elle y fit un jour la connaissance de Laurent, qui gagnait sa vie en écrivant des lettres pour ses compatriotes qui, souvent illettrés, rencontraient des difficultés à remplir des formulaires en français, voire à écrire à leur famille, demeurée en Sardaigne. Le téléphone portable n’existant pas encore, et le téléphone fixe étant peu répandu, il ne restait plus que l’écriture pour communiquer. Laurent et Catherine-Antoinette se marièrent à l’Église du Port. Ils eurent ensemble huit enfants : Antoine, dit Nini, Yolande, Jules, Reine, Marie, Béatrice, et les deux jumelles Yvonne et Joséphine, dite Fifi.
Deux disparurent rapidement, victimes d’une maladie dont on n’a pas gardé la trace : Reine et Marie. C’est Béatrice qui hérita du prénom de Marie.
Non seulement Catherine-Antoinette faisait les enfants, mais encore elle les lavait, les habillait, les nourrissait, s’occupait d’eux, et, cerise sur le gâteau, c’est elle qui travaillait pour permettre à sa petite famille de vivre, faisant le ménage dans de nombreux endroits. Le mari participait mollement à la vie de sa famille. Il allait parfois faire le docker dans le port de Nice, ou écrivait des lettres pour les autres. Mais surtout, il participait avec constance à la fabrication de ses enfants.
Un jour qu’elle en eut assez, Catherine-Antoinette prit ses enfants par la main et se rendit avec eux à Marseille, où elle trouva du travail dans une savonnerie. Au moins, le savon était désormais gratuit pour elle.
Mais Laurent la rejoignit rapidement C’est ainsi que Jules et Béatrice sont nés à Marseille. Finalement, la famille retourna à Nice, où naquirent encore les jumelles, ce qui mit un terme aux naissances nombreuses.
Les enfants Pisoni n’allèrent pas longtemps à l’école. Dès la fin du cours moyen deuxième année, chacun dut trouver un travail. Les deux garçons devinrent peintres en bâtiment. Yolande choisit le métier de coiffeuse. Marie (ex Béatrice), Yvonne et Yolande travaillèrent en usine (fabrication de sacs, mise en sachets de poudre de DDT). Ma future mère, Fifi, eut des problèmes avec les produits chimiques, qui attaquaient ses mains. Les doigts de la main droite durent être opérés. L’infirmière chargée de faire les pansements étant particulièrement maladroite, elle serra les bandelettes trop fort. Les doigts furent déformés, prenant vaguement la forme d’un « s » allongé. Quant à l’auriculaire de la main droite, la dernière phalange restant pliée, il prit la forme d’un « 7 ». La pauvre Fifi, qui avait honte de sa main, se débrouilla pour la cacher, l’entourant le plus souvent possible d’un mouchoir ou d’un foulard.
Fifi était d’un tempérament particulièrement paisible, et le travail ne lui faisait pas peur. L’épouse du propriétaire de l’usine, qui l’avait remarquée, lui fit savoir qu’elle allait ouvrir une parfumerie, en face du lycée Masséna, et qu’elle voulait la prendre comme vendeuse. Et c’est ainsi que la rencontre entre Roger, élève du lycée Masséna, et Fifi, qui travaillait juste en face, put avoir lieu.
Mais le mariage ne put pas avoir lieu tout de suite. En effet, la « drôle de guerre » venait de commencer, laquelle devait durer jusqu’au 10 mai 1940. L’Allemagne avait déjà envahi la Pologne, mais les armées alliées demeurèrent inactives jusqu’à cette date.
Nous avons relaté tous les détails de la guerre de Roger, son séjour dans le Cantal, sa déportation en Autriche au titre du STO à 30 km au sud de Vienne. Pour plus de détails, voyez Roger Books on Demand ISBN 978-2-322-22042 7. Il a été rapatrié le 24 août 45. La France ayant beaucoup de mal à payer tous ses soldats, elle promulgua une loi de « dégagement des cadres ». Roger en bénéficia et quitta l’armée le 6 juin 1946. C’est alors qu’il entra à la BNCI (Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie), l’ancêtre de la BNP, dont le siège se trouvait au Boulevard Victor Hugo, à Nice.
Il épousa sa fiancée le 19 juillet 1946.
Le couple vécut un certain temps chez les parents du jeune marié. La cohabitation entre la belle-mère et la belle-fille fut tout de suite problématique.
Déjà, avant le mariage, Lucie avait essayé de dissuader son fils de se marier avec Joséphine, lui précisant qu’il n’aurait rien s’il l’épousait. Elle a d’ailleurs tenu parole : lorsqu’elle a quitté ce monde, son fils n’avait eu droit à rien. Mais maintenant que la noce avait eu lieu, il fallait faire avec.
On comprendra que l’envoi de Roger par sa banque à Paris pour participer à un stage fut le bienvenu.
1.4 Retrouvons le jeune couple à Paris
Vous vous demandez sans doute ce que faisaient ces gens, qui vivaient habituellement à Nice, dans la capitale. Le futur papa était à l’époque sergent et avait dû faire un stage de longue durée à Paris. Le jeune couple avait élu domicile chez la tante de Roger, Cécile, la sœur de son père, qui était concierge Boulevard Raspail à Paris. La tante avait profit é de leur présence pour aller rendre visite avec son mari à leur fils Fernand, qui habitait en province et qu’ils voyaient trop rarement.
Le jeune couple avait occupé la loge du rez-de-chaussée. La porte d’entrée était fermée à clef par les concierges à 20 heures chaque soir.
Les visiteurs, qui ne possédaient pas cette clef, ne pouvaient entrer qu’en respectant la procédure du cordon : ils devaient sonner chez le concierge en disant très fort « Cordon, s’il-vousplaît ! », avant de dévoiler le nom de la personne chez qui ils se rendaient tout en précisant l’étage « Dupont, cinquième ! » La concierge, dans un demi-sommeil, tirait sur un cordon, lequel déclenchait l’ouverture de la porte d’entrée. Une fois le sonneur entré, la porte se refermait, et la concierge se rendormait. En juillet, la jeune famille rentra à Nice, abandonnant la cérémonie du cordon à la Tante Cécile et à son mari.
2 Nice 1947
2.1 L’hôtel de la rue Reine Jeanne
Comme Roger touchait maintenant un salaire, la petite famille fit ce que faisaient, à cette époque, la plupart des jeunes gens sans logement : elle se trouva une chambre dans un hôtel. La banque se trouvant au Boulevard Victor Hugo, situé au sud de la gare, ils allèrent dans un hôtel situé au nord de cette même gare.
Ce n’est pas si facile d’habiter un hôtel avec un nourrisson. En effet, le jeune couple devait pouvoir se nourrir et donc, cuisiner, et laver la vaisselle. Il devait aussi organiser la vie du bébé, veiller à ce qu’il soit propre, et particulièrement silencieux, pour ne pas gêner les autres clients. Enfin, il fallait s’occuper de la lessive, et surtout veiller à ce qu’elle sèche aussi discrètement que possible.
Cela ne se passait pas sans quelques frictions avec la direction. Heureusement, j’étais relativement silencieux et je dormais comme un petit ange.
L’hôtel ne payait pas de mine. Il occupait un immeuble, pas très large, de quatre étages.
La lessive posait les plus grands problèmes. Les bébés produisent des couches sales à la chaîne. A l’époque, il n’y avait pas de « Pampers » telles qu’on les connaît aujourd’hui. Il fallait se débarrasser des excréments, laver les couches, les faire sécher et, bien sûr, nettoyer le bébé, le talquer, lui mettre de la crème. Les couches, une fois lavées, devaient encore sécher. Où pouvait-on bien les étendre ? Sur un fil, dans la salle de bains commune ? Cela aurait gêné les autres clients. Dans la chambre ? Cela dérangeait les gens chargés du ménage. Il fallait donc se débrouiller avec un seau comme récipient, et une ficelle qu’il fallait déplacer selon les besoins.
Les propriétaires de l’hôtel, qui étaient responsables de l’organisation, devaient donc, selon les cas et les jours, se montrer sévères ou plus généreux, pour permettre une vie commune des clients et des employés.
Un autre problème vint apporter quelques soucis supplémentaires. Fin août 1948, Fifi était à nouveau enceinte. Comment continuer à habiter à l’hôtel, cette fois avec deux enfants ?
La France se trouvait à deux ans de la fin de la guerre, en pleine reconstruction. Mais par manque d’argent, les autorités avaient du mal à organiser une reconstruction rapide et efficace.
Le jeune couple déposa donc, à la mairie, une demande de logement, et attendit patiemment qu’elle débouche sur une solution.
Le sort leur offrit un moment de répit. En effet, Fifi ressentit des douleurs, et perdit du sang. Elle dut se rendre à l’hôpital où le médecin de garde diagnostiqua une fausse couche. Le bébé attendu ne verrait pas la lumière du jour.
Dans le livret de famille, on peut lire à la page →, au-dessous de Meunier, Christian, Antoine, Louis, une information sur un « Enfant présentement sans vie » (sexe masculin) le 21 janvier 1949. De nos jours, de tels enfants ont droit à un prénom. Ce n’était pas le cas à l’époque.
Quand ils parlaient de cet enfant, ce qui était fort rare, mes parents évoquaient le prénom de Gérard. Celui-ci fut réutilisé lors de la naissance du troisième, qui devenait ainsi le second enfant vivant. Quant au corps de l’enfant, il repose dans le caveau qu’avaient fait construire les grands parents pour eux-mêmes au cimetière de Caucade, à l’ouest de Nice. C’est cet enfant qui a inauguré le caveau, qu’il partage aujourd’hui avec ses grands-parents, même s’ils ne se sont jamais vus de leur vivant. Et puis, la mairie nous proposa un appartement dans un immeuble dont la construction venait de s’achever dans un quartier tranquille, situé dans la partie nord de la ville, nommé Saint-Barthélemy. L’immeuble, situé au numéro 49, portait le nom prometteur de «Palais Cyrille Besset». A l’époque, à la place du barbier, il y avait un marchand de vin. L’entrée étroite menait à un hall dans lequel se trouvaient le début de l’escalier, et un ascenseur. Ce dernier était un tantinet capricieux, et le concierge, qui en avait assez d’aller libérer les locataires coincés dans la cabine entre deux étages, avait tout simplement interdit aux locateurs de descendre par l’ascenseur. Il pensait ainsi diviser par deux les possibilités de blocage de la cabine.
L’appartement, un deux pièces avec cuisine et salle de bains, et une vue sur le sud, et donc sur la mer, dans le lointain, était situé au cinquième étage. Il n’était pas très spacieux, mais comme disent les Allemands, « klein, aber mein » (petit, mais à moi).
Je ne me souviens que de très peu de voisins : d’un Allemand qui faisait son jogging tous les matins, et de la famille Lucioni, qui habitait juste au-dessous de chez nous, au quatrième, et que nous avons quelques peu fréquentée. Monsieur Lucioni, originaire de Corse, avait collé sur sa porte une étiquette portant l’information « Luc de Corte, Journaliste ». En réalité, il s’était spécialisé dans les commissions pour nourrir ses cinq enfants, qu’il avait eus avec une femme nettement plus jeune que lui, mais qui l’adulait.
Il avait beaucoup à faire, étant donné que, par manque d’argent, il réglait les achats à crédit et que, lorsqu’il n’arrivait plus à payer, il était obligé d’aller faire ses achats plus loin, dans un autre magasin. Heureusement, il y avait beaucoup d’épiceries à Nice, et il avait encore un bon pas. Et il avait aussi une bellemère, concierge dans une maison se trouvant à côté de chez ma grand-mère, et qui, malgré son modeste salaire, soutenait sa fille financièrement. Elle aimait ses petits-enfants, mais elle détestait son gendre. Elle avait expliqué à sa fille comment se débarrasser de lui : « Quand il étend le linge à la fenêtre, et qu’il est obligé de se pencher, pousse-le bien fort ! »
Bien sûr, sa fille n’avait pas envie de le tuer, et ce d’autant moins qu’il travaillait pour la famille, même s’il ne gagnait pas d’argent. Et puis il recevait de l’argent, une aide financière de sa propre mère, qui vivait en Corse et envoyait souvent de modestes mandats qui faisaient pourtant du bien, là où ils tombaient.
Et puis, les aides commençaient à se créer : en 1945, une loi avait mis fin au monopole patronal et intégré les caisses d’allocations familiales dans la structure unifiée et centralisée de la Sécurité sociale. Le 22 août, une loi avait défini les quatre prestations de la branche famille de la sécurité sociale :
Les allocations familiales versées sans condition de ressources à partir du deuxième enfant ;
L’allocation de salaire unique versée dès le premier enfant ;
Les allocations prénatales ;
L’allocation de maternité.
Ainsi, en grattant les aides officielles, avec les dons venus de la famille et grâce aux cadeaux faits par l’église catholique Saint-Barthélemy, très proche, mais aussi en évitant de temps en temps de payer ses dettes, il réussit à maintenir sa famille à flot. Bref, la famille ne baignait pas dans le luxe ni la richesse, mais les enfants sont tous allés à l’école assez longtemps pour pouvoir acquérir un métier. Et puis, curieusement, à l’âge où la plupart des gens partent à la retraite, cet ennemi du travail a trouvé une place dans une firme distribuant les médicaments aux pharmacies de Nice et de la région. Pour autant que l’on puisse en juger, il a donné entière satisfaction à ses employeurs.
En face du Palais Cyrille Besset se trouvait une épicerie vendant un peu de tout. Elle était dirigée par Monsieur Ricci, un buveur de café invétéré. Lorsqu’il avait versé le breuvage dans sa tasse, il allait prendre les morceaux de sucre nécessaires dans une boîte destinée à la vente. Lorsque l’on inaugurait une boîte de sucre achetée chez Monsieur Ricci, il pouvait manquer jusqu’à cinq morceaux. La plupart des clients ne disposant pas de balance, ils ne pouvaient pas savoir si ce kilo de sucre pesait vraiment mille grammes. Beaucoup pensaient justement que la boîte devait contenir plus d’un kilo, et que c’était pour cela qu’on enlevait les morceaux en trop.
Si les clients étaient allés voir chez d’autres épiciers, ils auraient pu constater que les boîtes d’un kilo étaient toutes vendues pleines. Ce n’était pas pour rien que le dieu grec des commerçants, Hermès, était en même temps celui des voleurs.
Sans doute inspirés par le nouvel appartement, mes deux parents mirent en route le troisième enfant qui, lui, vint au monde le 1er avril 1950. Il naquit dans la Clinique Sainte Geneviève, et fut nommé Gérard, Luc, profitant ainsi, comme nous l’avons indiqué plus haut, du prénom laissé libre par le refus de naître du deuxième. Sa marraine était la sœur préférée de Maman, Marie (née Béatrice), et son parrain, le fils aîné de la sœur aînée de Maman, Yolande, qui s’appelait Lolo (en réalité, Laurent). Il était dans la marine nationale, et avait été élevé plus par notre grand-mère maternelle que par sa propre mère, qui était coiffeuse.
C’est alors que j’entrai à la maternelle Saint-Barthélemy, qui se trouvait très proche de la maison. Ainsi, Maman pouvait s’occuper de Gérard tandis que je m’amusais à la maternelle.
Cet établissement était situé entre l’école des garçons, à gauche, et celle des filles, à droite. Lorsque les garçons, quand ils jouaient dans la cour, voulaient voir les filles par-dessus la clôture, ils apercevaient les petits enfants de la maternelle. C’était une espèce de mur de Berlin exerçant la fonction de séparation des sexes.
Heureusement, l’école avait d’autres fonctions, et les institutrices ne manquaient ni d’idées, ni d’enthousiasme dans leur travail.
Je me souviens des séances de dessin, de la préparation à l’écriture, pendant laquelle on faisait des ronds et des bâtons verticaux, horizontaux ou penchés dans des cahiers au format A5, d’abord avec un crayon, plus tard avec un porte-plume et un encrier contenant la célèbre encre violette, réservée aux écoles.
Après le repas de midi, on avait droit à une sieste. Dans les maternelles d’aujourd’hui, on a des petits lits empilés dans une salle que l’on sort pour la sieste, et que l’on rangera après. Dans la maternelle Saint-Barthélemy, on s’assoyait comme pour faire des dessins, on croisait les bras que l’on couchait à plat sur la table, et on posait la tête dessus. Au bout d’un moment, on s’endormait assis, le dos arrondi. Je suppose qu’aujourd’hui, on critiquerait cette position que les enfants conservaient une bonne heure, en évoquant des déformations de la colonne vertébrale.
L’heure étant passée, les enfants pouvaient se remettre droits et reprendre leurs outils de travail. Les institutrices n’avaient rien à ranger, ni rien à conserver. Tout se rangeait de soi-même.
Les institutrices étaient sympathiques et savaient parler aux jeunes enfants. Je me souviens de Mlle d’Auvergne, qui s’occupait des plus grands, ou des moins petits, comme on voudra. J’étais là depuis quelque mois. Pendant une récréation, elle m’avait fait une remarque qui m’avait déplu. Or, à côté de chez ma grand-mère Lucie, venait de s’installer un ancien commissaire. Cette nouvelle m’avait fait réfléchir. J’ai donc annoncé à l’institutrice que j’allais la faire arrêter par le voisin de ma grand-mère et la faire mettre en prison, parce qu’elle avait tort de me reprocher quoi que ce soit. Cela l’avait fait rire : il semblait bien qu’on ne lui avait jamais fait cette menace. Je l’ai eu comme institutrice la troisième année de maternelle, mais jamais elle ne m’en a voulu, ce qui montre qu’elle avait de l’humour.
Mon frère Gérard est entré à la maternelle l’année où je suis entré à l’école de garçons. Ainsi, à partir d’octobre 1953, nous allions tous les deux tout seuls à l’école le matin. Maman se déclara bientôt enceinte du prochain enfant, prévu pour fin mai ou début juin. Hélas, Papa, qui avait passé bon nombre d’examens à la BNCI, auxquels il avait réussi, attendait de l’avancement pour entretenir sa famille qui allait s’agrandir d’une bouche supplémentaire à nourrir, ne voyait, tel sœur Anne, rien venir. Il avait donc pris la décision de retourner à l’armée. La guerre d’Indochine n’était pas encore terminée. Ce serait le cas après la bataille de Dien-Bien-Phu, le 7 mai 1954.
Il retourna au bataillon des chasseurs alpins. Il fut alors muté à la caserne de Rastatt, en Allemagne, ville où il obtint un appartement dans une cité réservée à l’occupant français.
3 Rastatt 1954
3.1 Rastatt : allons occuper l’Allemagne
En février, donc, toute la famille partit pour Rastatt, tout en conservant l’appartement de Nice. C’est ainsi que je changeai d’école. Gérard, pour qui on n’avait pas trouvé de place dans une maternelle, devait rester à la maison avec Maman.
Les habitants, 9 ans après la guerre, étaient plutôt pauvres : le soir, l’éclairage de leur logement était d’intensité plutôt faible. Ils manquaient d’argent pour payer leur consommation d’électricité. Chez les occupants français, qui ne payaient pas leur consommation de courant, tout était allumé dès que tombait la nuit.
Lorsque les femmes de soldats allaient faire les commissions, la plupart ne maitrisant pas la langue de Goethe, cela donnait lieu à des scènes cocasses. Dans les cas les plus simples, on se contentait de désigner ce que l’on désirait du bout de l’index. Pour montrer qu’elles voulaient du jambon, certaines remontaient leur jupe d’une main, et faisaient semblant de découper leur cuisse avec l’autre. Parfois, le vendeur se demandait pourquoi on lui montrait une cuisse, et si la dame ne lui faisait pas des avances, les Français ayant souvent, à l’étranger, une réputation de légèreté. D’autres commerçants étaient plus futés et comprenaient plus vite ce qu’on voulait leur dire.
Une aide-ménagère chargée de faire le ménage, la lessive, et le repassage du linge avait été engagée. Elle ne parlait pas le français, et nous ignorions l’allemand. Il était difficile d’expliquer ce que l’on voulait d’elle, et l’on mesurait les résultats à sa réaction aux explications.
C’est le 1er juin qu’arriva notre nouveau petit frère, Georges Laurent. Comme il n’y avait pas de clinique française à Rastatt, qui comptait dans les 20 000 habitants, c’est à Baden-Baden (dans les 30 000 habitants), situé à une dizaine de kilomètres au sud de Rastatt, que se trouvait la clinique française la plus proche. Et c’est là qu’eut lieu l’accouchement. Notre père se rendit donc à Baden-Baden pour voir sa femme et son troisième fils. Il nous avait auparavant confiés à une voisine. Le soir, à l’heure où nous allions au lit, il n’était toujours pas rentré. A l’époque, la plupart des gens n’avaient pas de téléphone. C’était notre cas aussi, si bien qu’il fallut attendre son retour pour connaître les raisons de son retard. Il arriva vers vingtdeux heures, libérant la voisine de ses deux « invités ». Sans doute victime de son émotion, au lieu de prendre le train de Baden-Baden vers Rastatt (qui se trouvait à 8 km au nord), il avait pris le train qui venait de Rastatt et se rendait à Freiburg, situé à 90 km au sud. C’est en arrivant à Offenburg, à 39 km, qu’il se rendit compte de son erreur. Il descendit aussitôt, mais dut attendre une bonne heure l’arrivée du train qui allait à Rastatt. Et c’est ainsi qu’il arriva avec plus de deux heures de retard.
Nous ne vîmes la troisième merveille de la famille qu’une bonne semaine plus tard. L’école dans laquelle j’étais inscrit se trouvait à mi-chemin entre la maison où nous habitions, le long de la Murg, une rivière qui se jetait dans le Rhin, et la Caserne Joffre, où travaillait notre père. Nous étions une douzaine d’élèves dans le cours préparatoire, garçons et filles mélangés, mais tous Français.
L’institutrice ne m’a pas laissé un grand souvenir. Parmi les élèves se trouvaient sa fille. A l’époque, je savais déjà lire, grâce à la maternelle et à l’école primaire où j’avais eu cours jusqu’en février. Je me souviens en revanche d’un incident survenu en classe. J’avais été puni par l’institutrice, je ne sais plus pourquoi, d’autant moins que je n’étais pas coutumier du fait. Au lieu de mettre les élèves au piquet, elle les faisait asseoir, à la belle saison, sur le rebord d’une fenêtre, et c’est ainsi que je me retrouvais à cette place d’infamie. Mais au lieu d’attendre que l’on me renvoie à ma place, j’ai profité de ce que la classe se trouvait au rez-de-chaussée pour m’évader par la fenêtre. Je me suis alors rendu séance tenante à la Caserne Joffre. Une fois arrivé, j’ai demandé à voir mon père. Celui-ci arriva promptement, et me ramena à l’école, où l’institutrice, qui ne m’avait pas vu partir, mais avait remarqué mon absence, se faisait, comme on dit, un mauvais sang d’encre à cause de ma disparition particulièrement discrète.
Notre séjour a été l’occasion d’un contact fréquent avec la nature. Nous avions pu aller chercher du muguet dans la forêt, nous promener le long de la Murg, découvrir les taupinières, bref, baigner dans la nature, que nous n’avions pas connue à Nice. La rivière de Nice, le Paillon, rivière plus ou moins asséchée selon la saison, et souvent enfermée dans un tunnel souterrain, était beaucoup moins riche en eau que la Murg.
Nous avons vécu à Rastatt jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous avons encore pu profiter de la nature au mois de juillet. A la fin de l’année scolaire, on me remit un prix pour mes bons résultats : le Buffon des petits enfants.
Les responsables Français sentant venir le début d’une guerre entre les Algériens et la France, commencèrent à envoyer des soldats à Alger. C’est ainsi que notre père partit pour l’Algérie. Il ne nous restait plus qu’à rentrer à Nice, ce que nous fîmes en août 1954.
4 Nice, deuxième épisode.
4.1 Retour à Nice
En octobre 1954, Gérard prit le chemin de la maternelle Saint-Barthélemy, tandis que je rentrais au Cours élémentaire 1ère année, et, en parallèle, je suivais les cours de catéchisme à l’Église du même nom.
Notre vie se concentra pendant deux années scolaires dans une sorte de carré niçois, centré sur le quartier Saint-Barthélemy.
En semaine, nous allions Gérard et moi à l’école, sauf le jeudi et le dimanche.
Le dimanche, j’allais seul à la messe de 11 heures, Maman n’étant pas portée sur la religion. Ses enfants étaient tous baptisés, et ils ont tous fait leur communion lorsque ce fut le moment. J’allais aussi le jeudi à 11 heures aux cours donnés dans le cadre du catéchisme.
Le problème, quand on suit des cours de religion qui ne trouvent aucun écho dans le cadre familial, c’est que l’on a du mal à bien en comprendre les principes.
Ainsi, je n’avais pas du tout compris ce que pouvait être un Dieu. Le Saint-Esprit m’est aussi passé par-dessus la tête. J’avais plus ou moins confondu Dieu avec le curé, auquel j’adressai des prières, pensant qu’il exaucerait peut-être certains de mes vœux. Le curé nous avait aussi parlé de la communion, que l’on recevait le dimanche. J’avais compris que, le dimanche suivant, nous ferions tous notre communion. J’en ai bien sûr parlé à Maman, qui ne comprit pas plus que moi comment on pouvait faire sa communion sans que la famille en soit avertie auparavant. Je me suis donc rendu à la messe du dimanche en pensant fermement que nous allions célébrer notre communion. Il ne se passa rien de spécial. Je ne vis pas le lien qui existait entre le fait de communier, et celui de faire sa communion, qui sont deux actes différents, même si l’on communie la première fois quand on fait sa communion. Je rentrai donc déçu à la maison. Maman ne fut pas en mesure de m’expliquer ce que je n’avais pas compris.
L’année du cours élémentaire 1ère année, 1954/55 se passa pour nous, les enfants, plutôt calmement. Papa était en Algérie. Il écrivait tous les jours une lettre à Maman, lui cachant les actes les plus dangereux. En gros, son séjour ressemblait un peu au voyage d’un touriste du Club Méditerranée. Maman n’était pas dupe, et les lettres n’arrivant pas régulièrement, même si Papa écrivait chaque jour, on voyait bien qu’il y avait les jours sans lettre, et ceux avec. L’humeur de notre mère en témoignait.
En 1955, Papa revint enfin nous voir profitant d’une permission, en juin. Cela nous fit beaucoup de bien, surtout à Maman, qui put voir qu’il était en bon état, et en bonne condition. Il resta quelques semaines, puis, dut repartir pour l’Algérie. Il avait une fois de plus laissé un souvenir car, peu de temps après, Maman se rendit compte qu’elle était enceinte. Cela ne suffisait pas pour permettre à Papa de revenir. Notre frère Yves naquit comme Gérard à Nice, à la Clinique Sainte-Geneviève. Il fut nommé Yves Christian Pascal, Christian parce que j’avais été choisi comme parrain, et Pascal parce que le 1er avril 1956 était le jour de Pâques. Notons que notre grand-mère Lucie avait accepté de s’occuper de nous le temps que Maman passait à la clinique. Elle comprit à cette occasion que les efforts qu’elle avait faits pour faire comprendre à Maman comment éviter les naissances étaient restés vains.
En effet, lorsqu’elle eut compris que sa belle-fille était prolifique, elle lui avait prodigué des conseils pour éviter les naissances trop nombreuses, faisant allusion aux lapins qui, dit-on, sont particulièrement actifs dans ce domaine… Elle lui avait expliqué l’utilité et le fonctionnement de certaines poires en caoutchouc, destinées à noyer les cellules de la reproduction, l’ovule et les spermatozoïdes en présence. Sa belle-fille ne l’avait pas écoutée, trouvant que sa belle-mère se mêlait de ce qui ne la regardait pas, et que c’était à elle et à son mari de décider de faire ou non des enfants. Une fois la naissance survenue, Papa eut droit à une courte permission. Il fit ainsi la connaissance du nouveau venu, et vit que ses autres garçons avaient grandi. L’année scolaire 1955 / 1956 n’était pas encore terminée, et je retournai dans la classe de Madame Arène, la meilleure enseignante que j’aie eue à l’école primaire.
C’était une femme de petite taille portant des lunettes. Elle avait installé son bureau au fond de la classe, ce qui lui permettait d’observer les élèves sans être vue par eux. Elle était très sérieuse, et savait bien expliquer tout ce qu’elle enseignait. Je me souviens encore, à plus de 75 ans, de son visage et de sa physionomie.
4.2 Les vacances
Nous sommes allés passer une semaine de vacances en juillet à deux reprises à Roquefort-les-Pins, avec Maman et Papa. Situé à l’ouest de Cagnes-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes, ce village qui rassemble aujourd’hui dans les 7000 habitants, beaucoup moins à l’époque dont nous parlons, n'attirait pas les vacanciers parce qu’il n’était pas situé au bord de la mer. Les locations étaient moins chères, donc.
Gérard et moi, nous nous amusions, et en particulier avec les fauteuils pliants format transatlantique qui avaient été mis à notre disposition pour que nous puissions nous allonger au soleil. A force d’ouvrir et de fermer mon fauteuil, j’avais fini par me coincer les doigts de la main droite, et j’avais dû appeler mes parents pour qu’ils m’aident à récupérer ma main. Cela fut fait rapidement. Mais alors que Maman étalait de la pommade sur mes doigts meurtris, nous entendîmes les cris de Gérard, qui demandait de l’aide parce qu’il lui était arrivé la même mésaventure qu’à moi. La douleur calma nos envie de trafiquer nos fauteuils.
La paysanne qui louait l’appartement, disons, la loueuse, élevait des poulets pour les vendre, les oiseaux comme leurs œufs. Justement, mes parents avaient commandé un poulet pour midi. Nous avons vu cette brave femme s’approcher d’un groupe de poulets avec un balai. Elle s’est servie de cet instrument pour taper sur l’un des poulets, plus exactement sur le cou, un peu au-dessous de la tête.
La pauvre bête a essayé d’échapper aux coups et elle est partie droit devant, dans la direction du champ situé devant la maison. Nous vîmes que son cou avait maintenant la forme d’un accent circonflexe, et que la tête pendait au bout de la partie libre de l’accent. Il mit un peu de temps avant de mourir, et de tomber couché sur le sol, arrêtant tout mouvement. Même si la méthode était douteuse, elle finissait par tuer le condamné.
4.3 Départ pour l’Algérie
Une fois rentré en Algérie, Papa fit une demande de logement pour nous permettre d’aller habiter à Alger. En effet, la situation dans ce pays s’était fortement dégradée, et on pouvait penser qu’elle ne s’arrangerait pas de sitôt. Ainsi, il y avait peu de chances pour qu’il soit nommé en France dans un avenir proche. En juin 1956, il était clair que nous allions pouvoir déménager pour Alger. Avant que je ne quitte l’École Saint-Barthélemy, Mme Arène me remit le prix d’honneur, correspondant à ma place de deuxième au classement général, derrière Michel Biondi. J’eus droit à un livre racontant l’histoire d’un jeune garçon qui avait découvert une statue en or représentant le dieu Mercure, dieu des voyageurs, des commerçants et des voleurs, un drôle d’oiseau donc.
Quelques semaines plus tard, déjà installés à Alger, nous reçûmes de notre grand-mère un extrait du journal Nice-Matin, dans lequel figuraient toutes les écoles primaires de Nice, et la liste des élèves ayant reçu un prix. Mon nom figurait sur la liste, et il y était précisé que j’avais eu le prix d’excellence, devant Michel Biondi, classé deuxième. A première vue, les calculs de moyennes avaient été refaits, et ils révélaient ainsi ma première place.
5 Alger la blanche
5.1 Tous à Alger !
Avant la fin du mois de juin, nous prîmes l’avion menant de Nice à Alger. Les meubles devaient suivre par bateau. Nous y retrouvâmes notre père, qui nous conduisit dans une petite maison de Saint-Eugène, un quartier d’Alger en bord de mer. Nous devions y passer les vacances, avant de prendre possession de notre appartement situé 3 rue Mozart, au rez-de-chaussée d’une villa nommée « Villa Gabrielle », et qui n’avait pas encore été libéré par ses occupants devant rentrer en France.
La maison pour les vacances n’était pas très luxueuse, mais elle était proche de la mer. On sortait de la maison, on traversait une ruelle, on passait sous un porche situé sous la maison parallèle, et l’on se retrouvait à la plage. Il n’y avait plus qu’à se jeter à l’eau, ce que nous fîmes dès le premier jour.
Malheureusement, nous nous retrouvâmes tout de suite entourés d’espèce de bouts de branches marron foncé pour la plupart, qui flottaient tout autour de nous. Curieux, je voulus examiner une de ces mini-pirogues de plus près, et j’en saisis une. Elle était molle, et, en l’approchant de mes narines, je perçus une odeur bien reconnaissable, celle du caca. Je n’étais pas assez spécialisé dans ce genre d’objets pour savoir si ces crottes provenaient de chiens ou d’humains. Mais vu le nombre important de ces déjections, il fallait que les producteurs soient bien nombreux. Et le nombre d’humains étant beaucoup plus élevé que celui des chiens de la région, on pouvait supposer que le lieu de la baignade était le point de sortie d’un égout, dans lequel toutes les toilettes du quartier se vidaient. Choqués par le spectacle, nos parents préférèrent abréger notre baignade, et décidèrent de ne plus jamais nous amener à la plage à Alger.
Sur le boulevard voisin de la maison, il y avait une boutique où un spécialiste fabriquait des chips à partir de pommes-de-terre fraiches. L’intéressant, c’était qu’il faisait l’ensemble des opérations devant les clients. Il lavait les pommes-de-terre dans un bassin, les essuyait avec un grand chiffon, puis, les mettait dans un appareil en forme de grande cuvette métallique équipé de couteaux et qui, en tournant, épluchait les pommes-de-terre, les couteaux découpant la peau.
Ensuite, avec une autre machine ressemblant à une trancheuse à jambon, il coupait les pommes-de-terre en fines lamelles, avant de les jeter dans un bain d’huile bien chaude, où elles devenaient des chips fraiches. Au bout de quelques minutes, il les pêchait avec une louche en forme de filet, les mettait dans un cône en papier, versait du sel dessus et tendait le tout à sa cliente, ou à son client.
Les chips avaient beaucoup de succès, car elles étaient excellentes, et pas chères.
La queue qu’il fallait faire avant d’être servi était un peu longue, mais on était dédommagé par la joie de manger les chips. Notre père nous expliqua que les gens qui travaillaient dans cette boutique étaient des pieds-noirs. Nous nous sommes donc efforcés de voir leurs pieds. Malheureusement, presque tous portaient des souliers fermés, nous empêchant ainsi d’expertiser la couleur de leurs pieds. Quant aux rares employés qui portaient des sandales, ils avaient les pieds roses. Papa nous précisa alors que les pieds noirs étaient des gens qui étaient certes le plus souvent d’origine française, italienne, espagnole ou maltaise, mais qui eux-mêmes étaient nés dans la région. Nous connaissions maintenant trois sortes de gens habitant en Algérie : les Algériens de souche, les pieds-noirs et les Français de métropole, nous par exemple.
Comme nous étions privés de bains, et que nous ne pouvions pas passer chaque après-midi à manger des chips, il ne nous restait plus que la promenade le long du rivage.
5.2 La villa 3 rue Mozart
En septembre, nous pûmes intégrer notre nouvel appartement situé au rez-de-chaussée de la Villa Gabrielle, sise au 3 de la rue Mozart, dans le quartier de Belcourt.
On peut voir que le jardin était surélevé, au-dessus de la rue Mozart. La villa était composée d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, auquel on accédait par un escalier extérieur. L’appartement que nous occupions au rez-de-chaussée était nettement plus grand que celui où nous habitions à Nice.
On y trouvait une salle à manger, trois chambres, une cuisine, une salle d’eau et à l’extérieur, dans la cour, les toilettes.
Le moins pratique, c’étaient les toilettes. En effet, quand on avait besoin d’y aller, il fallait sortir dans la cour. Cependant, la nuit, toutes les fenêtres et toutes les portes extérieures devaient rester closes, à cause des attentats toujours possibles. Il fallait donc utiliser un certain nombre de pots de chambres, qu’il fallait vider le matin.
Dans un pays où il fait, au mois d’août, 33° en moyenne, on éprouve le besoin, de temps à autre, de se baigner. Or, dans cet appartement, il n’y avait aucune baignoire, et aucune douche. Seul un lavabo permettait de se laver. Pour se baigner, il fallait une bassine assez grande, comme celle qu’avait achetée Papa à cet effet, 102cm x 66cm x 72cm, d’une contenance de 170 litres. Il fallait la remplir à l’aide d’un seau. Une fois pleine, vu son poids de près de 200kg, il n’était pas question de la déplacer. Pour la vider, il fallait réutiliser le même seau que pour le remplissage. Comme on renversait pas mal d’eau, on devait utiliser une serpillère pour sécher le sol. Si l’on estimait le temps qu’il fallait pour la remplir, pour baigner les quatre garçons, pour la vider et pour sécher le sol, il fallait compter deux bonnes heures.
Le problème suivant, c’était la sécurité. Pendant les quatre années que nous avons passées à Alger, il y eut plusieurs phases. Soit Papa était à Alger et travaillait au troisième bureau, soit il était en opération, en Kabylie ou dans le nord du Sahara. Dans le premier cas, il rentrait le soir à la maison. Quand il faisait nuit, Maman était derrière la fenêtre de leur chambre, qui donnait sur le jardin. Quand elle entendait le moteur de la voiture qui le ramenait, elle ouvrait la porte pour qu’il puisse rentrer dans l’appartement le plus vite possible. Un soir, elle avait entendu du bruit dans le jardin. Elle avait pris peur. A l’arrivée de son chéri, elle ouvrit la porte et cria : « Attention, Coco ! Il y a quelqu’un dans le jardin. » Coco arriva et entra sans problème. Mais le lendemain, nous trouvâmes un tas d’excréments humains dans un coin du jardin, preuve qu’il y avait bien eu quelqu’un, qui avait selon toute apparence ressenti une certaine peur.
Lorsque Papa était en opération, le scénario était différent. Maman fermait les volets et les portes à clé, puis, derrière la porte, elle nous faisait installer la table de la salle à manger, et poser, dessus, les six chaises. Alors, elle avait l’impression d’avoir assuré la protection de sa famille, et on pouvait aller se coucher. Un soir, notre voisin du dessus, un sous-officier qui vivait avec sa femme, sa fille de 15 ans et son garçon de 16 ans au premier étage et qui possédait une voiture Opel-Kapitän, était rentré précipitamment. Il avait, sur le chemin du retour, essuyé une rafale de mitraillette. Une balle avait traversé, sa manche, à hauteur du bouton qui ferme la manche gauche. Cinq autres avaient tout simplement traversé la carrosserie sans l’atteindre. Il avait eu beaucoup de chance de s’en sortir sans la moindre égratignure, mais il était rentré chez lui les genoux tremblants. Une autre nuit, nous eûmes droit à une rafale de mitraillette tirée dans le jardin de la maison d’à côté.
Cette insécurité, qui pouvait s’exprimer à tout moment, faisait peur à Maman, mais pas à nous, qui ne nous rendions pas vraiment compte des réalités, sans compter que la nuit, rien ne pouvait nous réveiller. Nous dormions du sommeil du juste.
L’armée était vigilante, peut-être même un peu trop. Un jour que je jouais dans le jardin, je vis dans la rue, juste au-dessous de moi, un Algérien portant une grosse pastèque, qu’il tenait contre son ventre, les bras serrés. Un groupe de trois soldats arriva en sens inverse. Le plus gradé lui demanda de lui confier la pastèque. L’un des soldats tira un poignard de sa ceinture et le planta dans la pastèque qu’il coupa en deux. Le gradé expliqua qu’il devait contrôler s’il n’y avait pas de bombe cachée dans le fruit. Apparemment, ce n'était pas le cas. Il rendit donc les deux moitiés à leur propriétaire, lequel avait du mal, maintenant, à tenir les deux morceaux, qui ne restaient pas en place. Les soldats s’éloignèrent en riant bruyamment. On se doute bien que si la pastèque ne portait aucune trace de coupure, il était impossible qu’une bombe ait pu y être cachée. C’était tout simplement un abus de pouvoir que de couper ce fruit. Mais cela montrait la supériorité des soldats sur un civil indigène, lequel allait se donner beaucoup de mal pour tenir ensemble les deux morceaux qui glissaient l’un contre l’autre et menaçaient de tomber par terre et de rouler dans le caniveau. Je n’étais pas bien vieux, mais j’avais compris que les soldats s’étaient bien moqués d’un pauvre civil sans défense.
5.3 L’école de la rue Darwin.
Gérard et moi, nous allions à l’école de la rue Darwin, Gérard au cours préparatoire, et moi au cours moyen première année (CM1).
Le CM1 était assuré par une institutrice dont j’ai tout oublié depuis : l’apparence et le nom m’échappent complètement. Début octobre, nous étions 8 garçons, tous européens. Et puis, fin novembre, l’école dut admettre les jeunes garçons d’origine algérienne, qui avaient fréquenté jusqu’à présent une école musulmane. Les autorités scolaires, pour être sûres que les enfants algériens allaient tous se rendre à l’école prévue, dans notre cas, celle de garçons de la rue Darwin, avaient chargé des soldats équipés de camions d’aller ramasser les enfants dans les quartiers où ils habitaient pour les amener en les saisissant par le bras ou le col, ou par la ruse en les attirant grâce à une distribution de bonbons de force à l’école.
C’est ainsi que nous nous retrouvâmes 82 dans la classe. Vu le succès de l’opération qui créait des classes trop remplies, les autorités scolaires décidèrent de diviser le groupe surdimen