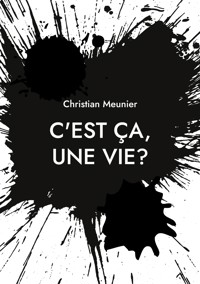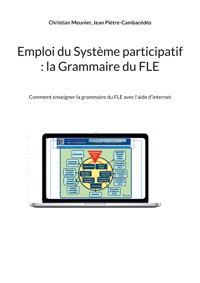7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'emploi des temps du français n'est pas facile à enseigner ou à apprendre dans le cadre du FLE. Les natifs apprennent à employer les temps de façon intuitive pour les cas de base, et des façon cognitive pour les cas relevant de la littérature. Pour ceux qui apprennent le français comme langue étrangère et qui vont le faire de façon cognitive, les explications données par les grammairiens manquent souvent de système et de clarté. Les auteurs ont recours, outre des règles manquant de clarté, à des aspects et des modalités qui varient selon les auteurs, ce qui sème le doute dans les esprits. L'auteur a recours à l'emploi de 12 traits pertinents temporels, clairement définis, expliqués et illustrés d'exemples, et propose un apprentissage en cours, en groupe et, grâce à l'emploi d'un site, en autonomie avec des exercices autocorrigés.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
6 Table des Matières
POSONS LE PROBLEME
1.1 P
AS D’EXPLICATION SIMPLISTE
1.2 P
AS D’EXPLICATIONS TROP LITTERAIRES
1.3 P
OURQUOI CONSTRUIRE UNE NOUVELLE THEORIE DES TEMPS
?
DECOUVRONS LES TRAITS PERTINENTS TEMPORELS
2.1 D
EFINITION DES TRAITS PERTINENTS TEMPORELS
2.2 D
ECOUVERTE DES TRAITS PERTINENTS
2.2.1 Topogramme des traits pertinents temporels
2.2.1.1 Les époques (Tpt1)
2.2.1.2 Le repère temporel lié à la locution (Tpt2)
2.2.1.2.1 Il y a deux repères temporels de base :
2.2.1.3 TptProc et les balises temporelles (Tpt3).
2.2.1.3.1 Procès sans balise :
2.2.1.3.2 Le procès est lié à une balise temporelle (TptBalTemp)
2.2.1.4 Le procès est lié à un autre procès (Tpt4).
2.2.1.4.1 Les deux procès sont mêlés de façon fortuite.
2.2.1.4.2 Un procès peut aussi être lié à un autre, qui a lieu avant, après ou pendant.
2.2.1.5 Les types de procès individuels ou en série. (Tpt5)
2.2.1.5.1 Procès individuel
2.2.1.5.2 Procès en série
2.2.1.6 Fenêtre et procès latent (Tpt6)
2.2.1.6.1 Notion de procès latent.
2.2.1.6.2 Les éléments en présence,
2.2.1.6.3 Les étapes de l’emploi d’une fenêtre.
2.2.1.6.4 Reconnaître et évaluer une fenêtre temporelle
2.2.1.7 Partie visée du procès (Tpt7)
2.2.1.7.1 Le moment intéressant se trouve situé juste avant le début du procès.
2.2.1.7.2 Le début du procès
2.2.1.7.3 Le corps du procès
2.2.1.7.4 La fin du procès
2.2.1.7.5 Le moment juste après la fin du procès.
2.2.1.7.6 L’ensemble du procès
2.2.1.8 La durée du procès (Tpt8)
2.2.1.8.1 Verbes bascules ou instantanés
2.2.1.8.2 Rapidité d’exécution (antériorité par rapport à procès-joker virtuel)
2.2.1.8.3 Verbes duratifs
2.2.1.8.4 Verbes sans précision de durée
2.2.1.9 Degré de probabilité de réalisation d’un procès (Tpt9).
2.2.1.9.1 Certitude que le procès s’est réalisé, se réalise ou se réalisera.
2.2.1.9.2 Une chance sur deux que le procès se soit réalisé, se réalise ou se réalisera.
2.2.1.9.3 Très faible chance que le procès se soit réalisé, se réalise ou se puisse se réaliser un jour.
2.2.1.9.4 Certitude que le procès n’a pas eu, n’a pas lieu, n’aura pas lieu.
2.2.1.9.5 Probabilité naïve : on n’envisage qu’une des parties de l’alternative.
2.2.1.10 Valeur du temps employé (Tpt10)
2.2.1.10.1 Valeur de base
2.2.1.10.2 Les valeurs stylistiques, ou détournées pour un usage personnel :
2.2.1.10.3 Les valeurs déviées :
2.2.1.10.4 Valeur grammaticale
2.2.1.11 Les contraintes obligatoires ou facultatives (Tpt11)
2.2.1.12 Résultat escompté (Tpt12)
2.2.1.12.1 Présenté comme sûr
2.2.1.12.2 Incertain
2.2.1.12.3 Raté
2.2.1.12.4 Ordre, conseil appuyé
2.2.1.12.5 Menaces, insultes, protestation
2.2.2 Récapitulons ce que nous avons découvert :
2.2.3 Tableau du réseau des divers traits pertinents temporels
2.2.4 Tableau des divers traits pertinents temporels
2.2.5 Voici la liste des Tpt utilisés avec leurs valeurs possibles :
2.2.6 Le code des temps
LES TPT A TRAVERS LES TEMPS ET LES MODES.
3.1 T
PT
1 : L
ES EPOQUES
3.2 T
PT
2 : L
ES REPERES DE BASE TPTLOCU ET TPTPROC
3.2.1 Généralités
3.2.2 Réflexions sur le temps
3.2.2.1 Tout est en mouvement
3.2.2.1.1 TptLocu
3.2.2.1.2 TptProc
3.2.2.2 Le fil de la locution
3.2.2.3 Rapports entre temps réel et temps grammatical
3.3 T
PT
3 : L
ES BALISES TEMPORELLES
3.3.1 Procès sans balise
3.3.2 Utilisation d'une balise de temps
3.3.2.1 Diverses balises de temps
3.3.2.1.1 Moment précis :
3.3.2.1.2 Date précise
3.3.2.1.3 Position par rapport à un autre procès
3.3.2.2 Importance des balises et nécessité d’un bon codage / décodage
3.4 T
PT
4 : P
ROCES LIE A UN AUTRE PROCES
3.4.1 Les différents types de procès
3.4.2 Quel est l'intérêt de faire cette distinction ?
3.4.3 La notion de focus
3.4.4 Les rapports d'antériorité, de simultanéité et de postériorité
3.4.4.1 Généralités
3.4.4.2 L’antériorité
3.4.4.2.1 Il y a antériorité de fait, sans que l’on mette l’accent dessus :
3.4.4.2.2 Il y a antériorité soulignée,
3.4.4.2.3 L’antériorité conditionnelle
3.4.4.2.4 L’antériorité éloignée
3.4.4.3 La postériorité
3.4.4.3.1 Qu’entend-on par postériorité ?
3.4.4.3.2 La postériorité fortuite.
3.4.4.3.3 La postériorité soulignée.
3.4.4.4 La simultanéité.
3.4.4.4.1 Qu’entendons-nous par simultanéité ?
3.4.4.4.2 La simultanéité revêt plusieurs visages :
3.5 T
PT
5 : T
YPE DE PROCES
3.5.1 Les différents types de procès
3.5.2 Quel est l'intérêt de faire cette distinction ?
3.6 T
PT
6 : F
ENETRE TEMPORELLE ET PROCES LATENTS
3.6.1 Problèmes posés par les répétitions
3.6.2 Fenêtre et procès latent
3.6.2.1 Définitions
3.6.2.2 La vie d’une fenêtre
3.6.2.2.1 Ouverture
3.6.2.2.2 Comment se servir de la répétition
3.6.2.2.3 Il faut qu’une fenêtre soit ouverte ou fermée
3.6.2.3 Comment fermer une fenêtre.
3.6.2.3.1 Fermer une fenêtre à chaud.
3.6.2.3.2 Fermer une fenêtre à froid.
3.6.2.3.3 Une fenêtre peut se fermer seule.
3.6.2.3.4 Une fenêtre peut ne pas pouvoir être fermée
3.6.2.4 Fenêtre et temps
3.7 T
PT
7 : P
ARTIE DU PROCES VISEE
3.7.1 Topogramme de la partie du procès visée
3.7.2 Les faits et résumés / n° du paragraphe correspondant :
3.7.3 Le moment juste avant le début du procès
3.7.3.1 Généralités
3.7.3.2 Époque du présent
3.7.3.3 Époque du passé
3.7.3.4 Époque du futur
3.7.4 Le début du procès.
3.7.4.1 Époque du présent
3.7.4.2 Époque du passé
3.7.4.3 Époque du futur
3.7.5 Le corps du procès.
3.7.5.1 Époque du présent
3.7.5.2 Époque du passé
3.7.5.3 Époque du futur
3.7.6 La fin du procès.
3.7.6.1 Époque du présent
3.7.6.2 Époque du passé
3.7.6.3 Époque du futur
3.7.7 Le moment juste avant la fin du procès.
3.7.7.1 Époque du présent
3.7.7.2 Époque du passé
3.7.7.3 Époque du futur
3.7.8 Le moment juste après la fin du procès
3.7.8.1 Époque du présent
3.7.8.2 Époque du passé
3.7.8.3 Époque du futur
3.7.9 L’ensemble du procès.
3.7.9.1 Époque du présent
3.7.9.2 Époque du passé
3.7.9.3 Époque du futur
3.8 T
PT
8 : D
UREE DU PROCES
3.8.1 Les verbes bascules ou instantanés
3.8.1.1 Principe des verbes bascules
3.8.1.2 La famille des verbes bascules
3.8.1.3 Cas du verbe « vouloir »
3.8.2 Procès de faible durée
3.8.3 Accélération de l’exécution
3.8.4 Les verbes duratifs
3.8.5 Le procès sans précision de durée
3.9 T
PT
9 : D
EGRE DE PROBABILITE
3.9.1 Probabilité certaine
3.9.2 Les hypothèses
3.9.3 Les conditions
3.9.3.1 Le potentiel probable
3.9.3.2 Le potentiel improbable mais possible
3.9.3.3 L’irréel du présent
3.9.3.4 L’irréel du passé
3.9.4 Futur et incertitudes
3.9.4.1 Le futur n’existe pas encore
3.9.4.2 Le futur hypothétique
3.9.4.3 L’information non vérifiée
3.9.5 Subjonctif
3.9.5.1 Souhait, ordre, conseil appuyé
3.9.5.2 Dans la subordonnée
3.9.5.2.1 Postériorité
3.9.5.2.2 Doute, incertitude, gêne
3.9.5.2.3 Caractère exceptionnel, unique
3.9.5.2.4 Cas exceptionnel de la conséquence.
3.10 T
PT
10 : V
ALEUR DES TEMPS
3.10.1 Nous considérons quatre formes d’emploi :
3.10.2 Tableau des emplois selon la valeur
3.10.3 Topogramme des valeurs du temps
3.11 T
PT
11 : C
ONTRAINTES
3.11.1 Contraintes amenant le subjonctif
3.11.2 Contraintes interdisant le conditionnel
3.12 T
PT
12 : R
ESULTAT ESCOMPTE
3.12.1 Le procès présenté comme sûr
3.12.2 Le procès incertain
3.12.2.1 Si l’on emploie un temps du futuro-conditionnel, le procès sera moins certain.
3.12.2.2 Le conditionnel de l’information non vérifiée.
3.12.2.3 Nous avons vu aussi les cas de potentiel.
3.12.3 Le but raté
3.12.4 L'ordre ou le conseil appuyé
3.12.4.1 A l’impératif, à la première ou à la deuxième personne, :
3.12.4.2 Ordre transmis par une tierce personne
3.12.4.3 Au futur, comme dans le Décalogue :
3.12.4.4 A l’infinitif, généralement sur des pancartes :
3.12.5 Menaces, insultes, protestation
3.12.6 Excuses
LES TPT SUR LE SITE HTTPS://WWW.LA-GRAMMAIRE-DU-FLE.COM
4.1 A
CTU
4.2 A
RTICLES
4.3 S
ITE
4.4 A
PPRENANTS
4.5 O
UTILS
4.6 C
ONTACTS
BIBLIOGRAPHIE
1 Posons le problème
Un article récent de Télérama {Rousset / Landrot 2017} a posé la question de savoir s’il fallait encore enseigner la grammaire du français dans les écoles, étant donné la frustration des élèves, ainsi que celle des enseignants. Les esprits se sont échauffés à propos de l’introduction du concept de prédicat, qui a amené des réflexions ébouriffantes de la part des enseignants : « J’hésite à enseigner le prédicat à mes collégiens. J’ai vraiment trop peur qu’ils se foutent de ma gueule. » (p. 23) Un autre déclare « Désolé, mais moi, c’est décidé, j’assume, à la rentrée 2017, je zappe le prédicat… Je serai à la retraite. » (Ouf, sauvé par le gong !) Un autre « Perso, c’est tellement le bordel … que je me contrefiche du prédicat. » Heureusement, quelqu’un garde son sang-froid dans ce psychodrame généralisé, même s’il l’exprime dans une langue très moderne : « Trop marre d’entendre les autres paniquer au mot « prédicat » alors que c’est juste un groupe verbal, quoi ».
Le linguiste Marc Wilmet, dont les propos ont été recueillis par Marine Landrot, voit la raison principale du malaise dans le manque de rigueur de la grammaire scolaire. « En grammaire, on énonce une règle et on l’assortit immédiatement d’une quantité d’exceptions. C’est donc que cette règle est mal formulée et qu’il faudrait la formuler autrement, avec la même rigueur que les sciences. On est loin du compte. » (p. 28).
Nous sommes tout à fait d’accord avec lui. La grammaire est trop souvent mal formulée. Ou alors, l’enseignant n’arrive pas à faire le lien entre deux phénomènes, comme dans le cas que nous exposons dans le §1.1 dans lequel, si l’on ne fait pas intervenir l’intonation et la phonétique, on n’aura pas de règle possible, seulement des exceptions sans aucun lien entre elles.
Mais nous ne pouvons le suivre dans sa comparaison avec les sciences, car si l’on prend, comme lui, une science dure comme la physique, on tombe aussi sur des problèmes non résolus. Le « big bang » est une théorie, et non une certitude. La physique relativiste est en contradiction avec la physique quantique et les physiciens, pas plus que les mathématiciens, n’arrivent à les unifier. La théorie des cordes, qui tente d’expliquer pourquoi des particules se comportent comme un phénomène vibratoire, et qui utilise un monde à 11 dimensions, a ses partisans et ses détracteurs.
Quant à la remarque « Je serais pour une position radicale : pas de grammaire du tout à l’école, pour commencer. Au fond, il faudrait étudier la grammaire à partir de 13-14 ans, à l’âge où les élèves ont une maturité suffisante. » nous ferons simplement remarquer qu’en mathématiques, on n’attend pas que les apprenants aient la maturité nécessaire à la compréhension du calcul intégral pour commencer à leur enseigner la matière. On peut très bien commencer par des choses simples, à la portée d’un cerveau d’enfant, et adapter la progression, au cours des années d’enseignement, à la maturité du cerveau.
Il fait aussi remarquer qu’en Amérique ou au Japon, on commence bien plus tard à apprendre la grammaire. Or, le temps et l’énergie nécessaires à l’apprentissage de la grammaire dépendent évidemment de sa difficulté. Les élèves français n’ont pas beaucoup de chance, car leur langue maternelle est compliquée : l’écrit est éloigné de l’oral, les accords sont nombreux et divers, les conjugaisons complexes, la précision et la clarté exigée ne supportent pas l’approximation et la compréhension à demi-mot. Son apprentissage est donc plus long, et nécessite une soigneuse progression tenant compte de la pédagogie et de la didactique adaptées à l’âge des apprenants.
1.1 Pas d'explication simpliste
On ne peut pas, lorsque l’on enseigne l’emploi des temps, se contenter d’explications simplistes. Ainsi, dans La Grammaire du Français contemporain, on trouve p. 341
« A l’intérieur d’une série de verbes au passé simple, l’imparfait s’intercale pour commenter un fait rapporté.
Le juge alluma une cigarette. La fièvre donnait au tabac un goût de miel. Il écrasa la cigarette (VAILLAND) »
La série de verbes, c’est « Le juge alluma une cigarette… Il l’éteignit. » On peut se demander pourquoi, venant d’allumer la cigarette, il s’empresse de l’éteindre. On trouve l’explication dans la phrase « La fièvre donnait au tabac un goût de miel. » De notre point de vue, cet imparfait s’explique parce que le goût de miel est encore perceptible au moment où il écrase la cigarette. C’est ce que nous appelons une simultanéité au contact (cf. Tpt4). Notons que l’explication « l’imparfait s’intercale pour commenter un fait rapporté. » n’explique rien, puisque le fait d’allumer la cigarette ainsi que celui de l’éteindre sont aussi des faits rapportés. De plus, on aurait pu intercaler : « Il trouva le goût écœurant et écrasa la cigarette. », et les deux faits rapportés seraient au passé simple. L’explication originale est donc floue et n’apporte rien au lecteur de la grammaire, lequel a consulté l’ouvrage pour trouver une explication qui lui explique cet emploi de l’imparfait et lui permette, quand il s’exprimera en français, de choisir l’imparfait à bon escient.
1.2 Pas d'explications trop littéraires
On ne peut pas non plus délirer dans ses explications et expliquer un exemple que l’on a choisi bien touffu, pour en donner une explication littéraire, interprétant l’exemple comme une œuvre littéraire, traquant l’intention de l’auteur jusqu’au mot le plus anodin.
Quelquefois, les auteurs grammairiens sont quelque peu difficiles à suivre :
« Je retournai de temps en temps à la Nationale ; j’empruntai pour mon compte chez Adrienne Monnier ; je m’abonnai à la bibliothèque anglo-américaine… L’hiver au coin de mon feu, l’été sur mon balcon, […] je complétais ma culture (S. DE BEAUVOIR). » Grammaire du français contemporain (p. 341)
«Sylvain, de ses deniers, a acquis de la naissance et un autre nom : IL EST seigneur de la paroisse où ses aïeuls payaient la taille ; il n’aurait pu autrefois entrer page chez Cléobule et IL EST son gendre (LA BRUYERE).»
Avant de pouvoir apprécier la valeur de l’imparfait dans le premier cas, et du présent dans le second, il faut comprendre le texte. Comprendre que « la Nationale » est une bibliothèque, et non pas une route, savoir qu’Adrienne Monnier tenait une librairie et prêtait certains ouvrages à ses meilleurs clients.
Dans le second, il faut comprendre « acquérir de la naissance », comprendre « la taille », ce qu’est « un page ».
Le principal problème de l’enseignement de la grammaire, que ce soit à des francophones ou à des étrangers, à des apprenants, à des enseignants ou à de futurs enseignants, vient de ce que les auteurs de grammaire, soucieux de ne rien oublier, décrivent le plus de phénomènes possible, même ceux qui doivent leur existence au fait que l’écrivain, qui est un artiste dans son domaine, manie la langue avec beaucoup de facilité, et peut très bien se servir de certains temps à contre-courant pour donner une impression.
Prenons trois exemples simples.
A.
Le navire coulait. L’équipage l’abandonna.
B.
Le navire coula. L’équipage l’abandonna.
C.
Le navire coula. L’équipage l’abandonnait.
Passons maintenant à leur analyse :
Dans l’exemple A, le navire commence à couler. Les marins, qui n’ont pas envie de périr, montent dans les canots de sauvetage et l’abandonnent. Nous aurions fait comme eux dans le même cas.
Dans l’exemple B, nous avons affaire à un équipage conscient de ses responsabilités. Il se trouve qu’un bateau naviguant à vide appartient à celui qui le trouve. Autrement dit, et cela s’est déjà vu, si les marins, paniqués, abandonnent un peu trop vite le navire alors que celui-ci, en fin de compte, ne coule pas, n’importe qui pourra s’emparer du bateau. Donc, on reste à bord jusqu’à ce qu’il finisse de couler, pour être bien sûr de ne pas l’abandonner trop tôt. En fait, la présence du capitaine suffit, mais comme ici son équipage tient à son officier, il reste avec lui jusqu’au bout.
Petit problème : l’équipage attend que le navire arrive au fond avant de l’abandonner. Que se passera-t-il s’il navigue entre le continent et la Corse, là où se trouve une profondeur de 3 000 mètres, le passé simple « coula » l’obligeant à rester à bord jusqu’au bout ?
L’exemple C, lui, est carrément surréaliste et pourrait être dû à un écrivain artiste dont nous avons parlé plus haut. Voilà un bateau qui coule jusqu’au fond. Et pourquoi le fait-il ? Parce que l’équipage est en train de l’abandonner, et qu’il sent qu’il va bientôt être seul. Ce bateau, qui est un grand sensible, devient ainsi quasiment un personnage qui, se sentant abandonné, se laisse mourir, voire se donne volontairement la mort.
Alors que les deux premiers exemples sont faciles à cerner, le dernier, auquel nous reconnaîtrons une certaine qualité littéraire et artistique, sort du cadre, et on peut se demander si une grammaire est le bon endroit pour l’enseigner.
L’art est un monde à part, surtout l’art contemporain. Ce qui pour certains est une œuvre d’art, comme l’urinoir de Marcel Duchamp, dont un exemplaire a été vendu en novembre 1999 pour la somme de 1.677.000 millions d’euros, n’est pour d’autres qu’un vulgaire objet utilitaire dans lequel on n’hésiterait pas à assouvir ses besoins si seulement il était branché sur le système d’eau !
Outre la fragilité de certaines règles, la grammaire des temps souffre aussi d’un manque de clarté dû au fait que les explications viennent de plusieurs domaines, traités différemment selon les auteurs. Ceux-ci parlent du temps, du mode dont la description est souvent malaisée, et y ajoutent encore l’aspect, qui nous donne des indications sur le procès (l’action), et sur la modalité, qui nous dit comment évaluer le contenu de l’information (degré de vérité, degré de sûreté etc.)
Le nombre d’aspects ou de modalités varie d’un auteur à l’autre, leur nom également. Certains aspects sont liés à la syntaxe, d’autres à la sémantique du verbe, d’autres enfin à la pragmatique. Comme la plupart des grammaires décrivent les détails, sans essayer de les rassembler en une unité dont ils pourraient montrer le fonctionnement, il serait temps que l’on mette sur pied une théorie unificatrice de tous ces détails, fondée sur un autre principe, qui explique l’emploi des temps dans une optique de compréhension, mais aussi d’expression.
1.3 Pourquoi construire une nouvelle théorie des temps ?
Nous venons de nous plaindre de toutes sortes de déficits dans les grammaires qui nous entourent. Nous allons maintenant tenter de définir ce que nous voulons mettre dans une nouvelle théorie afin qu’elle corresponde aux besoins que nous avons.
Avant tout, elle devrait être globale, c’est-à-dire couvrir l’ensemble des moyens qui concourent à la conception et à l’emploi des temps grammaticaux. Ce sont ces moyens qui participent à l’emploi des temps, leur codage (production) et leur décodage (compréhension) que nous appellerons « traits pertinents temporels ».
Il faut étudier les verbes, qui portent la flexion, laquelle permet de reconnaître, outre la personne et le nombre, rarement le genre du sujet ou du C.O.D dans le cas de l’accord du participe, les modes et les temps utilisés, mais aussi certains adverbes, certaines prépositions ou conjonctions de temps, quelquefois certaines expressions, bref, tout ce qui concourt à expliquer l’emploi des temps.
Il faut étudier leur fonctionnement dans leur domaine d’application, c’est-à-dire dans les principales ou indépendantes, certes, mais aussi dans les compléments de temps, dans les subordonnées en général, et surtout les subordonnées circonstancielles, les complétives par
que
et par
si
, et les relatives. Il ne faudra pas oublier le discours indirect, dans lequel les temps sont soumis à certaines transformations dues à un changement de repère.
Ensuite, il faut une grammaire des temps capable de remplir un certain nombre de conditions :
Elle doit expliquer la langue orale et la langue écrite.
Elle doit tenir compte des niveaux de style.
Elle doit aussi bien assurer la compréhension que la production, c’est-à-dire expliquer pourquoi on emploie un temps X (compréhension), mais aussi comment faire pour exprimer ce que l’on veut dire par un temps Y (production).
On attend de la grammaire que les règles soient claires, faciles à comprendre, selon le principe de Boileau : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… » et surtout pertinentes, ce qui suppose que l’auteur ait bien compris comment le tout fonctionne. Nous avons vu que ce n’était malheureusement pas toujours le cas des ouvrages existants, et si l’on a du mal à comprendre, en tant que lecteur, c’est parce que l’auteur n’a pas su démonter le système pour en décrire le fonctionnement.
On veut en outre pouvoir se servir des règles édictées pour être en mesure de construire ses phrases et ses textes, et de s’en servir comme d’un mode d’emploi. Il faut donc qu’elles soient assez claires et précises pour que l’on puisse les utiliser avec quelques chances de succès.
Nous devons employer une terminologie compréhensible à tout lecteur du niveau du public visé, en renonçant au jargon incompréhensible tout en utilisant les termes techniques d’un large usage.
Nous avons déjà eu l’occasion plus haut d’évoquer l’imprécision des règles utilisées dans l’enseignement, du manque d’unité des grammaires, même parmi les meilleures, qui sont plus soucieuses de tout expliquer, même si c’est de façon disparate, ad hoc que de trouver un plan directeur, une unité.
Chaque grammaire cherche à résoudre le problème à sa manière, et l’on se perd en passant d’un ouvrage à l’autre, les problèmes considérés, les aspects reconnus et les modalités envisagées étant diverses et variées, sans parler de la terminologie qui change d’un ouvrage à l’autre et déroute le lecteur.
Certes, le sujet est difficile, situé au croisement de plusieurs domaines (syntaxe, sémantique, pragmatique, intentions et psychologie des locuteurs et des auditeurs influant sur le choix des temps, du style, la performance artistique fondée sur le langage et l’art de l’utiliser) si bien qu’on se perd vite dans des considérations éloignées de la linguistique de base.
Comme la plupart des grammaires décrivent les détails, sans essayer de les rassembler en une unité dont elles pourraient montrer le fonctionnement, il serait temps que l’on mette sur pied une théorie unificatrice de tous ces détails, fondée sur un autre principe, qui explique l’emploi des temps dans une optique de compréhension, mais aussi d’expression orale et écrite.
Les locuteurs Français parlant à un rythme soutenu, ils n’ont pas le loisir de se poser toutes sortes de questions à caractère littéraire pour choisir le bon temps. Ils ont d’autres critères d’emploi, qu’ils ont acquis pour la plupart des temps de façon implicite, car l’emploi des temps et des modes, à part celui du subjonctif ou encore du conditionnel lorsqu’il est interdit (complétive par « si »), fait souvent partie de la grammaire implicite.
Selon {Germain/Netten 2013}, qui s’appuient sur les neurosciences, on doit parler chez les natifs de deux grammaires :
Une grammaire intuitive
Une grammaire cognitive
- La grammaire intuitive, que les enfants acquièrent au contact de leurs proches avant d’aller à l’école, par correction des proches, mais pour laquelle on ne formule aucune règle. On se contente de phrases simples, agrémentées de relatives et de circonstancielles rudimentaires.
- La grammaire cognitive qui s’apprend à l’école, avec des règles. L’école profite de l’occasion pour revenir sur la grammaire intuitive afin d’en préciser les règles, et d’en ajouter de nouvelles sur l’emploi des temps, la phrase complexe et certaines structures telles que l’hypothèse, l’accord du participe, certaines conjugaisons.
Dans le cas du FLE, les apprenants ont acquis de façon intuitive la grammaire de leur langue maternelle. S’ils ne sont pas natifs et apprennent le français comme langue étrangère, c’est seulement de façon cognitive.
Pourtant, nous avons nous-même appris l’allemand par une méthode intuitive, la méthode Evrard et Stürzer, sans règle, grâce à des activités dans la lignée des exercices structuraux sur la déclinaison de l’adjectif, avec un stimulus suivi d’une réaction :
Déclinaison de l’adjectif: Was für Wein wächst am Rhein? Guter Wein wächst am Rhein. -> Quelle sorte de vin (ici, vignoble) pousse le long du Rhin ?
Du bon vin (ici, boisson) pousse (ici, est produit) le long du Rhin.
Le stimulus était fourni par celui qui venait de répondre, et son voisin fournissait la réponse, avant de poser lui-même la question à un autre voisin. Nous avons pu ainsi apprendre la langue allemande sans la moindre règle, par répétition ou transformation, de façon intuitive mais terriblement lassante et peu motivante, la motivation étant « encouragée » par l’enseignant à coups de gueule, voire distribution de taloches ou d’heures de colle.
Notons qu’en règle générale, les ouvrages de grammaire ne s’occupent que de la compréhension orale / écrite de grammaire cognitive, c’est-à-dire qu’elles expliquent des problèmes, plus rarement de la partie expression orale /écrite, qui est justement celle dont les apprenants auraient besoin pour produire des phrases correctes et idiomatiques. Il conviendrait donc, dans notre théorie grammaticale, de traiter des deux formes : la grammaire de la compréhension, et celle de la production, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Pour simplifier et systématiser l’emploi des temps, nous allons utiliser un réseau de traits pertinents temporels (Tpt), au nombre de 12, qui peuvent prendre plusieurs valeurs, selon les cas, et qui jouent un rôle dans le choix des temps.