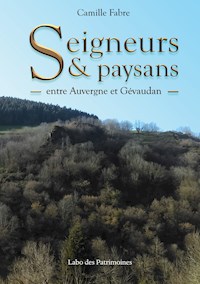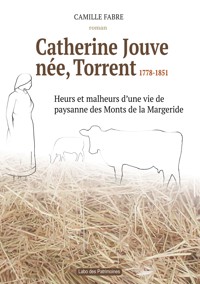
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Haletant, ce premier roman de Camille Fabre retrace le parcours et les combats d'une femme, Catherine Jouve née Torrent, à la période de la Révolution française. Dans cette saga familiale, le lecteur est invité à suivre le destin de Catherine : jeune femme qui intègre la famille de Joseph, exclusivement masculine. Elle devra faire face à l'hostilité, à l'indifférence et à l'amitié de ses Beaux-frères. Après le décès de joseph, elle prendra en charge l'exploitation familiale...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement de l’autrice
Il s’agit d’un roman et non d’un travail d’historien. Les familles Jouve et Torrent ont réellement existé. Elles servent de trame au récit de la vie quotidienne, des joies et des malheurs des familles paysannes vivant dans les monts de la Margeride à l’aube du XIXe siècle.
Un long travail de généalogie a permis de les cerner, de décrire leur ascendance et leur descendance jusqu’en 1850. Les actes notariés ainsi que les minutes de la justice de paix ont participé à la description des difficultés rencontrées, de leur endettement et à la façon de résoudre les conflits rencontrés à diverses périodes de la trajectoire de la famille Jouve.
Le récit romanesque est fictif mais il s’appuie sur des situations rencontrées dans différents textes. Elles ont été agrégées les unes aux autres afin de construire une histoire cohérente.
Le parler du plateau saugain était, à cette période, un patois local dérivant de l’occitan, difficile à transcrire puisqu’il s’agit d’une langue orale. C’était la langue commune à tout le monde. Le français était l’écrit utilisé dans les textes administratifs ou juridiques (minutes notariales ou jugements de la justice de paix, contrats de location, contrats de mariage ou état-civil). Aussi, nous avons fait le choix d’actualiser les dialogues afin qu’ils puissent être compréhensibles.
Ces femmes, par leur action au quotidien, cherchaient à améliorer leurs conditions : l’hygiène lors de la grossesse ou de l’accouchement, la gestion de leurs biens plutôt que de la déléguer à leur mari ou leur frère, la recherche d’une reconnaissance pour les veuves d’être reconnues comme des adultes majeurs. Il en est de même pour les femmes célibataires ou veuves sans descendance. Ces actions quotidiennes participaient, sans forcément avoir conscience des enjeux, au combat des femmes pour l’acquisition de nouveaux droits.
De même certains personnages comme Baptistine ou Nathalie sont fictifs. Ils ont été créés pour la cohérence du récit.
En fin d’ouvrage figurent un glossaire et une liste des principaux personnages.
Sommaire
Avertissement de l’autrice
PROLOGUE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Liste des principaux personnages
Glossaire
Publications de l’autrice
Remerciements
PROLOGUE
Ce premier août 1814, Joseph était parti vérifier le mûrissement des épis de seigle au champ. Le mois de juillet avait été très chaud cette année-là. Les champs avaient changé de couleur : de vert, ils étaient devenus jaune pâle. La moisson s’annonçait précoce alors que les fenaisons venaient juste de terminer.
L’heure du repas de midi était passée. La famille attendait Joseph pour passer à table. Il n’était toujours pas revenu. Catherine avait envoyé Jojo, leur fils aîné, pour lui rappeler qu’il était attendu pour le repas. Parfois, cela lui arrivait d’oublier l’heure bavardant avec un voisin un peu plus longuement que prévu.
Le fils alla jusqu’au champ. Il ne le vit pas. Puis, il aperçut un corps étalé sur le bord du champ, la face contre terre. Il se précipita… C’était Joseph, son père.
I
Octobre 1793
Il avait plu dans la nuit et ce matin d’automne était particulièrement humide. Tout son corps était douloureux et raide. Anne avait eu un peu plus de mal que d’habitude à se lever.
La cinquantaine, approchant, elle se sentait de plus en plus fatiguée. Les travaux lui incombant devenaient plus pénibles. Elle boitait et avait mal au dos, c’était une douleur chronique, la privant de sommeil la nuit, lui gâchant ses journées. Elle était seule pour s’occuper de l’oustal*. Cela ne peut plus durer, pensa-t-elle.
Depuis la disparition de Jean-Antoine Jouve et d’Anne-Marie Pic survenus en 1788, Anne, benjamine de la famille Jouve, âgée de 36 ans, était devenue mère de famille. Jean-Antoine, le père, décéda à 49 ans, en août 1788. Quatre mois plus tard, Anne-Marie, sa veuve, s’éteignit à son tour, à trente-huit ans, certains dirent que c’était de chagrin. Ils laissèrent à la charge d’Anne sept orphelins Joseph, Jean-Antoine, Jean-Pierre, Jean-Baptiste, Barthélémy, Guillaume et Jean-Louis. L’aîné des enfants, Joseph avait seize ans et le plus jeune de la fratrie Jean-Louis avait seulement un an.
De la même façon que le curé l’avait choisie pour devenir béate, il estima qu’il n’était pas bon pour les enfants orphelins de son frère aîné d’être séparés, et qu’il était temps que sa vie de béate se termine pour se consacrer à élever sa nouvelle famille. N’ayant prononcé aucun vœu puisqu’elle restait une laïque, elle abandonna sa fonction pour devenir mère de famille. Il faut dire que dans les petites localités où aucune autorité publique n’était présente, la vie sociale s’organisait autour de l’église. En l’absence de familles nobles, le curé était le personnage de référence. En cas de problèmes, c’est vers lui que l’on se tournait.
Le conseil de famille, en accord avec le curé de la paroisse, décida que c’était le rôle et la responsabilité d’Anne, la béate, de prendre soin de ses neveux.
Anne était généreuse et ouverte sur les autres. Elle était éduquée, elle aimait lire et apprendre aux enfants. Alors qu’elle avait 21 ans, sa tante Catherine, la demi-sœur de son père, Guillaume, la béate au village de La Pénide, décéda. Le curé lui proposa de prendre le relais et de devenir à son tour, la béate du village. Elle partit pendant deux longues années au Puy, chez les sœurs de l’Instruction, faire son noviciat. Un apprentissage de deux ans afin d’être capable d’enseigner le catéchisme, les rudiments de l’écriture, de la lecture et du calcul. C’est ce qu’elle fit à son retour. Elle enseigna ce qu’on lui avait appris aux enfants du village et parmi les lesquels, ceux de son frère, les aînés de ses neveux. Comme Joseph et ses frères, les enfants du village savaient écrire, lire et compter.
Il faut dire que Guillaume Jouve, le père de Jean-Antoine et d’Anne était devenu veuf pour la seconde fois. Il avait élevé seul ses enfants avec l’aide de sa fille aînée Catherine, demeurée vieille fille, comme on disait. Une dizaine d’années après le décès de sa première épouse, il épousa Anne Dumas, une voisine, qui, à son tour, était devenue veuve de Jean-Baptiste Pic. Elle était mère de trois filles âgées aux alentours d’une dizaine d’années. Le jour même du remariage du père, le jeune Jean-Antoine Jouve, âgé de 23 ans, épousa l’une des filles d’Anne Dumas, Anne-Marie Pic, âgée seulement de 12 ans. Catherine, la fille aînée de Guillaume, déserta alors la maison familiale pour devenir la béate du village. Guillaume, le père et Jean-Antoine, le fils se marièrent, donc, le même jour.
Guillaume avec l’aide de son fils, Jean-Antoine, travailla le domaine des Pic avec le sien. Anne apprit à sa fille, Anne-Marie, à devenir une bonne épouse pour Jean-Antoine.
La famille Jouve, bien que demeurant à La Pénide, alors paroisse de Cubelles, depuis de nombreuses années, n’était pas originaire d’ici et, Jeanne Pannefieu, la mère de ses enfants était native de la commune de Chanaleilles. Autrement dit, elle venait des montagnes de la Margeride. Elle n’avait jamais été vraiment acceptée par les autres femmes. Ce n’était qu’avec la génération de Jean-Antoine que la famille Jouve commença à faire souche. Mais, ce sentiment d’être mis à l’écart perdurait au sein de la famille Jouve. Joseph, naquit dix ans plus tard, en 1772.
Anne avait dû compter sur ses propres forces pour élever les enfants de son frère car aucun homme n’était là sur qui elle pouvait se reposer. De ce fait, elle avait, avec l’aide des enfants aînés de son frère, assuré seule la gestion du domaine. Les fils assurant le travail le plus dur de la ferme, elle se consacrait à leur éducation. Le nourrissage des cochons et des volailles ainsi que la fabrication du fromage et du beurre ; le filage de la laine ou le tricotage et l’entretien de la maison occupaient ses journées.
Anne éleva ses neveux du mieux qu’elle put. Autant, elle avait un ascendant certain sur les plus jeunes qu’elle avait élevés depuis leur plus jeune âge, autant sur les aînés, c’était pour elle un peu plus compliqué : certains comme Jean-Pierre contestait son autorité. Mais, bon an mal an, elle était fière de ses garçons, comme elle disait. D’autant que les soucis ne manquaient pas.
La vie de la famille Jouve comme celle des autres familles de la commune était rythmée par les nouvelles du pays en ces temps révolutionnaires. Les évènements locaux faisaient planer un climat d’incompréhension et d’insécurité. En ce début des années 1790, ils leur paraissaient inquiétants. Jean-Joseph, ancien seigneur de Charraix, marquis d’Apchier, comte de Besque et baron de Thoras, vivait avec sa famille au château de Besque, situé à la limite des communes de Charraix et de Cubelles, avait été élu, aux États généraux, par la noblesse du Gévaudan. Il démissionna rapidement, en juillet 1789, remplacé par son suppléant. Deux ans plus tard, accusé de cacher des armes, il fut arrêté sans ménagement par la garde nationale du Puy-en-Velay, dans la nuit du 10 au 11 juillet 1791. Il demeura dix-sept jours en prison.
La perquisition organisée démontra que les soupçons n’étaient pas fondés. Mais, les autorités lui firent savoir qu’il n’était plus bienvenu malgré le soutien des municipalités de Saugues et de Cubelles, car il avait un crédit certain dans la population. Aussi, il décida d’émigrer à Barcelone où il mourut. Il avait participé activement à la chasse contre la Bête qui avait sévi dans les années 1764 à 1767, cela comptait. Tout le monde lui en était reconnaissant. On se souvenait de lui comme d’un héros qui avait su protéger son territoire délaissé par les louvetiers envoyés par le roi.
Puis, vint en ce début d’automne 1792, l’appel aux hommes valides à se faire inscrire en mairie pour défendre le pays. Il était en danger, attaqué par les Prussiens auxquels s’étaient alliés des nobles immigrés, cela était loin et le danger, auquel la patrie devait faire face, restait flou. Mais Anne s’inquiéta pour les aînés de ses garçons en priant le ciel qu’aucun d’eux n’attira l’attention des autorités. Qu’allait-on devenir si l’un d’entre eux était réquisitionné ?
Seulement neuf jeunes hommes s’étaient inscrits sur cette fameuse liste afin de constituer la garde nationale. Cette histoire n’était pas finie puisqu’au printemps 1793, tous les jeunes hommes furent convoqués en la maison commune, dont les fils Jouve. Ils furent priés de rejoindre les rangs de l’armée. Mais, compte-tenu du nombre de postulants, le conseil municipal décida que la commune attendrait le résultat obtenu pour ce recrutement dans les autres communes et en particulier celle de Saugues, chef-lieu du canton. La réponse ne convainc pas la municipalité de Saugues qui pria celle de Cubelles de désigner quatre volontaires. Deux d’entre eux, étaient des jeunes habitants d’autres villages de la commune et, les deux autres furent des domestiques. Les fils Jouve échappèrent à la conscription.
La situation politique, quoique lointaine, et ses répercussions locales faisaient l’objet de palabres au marché et les hommes, au café, parfois éméchés prenaient position pour l’un ou pour l’autre, entraînant parfois des bagarres. Anne tenait à l’œil ses jeunes. Elle ne voulait pas d’histoires et elle le faisait savoir à ces jeunes hommes parfois impulsifs. Elle était juste mais elle était crainte. Elle ne tolérait pas les écarts de conduite sous peine d’être privé de sortie. Et cela, donnait à réfléchir car le marché du vendredi était la seule sortie autorisée en dehors de la participation à la messe, le dimanche, à l’église de Cubelles.
Aussi, elle décida que son état de santé était devenu trop précaire. L’arrivée d’une jeune femme serait la bienvenue pour prendre le relais. Il était temps que l’aîné des fils, Joseph, se marie. Aussitôt pensé, elle mit en demeure Joseph, l’héritier désigné par le père, de prendre femme. Elle se mit à la recherche d’une femme pour son neveu. L’arrivée d’une bru dans la famille ne pouvait pas être laissée à la seule appréciation du futur mari, la famille avait aussi son mot à dire. Tout le monde allait devoir vivre avec. Alors, cela demandait réflexion, le choix s’avérait parfois bien compliqué.
Il y avait bien Baptistine, une fille du village qui venait l’aider, au printemps, à faire la bujade* et à laver la laine des moutons à la rivière mais elle ne l’envisageait pas comme bru pour aucun de ses fils. Elle était gentille, serviable mais incapable de prendre une initiative et cela l’agaçait. Et puis, Joseph la trouvait niaise. Cela ne pouvait pas faire.
Il lui fallait une fille avec qui elle s’entendrait bien, agréable à vivre mais surtout travailleuse, n’ayant pas peur à la tâche, intelligente, prenant des initiatives, vivant en bonne entente avec le reste de la fratrie, tout en sachant s’adapter à Joseph et rester à sa place. Autrement dit, Anne devait trouver l’oiseau rare, et ce n’était pas une mince affaire.
Elle avait bien une idée sur la façon de procéder afin de trouver la jeune fille au goût de Joseph et qui lui donne un héritier. Elle espérait fortement, en tous cas, que cela marcherait.
Elle commença à prospecter.
II
Automne 1793
Encore une fois, les quelques jeunes du village de La Fagette, paroisse de Venteuges, avaient envoyé des pierres en direction de Catherine, qu’il surnommait la sorcière. Ce mardi, elle était venue, comme tous les mardis de l’année, apporter le repas de la béate*, au nom de sa famille. Chaque jour, une famille différente, nourrissait la béate contre les services qu’elle rendait à la communauté (apprentissage du catéchisme, accompagnement des malades, éducation des enfants). Comme d’habitude, quelques chenapans l’avaient attendue afin de lui chercher querelle. Elle s’en était allée, comme de coutume, sans rien dire. Aujourd’hui, elle avait une magnifique chevelure rousse, mais il n’en avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps, elle s’était rasée les cheveux avec le rasoir de son père : elle ne supportait plus les quolibets, remarques de tous genres et vexations de la part des jeunes de son âge au village. Elle était rousse, et alors était-elle une sorcière ou une jeune fille de mauvaise vie pour autant ?
Catherine se sentait très seule, dans ce village. Fille unique de Marguerite Chausse et de Joseph Torrent, elle avait des parents déjà âgés alors qu’elle n’avait que quinze ans. Elle n’avait pas de sœur à qui se confier et encore moins d’amie. Elle rêvait de rencontrer un jour quelqu’un capable de la comprendre et de l’accepter avec ses cheveux roux.
Pourtant Catherine avait un caractère agréable, facile à vivre et elle était compatissante. On la voyait ramasser des animaux blessés, les soigner puis les relâcher. Les parents des chenapans, en quête de mauvais tours à jouer, l’enviaient. Ils auraient aimé avoir une fille comme elle mais hélas, elle était la fille de Marguerite et de Joseph. Quelle femme du village n’avait pas eu affaire à Marguerite, lors de leur grossesse ? Aucune femme ne pouvait le nier si elle avait des enfants plus jeunes que Catherine.
Marguerite Chausse, la mère de Catherine, originaire du bourg de Venteuges, avait épousé Joseph Torrent, c’était le 15 juillet 1777, un mardi. Elle s’en souvenait comme si c’était hier. Il était tellement beau dans son costume confectionné pour l’occasion. Joseph, lui, était de La Vacheresse, hameau de la paroisse de Venteuges. Il y avait un beau soleil, le matin, ce jour-là. Puis, dans la journée, des nuages apparurent, une chaleur étouffante s’était installée. Le temps était à l’orage. Malgré tout, le repas des noces s’était tenu, à l’extérieur dans le pré devant la maison familiale, fauché, en prévision de la fête. De grandes tables avaient été installées recouvertes de nappes blanches, décorées de fleurs des champs, pour accueillir les nombreux invités. Des voisines étaient venues aider les deux servantes embauchées pour l’occasion. Les Torrent étaient une famille de laboureur aisée et l’activité complémentaire de marchand était rémunératrice. Ils étaient estimés. En cas de soucis, les voisins venaient voir le père.
Marguerite était cadette dans une fratrie composée de six filles. Elle était veuve de Vital Sauvant lorsqu’elle rencontra Joseph Torrent. De cette première union contrainte, aucun enfant n’était né. La vie d’une femme veuve sans descendance n’était pas aisée. Marguerite obtint de sa famille qu’elle puisse mener sa vie à sa guise, ce que peu de femmes obtenaient de leur famille. Puis elle avait rencontré Joseph. L’épouser avait été un choix qu’elle assumait pleinement alors qu’elle avait déjà trente-sept ans. Et, l’arrivée de Catherine avait été un bonheur pour eux alors qu’elle avait failli perdre la vie. Le fait d’être confrontée à la mort avait modifié complétement sa façon de voir les choses. Claire, la religieuse qui l’a soignée lui avait permis de s’ouvrir à des idées et à des pratiques nouvelles. Elle s’était engagée avec cette religieuse pour une meilleure hygiène lors des grossesses et des accouchements. Maintenant, elle bénéficiait d’une certaine renommée. On faisait appel à elle pour des conseils.
Bien qu’aîné de la famille, Joseph avait laissé sa place à son frère Jean sur l’exploitation agricole, située à La Vacheresse (autre hameau de la même paroisse). Reprendre les activités de laboureur et de marchand de bestiaux de son père ne l’intéressait pas, il préférait le travail de la ferme, cultiver les champs et surveiller ses animaux. Il était connu pour être un honnête travailleur. Une fois marié avec Marguerite, il avait postulé comme métayer à La Fagette, à la ferme du château. Le seigneur de Roquelaure et de Pompignac, propriétaire du château et du domaine était absent : personne n’avait affaire à lui directement hormis André Bonhomme, un des notaires à Saugues, qui en était le censitaire*. Vaquant à ses occupations de notaire, il n’avait ni le loisir ni les compétences pour s’occuper de ce domaine dont il payait le cens, il avait embauché Joseph, comme métayer. De la considération existait entre eux : le notaire Bonhomme l’estimait compétent si bien qu’une relation de confiance s’était établie au fil des ans. Si un désaccord survenait, ils prenaient le temps d’en discuter longuement afin de trouver un accord. La famille de Joseph logeait dans une petite maison jouxtant le château. Elle était relativement confortable.
En quittant la ferme de La Vacheresse, Jean Torrent, son père lui avait donné un pécule qu’il avait investi dans l’achat d’un troupeau composé de quelques vaches et de moutons. Le fermier en avait fait autant. Joseph avait ainsi à sa disposition un troupeau qui permettait de faire vivre sa famille avec une certaine aisance, si tout allait bien. Il se sentait une liberté que n’avait pas son frère à La Vacheresse, à condition qu’il réussisse, ce qu’il comptait bien faire avec l’assentiment du notaire.
À La Vacheresse, les biens des Torrent dépendaient majoritairement du chapitre de Saugues, auquel, ils payaient un cens annuel. Le reste était dû aux Dames des Chazes, monastère bénédictin gérant le prieuré de Venteuges.
La vie de Joseph aux côtés de Marguerite était agréable. Ils formaient un couple harmonieux. Catherine était leur fille unique.
Catherine faisait tourner les têtes lorsqu’elle passait en compagnie de sa mère dans le village de Venteuges pour aller à la messe le dimanche matin. Catherine était sa fille chérie. Elle serait bientôt en âge d’être mariée. Lorsqu’elle s’est mariée, Marguerite était analphabète, elle n’avait pas voulu que Catherine soit comme elle. La béate du village l’avait accueillie, dès son plus jeune âge, pour lui apprendre ses prières et être bonne chrétienne. Catherine avait aussi appris les rudiments de la lecture et de l’écriture. Marguerite voyait partir sa fille aux champs avec son père pour l’aider dans les travaux agricoles car elle était courageuse, sa Catherine et rien ne lui faisait peur.
Catherine s’avérait être une enfant gaie, volontaire et résolument optimiste. Elle aimait bien aller avec son père aux champs. Elle aimait particulièrement s’occuper des animaux et surtout des petits qui venaient de naître.
Lorsqu’elle voyait son père préoccupé, elle disait toujours, en le regardant en souriant :
- Ne t’inquiète pas, mon petit papa, on va s’en sortir.
Pourtant, ce n’était pas, tous les jours, réjouissant. Il faisait un temps épouvantable, en été, il pleuvait et faire les foins était compliqué, après un printemps trop sec. Les récoltes n’étaient pas celles espérées et on s’inquiétait. « Comment allons-nous faire ? » C’était la préoccupation de tous les paysans. Les animaux étaient fragiles et résistaient mal aux parasites. Les vaches avaient peu de lait, à peine suffisamment pour élever leur veau, alors les traire, il ne fallait pas y penser.
Marguerite avait quinze ans lorsque sévissait la « Bête », celle qui s’attaquait aux femmes et aux enfants. Marguerite, bien qu’elle aille garder les troupeaux avec ses sœurs ne l’avait jamais vue, mais elles avaient eu peur, elles s’étaient senties vulnérables. Elles imaginaient des tas de stratagèmes pour faire face à la Bête. Elles prenaient de gros gourdins en partant avec leurs vaches au pâturage, surtout lorsque celui-ci était éloigné du village ou en lisière des bois situés derrière Venteuges en direction du château de Meyronne. Les moutons étaient gardés par le berger du village qui avait un chien dressé.
L’année 1789 arrivant, les colporteurs parlaient des évènements qui se déroulaient à Paris, apportant les nouvelles. Ils disaient que le roi était prêt à gouverner avec une assemblée composée d’élus du peuple. Cela intéressait Joseph, il était curieux de savoir comment cela allait tourner et il en parlait avec Marguerite. Puis, il apprit que le roi avait fui, que Robespierre avait pris le pouvoir et que c’était la terreur à Paris. On guillotinait à tour de bras. Il avait appris que le jeune seigneur de Meyronne, Jean-Baptiste de Domangeville avait été guillotiné et les terres de Meyronne avaient été saisies. Ici à Saugues, on ne comprenait pas trop ce qu’était ni ce que faisait le comité révolutionnaire. En tous les cas, André Bonhomme, le censitaire qui était devenu propriétaire des terres et du château lors de l’abolition des privilèges, s’en tenait éloigné bien qu’il vît la Révolution plutôt d’un bon œil. De même, le frère de Joseph, Jean était devenu propriétaire et ne payait plus rien au chapitre de Saugues. Ce changement avait bénéficié au notaire et à son frère Jean mais cela n’avait rien changé pour Joseph, il restait toujours métayer et, dans les mêmes conditions. Il trouvait cela particulièrement injuste, mais que faire ?
Marguerite était intéressée par ce que l’on disait au sujet du statut des femmes. Le colporteur avait parlé d’Olympe de Gouges qui défendait les femmes, cela l’avait intéressée car elle sentait bien que cette femme avait compris ce que vivaient les femmes, surtout ici à la campagne. Pour elle, cela faisait résonance, mais comment changer ? C’était la perpétuelle question, à laquelle, elle n’avait pas de réponse. Qu’avait-elle fait de mal, cette femme, pour qu’elle soit ainsi guillotinée comme tant d’autres ? Si défendre les femmes méritait la mort, cela la laissait perplexe. Elle, avec Joseph, elle avait eu de la chance, ce qui n’avait été le cas avec son premier mari, lorsqu’il revenait de la foire à Saugues, il était saoul comme un cochon : il la violait, la battait pire que plâtre si bien que sa mort l’avait laissé froide, voire soulagée. Elle était partie de Masset avec son baluchon, ses deux brebis et son rouet.
Après son veuvage, elle avait demandé le statut de femme-majeure, le conseil de famille avait statué en sa faveur. Sinon, Marguerite n’aurait pu décider de rien concernant son avenir. Alors, elle avait trouvé une petite maison, attenante à l’atelier du maréchal-ferrant, Jean-François Veiret, dans le bourg de Venteuges. Elle travaillait la laine de ses moutons qu’elle amenait paître sur les communaux et les terres vaines. Elle achetait un peu de la laine surge* à sa sœur. Marguerite la lavait, la cardait et la filait. Avec son fil, elle faisait des bonnets, des tricots, des gants qu’elle allait vendre sur le marché à Saugues, le vendredi. Elle en avait mis aussi en dépôt dans le magasin des sœurs Pastre, mercières à Saugues, dans la rue des Roches. Elle gagnait ainsi sa vie. Elle se savait privilégiée.
Catherine était leur fierté, elle avait seize ans, déjà : cette jeune fille était longiligne, rousse, aux yeux verts. Catherine paraissait sûre d’elle tout en étant parfois d’une timidité presque maladive. Elle était belle leur fille et Marguerite était profondément émue en la regardant. Elle apparaissait, aux yeux des autres, comme indépendante, volontaire. Elle avait bon cœur.
L’avenir de Catherine les inquiétait car le couple n’avait pas de patrimoine. Le seul bien, qu’il possédait, était la moitié de leur troupeau de vaches et de moutons et une jument. Tout le reste appartenait au notaire, André Bonhomme. Joseph n’était plus tout jeune, perclus de rhumatismes, il avait du mal à faire tout son travail. Heureusement que Catherine était là pour l’aider. Et, puis Catherine était rousse, cela n’allait-il pas être un obstacle ? Certains considéraient les femmes rousses comme des sorcières ou des femmes de mauvaise vie, comme une personne dont il fallait se méfier. Dans les iconographies médiévales de l’église, la chevelure rousse était associée à traitrise, à l’exemple de Caïn qui tua son frère Abel ou Esaü qui vendit son frère pour un plat de lentilles, dans l’Ancien testament ou encore Judas dans la Bible. Lorsqu’elle était petite fille, les enfants du village l’appelaient la « rouquine » ou plus méchamment « la sorcière » avec un mélange de peur et de dédain. Les garçons, en particulier, se moquaient d’elle et la menaçaient. Plusieurs fois, la béate avait dû intervenir en sa faveur. Cela n’allait-il pas la desservir ?
C’est à ce moment-là de leur réflexion que le curé Rougeyron, les avait contactés au sujet de Catherine. Cette demande du curé, bien qu’il ne soit plus dans les petits papiers des autorités, -il avait refusé de prêter serment et il n’avait plus le droit de dire la messe-, les intriguait tout de même. Pour le curé qui connaissait Catherine et ses parents, la couleur de sa chevelure n’avait aucune importance, il n’allait pas chipoter là-dessus à propos d’une de ses ouailles. Il avait autre chose à faire. C’étaient de bons chrétiens, c’était ce qui lui importait, surtout en cette période où l’autorité de l’église était contestée et que tout allait à vau-l’eau. Ses ouailles, surtout les hommes, désertaient son église et prenaient leur aise vis-à-vis de la religion.
Alors, que voulait-il à Catherine ? Marguerite ne voulait pas que sa fille vive le même enfer qu’elle. Elle la voulait heureuse. Elle espérait qu’avec son mari, ils sauraient-ils faire le bon choix pour Catherine.
Ces questions taraudaient Marguerite.