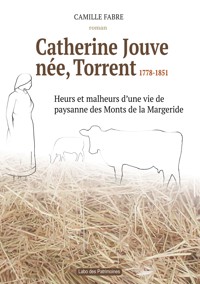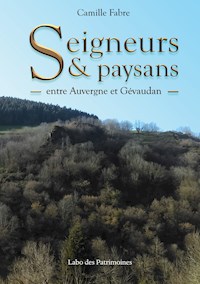
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Je me suis intéressée à la seigneurie de Meyronne, en 1989, après le décès de mon père. Il y avait, dans une boîte, des papiers de famille, la plupart en mauvais état et dont le plus ancien datait de 1592. En dépouillant ces documents, il est vite apparu que mes ancêtres étaient censitaires de la seigneurie de Meyronne, comme laboureurs. Leur destin avait dépendu, pendant plusieurs siècles, de ce château, aujourd'hui en ruine, qui avait été le siège d'une seigneurie importante pour la région, à cheval entre le Gévaudan et l'Auvergne." Camille Fabre
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Introduction
Une vallée entre Auvergne et Gévaudan
Les voies d’accès à Meyronne
Le prieuré de Pébrac et l’émergence d’une seigneurie
L’énigmatique Na Castelhoza
Vers de nouveaux sites...
Les guerres de religion : les répercussions locales
Un terrier, mais pour quoi faire ?
Une seigneurie en expansion
Une alliance régionale avec une famille renommée et fortunée : les Apchier
La vie paysanne au XVII
e
siècle
Fin de la résidence à Meyronne, revenu diversifié pour les seigneurs et gestion par des fermiers
La vie paysanne au village : une nouvelle venue, la béate
Par accident, la seigneurie devient baronnie
Nouveau seigneur, nouveau fermier et nouvelle gestion
1764-1767 : la bête du Gévaudan, une période troublée et charnière pour la seigneurie
Une période agitée sur les plans économique et social
La fin de la seigneurie et des terres de Meyronne
Le château de Meyronne au XXI
e
siècle
Conclusion
Glossaire
Documents annexés
Bibliographie
Table des illustrations
Table des annexes
Remerciements
Introduction
Pourquoi un château perché sur un rocher à mi-côteau d’une vallée étroite et encaissée, dominant un petit village de quelques habitants ? Les rares terres cultivables sont pentues et difficiles d’accès. La question se pose : pourquoi une seigneurie a-t-elle choisi de s’installer dans un tel endroit ?
Cette vallée est située, dans le département de la Haute-Loire, entre les communes de Langeac et de Saugues, dans la partie plus montagneuse, à l’ouest de la route qui relie ces deux villes. En partant de Langeac, le village de Meyronne se situe dans le premier contrefort avant d’atteindre les monts de la Margeride, dominés par le Mont Chauvet (1486 m.) et le Truc de la Garde (1486 m.), le Mont Mouchet (1497 m.). Il permet d’accéder au plateau de Saugues (900 à 1100 m. d’altitude), sur lequel se trouve la commune de Venteuges, dont dépend Meyronne.
Figure 1 : Département de la Haute-Loire
Sources :IGN FranceRaster GEOFLA
Je me suis intéressée à la seigneurie de Meyronne en 1989, après le décès de mon père. Il y avait, dans une boîte, des papiers de famille, la plupart en mauvais état, et dont le plus ancien datait de 1592. En dépouillant ces documents, il est vite apparu que les ancêtres de ma famille payaient des redevances, c’est-à-dire un impôt censitaire* à la seigneurie de Meyronne. Le destin de mes ancêtres avait dépendu, pendant plusieurs siècles, de ce château aujourd’hui en ruine qui avait été le siège d’une seigneurie importante dans la région à cheval entre le Gévaudan et l’Auvergne.
Figure 2 : Meyronne, vue à partir du sentier allant de Venteuges à Meyronne
© Camille Fabre
Quelques années plus tard, Mestre, un collectionneur, qui détenait l’original du « Terrier de Meyronne »1 m’en a fait une copie, ce dont je lui suis reconnaissante. De nos jours, un propriétaire dispose du cadastre pour avoir une connaissance précise de ses biens. Ce cadastre est remis à jour périodiquement. Dans les années 1570, les nobles, pour connaître leurs possessions et l’étendue de leur richesse, faisaient élaborer un terrier*, mis à jour périodiquement, ce qui fut le cas du seigneur de Meyronne, Antoine de Dorette. Terrier dans lequel j’ai retrouvé des traces de mes aïeux. Je me suis alors intéressée à l’histoire de la région. Le travail de transcription de ce document a comblé mes nuits d’insomnie et mes temps libres. Magistral document, ce terrier faisait encore référence à la veille de la Révolution Française, puisque Claude Béraud, dernier fermier* gestionnaire des terres de cette seigneurie, « trouve ce terrier beaucoup mieux fait et plus complet que le dernier ». Il estime qu’il faudrait privilégier son utilisation s’il était renouvelé2.
Il est possible de lire ce document du côté des possédants : il s’agit d’un état des lieux de leurs possessions et des revenus, financiers et en nature, que cela leur procure. On peut aussi l’aborder sous un autre angle : que dit ce document sur la paysannerie et les structures agricoles de cette région à la fin du XVIe siècle ? Pouvait-il servir de document de référence afin d’analyser l’évolution de ces structures dans le temps ? Quelles relations entretenaient ces paysans avec le bâti et le foncier qu’ils exploitaient au point de les considérer comme l’ancrage de la famille qui a été désigné comme l’oustal* au XIXe siècle ?
Il a servi de base de départ pour ce long travail de recherche. Il a été complété par les archives seigneuriales (justice et fiscalité, actes d’achat et de vente, aveu et dénombrement*), des archives familiales et les minutes notariales. Une bibliographie est proposée à la fin de l’ouvrage.
Je me suis particulièrement intéressé à l’étude de la paysannerie dans un cadre monarchique. Quelles relations entretenait-elle avec les autres couches de la société ? Comment les différents corps de métier coexistaient et s’entraidaient ? Comment les couches les plus défavorisées de la population étaient-elles prises en considération ? Y avait-il des mécanismes de prise en charge des miséreux ?
À quel impératif obéissait la seigneurie dans sa recherche de croître, d’abord sur le plan local par des alliances matrimoniales puis, plus tardivement, en se fondant dans des ensembles plus vastes étant proche du pouvoir royal ? Gérées par de petits seigneurs terriens, ces terres sont devenues, au fil des siècles, les possessions d’une baronnie, celle du baron Thomas de Domangeville (XVIIIe siècle).
Une raison supplémentaire, pour moi, de m’intéresser à cette seigneurie est la présence de Na Castelhoza, célèbre troubadoure du XIIIe siècle, reconnue parmi les plus influentes. Si ses origines restent encore incertaines, comme nous le verrons, ne doit-on pas s’interroger sur les raisons qui ont amené une jeune femme lettrée à vivre à Meyronne ?
Nous nous attarderons peu sur la période médiévale ; elle est connue par les travaux de l’abbé Fabre3. Cet ouvrage est le fruit d’un travail de recherche mené depuis plusieurs années sur la période débutant au XVIe. Comment ont évolué de façon concomitante cette seigneurie et les censitaires appartenant à ces terres ?
1 Noble Antoine de Dorette a passé commande de ce dossier à Jacques Langlade, notaire royal.
2 Mention écrite dans les premières pages du terrier de 1571-1573.
3 FABRE F. (abbé), Les seigneurs de Meyronne près Saugues (Haute-Loire), Imprimerie Gustave Mey, Le Puy-en-Velay, 1902, 19 pages.
– 1 –
Une vallée entre Auvergne et Gévaudan
Sous l’Ancien Régime, le sud de cette vallée faisait partie de la paroisse de Meyronne/Venteuges*. La partie nord dépend de la paroisse de Desges. À trois kilomètres de Venteuges, à l’ouest, descend un val profond et étroit, orienté sud-nord-est, aux pentes escarpées et au fond duquel murmure un petit ruisselet dénommé La Meyronne qui va se jeter dans le ruisseau : la Desges, affluent de l’Allier.
Figure 3 : Village de Meyronne
Source :Cadastre napoléonien AD 43
À l’intersection du ruisseau et du ravin de la Pereyre, à environ 850 mètres d’altitude, niché à flanc de l’adret, le village de Meyronne et son château s’éveillaient avec le soleil matinal. À l’automne, les couleurs vues du château étaient des plus flamboyantes : une mosaïque de couleurs composée où dominaient le vert des conifères, l’ocre, le rouge et le jaune de la hêtraie. Au fur et à mesure, la saison s’avançant, la pourpre cédait au gris-vert jusqu’à la tombée des feuilles. S’installait alors une impression de désolation. À moins que la neige ne leur donnât une nouvelle splendeur.
De bise4, la bien nommée, le château était balayé par un vent sec et froid ; en ouest, le soleil pouvait inonder le haut du village, jusque tard dans la journée. Au sud, à l’abri, se trouvaient la cour du château et les bâtiments de la ferme. Au sud et en dessous du château s’étageaient des pâtures, des vergers et des terrasses de cultures dont il ne reste que quelques vestiges. En descendant vers le ruisseau, quelques parcelles, abritées, devaient être des champs. En remontant la vallée du même nom au sud, s’étendait sur le plateau (à 1050 m environ), la plupart des terres de la seigneurie de Meyronne, exploitées dans le cadre de la censive seigneuriale. C’était la partie gévaudanaise des terres de Meyronne.
La partie auvergnate était au nord de la vallée, là où elle rejoignait celle de la Desges en contrebas vers l’abbaye de Pébrac, située à proximité, suivant le ruisseau qui venait grossir les eaux de la Desges. La vallée, encaissée, était moins ensoleillée que la partie haute de la vallée, principalement durant la période hivernale. L’ubac était peuplé d’une forêt de feuillus et de conifères mêlés, servant d’habitat notamment aux cèpes et aux sangliers.
4 "De bise" désigne l’orientation nord-nord-est d’une parcelle ou d’un bâtiment.
– 2 –
Les voies d’accès à Meyronne
L’accès à Meyronne s’avérait plus facile en provenance du sud que du nord. Avant la construction de la route actuelle, un accès était possible par le chemin au nord-ouest, traversant le plateau à partir du village de la Bastide et puis allant jusqu’à Meyronne. Par ce chemin, la première image avec le village était le château que l’on apercevait juste en contrebas. Celui-ci devait être emprunté par les habitants du village de La Soucheyre, paroisse de la Besseyre-Saint-Mary. Situé plus à l’ouest sur le plateau, ce village avait dépendu de la seigneurie de Montmonadier, rattachée à Meyronne probablement à la fin du Moyen-Âge.
Mais, le plus direct, sur le flanc est de la vallée, à partir de Venteuges, était celui qui longe un petit torrent, un filet d’eau qui prend sa source en dessous de l’actuel calvaire. Le sentier était étroit, escarpé, ressemblant parfois à celui emprunté par les chèvres ; il traversait la forêt de feuillus et de conifères. Le torrent qui grossit au fur et à mesure se confondait, parfois, avec la piste avant qu’il ne s’enfonce dans une gorge profonde et sur lequel s’était formée une série de petites cascades. Ce ruisselet était un affluent du ruisseau dénommé La Meyronne. Le trajet s’effectue en une grosse demi-heure.
Du nord, l’accès se faisait par la vallée de la Desges, encaissée et peu ensoleillée.
Les marchandises étaient, comme ailleurs, transportées à dos de mulet. Les muletiers utilisaient les mêmes voies de passage que celles empruntées par les hommes.
– 3 –
Le prieuré de Pébrac et l’émergence d’une seigneurie
L’histoire des terres de Meyronne est indissociable de celle du prieuré* et de l’abbaye de Pébrac, situés un peu plus bas dans la vallée de la Desges.
Aux XIe-XIIIe siècles, comme ailleurs durant cette période d’expansion5, un vaste mouvement de défrichement a été initié de façon conjointe par les paysans, en quête d’un nouveau lopin de terre pour se nourrir, et par les seigneurs. Les paysans fournirent la main-d’œuvre et les seigneurs, restant maîtres de leurs forêts, acceptèrent que des parties puissent être transformées en terres labourables. Pour cela, de nouveaux ordres religieux ou des ermites, cherchant l’ascétisme et la solitude, s’établirent dans des zones en friche détenues par les seigneurs6 ainsi que des individus isolés et probablement libres. C’est dans ce contexte que Pierre de Chavanon créa le prieuré de Pébrac et que se développèrent les relations entre la châtellenie de Meyronne et le prieuré devenu ensuite abbaye.
Qui était Pierre de Chavanon, le fondateur du prieuré de Pébrac ?
Né (-1080) dans une famille aristocratique, à Langeac où il fut archiprêtre, il devint le directeur spirituel de l’abbaye des Chaze, réformant cette communauté religieuse, affilié à l’ordre de Saint-Benoît7. Il se retira à Pébrac où il avait fondé un prieuré en 1062, et fut secondé par Pierre et Guy d’Artois. Robert II, comte d’Auvergne, ayant des possessions à proximité, avait cédé ses droits au prieuré de Pébrac sur le château de Ganillon, ce qui permit au prieuré de grandir en notoriété et en capacité financière.
En 1070, Pierre de Chavanon unit la prévôté* de Pébrac à la collégiale de Brioude, grâce à un membre de la famille de Lastic. Pierre Gaillart fils d’Henri (fondateur de cette maison) et d’Aldéarde de Mercœur, participa à la conclusion du traité entre ces deux institutions en tant que prévôt de Pébrac et chanoine-comte de Brioude8. La maison de Lastic (Cantal), affiliée à la famille des Mercœur, a été présente au sein du prieuré de Pébrac, dès le départ.
Puis, le prieuré de Pébrac accrut sa zone d’influence par le rattachement d’églises dépendantes des évêchés de Clermont, de Viviers et de Rodez9. Enfin, le pape Urbain II, en visite à Brioude, a « érigé » ce monastère en abbaye en 109510. Date à laquelle il initia à Clermont-Ferrand, la première croisade.
Cela est-il anodin pour la seigneurie de Meyronne ?
Le château de Meyronne, ses châtelains et ses terres étaient inconnus avant l’installation du prieuré de Pébrac. C’est grâce aux écrits et aux relations qu’ils entretenaient que nous pouvons, aujourd’hui, comprendre le développement de cette châtellenie, qui deviendra seigneurie puis quelques siècles plus tard baronnie.
Les premières mentions de la famille habitant le château de Meyronne datent du XIe siècle dans le Cartulaire* de l’abbaye de Pébrac11. D’abord, elles sont apparues sous forme de donations lors de funérailles des membres de la famille, notamment, assez modestes mais nombreuses. En 1142, Bernard de Meyronne et ses frères Foulques et Drogon, ont donné à l’abbaye Sainte-Marie de Pébrac, trois parts de sépulture en l’église du village de Desges, une redevance de cent poissons12 et une émine d’avoine pour que soit célébré l’office de sépulture de Pierre de Meyronne13.
Puis ce fut Trucha, veuve de Drogon qui, avec ses fils Pierre, Bertrand et Truchetz, fit donation de tous les biens qu’elle possédait à Chadernac à l’abbaye de Pébrac pour l’âme de son époux défunt. Les témoins sont de Tauliac ou Talhiac, Eblo prieur de Pébrac, de Vilaret et Palesmus de Grèzes14.
Durant cette période (XIIe et XIVe siècles), les données sont trop fragmentaires pour qu’une généalogie cohérente puisse être réalisée15. Les seuls éléments sérieux que nous ayons en notre possession sont : certains, restés sur place s’étaient alliés à la famille de Lastic, et/ou avaient hérités de biens (Lastic et Ruynes-en-Margeride)16 ; d’autres par alliance s’étaient installés ailleurs (Lempdes-sur-Allagnon)17 ; d’autres s’étaient mis au service de la maison de Polignac18. Durant cette période, il n’était pas rare qu’une seigneurie castrale* se vende au plus offrant ; enfin d’autres participèrent aux croisades. (Document 1, annexé).
Les relations entretenues, par la maison de Lastic dès XIe siècle, avec le prieuré de Pébrac s’intensifièrent. Au XIIe siècle, Guillaume de Lastic, troisième fils d’Etienne de Lastic, devint abbé de Pébrac alors que son frère aîné était chanoine-comte de Brioude19. Ils étaient tous les deux des cadets de famille. La présence de religieux dans cette structure religieuse de proximité, depuis sa création, rendit probablement possible la création de relations matrimoniales avec d’autres seigneuries que celles existantes localement.
Ainsi, un siècle plus tard, des relations matrimoniales s’établirent entre les Lastic, les Meyronne et les Tailhac. (Document 2, annexé).
Deux filles de Pierre Bompar III de Lastic ont épousé respectivement un membre de la famille de Meyronne et un autre de la famille de Tailhac, introduisant ainsi des liens de parenté entre ces deux familles. Ces mariages sont accompagnés de donations territoriales revendiquées ultérieurement.
Figure 4 : Généalogie des Lastic
Source :Geneanet Henri Pichot
5 GAUVARD Cl., La France au Moyen-Âge du V e au XVe siècle, Quadrige Manuels, PUF, 2019.
6 DUBY G., L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’occident médiéval, tome 1, pp. 154155, Champs-Flammarion, 1990.
7 POUGET J. « Les Chazes », in Almanach de Brioude, p.112 et suivantes, 1923.
8 LASTIC-SAINT-JAL (de), A., Généalogie de la maison de Lastic, Imprimerie Henri Oudin, Poitiers, 1858, BNF-Gallica. Lastic est un petit village situé dans le Cantal actuel au nord de Saint-Flour en direction de Massiac. Il domine la Planèze.
9 BNF, Monumenta pontificia arveniae decurrentibus IX°, X°, XI°, XII° saeculis. Correspondance diplomatique des papes, BNF-Gallica.
10 DU TEMS H., Le clergé de France, ou tableau historique et chronologique des archevêques, évêques, abbés, abbesses, et chefs des chapitres principaux du royaume, depuis la fondation des églises jusqu’à nos jours, tome 3, p. 275-280, Brunet, Paris, 1775.
11Terrarium S. Petri de Chavano, primo prepositi Piperaci, abbaye de Pébrac (diocèse de Mende), 1711, département des manuscrits en latin, n° 9855, BNF-Gallica.
12 FABRE (abbé), la Desges qui descend des alentours de Pinols est réputée pour être très poissonneuse.
13Tablettes historiques du Velay, Tome V, 1874-1875, Cartulaire de Pébrac, N° 37, page 166, BNF-Gallica.
14 Tablettes historiques du Velay, Tome V, 1874-1875, Cartulaire de Pébrac, N° 49, page 40, BNF-Gallica.
15 FABRE F. (abbé), Les seigneurs de Meyronne près Saugues (Haute-Loire), Imprimerie typo-lithographique Gustave Mey, Le Puy-en-Velay, 1902.
16 Archives Nationales (AN), Document 18679, Inventaire des lettres, titres, enseignements titres en pays d’Auvergne et en Gévaudan concernant la châtellenie et seigneurie de Salgues, document établi par les notaires royaux Gérault Planchette et Guillaume Pelisse pour le prince et monseigneur Gilbert Bourbon comte de Montespan, dauphin d’Auvergne, comte de Clermont et baron de Mercœur. Document dénommé Hereditas domini, p. 437. BNF-Gallica. Reconnaissance en 1322, par Bertrand de Meyronne d’une vassalité sur des châtellenies qu’il détient à Lastic et à Ruynes-en Margeride au nom de sa mère. Bertrand de Meyronne et Béraud de Taillac, dit seigneur de Meyronne seraient cousins germains par leur mère respective issue de la famille de Lastic, (lieu situé dans le Cantal actuel).
17 FOURNIER G., « Lempdes Haute-Loire, Histoire et topographie », in Almanach de Brioude, 1989, pp.19-39. AN, R 4* 1143 folio 327, n°718 ; Folio 158, n°310 (1284) ; Folio 162, n°323 (1366), au moins un siècle sépare Truc de Meyronne mentionné dans cet acte de l’époux de Béatrice de Lempdes qui portait le même nom.
18 JACOTIN A., Preuves de la maison de Polignac, recueil et documents, tome I, Ré-édition Lacour. Polignac est situé dans le Velay, à proximité du Puy-en-Velay.
19 LASTIC-SAINT-JAL (de), A., Généalogie de la maison de Lastic, op.cité.
– 4 –
L’énigmatique Na Castelhoza
C’était à peu près à cette période que Na Castelhoza – son nom est orthographié de différentes façons : Dona Castellosa, Na Castelloza, Na Castelhauza, Dame de Castel Doze – serait arrivée au château de Meyronne. Elle serait née entre 1195 et 120520 au Castel d’Oze, château situé à Sénezergues dans la Châtaigneraie cantalienne. Cette hypothèse développée par plusieurs auteurs21 prend appui sur la légende rapportée par l’abbé Peyrou22. L’abbé Prouzet, historien lozérien, lui donnait des origines espagnoles, jugées peu crédibles par différents auteurs23. Elle a été reconnue comme troubadoure auvergnate, en 1230. Le troubadour Hugues (Uc) de Saint Circ en aurait écrit la biographie, qui se résumait en quelques lignes. Robert, dauphin d’Auvergne, également troubadour, a indiqué qu’elle était d’Auvergne, il n’est pas précisé le lieu de sa naissance.
À cette période, afin d’accéder aux sphères seigneuriales plus élevées, les seigneurs locaux épousaient des femmes d’un rang supérieur au leur. La femme était tributaire de l’homme et devait lui être soumise en tous points, la seule exception faite était son rôle dans la procréation afin de donner des héritiers et d’assurer leur éducation24. Les enfants nés, dans le cadre du mariage, étaient les seuls reconnus comme héritiers. Et, dans la noblesse, souvent la cohabitation conjugale était brève : l’homme partait guerroyer et pouvait mourir au combat et la femme décéder en couches.
Figure 5: Icône de Na Castelhoza
Source :BNF, ms. 854, fol.125-Na Castelloza.
Dans ce contexte, Na Castelhoza, femme lettrée, cultivée et raffinée25, faisait exception, ce qui apportait à la seigneurie de Meyronne une renommée, et constituait peut-être un atout pour l’éducation des héritiers.
Félix de La Salle de Rochemaure, n’avait aucun doute : elle était issue de Castel d’Oze, elle était la dernière héritière de ce château inféodé à la vicomté de Carlat (Aveyron). La vallée d’Oze fut décrite, en 1846, par un journaliste cantalien comme une vallée triste dont les versants étaient peuplés de châtaigniers et de chênes, surnommée, dans sa partie méridionale « les portes de l’enfer ». C’était la résidence préférée de Henri Ier, comte de Rodez et vicomte de Carlat, au XIIIe siècle.26
Elle aurait épousé, vers 1230, Turc de Meyronne, homme fougueux, querelleur et violent, d’un certain âge, à la barbe grise, ayant guerroyé en Palestine ou en Egypte27, au cours d’une croisade d’où il serait revenu mutilé. Robert, dauphin d’Auvergne dans son Sirventes28 contre l’évêque de Clermont, son cousin, disait « qu’il va guerroyant sans cesse, pis que Turc de Meyronne »29. De ce mariage, est issu Antoine de Meyronne dit Truc, devenu seigneur de Lempdes par son mariage en 1280 avec Béatrice de Lempdes. Son petit-fils était Béraud dit le « Turc », en 1317.
Comment l’alliance matrimoniale entre Turc de Meyronne et Na Castelhoza avait-elle été conclue ? Plusieurs hypothèses pourraient être évoquées : par l’intermédiaire de relations créées durant les croisades ; par le biais des abbés de la maison de Lastic demeurant au prieuré de Pébrac ou alors grâce aux grandes migrations connues vers le sud depuis le XIe siècle.30
Le couple avait-il réellement vécu dans le château de Meyronne ?
Si la question de son origine reste pour le moins douteuse, ce que nous connaissons d’elle, ce sont trois chansons – longuement étudiées – et une quatrième probable, destinées à Armand de Bréon, frère de Maurin (1190-1240) qui rendit hommage en 1222 au Dauphin d’Auvergne pour ses possessions situées à Compains dans les Combrailles (63)31. Armand de Bréon, chevalier d’un rang socialement plus élevé que Na Castelhoza, aurait participé à des croisades. Il demeurait dans son château à Mardogne près de Neussargues (Cantal). Tout comme Na Castelhoza, il était marié. Na Castelhoza aurait assisté à plusieurs cours d’amour à Romanin en Provence et au Puy-en-Velay en 1265. Parmi les spectatrices, figuraient la vicomtesse de Polignac, les baronnes d’Allègre et de Mercœur. Comme Dona Alamuc de Castelnou, elle était son amie32. Dans ses chansons, elle célébrait l’amour courtois, qui n’était pas platonique, contrairement à ce qui a pu être écrit par le passé, il s’agissait d’un jeu et comme dans tous les jeux, le joueur avait l’espoir de gagner. L’amour courtois concédait à la femme un pouvoir certain qui restait confiné dans les domaines de l’imaginaire et du jeu.33
Na Castelhoza a exercé son art dans une période encore faste pour les troubadours. À partir de 1250, un changement sensible s’est opéré dans la société, il s’est manifesté par un désintérêt à l’égard de la poésie profane et un goût plus prononcé pour le religieux. Sous l’influence des ordres de frères prêcheurs et mendiants (dominicain et franciscain), l’orthodoxie religieuse fut restaurée. Le climat semblait propice à l’organisation de l’inquisition qui provoqua notamment l’exil d’une partie des troubadours34. Leur public de choix était principalement les femmes : jeunes vierges, veuves et femmes mariées et leur thématique était le contrôle de la sexualité aux fins de la procréation : les pensées se devaient être pures et la sexualité s’exercer dans le cadre défini du mariage35. C’est dans cette perspective que le 7 mars 1277, l’évêque de Paris, Etienne Tempier condamna les ouvrages suspects traitant de l’amour.36
20 DE LA SALLE DE ROCHEMAURE F, Les Troubadours cantaliens, 1910. BNF-Gallica. BNF-Gallica.
21 CUBIZOLLES P., « Dona Castelloza », Almanach de Brioude, 1973. Compte tenu de l’environnement géo-politique de l’époque, les différentes théories mériteraient d’être questionnées.
22 DE SARTIGES D’ANGLES, Sénézergues in Dictionnaire du Cantal, tome V, De Déribier du Chatelet, pp. 330-332.
23 PROUZET (abbé), Histoire du Gévaudan, BNF.
24 DUBY G., « Le modèle courtois » in Histoire de femmes en Occident, tome II, Le Moyen-Âge, sous la direction de Christiane Klapisch-Zuber, Tempus-Plon, pp. 323-343, 1991.
25 BNF, site Richelieu, ms côte Français 840 f° 125.
26