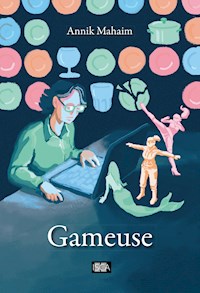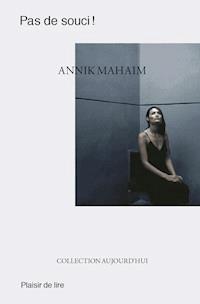Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Préparez-vous pour un voyage envoûtant au cœur de l'Île Maurice...
Une scénariste se rend à l’Île Maurice pour préparer un film sur Malcolm de Chazal, le grand poète mauricien. Une fois sur place, elle rencontre un personnage intrigant, venu d’un autre temps. Qui se cache derrière cet homme qui apparaît tel un fantôme et lui dicte jour après jour le récit mystérieux de sa vie ? Pourquoi s’adresse-t-il à elle en particulier ?
Prise au piège entre le désir d’en savoir plus et l’angoisse que lui inspirent ces révélations, la jeune femme va alors devoir réfléchir sur le véritable sens de son voyage. Ce roman emmène le lecteur dans un périple captivant à travers l’Île Maurice, ses paysages et son passé colonial, tout en explorant les pensées les plus intimes de ses personnages. Un voyage qui permet de s’initier à la magie de l’Île et à ses secrets. Une lecture envoûtante !
Un livre étrange et fascinant qui fait voguer son héroïne entre deux histoires, coloniale et familiale.
EXTRAIT
Cependant, les pieds ainsi plantés dans mon champs, j’aime à me balancer légèrement, ainsi que le font les tiges de cannes, en m’efforçant de pénétrer leur être. J’écoute les secrets qu’elles me racontent dans le vent. Peu à peu, je deviens moi-même canne. Alors dans ce léger balancement je m’enracine dans le sol et je me hisse vers les nuages, inventant un inexprimable rapport entre la terre, l’eau, le soleil et le ciel.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un souffle envoûtant habite ce livre riche de sensations et d’intuitions- sur une base documentée mais sans pédanterie aucune. -
A.B., Vie protestante
Grâce à l’écriture puissante et à la force d’évocation d’Annick Mahaim, le lecteur pénètre dans le for intérieur du personnage principal, vit une angoisse de perdre pied, ressent le vide de ce ventre qu’elle ne nourrit plus, étouffe dans la chaleur humide du climat mauricien. -
Jacques Poget, 24 heures
Ce roman est une belle découverte, d’un lieu, d’une plume, d’un poète, d’une époque où le passé s’invite au présent pour une danse troublante. -
Mot à Mot
À PROPOS DE L'AUTEUR
Annik Mahaim, romancière et nouvelliste, vit au Mont-sur-Lausanne. Elle a emprunté de multiples chemins d’écriture, chanson, textes pour la scène, journalisme, radio, publications historiques. Lauréate du prix Bibliomedia 1991, Sélection Lettres Frontières 1995.
Elle se consacre actuellement à l’animation d’ateliers d’écriture et au suivi d’auteur-e-s, tout en poursuivant son oeuvre de fiction.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-2-940486-15-1
© 2013 Editions Plaisir de Lire. Tous droits réservés.
CH – 1006 Lausanne
www.plaisirdelire.ch
Couverture : Naila Maiorana – www.fatformat.com
Version numérique : NexLibris – www.nexlibris.net
Le site de l’auteure : www.annikmahaim.ch
ANNIK MAHAIM
CE QUE RACONTENT LES CANNES À SUCRE
ROMAN
Ma gratitude à tous ceux, femmes et hommes, vivants et décédés, qui m’ont guidée, aidée et soutenue, chacun-e à sa façon, à cheminer dans ce livre.
Aujourd’hui seulement je déchiffre comment tout s’enchaîna, dès lors que je posai le pied sur ce bateau. J’y avais embarqué à Trou d’Eau Douce pour des raisons inexplicables ; il m’avait pour ainsi dire happée.
Bien sûr, le projet que je venais réaliser à l’île Maurice aurait pu m’entraîner à un peu de navigation. Si je le voulais, toute une flottille de plaisance s’offrait à moi, bien plus simplement que cette embarcation qui n’était en rien destinée au tourisme (d’ailleurs, les événements ne cessèrent de me détourner de mon projet initial, pour finalement me le livrer achevé, et cela de la manière la plus étrange – de la même façon qu’après avoir pensé errer pendant des heures dans une forêt touffue où l’on s’estimait perdu, on parvient à sa plus grande surprise à sa destination, ayant parcouru le chemin utile.)
La beauté surnaturelle de la mer à l’instant où je décidai (mais était-ce moi qui décidais ?) d’embarquer contribua sans doute à me projeter hors de moi, et, je le sais maintenant, vers des dimensions inconnues dont je ne devais pas revenir. La beauté, ou l’extrême lumière. Je les pris en plein visage aussitôt le port quitté. L’équipage quant à lui entamait une partie de cartes (le vent étant faible, il avait laissé les voiles serrées et enclenché le moteur).
Assise à la proue, je fus emportée par les bleus. Jusqu’à l’horizon un turquoise iridescent sous l’azur mauve. D’un coin de l’œil à l’autre rien que cela vibrant.
Je m’en éclaboussais, incrédule.
La lumière ne cessait de changer. Sitôt franchie la barrière de corail, l’eau brassa un profond émeraude brusquement moucheté d’or. L’instant d’après, le ciel se voila et une mer pastel s’étala, irréelle, sous des nuages de cendres pâles.
C’était dans l’après-midi, le troisième jour de mon séjour. Je m’étais rendue à Trou d’Eau Douce à la suite de ce que je nommais un pointage. Fermant les yeux, j’avais pointé un stylo sur la carte de l’île et y avais tracé ainsi à l’aveugle six ou sept cercles. Ayant par ailleurs acquis la veille un dictionnaire toponymique découvert dans une librairie de Curepipe, j’y avais également entouré d’un cercle une quinzaine de noms de lieux-dits, dont les sonorités m’attiraient sans que je susse pourquoi. Je constatai aussitôt que tous ces lieux-dits se situaient à l’intérieur d’une des zones sélectionnées sur ma carte.
Cette technique de « pointage » me paraissait découler très logiquement de mon projet, Trou d’Eau Douce se trouvait être l’un de ces lieux « pointés ». Feuilletant mon guide de voyage, j’avais lu qu’il s’agissait d’ « un gros village où personne ne s’arrête vraiment ». Cela avait accru mon envie de m’y rendre.
On m’avait conseillé de me renseigner à la gare routière de Mahébourg. Il me fut impossible d’obtenir un plan des itinéraires des bus, un horaire moins encore. Quant aux chauffeurs, attendant à l’ombre de leur véhicule hors d’âge qu’il soit rempli pour partir, ils m’avaient fourni des indications contradictoires. Je crus saisir qu’ils appartenaient à des compagnies rivales. Finalement, des gens m’avaient poussée dans un bus incroyablement plein, « vite-vite ! »
À chaque cahot, je manquais m’asseoir sur les genoux d’une grand-mère en sari, qui devançait mes questions inquiètes en me faisant signe de ne pas descendre (le bus s’arrêtait toutes les cinq minutes environ dans des grincements effrayants ; en outre, j’observais qu’il ne suivait pas l’itinéraire qui m’eût paru logique, c’est-à-dire le plus court ; il effectuait nombre de détours par des villages où des passagers l’attendaient, et parfois revenait sur son chemin ; il observait une autre rationalité, celle de desservir le plus d’endroits possibles en un seul trajet ; j’étais donc complètement perdue.) Une heure et demie et un changement de ligne plus tard (j’avais calculé que Trou d’Eau Douce était à un peu plus de trente kilomètres de Mahébourg), le bus s’étant arrêté sur une placette poussiéreuse, un mouvement général vers la sortie s’amorça et la grand-mère me signifia : « Là ! »
Mes pas me portèrent vers le port où, assoiffée, j’achetai à une marchande ambulante de dholl puri un soda d’un vert fluorescent, censément aux amandes. Je le bus en regardant le vent rebrousser la surface du lagon, dont le turquoise brassait des zones d’un vert semblable à celui de mon soda. Cette plaisante concordance m’aidait à ignorer le goût de mon breuvage (je n’ai jamais bu de gel douche, mais à mon avis c’en était proche).
C’est alors qu’une large bande de ce vert, cette fois-ci courant le long d’une coque, attira mon attention. Ce bateau ne ressemblait à aucun de ceux qui mouillaient dans le port. Une vingtaine de mètres peut-être, deux mâts barrés chacun d’une longue vergue. Des hommes s’agitaient sur le pont. J’eus aussitôt envie d’y embarquer.
C’est ainsi que débuta le surprenant enchaînement d’événements qui devait bouleverser mon séjour sur cette île.
Embarquer ne fut pas simple. Il me fallut d’abord trouver un canot qui voulût bien m’y emmener. Puis, du pont, on me lança que ce bateau marchand ne transportait pas de passagers.
Finalement, je parvins à obtenir qu’on me laissât grimper sur le pont pour discuter et je convainquis le capitaine, un Afromauricien d’une soixantaine d’années, non je crois avec les roupies que je lui proposai, mais en lui racontant pourquoi j’étais venue à Maurice. Il m’écouta en silence et, ses yeux noirs brusquement fendus d’un sourire :
- Toutes les clés ont la même pointure pour entrer dans la Serrure universelle des choses, malgré les divergences d’aspects, malgré les antinomies apparentes.
Ayant aussitôt reconnu un vers de Malcolm de Chazal, je lui adressai un demi-sourire incrédule.
Profitant de son triomphe, il enchaîna en chantant :
longtemps, longtemps, longtemps
après que les poètes ont disparu
leurs chansons courent toujours dans les rues
la foule les chante un peu distraite
en ignorant le nom de l’auteur
sans savoir pour qui battait leur cœur…
J’eus du mal à croire que sa voix énorme, incroyablement basse et rocailleuse, pût sortir de son corps frêle et sec.
Ils allaient à Mahébourg.
C’est ainsi que je me retrouve assise à cette proue, le bateau s’éloignant de la côte au moteur. Je n’ai pas pu apprendre ce qu’il transportait dans ses cales. Je ne sais pas pourquoi j’y suis montée. Je me trouve juste là, submergée de lumière.
Au large de Quatre Sœurs (me dit-on alors que je déplie ma carte dans l’envie d’identifier les reliefs du rivage), le vent forcissant, l’équipage se met à hisser les voiles. La grand-voile et un foc établis, une secousse incline le bateau qui s’envole aux mains du vent. Aussitôt, grincements, craquements, bruissements. Les joues piquetées par les embruns, levant les yeux vers l’architecture de voiles, de coutures, de cordages, de nœuds savants et de bambous de toutes tailles, je suis éblouie par l’intelligence qui a conçu cet appareillage. Danser ainsi sur la mer, jouer avec le vent, se faire pousser où l’on veut et cela avec tant d’élégance !
On vogue bon plein. Assise le dos au vent, je ne vois plus la côte que me cachent les voiles.
C’est alors que j’aperçois le cafard. Il surgit entre deux lattes du pont, près du triangle de la proue et il paraît m’observer. Très noir, très plat, il me semble gros pour un cafard.
– Bonjour… lui dis-je et je m’interromps aussitôt, traversée par l’idée invraisemblable que je sais comment il s’appelle. C’est une intuition informe, en deçà du dicible, en train de se frayer un chemin dans mon esprit.
– Bonjour, Roi-du-Monde, dis-je au cafard.
J’entends l’équipage crier en créole et brutalement, dans le grincement des cabestans, le bateau s’incline plus au près encore. Cramponnée pour ne pas glisser vers le bord opposé, je ne perds pas des yeux Roi-du-Monde que la manœuvre n’a pas paru troubler. Il agite ses antennes dans ma direction. Je sais comment il s’appelle. Il m’a été familier il y a longtemps… longtemps.
Je consulte ma carte qui claque dans le vent. Nous nous apprêtons je crois à doubler la Pointe du Diable. Je lève les yeux. Le ciel s’est plombé au-dessus des pics de la rive. La coque se redressant légèrement, un triangle inscrit entre le pavois, le bord inférieur du foc et le grand mât me dévoilent les remous d’un soleil métallique filant sur la mer, et c’est à cet instant que j’éprouve la première fluctuation.
Ce que je nomme fluctuation. Sur le moment, je la pris pour une sorte d’hallucination.
Je suis sur ce bateau, ce bateau même. Il en diffère pourtant légèrement par le fait qu’il sent le neuf et que son bois n’est pas peint, mais enduit de galipot ; les voiles sont d’un bon lin serré, la mâture en bambou. Ce bateau comme son équipage sont miens. Il se nomme La Beauté.
La ligne de flottaison basse sur l’eau, mes cales remplies à ras bord, j’emporte mon sucre au Port Louis. Nous cinglons en direction de Souillac et dans le triangle inscrit entre le pavois, le bord inférieur du foc et le grand mât, je regarde distraitement filer les remous d’un soleil métallique. Je songe à la gorge de bronze de Parveen, au parfum d’épices et d’océan de ses reins. Je suis déjà chez elle en pensée ; j’aperçois l’encens, la statuette dorée brillant au-dessus de sa couche, la flamme de la lampe à huile.
Les sommets de la rive défilent en m’indiquant la distance qui me sépare encore d’elle ; l’équipage me déposera à Port Souillac et me reprendra en revenant du Port Louis. Pour tromper mon impatience, je tends une miette de pain à Roi-du-Monde ; c’est qu’au fil des voyages, j’ai formé l’intention de l’amener à venir manger entre mes doigts.
Sur la rive se succèdent des collines quadrillées d’ocre, de vert banane et de safran ; au-dessus, les silhouettes bleuissantes des anciens volcans, procession de personnages bizarres façonnés par l’érosion.
Mes sensations sont étranges. Sans la moindre transition je suis lui, sans l’être. Comment dire ? Je reste moi-même, assise à la proue de ce bateau et en même temps, je suis vêtu d’une chemise en baptiste, d’un gilet de satin grivelé et de pantalons marron clair ; je porte une montre à gousset dont la chaîne dépasse de la poche de mon gilet ainsi qu’une chevalière à l’annulaire et je cingle vers Souillac, emportant mon sucre dans mes cales. Tout cela, et mon désir tendu vers cette femme que j’appelle Parveen, et la vision de sa caze, et la miette que je tends à Roi-du-Monde et les volcans défilant en cet instant qui n’en est pas un, un instant sans durée, un éclair.
donne-moi encore une fois…
Le Capitaine chantant me fait passer un gobelet d’acier. C’est du rhum.
… donne-moi encore une fois
l’illusion d’être dans tes bras…
Je lui souris. Ils ont affalé les voiles et se dirigent au moteur vers la baie de Mahébourg. Je n’ai rien vu. Nous accostons déjà.
– Nou’ne arrivé. Enn lot lokazion !
Je les connais tous. Je connais très bien ces hommes.
À quai, je leur demande où on les trouve habituellement. Je veux aussi entendre le nom du bateau écrit en caractères hindis :
– Coubsourati, entends-je.
– Coubsourati. Merci, je m’en souviendrai. Au fait, quel jour est-on ? J’ai un peu perdu de vue le calendrier depuis mon arrivée.
– Diss set novam.
– C’est la première fois que je reviens ici, lâché-je.
Je ne comprends pas ce que je viens de dire. Mais le Capitaine s’en fout. Il finit son rhum. Et c’est en chantant qu’il me fait ses adieux tandis que je m’éloigne :
…un chalet bleu
tombé du ciel…
Dans la chambre que j’occupe à Pointe d’Esny, je me tiens assise sur le seuil comme chaque soir depuis mon arrivée (étonnant comme le corps, à peine a-t-il trouvé un coin qui lui convient, il en prend l’habitude), les fesses posées sur le carrelage rouge et les pieds reposant sur la deuxième des trois marches qui mènent au jardin. C’est le moment que je préfère. Je me suis baignée dans le lagon en revenant de Mahébourg, j’ai pris une douche d’eau douce, j’ai grignoté quelque chose et la nuit tombant, je bois un punch.
Je récapitule, je laisse mon esprit divaguer. Sur mon lit, la carte dépliée, le dictionnaire toponymique, mon carnet de notes, l’appareil photo, un stylo et La Clef du Cosmos, recueil du grand poète mauricien Malcolm de Chazal ; c’était le seul de ses textes que je possédais avant mon départ.
Le projet qui m’amenait, et cela pour la première fois sur cette île, était un film sur le poète mauricien Malcolm de Chazal. Je n’avais pas eu de mal à convaincre Nejib, mon ami de toujours et mon associé, de l’intérêt d’un documentaire sur de Chazal : une grande figure littéraire francophone méconnue, l’exotisme, l’originalité du sujet, j’avais des arguments. Mais surtout, je crois que Nejib lisait sur mon visage les signes de la passion, et qu’en bon cinéaste, il savait que c’était de cette pâte que l’on pétrit un scénario. Je tombais bien, une chaîne culturelle avec laquelle nous travaillions venait de lui demander un projet. Le planning et son financement avaient été montés en peu de temps. Et maintenant, je voyageais sur notre budget et j’entendais revenir avec un synopsis inspiré et précis qui permette à Nejib de venir faire des repérages.
Avant de partir, un peu à l’arraché il faut dire, j’avais pris contact avec un spécialiste de Chazal, LE spécialiste m’avait-on dit : F.D. Une entrevue n’avait pas été possible : il venait de subir un pontage fémoral et sa femme, rechignant à me le passer au téléphone, m’avait indiqué d’un ton revêche qu’il ne recevait pas en ce moment. J’avais pu échanger quelques mots avec lui, ensuite de quoi l’épouse avait raccroché d’autorité. Je me contentais donc d’emporter son ouvrage consacré au poète.
J’en avais lu le premier chapitre à mon arrivée. Malcolm de Chazal, expliquait F.D., adepte des voyages extatiques, n’avait cessé de sillonner Maurice en utilisant des techniques hallucinatoires. Je comprenais mieux le conseil qu’il m’avait donné au cours de notre bref entretien téléphonique, m’engageant à me « laisser faire par l’île » : « Chère Madame, allez-y au radar, comme on dit aujourd’hui ».
C’est alors que m’était venue l’idée de me diriger par cette méthode de « pointages » en laissant mes intuitions orienter mes trajets. J’envisageais d’errer ainsi un certain temps. Je pensais aussi, au fur et à mesure de mes lectures, entreprendre des démarches plus précises, et notamment me rendre sur les lieux qui avaient compté pour de Chazal. Je voulais enfin effectuer certaines recherches à la Bibliothèque nationale au Port Louis.
Il me semble être ici depuis des mois, alors que cela ne fait que trois jours.
C’est par hasard que j’ai fini par louer une chambre à Pointe d’Esny (mais qu’entends-je quand j’écris « par hasard » ? que les choses se sont présentées ainsi, sans que j’aie eu l’impression de les vouloir ?) Je pensais initialement séjourner au Port Louis pour être près des archives, des musées et de la Bibliothèque nationale, et parce que c’était dans la capitale que j’imaginais de Chazal. Mais une connaissance, me déconseillant la ville, m’avait recommandé cette location ; la chambre, située au rez-de-chaussée d’un bungalow, présentait l’avantage de se trouver juste à côté d’un restaurant appartenant aux propriétaires. Le tout se trouvait à trois kilomètres de la petite ville de Mahébourg, tout près de l’aéroport international. Un coup de fil avait suffi, j’avais de la chance, quelqu’un venait de se désister, c’était libre. J’avais aussitôt réservé. Je ne voulais pas perdre de temps avec des problèmes d’intendance.
À mon arrivée, j’avais eu la sensation inattendue en posant ma valise sur le lit de reconnaître des odeurs ; quelque chose me semblait familier dans l’ameublement colonial vieillot et l’atmosphère. La chambre était spartiate, un lit, une table de nuit, une petite table en demi-lune, une commode, un ventilateur. Bien entendu je n’avais jamais vu ni ce bouddha noir émacié posé sur la commode, ni le meuble assez particulier à deux battants en croisillons de bois roux, mais ils me rappelaient quelque chose. L’odeur même de la pièce m’évoquait une ambiance connue et je m’étais sentie joyeuse sans savoir pourquoi.
Je m’en étonne depuis trois jours, je me sens singulièrement accordée à cet endroit, à ce coin de l’île. D’ailleurs, je constate que je repousse un déplacement au Port Louis, où j’avais l’intention de me rendre dès mon arrivée.
Les Mauriciens sont fiers de leurs poètes. Quand j’expose le motif de mon voyage, tout le monde s’emploie à m’aider. Devianai, la femme à tout faire de la maison et du restaurant, ne fait pas exception. En fin de journée, elle sort de la cour du linge qu’elle étend sur des fils tendus entre la clôture du jardin et les arbres, et vient volontiers discuter un brin avec moi :
– Ki manière ? Letan la pa bon. Fer tro so. De Chazal, trouvé quique çôze zordi ?
Elle s’efforce de parler un français compréhensible pour moi et je commence à me faire l’oreille à son créole. Comment ça va, le temps n’est pas bon, il fait trop chaud. Si j’ai trouvé quelque chose sur le poète aujourd’hui.
Sans transition, elle entreprend de montrer les plantes du jardin. Me traînant à sa suite, elle me désigne des feuilles et des herbes qu’elle froisse entre ses doigts et qu’elle me fait humer :
– Ène bon manzé !
J’en viens à me demander si tout se mange dans ce jardin d’agrément pourtant modeste : sous l’arbre à caripoulé, le manguier, le cocotier, l’arbre à litchis, elle ne cesse de ramasser des « brèdes » semi-sauvages (ainsi qu’elle me l’explique, ce terme désigne en créole tous les légumes verts).
– C’est le jardin du Bon Dieu ! lui dis-je en riant.
Levant une main pour me faire taire, les sourcils froncés, elle se concentre et me récite en hésitant :
– Le Paradis fut créé d’abord… et ensuite vint la vie. Le Paradis… c’est le Réduit d’Essence des Mythes.
L’Essence des mythes ! Malcom de Chazal ! Elle a dû l’apprendre à l’école.
J’applaudis. Elle me conseille d’aller au Jardin Botanique de Pamplemousses, j’y trouverai tout tout tout, l’arbre contre les fièvres, l’arbre à saucisses, celui qui guérit les maux d’estomac, celui qui étanche la soif, les caféiers, tout tout tout.
Les Mauriciens paraissent aussi fiers de la végétation de leur île que de leurs poètes et il y a de quoi.
Bien sûr, Nejib et moi pourrions aller tourner une partie de notre film à Pamplemousses. Il ne devrait pas être difficile de trouver là-bas de quoi illustrer le panthéisme de Chazal, et une voix off lisant des vers appropriés sur les images habilement montées nous ferait une séquence à peu de frais, mais c’est justement ce que je voudrais éviter. Il va me falloir de la rigueur pour éviter d’enfoncer ces portes ouvertes, si tentantes, si rassurantes, alors qu’ayant envie d’aller au-delà des évidences, j’ignore par définition ce que je cherche.
J’observe Devianai. Au fil de ces trois petits jours, nous avons fait connaissance et ce n’est pas difficile avec elle, qui déborde de l’envie d’échanger. Nous avons parlé de tout et de rien, des bonnes brèdes et des mauvaises, de la manière de s’y prendre avec les bus, du meilleur endroit pour faire ses commissions à Mahébourg, de mon projet, de son fils, de ma vie en Europe, de la façon d’apprêter un briani mauricien (l’un des nombreux plats qu’elle veut m’apprendre à faire), et ce n’est pas l’essentiel. C’est une femme qui porte son cœur sur sa figure et c’est cela qui me touche vraiment, un cœur chaleureux au naturel, entièrement spontané dans son sourire dénué de retenue, de façade sociale, de considérations irréelles. Juste un vrai sourire du fond du cœur.
– Dis-moi Devianai, coubsourati cela veut dire quelque chose en hindi ?
Elle me fait répéter. Elle croit que cela veut dire la beauté.
Je répète troublée :
– La beauté.
Elle me salue :
– Monn fini travail la.
Je rentre moi aussi, fermant la porte et les fenêtres à cause des moustiques. J’étouffe aussitôt. Mais j’ai découvert une commande à mon chevet qui non seulement enclenche le ventilateur, mais permet d’en régler la vitesse de rotation sur une échelle de six degrés. Couchée sur le lit, je regarde de larges pales cannées tracer au plafond des motifs variant avec leur vitesse. La troisième vitesse est celle qui me convient le mieux. Au-delà, j’ai l’impression de reposer sous un hélicoptère, en deçà, je ne me sens pas rafraîchie.
Je me demande ce qui m’est arrivé sur le Coubsourati et je cherche un rapport avec de Chazal. Une donnée m’intrigue : « Cet équipage est mien ». Je savais qu’il s’agissait d’une propriété, non d’un équipage engagé par « moi ». Comment ai-je pu penser une chose pareille ? L’esclavage est aboli depuis longtemps quand naît de Chazal.
Certes, je me doute que l’esclavagisme fera peu ou prou partie de ce voyage. Malcolm a beau avoir vécu au 20e siècle, il descend d’une famille de grands propriétaires sucriers et il a travaillé comme chimiste dans les plantations de la première moitié du siècle. D’après ce que je sais, les mentalités n’y avaient guère bougé et les travailleurs agricoles indiens, qui avaient remplacé les anciens esclaves, n’étaient pas beaucoup mieux traités qu’eux. De Chazal a porté la terre à cannes et l’esclavage dans ses fibres. Avait-il une maîtresse indienne ? Sans doute mon esprit a-t-il profité, cet après-midi, du plaisir de la navigation pour effectuer un petit tour hypothétique dans un aspect plus secret de sa personnalité.
Je me réveille vers deux heures, comme les trois dernières nuits d’ailleurs. Cela ne m’arrive jamais en Europe. Il est vrai qu’à ma manière cherchant La Clef du Cosmos, je ne serais pas étonnée qu’une partie de mon séjour se déroule de nuit sous les astres.
Je me lève. Je sors m’asseoir sur les marches de la chambre et je me laisse habiter par le jardin silencieux, les étoiles, la lune, les plantes que je devine dans l’obscurité, celles que j’aperçois pâles et fantastiques dans le rai de lumière qui s’étale depuis ma porte-fenêtre ouverte. Ce rai court dans le gazon et meurt sur le mur en pierres volcaniques qui clôt le jardin, à une petite dizaine de mètres. Il forme un halo flou sur les rectangles gris-roux où mon regard s’attarde.
Ces réflexions sur l’esclavagisme ont dû imprégner mes rêves, elles flottent toujours autour de moi. C’est alors que j’éprouve pour la deuxième fois ce que je nomme fluctuation.
« Il » m’apparaît distinctement dans le halo contre le mur. Un regard très noir, très brillant, très dense. Quelque chose d’un S horizontal dans la forme des yeux, des pupilles de pierre noire. Il fume une pipe en terre dont le fourneau représente une tête barbue, au nez en bec d’aigle acéré. Il est vêtu d’un gilet, d’une chemise, d’une veste et d’un pantalon de très bonne qualité, beiges apparemment. Je dis apparemment parce qu’il fait sombre. Quand j’écris qu’il m’apparaît, ce n’est pas tout à fait cela. Je le vois sans le voir. Je suis devant son image et l’image du mur vide en même temps. Exactement comme tantôt sur le bateau, quand j’étais lui sans être lui. Car je l’ai aussitôt reconnu.
Je lui trouve une expression à la fois moqueuse et agacée.
– Ne te soucie point excessivement d’esclavage. Etes-vous différents aujourd’hui ? me lance-t-il.
C’est fini.
Je m’étends sur mon lit obscur dans le bruit doux et régulier des pales. Le visage qui vient de m’apparaître n’a rien à voir avec les lignes droites, la perpendicularité sévère de celui de Chazal. Un je ne sais quoi dans ses vêtements évoque d’ailleurs une époque plus ancienne, le 19e siècle peut-être.
Or sa présence ne produit nullement l’effet d’une hallucination, d’un rêve éveillé ou d’une fantaisie de l’imagination. Le plus curieux est peut-être qu’il m’a paru tout à fait naturel qu’il s’adresse à moi. Perplexe, je commence à me réfugier dans le sommeil. Je suis sur le point de m’assoupir quand ces mots me traversent :
« Tous les hommes aiment se prélasser à l’ombre d’une varangue, ne pas devoir compter leurs verres de rhum, vêtir de soie leurs femmes et leurs filles ; tous les hommes ont le goût de se promener où ils l’entendent, quand cela leur chante, et de naviguer à bord de grands vaisseaux à la découverte de pays lointains et fabuleux.
En un point de l’histoire, un esprit déterminé se sent assuré de ses choix.
Vous qui m’entendrez dans cent ans, dans deux cents ans, alors que l’esclavage sera aboli depuis des décennies, tout au moins dans les lois, ne soutenez point que vous ne faites cas ni de la soie ni des voyages. Ne me faites pas croire qu’en mangeant votre riz blanc, vous pensez à ceux qui l’ont cultivé ; ce sont toujours les mêmes dispositions ».
Je rallume et je note précisément. Je verrai plus tard que ce n’était pas la peine. Toutes ces phrases, je les connais aussitôt par cœur.
Je ne sais pas ce que je pense de cette manière de voir. Il doit y avoir du vrai dans son constat cependant, car je sens que je m’endors très confortablement dans les draps propres lavés pour quelques roupies par Devianai, sous la brise agréable des pales du ventilateur.
Aujourd’hui, je m’accorde un jour de repos. Je ne fais rien, je ne cherche rien, j’écoute ce qui me traverse. D’abord je vais me baigner dans le lagon, puis je reste assise dans le jardin sous le manguier en buvant du thé parfumé à la vanille. Je vais apprendre que c’est en ne faisant rien justement que l’essentiel m’arrive.
Au début de l’après-midi, je me sens l’élan de me rendre à Mahébourg pour envoyer un mail à Nejib depuis un petit cybercafé que j’ai repéré. Je veux aussi me racheter le thé, les fruits et les biscuits avec lesquels, étonnamment, je me nourris toute la journée (d’ordinaire, j’ai plutôt un bon coup de fourchette).
Sortie en direction de l’arrêt du bus, je me heurte à un soleil agressif qui me donne envie de retourner m’allonger à l’ombre du manguier. Mais un taxi collectif aussitôt s’arrête. Je me serre sur la banquette arrière contre un routard d’allure nordique tenant un gros sac à dos contre son ventre, lui-même calé contre une maman en tunique brodée jaune sur rose, deux jeunes enfants sur ses genoux. Le siège avant est occupé par un Mauricien entre deux âges, tiré à quatre épingles, l’allure d’un employé de banque, un attaché-case sur les cuisses. Il n’y a que moi qui n’ai rien sur les genoux. Cela me plaît d’être ainsi sans bagages, sans attaches, sans horaires.
Au moment d’entrer dans le cybercafé, mon regard est attiré par un dessin de craie multicolore sur le trottoir. Six grandes fleurs de lotus stylisées, violettes et rose vif, entourent une fleur centrale turquoise en forme d’étoile. Une jeune femme en sari prune, une longue tresse noire, épaisse et frisée battant ses reins, me fait signe d’entrer. Je lève les yeux. Le dessin décore la partie du trottoir située devant la porte d’une maison basse, peinte en saumon, à côté de laquelle s’ouvre une terrasse. Une enseigne : Le Magnifique – Cuisine tamoule. Ne résistant pas à la proposition, je m’installe sur la terrasse et demande à la belle patronne un chaï. Elle me le sert brûlant et très épicé, le meilleur que j’aie jamais bu sur l’île. Je le déguste à petites gorgées, laissant mon regard errer sur le mur saumon, le dessin coloré du trottoir et les silhouettes élancées des yuccas qui bordent la terrasse.
Le petit cybercafé flambant neuf réunit quelques jeunes branchés du cru, qui se pavanent avec un téléphone mobile et paraissent chercher à s’y faire voir bien plus qu’à surfer (ils fument et papotent devant les écrans déconnectés.) Il faut dire que la connexion se paie par tranches de dix minutes et qu’elle est terriblement chère – les prix internationaux – pour le niveau de vie local. J’écris à Nejib que je ne sais pas où je vais, mais que j’y vais. Qu’il ne pourra qu’être submergé d’images quand il viendra. Que nous allons réaliser un film exceptionnel. Que je viens de retrouver dans La Clef du Cosmos l’un des vers de Malcolm de Chazal qu’il avait le plus aimé : … la mer dont l’infini des eaux est limité par les vagues. La vague est un aspect des eaux, et non distincte d’elle. De même le fini est un aspect de l’infini, vague d’une mer illimitée et dont le reflet est la conscience… J’ai envie de bâtir le synopsis autour de ces mots, conclus-je en lui demandant ce qu’il en pense.
Je flâne ensuite entre les saris pendus sous les auvents des échoppes. Ils encadrent les ruelles de merveilleux arcs-en-ciel agités par le vent. Je m’achète des lamelles de mangue verte pimentées à la Pointe des Régates. Finalement je m’assieds au frais sur un banc circulaire, qui entoure les racines aériennes d’un énorme banian, pour regarder les barques de pêche évoluer sous la montagne du Lion, laissant une petite brise se charger de la marche du temps.
Un homme en tunique blanche prend place à côté de moi et me demande :
– Bonzour. Prémié foi ou vine Maurice ?
Comme je lui réponds oui, il entreprend de m’énumérer les endroits intéressants de la région et très rapidement évoque l’épave du Sirius.
Je me sens justement curieuse d’en savoir plus sur ce fameux Sirius : dans la zone bleue de ma carte figurant la baie de Mahébourg, un point est noté H.M.S Sirius, à propos duquel mon guide ne fournit aucune explication, et qui se trouve sans doute sous mes yeux. Des gens m’ont dit hier sur la plage de Pointe d’Esny que l’étrange tulipe d’acier rouillé que l’on y aperçoit à marée basse, au loin juste avant la barrière de corail, était le Sirius. Ils croyaient savoir qu’il s’agissait d’un vaisseau ayant fait naufrage dans le coin une centaine d’années plus tôt.
Ensuite de quoi la charmante patronne du charmant restaurant qui jouxte le bungalow où je suis logée m’a indiqué que ce que l’on voyait à Pointe d’Esny était en réalité l’épave d’un bateau danois, sombré là dans les années 1930. Je la crus, car sur ma carte, le point H.M.S Sirius ne se trouvait pas en face de la plage de Pointe d’Esny. « Le Sirius, me dit-elle, doit reposer par très grand fond au milieu de la baie de Mahébourg ». Intriguée, j’avais posé des questions à gauche et à droite. Chacun connaissait le Sirius et chacun m’indiquait approximativement un endroit différent dans la baie.
Je sentais l’épave très agissante dans la ville. Ce monument invisible hantait les esprits. Curieusement, les restes du bateau danois contribuaient à renforcer cette présence, telle une allusion à ce que l’on ne pouvait voir.
Autre personnage puissant dans la baie, la montagne du Lion se dressant au-dessus de l’eau et prenant racine dans les grands fonds où, justement, reposait le Sirius. J’étais en train de faire la relation avec l’hexagramme Meng du Yi-King, le Jeune fou : en haut Montagne, en bas Eau. Ce n’est pas moi qui recherche la jeunesse du jeune fou, c’est la jeunesse du jeune fou qui me recherche, disait à mon souvenir le commentaire, qui évoquait l’intrépidité de la jeunesse et le nécessaire apprentissage qui remédie à l’inexpérience ; l’hexagramme conseillait la ténacité. Devais-je mettre cela en relation avec ma recherche et La Clef du Cosmos ?
– Tu veux que je te montre où le Sirius a coulé ?
– Bien sûr !
– Là, me fait l’homme en tunique blanche, se levant et pointant un index assuré vers un point de la baie.
J’ai l’intuition qu’il dit juste. Fixant le point qu’il m’indique, je mémorise les repères dont je dispose, l’endroit où je me tiens, ma position exacte. « Il faut que je vérifie et que je m’en souvienne pour Nejib ».
Ensuite nous parlons de la vie sur l’île, de ce que je fais ici, de l’un de ses enfants qui est parti trouver du travail à la Réunion. J’en profite pour lui demander ce qu’est une varangue. Il me l’explique avec des mots créoles que je ne comprends qu’à demi. Quelque chose à l’avant d’une maison traditionnelle de planteur, une sorte d’auvent, une véranda ? Il me raconte qu’il y avait autrefois, du côté d’Union Vale, une très grosse propriété sucrière, une des plus anciennes de la région, qui s’appelait justement Varangues : « Varangues avec s, cette maison, on dit qu’elle était spéciale, elle en avait deux, une pour la famille, l’autre pour le maître ».
– Si tu cherches des renseignements sur un poète mauricien, tu dois aller au musée ici. Tu remontes la rue Royale, c’est tout près. Salam. Mo bizin alé.
Je le remercie sans lui dire que je n’ai pas l’intention de visiter ce musée historique dont les collections évoquent le 18e et le 19e siècle, période qui ne concerne pas mon sujet, et cela de surcroît sous l’angle militaire et naval. Puis finalement, en cherchant l’arrêt du bus pour Pointe d’Esny, je m’aperçois que je suis rue Royale et je décide d’y faire un saut.
C’est une belle bâtisse du 18e ayant appartenu à une grande famille de l’île. Le prospectus évoque les bals et les réceptions qui y furent donnés, où se retrouvait la haute société mahébourgeoise.
Dans la première salle, un tableau me saute aux yeux. Il représente la baie de Mahébourg remplie de vaisseaux battant pavillons anglais et français, occupés à se tirer des boulets de canon les uns sur les autres. Un bâtiment est déjà couché sur le flanc, un autre a brisé son grand mât et laisse échapper des flammes. Le peintre a rougi la mer où flottent des blessés agrippés à des planches. Une vraie boucherie. La légende indique : Bataille de Grand Port. H.M.S Sirius. Frégate de 5e rang, construite sur la Tamise en 1797, longue de 45 mètres et large de 12, 274 hommes d’équipage, 26 canons. Elle sombra en août 1810 durant la bataille navale du Grand Port et fut découverte en 1964. Voilà donc l’histoire du Sirius ! Ces indications sont complétées par un panneau titré : L’unique victoire maritime de Napoléon sur les Anglais et racontant la bataille. (Ce fut bien l’unique, puisque quelques mois plus tard, les Anglais conquéraient l’île et y établissaient leur administration coloniale).
Ayant peu de goût pour ces choses-là, je me tourne vers une collection d’objets vermoulus et noircis par leur séjour dans l’eau de mer, ayant été retirés du Sirius par les archéologues au cours de leurs expéditions sous-marines. Ils sont exposés dans une vitrine : ferrures de gouvernail, chevilles à viroles de liaison de coque, clous à tillac et à carvelle. « La boîte à outils du poète » me dis-je, sortant mon carnet pour noter cette pensée à tout hasard, puis j’expédie le reste de la salle en quelques pas.
Je m’arrête encore devant une chaise à porteurs en cuir noir, objet aujourd’hui stupéfiant, quand on imagine le transport d’un maître sur les épaules de quatre esclaves ployant sous les lourdes perches de bois.
Je ressors du musée à peu près aussi vite que j’y suis entrée, sous l’œil réprobateur et, je le crains, vexé du gardien (j’étais l’une des trois visiteuses et je suis restée moins de dix minutes). Je me sens collante et en sueur, j’ai hâte de retrouver mon lagon et l’ombre du manguier.
Ce soir, je décide de dîner au restaurant. Trois jeunes Mauriciennes, fluettes et infiniment correctes dans leur ensemble de travail chemise-pantalon, illuminent le bar de leurs sourires. C’est un vrai bonheur servi avec le punch aux fruits frais. Je ne crois pas que je vais continuer à prendre l’apéro seule dans le jardin. J’ai emporté la carte, le dictionnaire toponymique et mon carnet. Je me transporte avec une pile de papiers, ce qui me donne l’air d’une chercheuse zélée enfoncée dans une recherche d’importance : elles m’aident avec le plus grand sérieux. Durant tout mon séjour elles vont m’offrir un appui quotidien, me cherchant des numéros de téléphone, m’aidant à situer les lieux et m’indiquant quel bus prendre où pour aller où.
Pour l’heure, un peu intriguée par la maison de planteur à deux varangues dont j’ai entendu tantôt parler au port, je leur demande où se situe Union Vale, dans l’idée que si l’endroit se situe sur l’un de mes trajets, je pourrais peut-être apercevoir la bâtisse depuis le bus ; je leur demande si le village est grand. Elles pouffent. Ce n’est pas un village. Je me rends compte qu’ici tout le monde connaît Union Vale : c’est l’une des plus grosses entreprises sucrières de l’île. En mains australiennes, elles croient. Autrefois, il y avait dans le pays des centaines de petites sucreries, aujourd’hui, une douzaine de grandes installations suffit à transformer la production de l’île. Je leur demande de me montrer l’endroit sur la carte. Cela n’a pas l’air très loin de Mahébourg ? « Un quart d’heure en bus » rient-elles.
Je commande un curry de patates douces, une « maman rouge » parce que c’est un poisson que je ne connais pas, un verre de Sauvignon sud-africain et, le punch aidant, je me sens gaie et pleine d’idées. En attendant les plats, je déniche dans mon dictionnaire toponymique un article fourni sur Union Vale, mais rien sur Varangues. Cependant je m’aperçois que mon « dictionnaire », un mince fascicule, le seul que j’aie trouvé dans une librairie de Curepipe le premier jour de mon séjour, porte le No 3 : il doit exister au moins deux autres numéros, j’ai envie de me les procurer. J’avais commandé dans la librairie plusieurs titres de Malcolm de Chazal et quoi qu’il en soit, je devais y retourner prochainement. À cette occasion, je pourrais acheter les deux autres fascicules.
J’ai envie d’aller visiter Varangues. Si cette propriété est proche d’Union Vale, d’après ce que m’ont montré les filles, elle se trouve à l’intérieur d’un de mes cercles. « Je perds mon temps, je m’éloigne de mon sujet » me tancé-je, puis : « Au diable Malcolm de Chazal, j’ai envie de voir ces varangues ».
Trois compagnons m’attendent dans la chambre, deux petits lézards verts mouchetés de rouge qui se tiennent habituellement dans le coin du plafond, au-dessus de l’angle de mon lit, et le ventilateur au centre, la personnalité principale de la pièce. J’ai le choix entre deux positions, vu l’exiguïté des lieux : couchée sur le lit ou assise sur les marches en face des ombres du jardin.
Je me couche. Les pales tournent doucement, emmenant mon esprit. Je fluctue. Ce ventilateur n’est sans doute pas pour rien dans ce qui m’arrive et m’arrivera. Quand je fixe son mouvement hypnotique, je me trouve dans une spirale d’images qui passent et qui repassent, chargées de significations inconnues. Dans le triangle inscrit entre le pavois, le bord inférieur du foc et le grand mât file une eau sombre, froncée d’aluminium étincelant. Roi-du-Monde émerge entre deux lattes à la proue de La Beauté. Mon visiteur nocturne d’hier plante son regard si particulier en S horizontal dans le mien. Et maintenant Varangues, je ne sais pourquoi, Varangues que je ne parviens pas à imaginer et que j’aimerais voir.