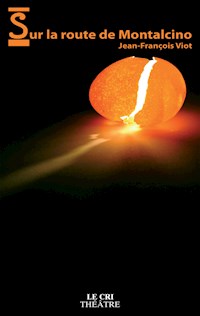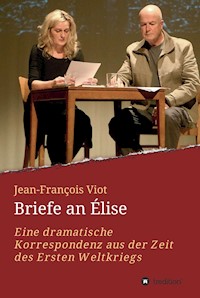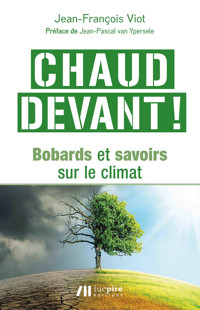
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Une collègue, un ami ou un parent, nous avons tous une relation qui refuse de penser que le réchauffement climatique a lieu, qu’il a une cause humaine ou que nous pouvons réagir. Alors qu’un consensus scientifique solide existe, certains multiplient les arguments pour nous convaincre que nous ne devons pas nous en faire ou que nous ne sommes pas responsables. Cet ouvrage va à la rencontre de ces arguments. Au départ d’une discussion entre une nièce militante et une tante physicienne, Jean-François Viot explore l’histoire et les fondements de la science climatique, s’intéresse à l’action du GIEC et interroge les mécanismes du climato-scepticisme. Son investigation minutieuse dénoue ainsi, petit à petit, les fils des théories qui nient le réchauffement climatique. Il en ressort un formidable outil à la portée du plus grand nombre pour démêler une question fondamentale du XXIe siècle : Le réchauffement climatique, savoir ou bobard ? Avec une préface de J ean-Pascal van Ypersele, climatologue et ancien président du GIEC.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chaud devant !
Éditions Luc Pire [Renaissance SA]
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
Éditions Luc Pire
www.editionslucpire.be
Chaud devant !
Édition : Morgane De Wulf
Corrections : Astrid Legrand
Mise en pages : CW Design
Impression : Structure Production
e-ISBN : 9782875422248
Dépôt légal : D/2020/12.379/06
© Éditions Luc Pire, 2020
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Jean-François Viot
Préface de Jean-Pascal van Ypersele
Chaud devant !
Bobards et savoirs sur le climat
« L’ouverture d’esprit n’est pas la fracture du crâne. »
Pierre Desproges
« L’ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance. »
Charles Darwin
Préface
Quel paradoxe ! C’est un homme de théâtre, champion de l’illusion, qui démontre avec brio que le climatoscepticisme n’est pas un scepticisme. Qu’il n’est qu’une illusion, un travestissement de la vérité.
Jean-François Viot est allé voir derrière les masques et les décors de pacotille des « semeurs de confusion climatique », comme je préfère les appeler. Interpellé par la résistance de sa tante, pourtant professeure de chimie, à accepter l’évidence des changements climatiques d’origine humaine, il s’est mis à creuser pour comprendre.
Nous connaissons tous un membre de notre famille, une collègue, un ami ou un décideur politique qui déclare ne pas « croire » aux changements climatiques. Je n’interprète évidemment pas « croire » au sens religieux, mais comme « accorder un haut degré de confiance ».
Moins il y a de personnes qui ont confiance dans la science du climat, moins il y aura de soutien à des mesures ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc pour quitter les énergies fossiles.
Il ne faut pas se leurrer, les intérêts économiques en jeu sont gigantesques et les industries fossiles, comme les vendeurs de tabac avant elles, font tout pour propager le doute. Exposer le scandale des « marchands de doute », expliquer les mécanismes des changements climatiques et les manières de les contrer est donc essentiel.
Séduit par la manière dont Jean-François Viot avait tiré parti de l’information scientifique dans sa pièce Sur la route de Montalcino (2007), consacrée à la théorie du Big Bang, je lui avais suggéré d’écrire une pièce de théâtre sur les changements climatiques. Il en a fait ce livre. J’espère que la pièce suivra un jour.
Car le travail qu’il a fait en vaut la peine. Pour pouvoir répondre à sa tante, ce littéraire a d’abord fait l’effort de se plonger dans l’histoire de la climatologie et des changements climatiques.
Il n’a pas hésité à s’intéresser dans la littérature scientifique, à lire les rapports du GIEC, et même à se faire diplômer de l’Université de Queensland (Australie) pour une formation à propos de la dénégation climatique !
D’une certaine manière, ce livre soigne le mal par le mal. Il met le véritable scepticisme, le doute qui est à la base de la démarche scientifique, au service de la lutte contre la dénégation scientifique. Il démonte de manière magistrale quatre des techniques préférées des semeurs de doute climatique : le millefeuille argumentatif, les faux experts, la science fausse et la rhétorique.
Chacun de ces outils de la dénégation est mis à nu, et leur usage est illustré par des exemples empruntés à Claude Allègre, Michel Onfray, Vincent Courtillot, François Gervais et Benoît Rittaud, ou, de l’autre côté de l’Atlantique, à Fred Singer, Frederick Seitz, ou John Christy.
Ces personnes et les firmes, institutions ou médias qui les soutiennent n’en sortent pas grandies. Mais l’essentiel est ailleurs : le lecteur de ce livre pourra démonter lui-même bien des arguments qu’il est susceptible de voir passer sur les réseaux sociaux ou d’entendre en société.
Le « Guide de survie du climatologue en herbe » à la fin du livre est un petit bijou. Il permettra à chacun de comprendre à quel point les « semeurs de confusion climatique » sont pervers et intellectuellement malhonnêtes, aveuglés qu’ils sont par leur refus du nécessaire changement dans la manière dont nous nous comportons à l’égard de l’atmosphère, de la nature et des générations qui nous suivront.
Alors que la science du climat fait l’objet d’un si large consensus au sein de la communauté scientifique, et alors que c’est l’habitabilité même de la seule planète hospitalière du système solaire qui est mise en cause par les émissions humaines de gaz à effet de serre, il est sidérant qu’il faille encore passer du temps à démonter des « bobards » sur le sujet.
Mais puisque la réalité est que les lobbies fossiles et les partisans de l’immobilisme sont toujours là, il faut remercier Jean-François Viot d’avoir fait cette démarche de « démontage » et d’analyse.
Merci à vous de lire ce livre. Si vous avez dans votre entourage quelqu’un qui est convaincu que « le climat a toujours varié, sans avoir besoin des humains », ou que « le GIEC est alarmiste », vous comprendrez ici ce qu’il y a derrière son attitude, et vous pourrez lui répondre. C’est essentiel.
Jean-Pascal van Ypersele
Ancien vice-président du GIEC Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement à l’Université catholique de Louvain
À ma fille, Jeanne. À mes neveux et nièces. Et à tous ceux qui leur ressemblent.
Repas de famille
« Si ! C’est un fait !C’est sûr et certain ! Le réchauffement climatique a lieu, dit ma nièce, assise à table, en agitant sa cuiller à soupe.
– Non, ce n’est pas sûr, répond ma tante, debout, tout en me servant un verre de Chinon.
– Si, c’est sûr ! Et nous en sommes responsables !
– Écoute,Éloïse, ajoute ma tante avec un tranchant soudain, je suis scientifique, je sais de quoi je parle ! ».
Moi, j’ai le nez plongé dans mon verre de vin et je compte les points. Ou plutôt j’essaye de les compter. J’aime bien les discussions engagées, mais je dois avouer que là, ça frise le match de boxe. C’est qu’elles ont l’air sûres d’elles. Ma nièce, qui prétend du haut de ses seize ans qu’elle a raison de brosser les cours pour aller manifester. Et ma tante, qui rappelle avec le prestige de ses cheveux tirant vers le gris blanc qu’il faut toujours pratiquer le doute.
Alors moi, je fais quoi ?
Pour tout vous dire, ma vie, je la passe à essayer d’écrire de bonnes histoires pour le théâtre et la télévision. À bien des égards, en matière de sciences, je suis comme le premier citoyen venu : j’ai du mal à me faire une idée. À un moment donné, je dois faire confiance. Mais à qui ? À ma nièce ? Ou à ma tante ?
En rentrant à la maison – il doit être minuit passé – je me demande s’il est possible d’éclaircir la question. À la surprise de ma fille, Jeanne, qui me fait observer l’heure tardive, je monte au grenier à la recherche d’une caisse en carton. Je m’en souviens bien : c’est une caisse à archives balafrée de marqueur rouge dans laquelle j’ai classé des documents il y a un peu plus de dix ans.
J’avais écrit une pièce de théâtre sur la théorie du Big Bang1 et le soir de la première, un homme était venu vers moi après la représentation. Il avait la cinquantaine, le front dégarni et abritait un regard espiègle sous une des plus petites paires de lunettes qu’il m’ait été donné de voir. Les présentations faites, Jean-Pascal van Ypersele, climatologue belge alors vice-président du GIEC, me suggéra d’écrire une pièce sur le changement climatique. L’idée me plut, mais je n’avais aucune connaissance sur le sujet. Aussi, je fis ce que j’avais fait sur la théorie du Big Bang : je me mis à rassembler de la documentation.
Dans les mois qui suivirent, toutefois, d’autres projets artistiques vinrent remplir mon emploi du temps. Ma conversation avec Jean-Pascal van Ypersele s’éloigna et je n’écrivis jamais la pièce évoquée ce soir-là. Ma documentation, bientôt chassée de mon bureau, alla s’évanouir dans une caisse en carton.
C’était cette caisse que je cherchais dix ans plus tard.
Retrouver ces archives revint à ouvrir la boîte de Pandore. Les questions que la lecture de ces documents souleva m’amenèrent à d’autres documents, qui me conduisirent à de nouvelles questions.
Si je me suis résolu à écrire ce livre, loin des scénarios et des pièces de théâtre qui font mon quotidien, c’est pour partager avec vous les découvertes que je fis en essayant de démêler qui, de ma nièce ou de ma tante, lors de ce fameux repas de famille, avait raison ; les réponses qui se dégagèrent au fil des mois alors que j’essayais de comprendre si le réchauffement climatique d’origine humaine était un canular, une incertitude ou un fait scientifiquement établi.
Un petit bout d’histoire
La première des impressions que me renvoya l’examen de ma documentation fut que la climatologie était une science bien plus ancienne que je ne l’imaginais.
Mais, d’abord, la climatologie, qu’est-ce que c’est ?
La climatologie étudie les conditions météorologiques moyennes, l’évolution de ces conditions et les causes de cette évolution. C’est une branche combinée, c’est-à-dire qu’elle fait appel à plusieurs autres disciplines scientifiques. Elle recourt2 entre autres à la physique, à la chimie, à la biologie, à l’océanographie, à la glaciologie, à la statistique appliquée, à la modélisation informatique des systèmes complexes, à la sédimentologiei, à la spectroscopie moléculaireii et même à l’ornithologie.
Il n’est pas rare de confondre la climatologie avec la météorologie. Pourtant, ce sont deux sciences bien différentes. En étant un peu caricatural, on peut affirmer que ce qui intéresse le météorologue, ce sont les événements météorologiques dans les quelques jours qui précèdent et qui suivent une date donnée, et sur une surface terrestre assez limitée ; alors que ce qui intéresse le climatologue, ce sont les tendances des événements météorologiques en considérant des périodes plus longues (en général au moins trente ans) et des surfaces beaucoup plus grandes. Pour prendre une comparaison, la météorologie permet d’avoir des informations pour choisir sa tenue vestimentaire du jour, tandis que la climatologie permet d’avoir des informations pour constituer sa garde-robe3.
La confusion entre les deux sciences peut amener à bien des erreurs de raisonnement. Par exemple, constater qu’il grêle en plein mois d’août pour conclure qu’il n’y a pas de réchauffement climatique est une erreur. À l’opposé, constater qu’une seule journée du mois de décembre est particulièrement chaude et conclure qu’il y a un réchauffement climatique en est une autre.
*
La climatologie semble apparaître comme spécialité universitaire au cours de la seconde moitié du xxesiècle. Elle est toutefois pratiquée depuis beaucoup plus longtemps. L’étymologie du mot climat suffit à nous le rappeler. Klima, en grec, signifie inclinaison. Et l’un des tout premiers à évoquer la notion de climat, c’est Aristote4, qui pratique davantage l’astronomie et la géographie mathématique que la climatologie proprement dite. Aristote, génie universel et touche-à-tout, démontre que la Terre est sphérique et divise le globe en cinq zones climatiques correspondant à l’inclinaison des rayons du Soleil par rapport à l’horizon. Il en déduit de manière assez prémonitoire deux zones polaires, deux zones tempérées habitables de chaque côté de l’équateur et une zone centrale à l’équateur rendue inhabitable en raison de la chaleur.
L’une des personnalités fondatrices de la climatologie comme science est l’Américain Benjamin Franklin (1706-1790). Autre génie touche-à-tout, Benjamin Franklin a été imprimeur, journaliste et éditeur, mais aussi homme politique et premier ambassadeur des États-Unis en France. Il a participé à la rédaction et à l’adoption de la Déclaration d’indépendance américaine. Mais Benjamin Franklin était aussi naturaliste : il a inventé le paratonnerre après s’être intéressé aux tempêtes, à la formation des nuages et à leur électrification. Deux de ses apports scientifiques majeurs sont d’avoir publié la première carte du Gulf Stream et d’avoir deviné l’effet joué par les éruptions volcaniques sur les conditions météorologiques. Benjamin Franklin ne joue pas de rôle particulier dans les découvertes qui concernent le changement climatique. Si je l’évoque, c’est parce qu’il est l’un des pèresfondateurs d’une nation qui, elle, joue un rôle considérable dans la climatologie et vers laquelle nous allons régulièrement voyager au fil de cet ouvrage : les États-Unis d’Amérique.
Mais n’anticipons pas. Pour rencontrer les premiers scientifiques qui mettent au jour les principes d’un changement climatique d’origine anthropiqueiii, il faut rejoindre le xixesiècle.
*
En 1824, le mathématicien et physicien français Joseph Fourier, qui s’est beaucoup intéressé à la diffusion de la chaleur, est le premier à proposer une théorie selon laquelle les gaz qui composent l’atmosphère terrestre ont des conséquences sur la température du globe.
Le raisonnement de Fourier part du Soleil. Le Soleil nous envoie chaque jour une quantité importante d’énergie. Une partie de ce rayonnement solaire, environ 30%, repart vers l’espace en raison des nuages qu’il trouve sur son chemin, de la nature de certaines surfaces terrestres qui ont un pouvoir réfléchissant et de la composition de l’atmosphère. En outre, environ 20% du rayonnement solaire contribue à réchauffer l’atmosphère elle-même.
Mais le solde de ce rayonnement solaire, environ 50%, traverse, lui, l’atmosphère sans rencontrer d’obstacle et atteint la surface de la Terre. Que fait alors la surface ? Elle chauffe. Les continents et océans transforment en chaleur la lumière reçue du Soleil, qu’on appelle plus précisément lumière visible, et l’emmagasinent.
Toutefois, quand la surface de la Terre rendcette chaleur, elle ne la rend pas sous forme de lumière visible : la Terre ne luit pas. La surface rend cette énergie sous la forme d’une lumière que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu, une lumière invisible appelée « rayonnement infrarouge ». C’est un élément capital : le contact de la lumière avec la surface modifie les caractéristiques de l’énergie que nous recevons du Soleil.
Nous l’avons vu : 50% de la lumière visible n’a pas rencontré d’obstacles en traversant l’atmosphère pour venir toucher la surface (on dit que l’atmosphère est transparenteà lalumière visibleiv). Par contre, et c’est le second élément capital, le rayonnement infrarouge, lui, rencontre des obstacles lorsqu’il repart vers l’espace, parce que certains des composants gazeux de l’atmosphère (comme la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et le méthane) sont partiellement opaques pour le rayonnement infrarouge. Autrement dit, ces différents gaz constituent une barrière : ils absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface.
Ils vont ensuite émettre leur propre rayonnement infrarouge. Et ils vont le faire dans toutes les directions ; si bien qu’une partie de ce rayonnement s’échappe enfin vers l’espace, mais qu’une autre partie est renvoyée vers la surface de la Terre. L’interception du rayonnement infrarouge par ces gaz amène donc l’atmosphère basse de la Terre et la surface elle-même à être globalement plus chaudes que si le rayonnement infrarouge pouvait traverser l’atmosphère sans être intercepté. On peut donc dire que ces gaz agissent comme un isolant thermique : ils régulent la température globale moyenne de la Terre qui est, grâce à eux, de l’ordre de 15 °C. La planète Vénus, qui dispose d’un effet de serre beaucoup plus important que celui de la Terre, connaît une température de surface beaucoup plus élevée (460 °C environ), laquelle n’évolue que peu entre le jour et la nuit.
En l’absence de ce phénomène naturel, le rayonnement infrarouge repartirait beaucoup plus facilement vers l’espace. Le climat global de notre Terre serait plus froid et les différences de températures entre le jour et la nuit seraient beaucoup plus marquées. La Lune, par exemple, qui a une atmosphère insignifiante par rapport à celle de la Terre, connaît des températures de l’ordre de +120 °C en journée et de - 180 °C de nuitv. Si notre Terre n’avait pas l’atmosphère dont elle dispose, il y ferait en moyenne -18 °C et la vie ne pourrait pas exister.
Pour désigner la découverte de Joseph Fourier, on parle dans le langage courant d’effet de serre, parce que la composition de l’atmosphère agit à la manière des vitres d’une serre : elle laisse entrer la lumière, mais elle retient en partie les rayons infrarouges produits par le sol de la serre.
On compare parfois ce phénomène à une couverture sur notre corpsvi : « Notre corps refroidit quand nous nous allongeons sur le lit, le soir. La planète, elle, perd de la chaleur vers l’espace. Lorsque nous nous couvrons d’une couverture, la chaleur de notre corps n’est pas totalement perdue dans notre chambre, elle reste piégée sous la couverture5. »
*
Trente ans après Joseph Fourier, une femme, Eunice Foote, physicienne américaine, affine la compréhension de l’effet de serre. En 1856, elle met en évidence que le réchauffement de l’air atmosphérique par le Soleil est accentué lorsque du gaz carbonique (le dioxyde de carbone, le CO2) est présent6. Elle n’est pas autorisée à présenter ses découvertes à l’Association américaine pour l’avancement des sciences, parce qu’elle est une femme. Un homme, le professeur Joseph Henry, donnera lecture de ses travaux en déclarant en introduction : « La science n’a ni pays ni sexe. La sphère de la femme englobe non seulement le beau et l’utile, mais aussi le vrai7. »
Presque au même moment, de 1859 à 1879, le physicien irlandais John Tyndall va également apporter sa pierre à la compréhension du phénomène. Il montre8 –comme Eunice Foote– la capacité des différents gaz en suspension dans l’air à absorber le rayonnement infrarouge, c’est-à-dire à conserver de la chaleur. Ainsi, il mesure correctement les pouvoirs d’absorption de l’azote, de l’oxygène, de la vapeur d’eau, du dioxyde de carbone, de l’ozone et du méthane.
Tyndall va conclure que le plus puissant absorbeur de chaleur rayonnante –et, partant, le principal gaz contrôlant la température de l’air– c’est la vapeur d’eauvii. Dans ses travaux, Tyndall établit une règle valable pour tous les gaz à effet de serre : puisque ces gaz absorbent de la chaleur, les variations de leur concentration dans l’atmosphère peuvent entraîner des changements climatiques. Une fois encore, l’idée est simple et elle se résume à peu près à ceci : si, en allant nous coucher, nous mettons deux couvertures plutôt qu’une, nous augmentons la conservation de chaleur, et la température augmente en-dessous.
Enfin, en 1896, Svante August Arrhenius, chimiste suédois, a une nouvelle idée. Il se dit que si la concentration en CO2 de l’atmosphère a un lien avec la température globale, il doit être possible de déterminer à quelle variation de température donnera lieu une variation donnée de la quantité de CO2. Il estime9 alors qu’un doublement du taux de CO2 dans l’atmosphère causera un réchauffement d’environ 5 °C.
Arrhenius s’attendait à ce que le taux de CO2 double dans la suite de l’histoire, mais il établit ses calculs sur la base du rythme où le CO2 est émis à son époque, à partir des émissions issues de la combustion du charbon. Il pense donc que ce doublement prendra environ 3000 ans. Arrhenius s’est trompé sur certaines choses, mais il a formulé une loi sur l’effet de serre du CO2 qui n’a pas été invalidée depuis. Cette loi dit : si la quantité d’acide carbonique augmente en progression géométrique, l’augmentation de la température suivra, presque avec une progression arithmétique. Pour reprendre la comparaison, qui est imparfaite, Arrhenius établit un lien direct, mathématique, entre le nombre de couvertures que nous mettons et la température globale qu’il fait sous celles-ci.
Résumons. Fourier identifie l’effet de serre, Foote et Tyndall discernent le rôle des différents gaz dans cet effet de serre et Arrhenius établit le lien mathématique entre variation de la quantité de CO2 et variation de la température.
Somme toute, à la fin du xixesiècle, en se fondant sur les principes théoriques, tous les outils sont sur la table : les activités humaines peuvent modifier la concentration de CO2 dans l’atmosphère et peuvent donc, au même titre que les causes naturelles, provoquer des changements climatiques. En quelque sorte, les scientifiques se doutent que la Terre va devenir le théâtre d’une expérience de physique-chimie aux dimensions planétaires, mais personne ne peut encore en observer les effets.
*
La compréhension des théories qui précèdent va s’affiner au cours du xxesiècle. Elle va, surtout, s’enrichir d’observations tangibles.
En 1938 déjà, l’ingénieur britannique Guy Callendar publie un article10 qui apparaît aujourd’hui comme révolutionnaire. Callendar ne pratiquait la climatologie qu’en amateur et effectuait tous ses calculs à la main. Toutefois, il recueille des mesures de la température mondiale, déduit de leur analyse que la planète s’est déjà globalement réchauffée et lie ce réchauffement à l’exploitation des énergies fossiles.
Dans une série d’articles publiés en 1956, le physicien américano-canadien Gilbert Plass11 précise les conclusions d’Arrhenius. Il estime qu’un doublement du CO2 dans l’atmosphère réchauffera la planète de 3,6 °C, que les concentrations de CO2 augmenteront de 30% au cours du xxesiècle et que la Terre se réchauffera d’environ 1 °C au cours de la même période.
En 1961, à partir d’une base de recherche située à Hawaii, le chimiste américain Charles David Keeling montre que les niveaux de CO2 dans l’atmosphère sont effectivement en augmentation12.
Enfin, en 1965, Lyndon Johnson, président des États-Unis, évoque pour la première fois le sujet devant le Congrès américain13. Le rapport, qui le met en garde contre les risques d’un déséquilibre climatique, n’envisage pas de réduire les émissions mondiales de CO2, mais de recourir à la technologie.
*
L’année 1979 est, à bien des égards, une année capitale en sciences climatiques.