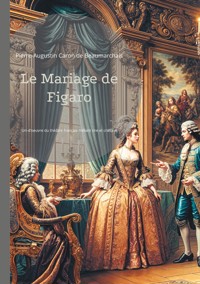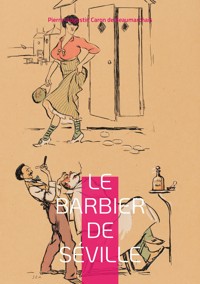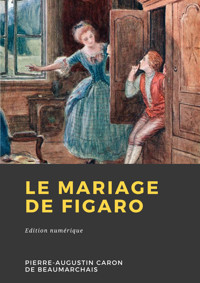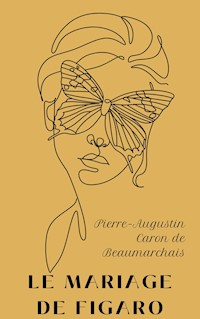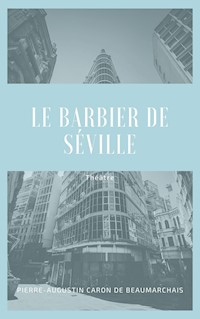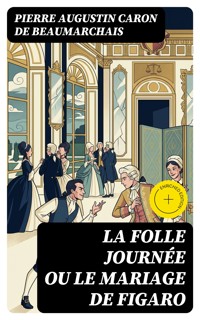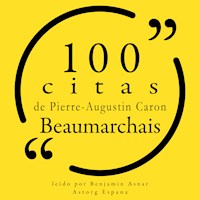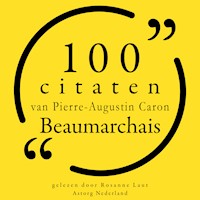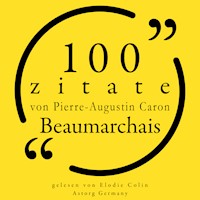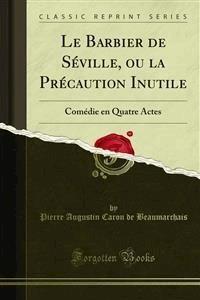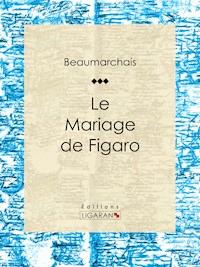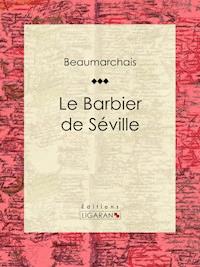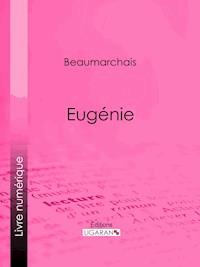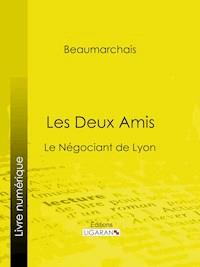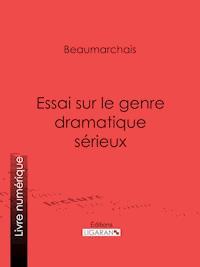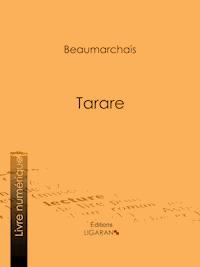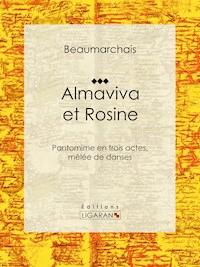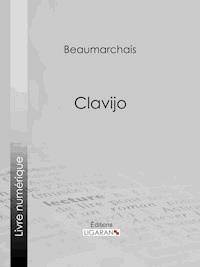
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis douze ou quinze jours, Marin fait courir par la ville une lettre d'un soi-disant ambassadeur adressée à lui, dans laquelle on suppose que j'ai commis, en pays étranger, des crimes dignes du dernier supplice. Les uns mettent la scène en Italie, d'autres la portent en Angleterre ; les commis de Marin, les sieurs Adam et Mercier, en racontant ce prétendu délit, ont attesté devant neuf ou dix témoins, qui le certifieront, qu'à son occasion mon procès m'avait..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091755
©Ligaran 2015
À quarante et un ans, en 1773, Beaumarchais n’était encore connu, socialement parlant, que comme un parvenu de plus d’audace encore que d’esprit, et, littérairement parlant, que comme l’auteur de deux drames, EUGÉNIE et LES DEUX AMIS, où l’originalité de son talent, impatient de trouver des voies nouvelles, ne se dégageait pas encore assez de l’imitation de Diderot et de Sedaine. Il était d’ailleurs, à ce moment, trop occupé pour se donner tout entier à une seule ambition : il les avait toutes, et tous les genres de succès avaient tour à tour attiré son hommage. Il s’était d’abord donné un nom, celui de Beaumarchais, qui lui appartenait bien, puisqu’il l’avaitpayé, disait-il lui-même, et en avait quittance, comme de la noblesse hâtive dont son brevet de secrétaire du roi lui donnait le privilège. Écuyer, conseiller-secrétaire du roi, lieutenant général des chasses aux bailliages et capitainerie de la Varenne du Louvre, grande vénerie et fauconnerie de France, le fils de l’horloger Caron, devenu sieur de Beaumarchais, maître d’un nom et d’une charge, avait essayé vainement par deux fois, en épousant deux riches veuves qu’il avait fascinées, de fonder une famille.
En 1770, la mort de sa seconde femme l’avait laissé libre de cœur, absorbé par le soin d’établir sa fortune sur la faveur lucrative du vieux Pâris-Duverney, séduit comme les autres par le charme irrésistible d’un homme entreprenant, actif, habile, éloquent, devinant tout ce qu’il ignorait, capable de tous les talents, et qui prétendait sans ridicule à tous les succès. Il en avait même de galants, qui lui coûtaient plus cher qu’ils ne valaient. C’est ainsi qu’il encourut la fureur jalouse d’un grand seigneur brutal, le duc de Chaulnes, supplanté par ce rival trop heureux auprès de la comédienne-courtisane Mlle Ménard. La querelle scandaleuse qui s’ensuivit commença la série desmésaventures d’un homme à qui tout réussissait jusque-là si insolemment, et mit le feu aux poudres de la malignité publique.
Les malheurs ne venant jamais seuls, la mort de son protecteur Pâris-Duverney continua d’ébranler et menaça de ruiner l’édifice fragile d’une fortune non encore assise, à peine fondée, toute en façade, en décor, en apparences, en espérances, en crédit. Le règlement de comptes sur lequel elle reposait fut contesté et même argué de faux par l’héritier de Pâris-Duverney, le comte de La Blache. La police du temps avait, en emprisonnant arbitrairement Beaumarchais au For-l’Évêque, mis Beaumarchais dans l’impossibilité matérielle et morale de se défendre, et l’avait livré désarmé à cet impopulaire parlement Maupeou, corps plus politique que judiciaire, composé de magistrats de hasard, plus soucieux de rendre des services que de rendre la justice.
Ce fut un terrible moment dans la vie d’un homme fait pour tous les combats et qui ne désespérait d’aucune victoire, à la condition cependant de pouvoir lutter. Or, dans la situation qui lui était faite, en face des puissances hostiles, de l’opinion prévenue, ce n’était pas trop de toutes ses forces, detoute sa liberté, pour oser affronter un duel si inégal ; et Beaumarchais, discrédité par des calomnies auxquelles il n’avait pu répondre, privé par des saisies rigoureuses des ressources qui lui étaient si nécessaires, ne semblait plus pouvoir paraître devant ses juges que pour s’entendre condamner. Tout était contre lui ; il n’avait pour lui que lui-même.
Ce n’eût pas été assez si les circonstances, qui le desservaient à l’envi, ne se fussent, au moment le plus critique, décidées, par un revirement imprévu dont il usa habilement, intrépidement, en sa faveur, détournant au profit de son salut, puis de son triomphe, tout ce qui devait le perdre. Au moment même où, ayant contre lui la cour, la ville, la police, le parlement, il touchait à l’abîme et mesurait, d’un suprême coup d’œil aux lucidités terribles, la profondeur de ce gouffre d’infamie où il allait tomber, il se releva et rebondit au succès par un de ces efforts inouïs, de ces prestigieux tours de force, qui enlèvent les foules, parce qu’elles ne voient que le succès, mais donnent le vertige à l’observateur de sang-froid, qui calcule le danger.
Accusé de faux par le comte de La Blache, Beaumarchaisse trouvait de plus, à la suite d’une démarche imprudente divulguée par lui-même avec la témérité d’un joueur qui joue son va-tout, accusé de calomnie et de corruption par le juge lui-même dont il proclamait la vénalité. La querelle du conseiller rapporteur Goëzman devenait celle du corps auquel il appartenait. Il semblait que l’homme coupable de l’avoir diffamé ne put être que sa victime. Il l’eut été sans l’appui de l’opinion : elle prit parti pour celui qui, par ce courageux affront, vengeait son humiliation et satisfaisait ses rancunes, Beaumarchais, il faut le dire, pour son coup d’essai, avait fait un coup de maître : il avait fait de sa cause celle de tout le monde ; il l’avait plaidée dans des Mémoires immortels, qui créaient un genre nouveau, et faisaient monter une fois de plus, – après Voltaire, dont ils rappelaient l’éloquence, dont ils reproduisaient l’ironie avec tout ce qu’ajoute de feu à l’une, de sel à l’autre, le sentiment de l’intérêt et du péril personnels, – de simples factums judiciaires au rang des chefs-d’œuvre de notre littérature.
Nous venons de parler de Voltaire. C’est le cas de dire qu’il se reconnut avec plaisir dans son image, qu’il salua dans Beaumarchais, avec un enthousiasme paternel, la révélation d’un fils digne de lui, et qu’il se fit honneur de le recommander comme sien à l’opinion.
« Quel homme ! écrivait-il à d’Alembert. Il réunit tout, la plaisanterie, le sérieux ; la raison, la gaieté, la force, le touchant, tous les genres d’éloquence, et il n’en recherche aucun, et il confond tous ses adversaires, et il donne des leçons à ses juges. Sa naïveté m’enchante. Je lui pardonne ses imprudences et ses pétulances. »
Horace Walpole, de son côté, écrivait à Mme du Deffand :
« J’ai reçu les Mémoires de Beaumarchais ; j’en suis au troisième, et cela m’amuse beaucoup. Cet homme est fort adroit, raisonne juste, a beaucoup d’esprit ; ses plaisanteries sont quelquefois très bonnes, mais il s’y complaît trop. Enfin, je comprends que, moyennant l’esprit de parti actuel, chez vous cette affaire doit faire grande sensation. »
« En Allemagne, dit M. de Loménie, le biographe de Beaumarchais, l’effet ne fut pas moindre qu’en Angleterre. Gœthe nous a raconté lui-même comment, à Francfort, dans une société où on lisait tout haut les plaidoyers de Beaumarchais, une jeune fille lui donna l’idée de transformer en drame l’épisode de Clavijo… »
Rien ne manqua donc au succès de Beaumarchais. D’obscur il devint célèbre ; d’abord antipathique à l’opinion, il passa au rang de ses idoles. Les princes lui firent la cour ; M. de Sartine s’empressa de mettre au service d’une négociation scabreuse les talents de ce diable d’homme, qui n’avait peur de rien et réussissait dans tout ce qu’il entreprenait. Les femmes joignirent leurs compliments aux hommages des hommes. C’est à l’occasion de son procès qu’il connut la troisième femme qui, doucement victorieuse de ses instincts vagabonds, devait le réduire peu à peu au joug des devoirs et des bonheurs domestiques, et le lui faire trouver léger.
Enfin Beaumarchais goûta dans la chute de ce parlement Maupeou, qui ne devait pas se releverdes coups qu’il lui avait portés, la plus noble des vengeances, puisque la nation en triomphait avec lui.
Cette impopularité des juges de Beaumarchais ne devait pas être rachetée même par les généreuses illusions et les efforts téméraires qui associèrent les parlements réintégrés par Louis XVI, dès son avènement, sur les fleurs de lis, d’où leurs suppléants usurpateurs avaient été chassés comme intrus, aux premières revendications de cet esprit nouveau d’où sortit la Révolution.
Un des premiers actes de cette Révolution triomphante, – et ingrate en cela comme en d’autres choses, – fut de supprimer les parlements et d’envoyer à l’échafaud leurs membres, sans distinguer s’ils avaient reçu leur investiture du coup d’État de 1770 ou de la restauration du droit qui répara en 1774 l’injure faite à la justice. Le chancelier Maupeou échappa à la proscription de ces corps de judicature suprême qu’il avait tant contribué à discréditer ; mais nous trouvons le conseiller Goëzman, que les vingt ans d’obscurité qui succédèrent à sa disgrâce et à sa démission non volontaire n’avaient pas fait oublier, dans une des dernières fournées de condamnés (c’estcelle d’André Chénier) envoyés à la guillotine par un ancien avocat au parlement qui s’appelait Fouquier-Tinville.
Beaumarchais lui-même, en dépit de ses Mémoires, en dépit de ce Figaro qui fit plus pour la dévolution peut-être que tout le reste, devait avoir à se plaindre de la Révolution et à lui disputer sa fortune, sa liberté et sa vie. Mais nous ne sommes qu’en 1773, et par le bénéfice de notre sujet nous pouvons y rester. Ce sujet ne comporte que le récit de cette année, la plus malheureuse et la plus heureuse à la fois de la vie de Beaumarchais, où il gagna la réputation et la fortune, après avoir risqué de perdre tout, hormis la vie, même la vie, peut-on dire, puisqu’il était résolu à ne pas survivre à la ruine de son honneur.
Il ne nous reste donc, pour justifier le choix que nous avons fait des meilleures parmi les meilleures pages que Beaumarchais ait écrites, au jugement de M. de Loménie, qu’à expliquer par suite de quelles circonstances Beaumarchais, en procès avec le comte de La Blache, se trouva pris à partie par le conseiller Goëzman, et qu’à déterminer la part exacte de vérité que contient ce fameux épisode de CLAVIJO, où certains critiques, chicanantleur émotion et marchandant leur éloge, ont exagéré la dose de fiction inévitable et légitime dans tout récit de ce genre. L’aventure est certaine. Beaumarchais la racontait à distance, en réponse à une calomnie, et l’on ne saurait lui en vouloir d’avoir ajouté à la réalité cette pointe de roman, cet assaisonnement dramatique, qui sont du droit de l’art, et le rendent parfois plus vrai que la nature elle-même. La question, toutefois, vaut la peine d’être étudiée, et nous allons trouver dans le récit sans commentaires, dans le procès-verbal historique des faits qui se rattachent au procès Goëzman et à l’épisode Clavijo, l’occasion de le faire brièvement.
Beaumarchais avait eu l’occasion de rendre un service au fameux financier Pâris-Duverney, qui ne l’avait pas oublié. De là entre eux une liaison d’amitié et d’affaires qui dura dix ans, pendant lesquels Beaumarchais, tout en servant les intérêts de son patron, ne négligea point les siens. Cette association, qui ne se dénoua que par la mort dePâris-Duverney, avait donné lieu à des comptes dont le règlement se fit entre lui et Beaumarchais le 12 avril 1770.
Par un acte fait double sous seing privé entre les deux contractants, Beaumarchais restituait à Duverney 160 000