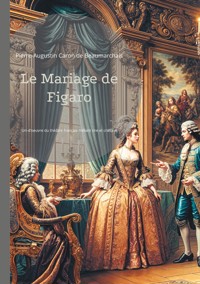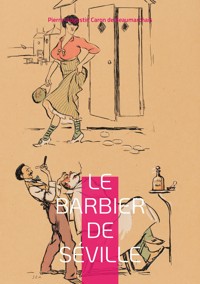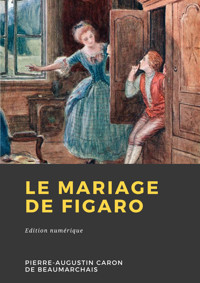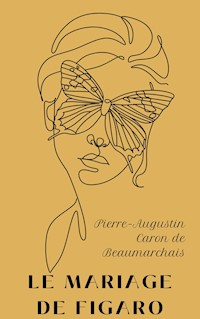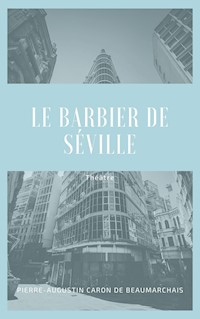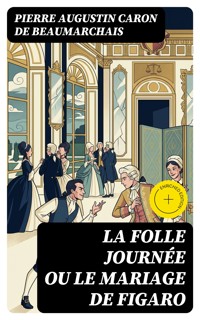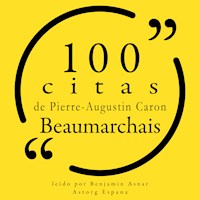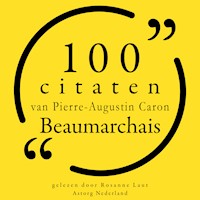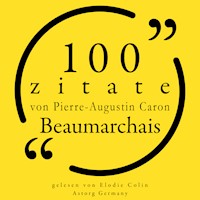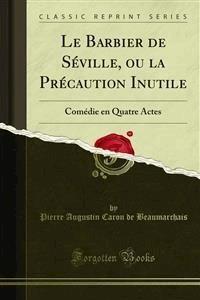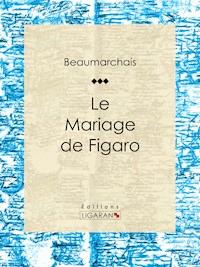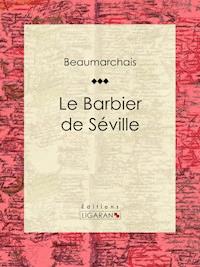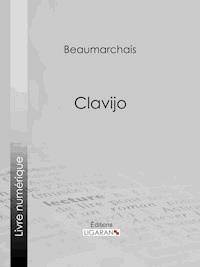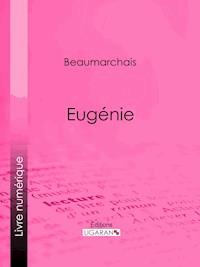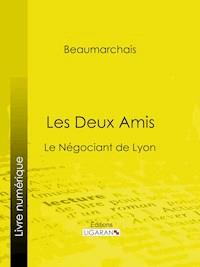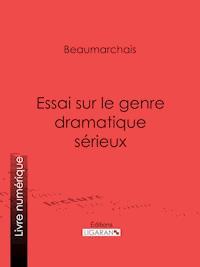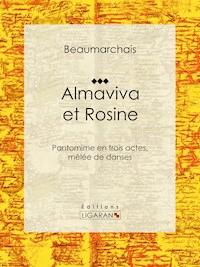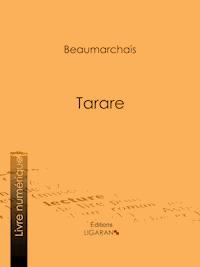
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est assez troubler l'Univers ; Vents furieux, cessez d'agiter l'air et l'onde. C'est assez, reprenez vos fers : Que le seul zéphir règne au monde."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335095487
©Ligaran 2015
Barbarus ast ego sum…
QUI VOUDRAIENT AIMER L’OPÉRA
Ce n’est point de l’art de chanter, du talent de bien moduler, ni de la combinaison des sons ; ce n’est point de la musique en elle-même, que je veux vous entretenir : c’est l’action de la poésie sur la musique, et la réaction de celle-ci sur la poésie au théâtre, qu’il m’importe d’examiner, relativement aux ouvrages où ces deux arts se réunissent. Il s’agit moins pour moi d’un nouvel opéra que d’un nouveau moyen d’intéresser à l’Opéra.
Pour vous disposer à m’entendre, à m’écouter avec un peu de faveur, je vous dirai, mes chers contemporains, que je ne connais point, de siècle où j’eusse préféré de naître, point de nation à qui j’eusse aimé mieux appartenir. Indépendamment de tout ce que la société française a d’aimable, je vois en nous, depuis vingt ou trente ans, une émulation vigoureuse, un désir général d’agrandir nos idées par d’utiles recherches, et le bonheur de tous, par l’usage de la raison.
On cite le siècle dernier comme un beau siècle littéraire ; mais qu’est-ce que la littérature dans la masse des objets utiles ? Un noble amusement de l’esprit. On citera le nôtre comme un siècle profond de science, de philosophie, fécond en découvertes, et plein de force et de raison. L’esprit de la nation semble être dans une crise heureuse : une lumière vive et répandue fait sentir à chacun que tout peut être mieux. On s’inquiète, on s’agite, on invente, on réforme ; et depuis la science profonde qui régit les gouvernements, jusqu’au talent frivole de faire une chanson ; depuis cette élévation de génie qui fait admirer Voltaire et Buffon, jusqu’au métier facile et lucratif de critiquer ce qu’on n’aurait pu faire ; je vois dans toutes les classes un désir de valoir, de prévaloir, et d’étendre ses idées, ses connaissances, ses jouissances, qui ne peut que tourner à l’avantage universel ; et c’est ainsi que tout s’accroît, prospère et s’améliore. Essayons, s’il se peut, d’améliorer un grand spectacle.
Tous les hommes, vous le savez, ne sont pas avantageusement placés pour exécuter de grandes choses ; chacun de nous est ce qu’il naquit, et devient après ce qu’il peut. Tous les instants de la vie du même homme, quelque patriote qu’il soit, ne sont pas non plus destinés à des objets d’égale utilité : mais si nul ne préside au choix de ses travaux, tous au moins choisissent leurs plaisirs ; et c’est peut-être dans ce choix qu’un observateur doit chercher le vrai secret des caractères. Il faut du relâche à l’esprit.
Après le travail forcé des affaires, chacun suit son attrait dans ses amusements ! l’un chasse, l’autre boit ; celui-ci joue, un autre intrigue ; et moi qui n’ai point tous ces goûts, je fais un modeste opéra.
Je conviendrai naïvement, pour qu’on ne me dispute rien, que de toutes les frivolités littéraires, une des plus frivoles est peut-être un poème de ce genre, je conviens encore que si l’auteur d’un tel ouvrage allait s’offenser du peu de cas qu’on en fait ; malheureux par ce ridicule, et ridicule par ce malheur, il serait le plus sot de tous ses ennemis.
Mais d’où naît ce dédain pour le poème d’un opéra ? car enfin ce travail a sa difficulté. Serait-ce que la nation française, plus chansonnière que musicienne, préfère aux madrigaux de sa musique l’épigramme et ses vaudevilles ? Quelqu’un a dit que les Français aimaient véritablement les chansons, mais n’avaient que la vanité d’un prétendu goût de musique. Ne pressons point cette opinion, de peur de la consolider.
Le froid dédain d’un opéra ne vient-il pas plutôt de ce qu’à ce spectacle la réunion mal ourdie de tant d’arts nécessaires à sa formation a fini par jeter un peu de confusion dans l’esprit, sur le rang qu’ils doivent y tenir, sur le plaisir qu’on a droit d’en attendre ?
La véritable hiérarchie de ces arts devrait, ce me semble, ainsi marcher dans l’estime des spectateurs. Premièrement, la pièce ou l’invention du sujet, qui embrasse et comporte la masse de l’intérêt ; puis la beauté du poème, ou la manière aisée d’en narrer les évènements ; puis le charme de la musique, qui n’est qu’une expression nouvelle ajoutée au charme des vers ; enfin, l’agrément de la danse, dont la gaieté, la gentillesse, embellit quelques froides situations. Tel, est, dans l’ordre du plaisir, le rang marqué pour tous ces arts.
Mais, par une inversion bizarre particulière à l’opéra, il semble que la pièce n’y soit rien qu’un moyen banal, un prétexte pour faire briller tout ce qui n’est pas elle. Ici, les accessoires ont usurpé le premier rang, pendant que le fond du sujet n’est plus qu’un très mince accessoire ; c’est le canevas des brodeurs que chacun couvre à volonté.
Comment donc est-on parvenu à nous donner ainsi le change ? Nos Français, que l’on sait si vifs sur ce qui tient à leurs plaisirs, seraient-ils froids sur celui-ci ?
Essayons d’expliquer pourquoi les amateurs les plus zélés (moi le premier) s’ennuient toujours à l’Opéra. Voyons pourquoi dans ce spectacle on compte le poème pour rien ; et comment la musique, tout insignifiante qu’elle est lorsqu’elle marche sans appui, nous attache plus que les paroles, et la danse plus que la musique. Ce problème, depuis longtemps, avait besoin qu’on l’expliquât ; je vais le faire à ma manière.
D’abord, je me suis convaincu que, de la part du public, il n’y a point d’erreur dans ses jugements au spectacle, et qu’une peut y en avoir. Déterminé par le plaisir, il le cherche, il le suit partout. S’il lui échappe d’un côté, il tente à le saisir de l’autre. Lassé, dans l’opéra, de n’entendre point les paroles, il se tourne vers la musique : celle-ci, dénuée de l’intérêt du poème, amusant à peine l’oreille, le cède bientôt à la danse, qui de plus amuse les yeux. Dans cette subversion funeste à l’effet théâtral, c’est toujours, comme on voit, le plaisir que l’on cherche : tout le reste est indifférent. Au lieu de m’inspirer un puissant intérêt, si l’opéra ne m’offre qu’un puéril amusement, quel droit a-t-il à mon estime ? Le spectateur a donc raison ; c’est le spectacle qui a tort.
Boileau écrivait à Racine : On ne fera jamais un bon opéra. La musique ne sait pas narrer. Il avait raison, pour son temps. Il aurait pu même ajouter : La musique ne sait pas dialoguer. On ne se doutait pas alors qu’elle en devint jamais susceptible.
Dans une lettre de cet homme qui a tout pensé, tout écrit ; dans une lettre de Voltaire à Cideville, en 1752, on lit ces mots bien remarquables : « L’opéra n’est qu’un rendez-vous public, où l’on s’assemble à certains jours, sans trop savoir pourquoi ; c’est une maison où tout je monde va, quoiqu’on pense mal du maître, et qu’il soit assez ennuyeux. »
Avant lui, la Bruyère avait dit : « On voit bien que l’opéra est l’ébauche d’un grand spectacle ; il en donne l’idée ; mais je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer. »
Ils disaient librement ce que chacun éprouvait, malgré je ne sais quelle vanité nationale qui portait tout le monde à le dissimuler. Quoi ! de la vanité jusque dans l’ennui d’un spectacle ! Je dirais volontiers comme l’abbé Basile : Qui est-ce donc qu’on trompe ici ? Tout le monde est dans le secret !
Quant à moi, qui suis né très sensible aux charmes de la bonne musique, j’ai bien longtemps cherché pourquoi l’opéra m’ennuyait, malgré tant de soins et de frais employés à l’effet contraire ; et pourquoi tel morceau détaché qui me charmait au clavecin, reporté du pupitre au grand cadre, était près de me fatiguer s’il ne m’ennuyait pas d’abord ; et voici ce que j’ai cru voir.
Il y a trop de musique dans la musique du théâtre, elle en est toujours surchargée ; et, pour employer l’expression naïve d’un homme justement célèbre, du célèbre chevalier Gluck, notre opéra pue de musique : puzza di musica.
Je pense donc que la musique d’un opéra n’est, comme sa poésie, qu’un nouvel art d’embellir la parole, dont il ne faut point abuser.
Nos poètes dramatiques ont senti que la magnificence des mots, que tout ce luxe poétique dont l’ode se pare avec succès, était un ton trop exalté pour la scène : ils ont tous vu que, pour intéresser au théâtre, il fallait adoucir, apaiser cette poésie éblouissante, la rapprocher de la Nature ; l’intérêt du spectacle exigeant une vérité simple et naïve, incompatible avec ce luxe.
Cette réforme, faite, heureusement pour nous, dans la poésie dramatique, nous restait à tenter sur la musique du théâtre. Or, s’il est vrai, comme on n’en peut douter, que la musique soit à l’opéra ce que les vers sont à la tragédie, une expression plus figurée, une manière seulement plus forte de présenter le sentiment ou la pensée, gardons-nous d’abuser de ce genre d’affectation, de mettre trop de luxe dans cette manière de peindre. Une abondance vicieuse étouffe, éteint la vérité : l’oreille est rassasiée, et le cœur reste vide. Sur ce point, j’en appelle à l’expérience de tous.
Mais que sera-ce donc, si le musicien orgueilleux, sans goût ou sans génie, veut dominer le poète, ou faire de sa musique une œuvre séparée ? Le sujet devient ce qu’il peut ; on n’y sent plus qu’incohérence d’idées, division d’effets, et nullité d’ensemble ; car deux effets distincts et séparés ne peuvent concourir à cette unité qu’on désire, et sans laquelle il n’est point de charme au spectacle.
De même qu’un auteur français dit à son traducteur : Monsieur, êtes-vous d’Italie ? traduisez-moi cette œuvre en italien, mais n’y mettez rien d’étranger ; poète d’un opéra, je dirais à mon partenaire : Ami, vous êtes musicien : traduisez ce poème en musique ; mais n’allez pas, comme Pindare, vous égarer dans vos images, et chanter Castor et Pollux sur le triomphe d’un athlète ; car ce n’est pas d’eux qu’il s’agit.
Et si mon musicien possède un vrai talent, s’il réfléchit avant d’écrire, il sentira que son devoir, que son succès consiste à rendre mes pensées dans une langue seulement plus harmonieuse ; à leur donner une expression plus forte, et non à faire une œuvre à part. L’imprudent qui veut briller seul n’est qu’un phosphore, un feu follet. Cherche-t-il à vivre sans moi, il ne fait plus que végéter : un orgueil si mal entendu tue son existence et la mienne ; il meurt au dernier coup d’archet, et nous précipite à grand bruit, du théâtre au fond de l’Érèbe.
Je ne puis assez le dire, et je prie qu’on y réfléchisse ; trop de musique dans la musique est le défaut de nos grands opéras.
Voilà pourquoi tout y languit. Sitôt que l’acteur chante, la scène se repose (je dis s’il chante pour chanter), et partout où la scène repose l’intérêt est anéanti. Mais, direz-vous, si faut-il bien qu’il chante, puisqu’il n’a pas d’autre idiome ! – Oui ; mais tâchez que je l’oublie. L’art du compositeur serait d’y parvenir. Qu’il chante le sujet comme on le versifie, uniquement pour le parer ; que j’y trouve un charme de plus, non un sujet de distraction.
« Moi, qui toujours ai chéri la musique, sans inconstance et même sans infidélité, souvent aux pièces qui m’attachent le plus, je me surprends à pousser de l’épaule, à dire tout bas avec humeur : Va donc, musique ! Pourquoi tant répéter ? N’es-tu pas assez lente ? Au lieu de narrer-vivement, tu rabâches au lieu de peindre la passion, tu t’accroches oiseusement aux mots ! »
Qu’arrive-t-il de tout cela ? Pendant qu’avare de paroles, le poète s’évertue à serrer son style, à bien concentrer sa pensée ; si le musicien, au rebours, délaye, allonge, les syllabes, et les noie dans des fredons, leur ôte la force ou le sens ; l’un tire à droite, l’autre à gauche ; on ne sait plus auquel entendre : le triste bâillement me saisit, l’ennui me chasse de la salle.
Que demandons-nous au théâtre ? Qu’il nous procure du plaisir. La réunion de tous les arts charmants devrait certes nous en offrir un des plus vifs à l’Opéra. N’est-ce pas de leur union même que ce spectacle a pris son nom ? Leur déplacement, leur abus en a fait un séjour d’ennui.