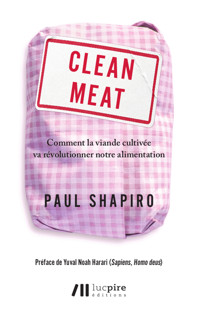
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Résumé : Depuis l’apparition de l’Homo sapiens il y a plus de 200 000 ans, nous nous sommes toujours tournés vers les animaux pour satisfaire notre désir de viande. Mais cette habitude séculaire est-elle compatible avec la croissance démographique que connaît notre espèce ? On prévoit que la Terre comptera neuf à dix milliards d’habitants d’ici 2050. Si la plupart auront les moyens d’adopter un régime alimentaire aussi fastueux que les Occidentaux d’aujourd’hui, on peut difficilement imaginer où trouver les terres cultivables et les autres ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Et si nous pouvions produire la viande autrement ? La viande dite « propre » (clean meat), une véritable viande obtenue grâce à la culture de cellules musculaires animales, pourrait être la solution. Avec une seule cellule provenant d’une vache, nous pourrions nourrir un village entier sans avoir besoin de recourir à l’élevage et à l’abattage d’animaux, et ainsi éviter la souffrance animale. Ce nouveau procédé pourrait révolutionner notre alimentation, rien de moins. Découvrez les dessous de cette course pour la création et la commercialisation d’une viande plus propre, plus sûre et plus durable. En allant à la rencontre de jeunes entrepreneurs visionnaires, de scientifiques spécialisés dans l’ingénierie tissulaire ou encore de grands leaders du secteur alimentaire, l’auteur détaille cette quête pour une viande propre et expose le débat qu’elle suscite. Auteur : Paul Shapiro est le vice-président de la Humane Society of the United States, une des plus grandes organisations de protection des animaux. En tant qu’expert reconnu sur la question du bien-être animal, il a notamment été interviewé par le New York Times, le National Review, le Time, le Chicago Tribune, Fox News et NPR. La version originale de Clean Meat fut sacrée best-seller par le Washington Post.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLEAN MEAT
Éditions Luc Pire [Renaissance SA]
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
Éditions Luc Pire
www.editionslucpire.be
Clean Meat
de Paul Shapiro
Couverture : © Studio Pelckmans uitgevers
Photo en quatrième de couverture : © Paul Shapiro
ISBN : 978-2-875-42185-2
Version originale : Clean Meat. How Growing Meat Without Animals
Will Revolutionize Dinner and the World
© Paul Shapiro, 2018
Version française : © Éditions Luc Pire, 2019
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Avec le soutien de GAIA.
www.viandecultivee.be
Paul Shapiro
CLEAN MEAT
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-François Caro
Ce livre est dédié à tous ceux qui, face à une épreuve qui semble insurmontable, s’inspirent des paroles de Nelson Mandela : « Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. »
Préface
Aujourd’hui, la plupart des grands animaux de notre planète vivent dans des fermes industrielles. On s’imagine que la Terre est peuplée de lions, d’éléphants et de pingouins libres de circuler comme bon leur semble dans les étendues sauvages et sous la surface des océans. C’est peut-être le cas dans les émissions de la chaîne National Geographic, les films produits par Disney et les contes pour enfants, mais cela ne l’est certainement plus dans le monde réel, hors des écrans. Notre planète compte 40 000 lions et 1 milliard de cochons domestiqués ; 500 000 éléphants et 1,5 milliard de vaches domestiquées ; 50 millions de pingouins et 50 milliards de poulets. En 2009, une enquête estimait à 1,6 milliard la population des oiseaux sauvages en Europe, toutes espèces confondues. La même année, la filière européenne de la viande et des œufs totalisait près de 7 milliards de poulets d’élevage. Une part considérable des animaux vertébrés de notre planète ne vivent plus en liberté, mais sous la domination d’un seul animal : l’Homo sapiens.
Dans ces fermes industrielles, ces milliards d’animaux ne sont pas traités comme des créatures vivantes qui éprouvent de la douleur et de la détresse, mais comme des machines à produire de la viande, du lait et des œufs. La plupart sont élevés en masse dans des bâtiments semblables à des usines, et leur corps lui-même doit se plier aux exigences de l’industrie. Toute leur vie durant, ces animaux sont réduits à des rouages au service d’une gigantesque chaîne de production, et la longueur et la qualité de leur existence dépendent des profits et des pertes des entreprises d’agrobusiness. Si on le juge par les souffrances qu’il provoque, l’élevage industriel des animaux figure sans doute parmi les crimes les plus horribles de l’histoire.
Au fil de l’histoire, la recherche scientifique et les progrès technologiques ont généralement eu tendance à aggraver les conditions de vie des animaux d’élevage. Dans les sociétés traditionnelles telles que l’Égypte ancienne, l’Empire romain ou la Chine médiévale, les humains avaient une maîtrise très rudimentaire de la biochimie, de la génétique, de la zoologie et de l’épidémiologie, ce qui limitait leur pouvoir de manipulation. Au Moyen Âge, les poulets erraient librement entre les maisons des villages, picorant des graines et des vers dans les tas d’ordures et faisant leur nid dans les étables. Si un ambitieux paysan avait voulu entasser 1 millier de poulets dans un enclos exigu, il aurait probablement déclenché une épidémie mortelle de grippe aviaire qui aurait décimé ses bêtes et de nombreux villageois. Aucun prêtre, chaman ou sorcier n’aurait pu enrayer la catastrophe.
Mais quand la science moderne nous a permis de percer les secrets des oiseaux, des virus et des antibiotiques, les humains ont pu commencer à obliger les animaux à vivre dans des conditions extrêmes. À l’aide de vaccins, antibiotiques, hormones de croissance, pesticides, systèmes de climatisation centrale, mangeoires automatiques et quantité d’appareils inédits, nous pouvons désormais parquer des dizaines de milliers de poulets ou d’autres animaux dans des espaces exigus pour produire de la viande et des œufs avec une efficacité sans précédent – et dans des conditions de souffrance invraisemblables.
Au XXIe siècle, la science et la technologie renforceront encore un peu plus notre ascendant sur les autres espèces vivantes. Pendant quatre milliards d’années, la vie sur Terre était régie par la sélection naturelle. Bientôt, elle obéira au dessein intelligent de l’espèce humaine. Mais la technologie n’est jamais déterministe. Selon notre manière de les exploiter, les mêmes révolutions technologiques engendrent des sociétés et des contextes radicalement différents. Au XXe siècle par exemple, l’utilisation des progrès hérités de la révolution industrielle – le rail, l’électricité, la radio, le téléphone – a aussi bien abouti à des dictatures et des régimes fascistes qu’à des démocraties libérales.
De la même manière, au XXIe siècle, la biotechnologie peut servir de nombreuses fins différentes. Nous pourrions choisir de l’utiliser pour créer des vaches, cochons et poulets qui grandiraient plus rapidement et produiraient plus de viande sans nous soucier une seule seconde des souffrances que nous leur infligeons. Mais nous pourrions également créer de la viande dite « propre » – de la véritable viande, fabriquée à partir de cellules animales, sans devoir élever ni abattre une seule créature vivante. Si nous empruntons cette voie, la biotechnologie ne serait plus un fléau pour les animaux d’élevage et garantirait même leur libération. Grâce à elle, on pourrait produire de la viande pour les nombreux humains qui en raffolent sans causer autant de dégâts sur notre planète : cultiver uniquement de la viande est effectivement bien plus avantageux que d’élever des animaux dans le même but.
La viande propre n’est pas de la science-fiction. Comme vous le découvrirez dans cet ouvrage, le premier hamburger cultivé au monde a été créé et consommé en 2013. Certes, sa fabrication a coûté 330 000 dollars et a été en partie financée par le cofondateur de Google, Sergey Brin. Mais rappelons-nous que le premier séquençage du génome humain a coûté des milliards et qu’aujourd’hui, la même procédure revient à peine à quelques centaines de dollars. En 2017 – seulement quatre ans après la dégustation du premier burger de culture –, les auteurs de cette innovation culinaire ont déjà perfectionné leurs méthodes, si bien que les coûts de production ne représentent aujourd’hui qu’une infime fraction de ceux du premier hamburger. La concurrence est déjà sur le pied de guerre, notamment une entreprise américaine qui a créé en 2016 la première boulette de viande cultivée au prix relativement modique de 1 200 dollars. En 2017, elle a élaboré le premier sandwich au poulet et le premier canard à l’orange cultivés, le tout à un coût encore plus faible – et elle compte commercialiser ses produits dans un futur plus ou moins proche. Avec les recherches et les investissements appropriés, nous pourrions dans une décennie ou deux produire de la viande propre à l’échelle industrielle, un procédé moins coûteux que l’élevage de vaches et de poulets. Si vous avez envie d’un steak, plus besoin d’élever et d’abattre une vache entière :il vous suffira de le faire pousser.
On peut difficilement surestimer la dimension révolutionnaire de cette technologie. Quand la viande propre deviendra suffisamment abordable, le remplacement de la viande d’élevage sera justifiable non seulement sur le plan éthique, mais aussi économique et écologique. L’élevage intensif est l’une des causes principales du réchauffement climatique – d’après les Nations unies, la part de l’effet de serre dont il est responsable équivaut à l’ensemble du secteur des transports. Au-delà des questions climatiques, l’élevage intensif se classe parmi les plus gros consommateurs industriels d’antibiotiques et de produits toxiques, en plus de figurer parmi les principaux pollueurs atmosphériques, terrestres et maritimes. On montre facilement du doigt les industries du pétrole et du charbon pour dénoncer les dégâts infligés par l’Homo sapiens à notre planète, mais l’industrie de l’élevage est loin d’être en reste. Il est tout aussi urgent de remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie propre que de remplacer l’agro-industrie par la culture de la viande propre. Cette transition est capitale si nous voulons préserver notre planète du changement climatique et de la catastrophe écologique.
Dans ce livre fascinant et plein d’espoir, Paul Shapiro décrit les fabuleuses promesses d’une nouvelle façon de produire notre nourriture et nos vêtements : l’agriculture cellulaire. Grâce à cette avancée, les humains pourraient bientôt arrêter d’élever et de tuer des milliards d’animaux. D’ici peu, nous regarderons peut-être l’élevage industriel avec la même horreur que l’esclavage aujourd’hui, comme une page sombre de notre histoire que nous aurons heureusement tournée pour de bon.
Au XXIe siècle, la technologie est en passe de nous offrir un pouvoir de création et de destruction presque surnaturel. Mais la technologie ne nous dira pas comment l’utiliser. À l’heure de créer ce nouveau monde, nous devrons veiller au bien-être non seulement de l’Homo sapiens, mais aussi de tous les êtres sensibles, sans exception. Nous sommes libres d’utiliser les prouesses de la biotechnologie pour bâtir un paradis ou un enfer. Il nous revient de faire le choix le plus éclairé.
Yuval Noah Harari
CLEAN MEAT
1
La seconde domestication
Nous sommes en 2014. Par une journée étouffante, je cherche mon chemin au milieu du Brooklyn Army Terminal, une ancienne gare ferroviaire datant de la Seconde Guerre mondiale située dans l’arrondissement le plus branché de New York, qui abrite aujourd’hui plusieurs dizaines de startups. Sur les voies, des wagons immobiles, vieux de plusieurs générations, sont entourés d’immeubles de bureaux flambant neufs et majoritairement vides. Cet endroit figé dans le temps est-il vraiment le quartier général d’une entreprise spécialisée dans la biotechnologie qui, avec d’autres startups, développe actuellement une technologie inédite vouée à bouleverser notre système alimentaire ?
Tout au long de ma carrière, j’ai milité pour un système agricole plus durable, notamment au sein de la Humane Society of the United States1. J’ai côtoyé de nombreuses startups agroalimentaires qui affirment que leurs produits vont sauver la planète et enrayer les maux qui la rongent, tout en produisant suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins d’une population mondiale en pleine expansion. Mais ces entreprises sont presque toutes implantées dans la baie de San Francisco, proches de la Silicon Valley et des riches investisseurs qui leur ont permis de se développer et de continuer à inventer cet avenir meilleur qu’elles nous promettent. À mes yeux, Brooklyn est plus proche d’un paradis pour hipsters que d’un vivier de la biotech, et pourtant, c’est ici qu’Andras Forgacs m’a invité pour visiter les locaux de sa nouvelle entreprise, Modern Meadow (« prairie moderne »).
Cet endroit n’a rien de moderne et encore moins de champêtre. Acquise par la mairie de New York au début des années 1980, cette ancienne base militaire a été convertie en espaces de bureaux. Forte de plusieurs dizaines de locataires, l’ancienne gare est devenue le fief de plusieurs startups. L’une d’entre elles, Modern Meadow, fait les gros titres de la presse internationale.
Après quinze minutes passées à chercher mon chemin parmi toutes ces startups spécialisées dans les biotechnologies, je trouve enfin l’entrée du laboratoire. Avec un sourire chaleureux, Forgacs, fin de la trentaine, m’accueille dans ses locaux modestes mais impeccables. À l’époque, seule une dizaine d’employés travaillait pour lui. Je me suis demandé si j’allais vraiment voir s’écrire une page de l’histoire.
Une fois entré, Forgacs m’a présenté les activités de ModernMeadow : la culture de cellules bovines pour fabriquer du bœuf et du cuir sans recours à l’élevage. En d’autres termes, son entreprise produit du cuir véritable sans tuer le moindre animal. Fondée en 2011, Modern Meadow était la première compagnie commerciale spécialisée dans la fabrication de viande et de cuir in vitro ; au détour de mes lectures, j’avais également appris qu’à partir d’une seule cellule microscopique, l’entreprise de Forgacs était (théoriquement) capable de satisfaire la demande mondiale de viande bovine. Les conséquences de cette technologie, si l’on pouvait la perfectionner et la mettre en œuvre à grande échelle, sont évidemment considérables et nous permettraient peut-être de continuer à consommer des produits animaux sans les souffrances, le gaspillage et les dégâts environnementaux causés par le système agroalimentaire actuel.
Si Modern Meadow est la première compagnie fondée dans le but de commercialiser ces produits, Forgacs est loin d’être isolé dans ses efforts. Depuis, plusieurs entreprises – dont certaines seront présentées dans ce livre – ont vu le jour dans le but de proposer au grand public des produits animaux cultivés.
Après m’avoir montré les incubateurs qui ronronnaient en sourdine, Forgacs m’a pris de court en me posant une question innocente.
« Vous voulez goûter ? »
Ça n’était pas du tout le but de ma visite, et après plus de vingt heureuses années de régime végane, l’idée de manger du bœuf ne m’était pas des plus appétissantes.
Mais j’étais aussi conscient qu’à l’époque, les humains qui avaient voyagé dans l’espace étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui avaient mangé de la viande de laboratoire. Avant la création de Modern Meadow, les scientifiques qui avaient fabriqué de la viande in vitro se comptaient sur les doigts d’une main, et à peine quelques dizaines de personnes au monde en avaient probablement déjà consommé.
« Ça fait très longtemps que je n’ai pas mangé de viande, je ne suis pas certain d’être le mieux placé pour vous donner un avis », ai-je réussi à maugréer sur le ton de la plaisanterie tout en priant de tout mon cœur que cette réponse me sortirait d’affaire.
Je songeais également au coût de cet aliment : j’avais lu dans la presse que le plus petit morceau de cette viande valait une fortune.
« Le steak haché qui a été goûté en Europe a coûté 330 000 dollars, de la cellule jusqu’à l’assiette, je me trompe ? » Je faisais allusion au désormais célèbre hamburger de laboratoire, le premier du genre – financé par le cofondateur de Google, Sergey Brin –, qui avait été cuisiné et dégusté lors d’une conférence de presse à Londres à peine un an plus tôt.
« Ne vous inquiétez pas, répondit Forgacs d’un ton rassurant. On vous invite. Et c’est un tout petit échantillon : une chips de steak, si vous préférez. Ça ne coûte qu’une centaine de dollars à fabriquer. Et ça deviendra bientôt beaucoup moins cher. »
C’est sûr, j’avais déjà mangé beaucoup de steaks frites dans ma vie, mais une chips de steak, c’était une autre histoire. Forgacs ne voulait pas se contenter de reproduire en laboratoire des aliments que nous apprécions déjà, comme le hamburger ; il voulait aussi inventer des expériences culinaires inédites. Il avait eu l’idée d’une chips de steak – où la viande remplace la pomme de terre – quand il s’était rendu compte que de minces lamelles de viande coûtaient beaucoup moins cher à fabriquer que des morceaux plus complexes. On achète bien du jerky de bœuf séché dans les stations-service pour combler une petite faim : alors pourquoi pas des chips de steak ?« Riche en protéines, pauvre en lipides et super pratique. Personnellement, ça me fait envie », m’a lancé Forgacs avec un large sourire.
Initialement sur la défensive, j’ai vite pris conscience que j’avais l’opportunité d’être l’une des premières personnes à goûter un aliment qui faisait tant parler de lui – et suscitait tant de controverses. J’ai donc décidé d’honorer la généreuse invitation de mon hôte.
Forgacs a sorti une chips de son bocal. Avec un sourire, je l’ai prise dans ma main tout en me demandant comment mon organisme allait réagir à cette première bouchée de viande en plus de vingt ans. Manger ce produit ne me posait aucun dilemme moral, mais l’idée que j’étais sur le point d’ingérer de la chair animale – et qui plus est issue d’un procédé aussi révolutionnaire – n’en demeurait pas moins étrange.
Je n’ai pas fait une croix sur la viande parce que je n’aimais pas ça, bien au contraire : enfant, j’en raffolais, et je suis un adepte des substituts de viande végétariens, lesquels sont de plus en plus populaires chez les omnivores. Je suis devenu végane en 1993, au début de l’adolescence, après m’être documenté sur les conséquences néfastes d’un régime carné. Les humains n’ont pas besoin de manger des animaux pour être en bonne santé, et l’industrie de la viande est un véritable fléau pour le bien-être animal et la santé de la planète. Alors pourquoi ne pas atténuer ces dommages en retirant les animaux de mon assiette ? Descendre la chaîne alimentaire de quelques échelons permet de produire plus de nourriture, étantdonné que l’alimentation du bétail accapare une vaste quantité de ressources – les céréales et l’eau, par exemple. À mesure que la population mondiale augmente, la question de l’efficience devient de plus en plus importante.
Mon amour des animaux m’a conduit à mener une carrière dans la protection animale. J’ai notamment œuvré pour des campagnes visant les secteurs public et privé pour améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage, et réduire leur exploitation et leur abattage à des fins alimentaires, en faisant par exemple la promotion de l’alimentation végétarienne. Cela faisait des années que je me documentais sur la viande de laboratoire et que j’en parlais autour de moi. Depuis toujours, c’est pour moi une solution prometteuse face à un problème délicat. Mais à mes yeux, ce genre de produit ne s’adressait qu’aux amoureux de la viande.
Et pourtant, j’étais sur le point d’intégrer à mon régime, du moins pour aujourd’hui, de la véritable viande animale qui ne provenait pas d’un abattoir. La chips ressemblait à une fine lamelle de jerky. En l’observant, j’ai songé à quel point ce petit morceau de bœuf séché était remarquable, aussi bien technologiquement que symboliquement parlant. Je tenais peut-êtreentre les mains la réponse aux ravages causés par l’agrobusiness animal sur l’humanité et la planète qui nous abrite. J’ai porté la viande à ma bouche, inspiré profondément, et je l’ai déposée sur ma langue.
J’avais lu des témoignages de végétariens de longue date qui, après avoir goûté de la viande pour la première fois depuis des années, ont éprouvé toutes sortes de sensations : bouffées d’endorphines et sentiment d’euphorie, ou nausées, maux de ventre et vomissements. Pour ma part, je n’ai rien ressenti de tel. J’ai mâché ma chips de steak et ça m’a plu : j’avais l’impression d’être à un barbecue.
Et subitement, une foule de questions m’ont assailli : allais-je me sentir mal ? Étais-je toujours végétarien ? Fallait-il vraiment s’en soucier ?
En réalité, peu importe que les végétariens ou les véganes mangent de la viande qui provient d’un laboratoire plutôt que d’un abattoir. Ils ne constituent pas le public visé. La vraie question – que je me suis posée dans les bureaux de Modern Meadow et qui est l’un des sujets de ce livre – est la suivante : les carnivores accepteront-ils cette nouvelle méthode de production de la viande de bœuf, de poulet, de porc – et d’une quantité d’autres produits animaux –, des aliments quioccupent une place si importante dans nos régimes alimentaires ? Notre société peut-elle au moins envisager de se familiariser en douceur avec ces nouveaux produits, en commençant par exemple par adopter du cuir in vitro signé Modern Meadow ? (L’entreprise se consacre aujourd’hui exclusivement à la culture du cuir, tandis que d’autres se sont spécialisées dans la fabrication de viande.) Et quand bien même nous accepterions ces aliments et ces vêtements, Modern Meadow et ses homologues parviendront-ils à commercialiser leurs produits à temps pour endiguer les ravages de l’agriculture animale ? En résumé, doit-on voir dans cette modeste – et très chère – chips de steak le futur de l’alimentation ?
Notre espèce est confrontée à une crise : à mesure que la population mondiale augmente, comment allons-nous nourrir ces milliards de nouveaux habitants alors que notre planète est déjà en proie à une pénurie de ressources naturelles ? L’humanité a doublé depuis 1960, mais notre consommation de produits animaux s’est multipliée par cinq, un chiffre qui, selon les Nations unies, ne va cesser de croître. Pour ne rien arranger, plus les nations des pays en développement comme la Chine et l’Inde (parmi les pays les plus peuplés au monde) s’enrichissent, plus leurs habitants adoptent progressivement un régime à l’américaine, riche en viande, œufs et produits laitiers – des aliments autrefois réservés aux classes aisées, mais désormais abordables –, alors qu’ils observaient autrefois un régime principalement végétarien. De nombreux spécialistes du développement durable sont formels : vu l’inefficience de l’élevage comparé à la culture des plantes pour notre alimentation, la Terre est tout simplement incapable de supporter une telle hausse de la demande en produits animaux. Les changements climatiques seront trop brutaux, la déforestation trop sévère, la consommation d’eau trop élevée et le traitement des animaux trop cruel.
Les prévisions montrent que la Terre comptera 9 à 10 milliards d’habitants d’ici 2050. Si la plupart auront les moyens d’adopter un régime alimentaire aussi fastueux que les Occidentaux – et particulièrement les Américains – d’aujourd’hui, on peut difficilement imaginer où trouver les terres cultivables et les autres ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Rien que pour nourrir les Américains, plus de 9 milliards d’animaux sont élevés et abattus chaque année, sans compter les espèces aquatiques telles que les poissons, que l’on mesure au poids et non individuellement. En d’autres termes, on utilise en une seule année plus d’animaux pour nourrir les États-Unis qu’il n’y a d’habitants sur Terre. Et la quasi-totalité de ces animaux sont emprisonnés à vie dans des usines qui ressemblent davantage à des goulags qu’à des fermes.
La révolution verte – qui a vu la recherche agricole aboutir à une formidable augmentation des récoltes – a permis aux humains de produire beaucoup plus de nourriture avec moins de ressources, mais le temps que nous avons gagné grâce à cette productivité accrue s’amenuise, et nous devons compter sur notre ingéniosité pour sortir d’une nouvelle crise agricole que nous avons nous-mêmes engendrée.
Mettons le problème en perspective. Vous êtes devant le rayon des volailles de votre supermarché. À côté de chaque poulet que vous voyez, imaginez plus de 1 000 jerricanes d’un gallon d’eau chacun, soit près de 3,80 litres. Imaginez maintenant que vous ouvrez chaque bidon, un par un, et que vous les déversez par terre. Trois mille huit cents litres d’eau : c’est à peu près la quantité nécessaire à l’élevage d’un seul poulet, de sa sortie de l’œuf à son arrivée dans votre assiette. En d’autres termes, vous économisez plus d’eau quand vous décidez de retirer le poulet du menu d’un seul repas de famille que lorsque vous arrêtez de vous doucher pendant six mois.
Alors que la demande en eau s’intensifie, la Californie et d’autres régions victimes de la sécheresse se contentent d’imposer des restrictions sur l’arrosage des pelouses ou d’inviter la population à prendre des douches plus courtes, mais ces économies individuelles ne suffisent pas à compenser les volumes d’eau nécessaires au maintien – sans parler de la croissance – de notre système agroalimentaire.
Et je ne vous parle que du poulet.
Il sera de plus en plus difficile d’ignorer les 190 litres d’eau nécessaires pour produire un seul œuf, une quantité suffisante pour remplir votre baignoire à ras bord. Ou les 3 400 litres nécessaires à un seul litre de lait de vache (de quoi remplir plusieurs baignoires). À titre de comparaison, remplacer un gallon de lait de vache par un gallon de lait de soja représente une économie de plus de 3 210 litres d’eau.
Ce rendement désastreux est exactement le même dans le cas des produits locaux, bio, sans OGM, ou tout autre terme en vogue qui figure sur tant d’emballages de produits d’origine animale. Plus que jamais, ces réalités nous font prendre conscience qu’à mesure que notre population s’accroît, la seule manière dont nous pourrons continuer à consommer de la viande, du lait et des œufs en quantités similaires sera de trouver un système – considérablement – plus efficient.
C’est précisément l’exploit qu’une poignée de scientifiques et d’entrepreneurs tentent d’accomplir. Leur objectif : cultiver de la véritable viande pour que les omnivores puissent continuer à manger du bœuf, du poulet, du poisson et du porc sans dépendre de l’élevage et de l’abattage. Si elles réussissent leur pari, ces startups représenteront peut-être notre meilleure chance de renverser notre système alimentaire défectueux et d’endiguer les nombreuses menaces qui pèsent sur nous – de la destruction de l’environnement et la souffrance animale aux maladies, voire les pathologies cardiovasculaires liées à notre alimentation. Ces jeunes entreprises sont lancées dans une course pour inventer un monde où il sera toujours possible de manger de la viande : un monde dans lequel nous pourrons profiter de toute une variété de produits animaux en abondance sans nuire à l’environnement, au bien-être animal ou à la santé publique.
Forgacs et son équipe au sein de Modern Meadow sont loin d’être les premiers à avoir envisagé la culture de produits animaux sans passer par l’élevage d’animaux entiers. Outre d’innombrables œuvres de science-fiction (notamment Le Dernier Homme de Margaret Atwood, sans oublier Star Trek avant elle), maints intellectuels progressistes – dont plusieurs n’ont rien à voir avec la science ou la science-fiction – ont prédit qu’une telle transition était inévitable. L’un d’entre eux devint même une figure historique majeure du monde occidental.
« Nous échapperons à l’absurdité d’élever un poulet entier afin d’en manger le blanc ou l’aile, en cultivant ces pièces séparément », déclarait Winston Churchill en 1931 dans un article intitulé « Dans cinquante ans ». Sa prédiction tombait certes quelques décennies trop tôt, mais son jugement n’en est pas moins remarquable : il annonçait sans équivoque les progrès technologiques qui ont donné naissance à Modern Meadow et à ses chips de steak. « D’emblée, les nouveaux aliments seront en tous points semblables aux produits naturels, continuait le futur Premier ministre britannique, et chaque changement sera si progressif qu’il sera imperceptible. »
Churchill pressentait une révolution majeure dans notre mode d’obtention de protéines, qui reste le même depuis des millénaires. Non sans rappeler la façon dont la voiture relégua la calèche aux livres d’histoire, son article annonçait une avancée technologique qui selon lui transformerait complètement nos rapports avec toute une catégorie d’animaux. Churchill n’était pas le premier à se livrer à ce genre de prédiction. Dès 1894, le célèbre professeur de chimie Marcellin Berthelot déclara qu’en l’an 2000, les humains consommeraient de la viande cultivée en laboratoire qui ne proviendrait plus de l’abattage. Interrogé par un journaliste sur la viabilité d’un tel produit, Berthelot répondit : « Pourquoi ne le serait-il pas, si fabriquer ces produits de toutes pièces s’avère moins cher et meilleur que de recourir à l’élevage ? » Comme celle de Churchill, la prévision de Berthelot tombait un peu trop tôt, mais n’était pas loin de la réalité.
Les humains s’emploient à améliorer la qualité de leur alimentation depuis la nuit des temps. Pour la majeure partie de son existence, l’Homo sapiens a tiré sa subsistance de la cueillette et de la chasse. Puis, il y a 10 000 ans, certains déposèrent leur lance pour se tourner vers les semences et commencèrent à domestiquer les plantes puis les animaux, transition qui fut à l’origine d’une véritable révolution agricole. Peu après, l’invention de la bière et du yaourt – probablement les premiers aliments biotechnologiques – a inauguré la culture in vitro. Au cours du siècle dernier, l’industrialisation de notre économie alimentaire a de nouveau révolutionné nos habitudes en offrant des rendements beaucoup plus importants capables de maintenir – et d’encourager – une croissance démographique toujours plus forte.
Peut-être sommes-nous en train d’assister aux prémices d’une nouvelle révolution alimentaire avec l’apparition de l’agriculture cellulaire, qui consiste à cultiver des aliments – de la viande et d’autres produits d’origine animale – en laboratoire tout en laissant les animaux en paix, et même en leur restituant des hectares de terres agricoles. Grâce à une technologie initialement développée dans les domaines universitaire et médical, et aujourd’hui commercialisée par plusieurs startups, des chercheurs innovants prélèvent desbiopsies microscopiques de tissus musculaires, puis cultivent ces cellules souches en dehors de l’organisme de l’animal. Certains entrepreneurs n’utilisent même pas de cellules souches, et produisent – à partir de simples molécules – du lait, des œufs, du cuir et de la gélatine véritables, parfaitement identiques aux produits animaux que nous connaissons, le tout sans abattre un seul animal.
Fortes de cette nouvelle application de la technologie, les startups que vous allez découvrir dans ce livre tentent de faire de la vision de Churchill une réalité. À l’heure où j’écris ces lignes, ces entreprises produisent de véritables produits animaux à partir de cellules microscopiques – mais aussi de levures, de bactéries et d’algues – qui ont le potentiel de révolutionner les industries alimentaire et textile. Dans le même temps, elles s’engagent à relever les défis environnementaux et économiques considérables posés par la hausse de la population mondiale – à condition d’obtenir les financements, décrocher les autorisations nécessaires et gagner la confiance des consommateurs, autant d’impératifs dont dépend la commercialisation de leurs produits à l’échelle mondiale.
Contrairement à la révolution des substituts végétariens – une avancée de bon augure et déjà bien établie qui nous a donné des marques comme Alpro et Beyond Meat –, ces produits de laboratoire ne sont pas des alternatives, mais de véritables produits animaux. Cette technologie peut vous sembler radicalement nouvelle, mais saviez-vous que presque chaque fromage à pâte dure que vous consommez aujourd’hui contient de la présure – un coagulant du lait composé d’enzymes, traditionnellement extrait des intestins du veau – produite de manière synthétique, selon des procédés quasiment identiques à ceux qu’emploient de nombreuses entreprises présentées dans ce livre ? Et si vous êtes diabétique, il est très probable que l’insuline humaine que vous vous injectez relève du même processus biotechnologique.
Par ailleurs, les laboratoires utilisent les mêmes méthodes depuis des années pour créer de véritables tissus humains dans le cadre d’expériences et de greffes. Par exemple, un laboratoire peut prélever les cellules épidermiques d’un patient pourles cultiver en vue d’obtenir une véritable peau humaine parfaitement identique à celle du patient. L’organisme ne fait pas de différence, parce qu’il n’y en a tout simplement pas – hormis le fait que cet épiderme ait été développé in vitro.
En appliquant des technologies déjà répandues dans le domaine médical à la fabrication de produits alimentaires animaux, les scientifiques sont en passe d’inaugurer ce que le Dr Uma Valeti, PDG de la startup d’agriculture cellulaire Memphis Meats, a surnommé la « seconde domestication ».
Au cours de la première domestication, survenue il y a des milliers d’années, les humains ont commencé à élever du bétail et planter des semences de manière sélective, et ont pu ainsi mieux maîtriser les lieux, les méthodes et le volume de leur production alimentaire. Aujourd’hui, cette maîtrise s’est étendue au niveau cellulaire. « Nous fabriquons de la viande propre », explique Valeti. « Grâce à ce procédé, nous allons pouvoir produire de la viande à partir de cellules animales issues de tissus musculaires de premier choix, et par conséquent obtenir des produits de haute qualité. » Seth Bannon, l’un des investisseurs de Memphis Meats, apprécie cette analogie. Son fonds de capital-risque – baptisé Fifty Years, en hommage à l’essai de Churchill – soutient des innovateurs comme Valeti. « Traditionnellement, on domestiquait les animaux pour récolter leurs cellules afin de les transformer en nourriture et en boisson », résume Bannon au sujet du travail de Memphis Meats. « Aujourd’hui, ce sont les cellules elles-mêmes que nous domestiquons. »
Les scientifiques et les entrepreneurs que vous découvrirez dans ce livre cherchent à corriger les imperfections d’un système agroalimentaire qui provoque d’innombrables dégâts à l’échelle mondiale. Ces femmes et ces hommes ont beau être issus de milieux différents et ne pas forcément partager les mêmes valeurs, ils poursuivent néanmoins le même but : parvenir au plus vite à réaliser leur idéal – celui d’un monde où nous produisons notre viande et d’autres produits animaux sans devoir élever et tuer poulets, dindes, cochons, poissons ou vaches, mais en employant des techniques de culture qui, fondamentalement, se passent des animaux.
« On utilise bien ce genre de technique pour le brassage de la bière et du yaourt – on n’entend pas les cris des levures et des lactobacilles, parce que tout se passe dans une cuve », lança malicieusement Forgacs à un journaliste un an après notre rencontre au siège de Modern Meadow. « Voilà notre but : appliquer ces principes aux produits animaux. Rien ne nous oblige à réduire des êtres sensibles en esclavage. »
Si ces entreprises gagnent leur pari, les retombées positives pour notre planète, les animaux et notre santé sont évidentes. Et les profits pour les investisseurs, qui injectent des dizaines de millions de dollars dans ces startups, potentiellement considérables. Dans une interview diffusée en décembre 2016 sur CNBC, Bill Gates évoqua ces entreprises innovantes dans le cadre d’une discussion à propos de Breakthrough Energy Ventures, un fonds d’investissement dans les énergies propres qu’il a mis sur pied avec d’autres milliardaires, dont Jeff Bezos et Richard Branson. « Nous soutenons plusieurs dizaines d’entreprises, commenta le fondateur de Microsoft. Dans le domaine de l’agriculture, on fabriquera bientôt de la viande artificielle – des projets sont déjà en cours de développement. L’industrie alimentaire est une source considérable d’émissions. […] Fabriquer de la viande autrement nous permettra d’éviter beaucoup de problèmes, notamment la cruauté envers les animaux, mais il faut que ces produits deviennent abordables. »
En août 2017, Gates, qui finançait depuis des années les substituts végétariens de viande, commença à investir dans le secteur de la viande propre avec d’autres figures de proues telles que Richard Branson et Jack Welch, ex-PDG de General Electric. Célébrant un investissement réalisé avec des partenaires dans une startup, un Branson enthousiaste précisa que « d’icitrente ans, on n’aura plus besoin de tuer des animaux. La viande propre et les substituts végétaux auront le même goût et seront bien meilleurs pour la santé de tous. Un jour, nous regarderons en arrière, et l’abattage des animaux que pratiquaient nos grands-parents nous paraîtra totalement archaïque. »
Rien qu’en termes de sécurité alimentaire, ces produits pourraient déclencher un changement sans précédent. Dans les abattoirs, le risque de contamination est très élevé, aussi bien à cause des déjections des animaux – fréquentes lorsqu’on les introduit dans l’environnement inconnu et terrifiant d’un abattoir – que des restes de matière fécale présents dans les intestins, susceptibles de contaminer la viande lors de l’abattage et du découpage. De nombreux agents pathogènes d’origine alimentaire sont des microbes intestinaux issus de ce type de contamination, tels que l’E. coli et les salmonelles. Bien sûr, aucun risque de ce genre n’est à prévoir avec une viande cultivée en dehors de l’animal : la production se déroule dans un environnement totalement stérilisé. Comme nous le verrons par la suite, il s’agit là d’une des principales raisons qui a poussé le Good Food Institute (GFI), organisme en faveur de l’agriculture cellulaire, à promouvoir l’appellation de « viande propre ».
Tout cela explique l’optimisme de certains défenseurs de la sécurité alimentaire envers l’arrivée de cette viande propre. Michael Jacobson, docteur en microbiologie et fondateur du Center for Science in the Public Interest, en fait partie. En croisade contre les dangers des additifs alimentaires tels que les acides gras trans et l’Olestra, il place de grands espoirs dans l’agriculture cellulaire. « C’est un moyen très encourageant de fabriquer des produits animaux beaucoup plus sains et plus durables, confie-t-il. Je suis prêt à les consommer. »
Au-delà de ses bénéfices pour la sécurité alimentaire, le remplacement de l’élevage intensif par la production de viande cultivée pourrait aussi contribuer à réduire considérablement le risque d’une pandémie globale – le cauchemar des professionnels de la santé publique. Les épidémies de grippe aviaire, notamment en Asie, déciment des millions d’animaux chaque année. Mais le principal motif d’alarme tient dans la possible transmission de cette maladie aux êtres humains – ce qui fut précisément la cause de la terrible épidémie de grippe espagnole de 1918, qui frappa un tiers de la population mondiale et fit plus de 50 millions de victimes. Et nous parlons d’une époque où la Terre comptait seulement 1,2 milliard d’habitants, soit une infime fraction des 6,5 milliards qui la peupleront seulement un siècle plus tard. De plus, parallèlement à cette croissance, notre mobilité s’est elle aussi accrue. Des millions de personnes voyagent dans le monde chaque jour. Si une pandémie comparable à celle de 1918 se déclarait aujourd’hui, elle serait encore plus dévastatrice.
En 2007, un éditorial du bulletin de l’American Public Health Association évoquait les risques de pandémie provoqués par l’élevage industriel de poulets.
« Nous constatons avec étonnement le total désintérêt envers la nécessité de changer radicalement notre manière de traiter les animaux – c’est-à-dire avant tout de cesser leur consommation, ou à tout le moins de la limiter drastiquement –, à titre de mesure préventive. Un tel changement, s’il est adopté ou imposé de manière appropriée, permettrait de réduire les risques d’épidémies de grippe tant redoutées. Il nous permettrait aussi de prévenir des maladies futures encore inconnues qui, sans cette transition, risquent d’être provoquées par l’élevage et l’abattage intensifs. Malheureusement, cette option n’est pas envisagée par l’humanité. »
Dix ans plus tard, la suggestion de l’association des professionnels de la santé de démanteler l’agrobusiness animal pour éliminer le risque d’une catastrophe sanitaire semble rester lettre morte. Même si la probabilité d’un tel désastre demeure généralement faible, bien d’autres arguments peuvent nous convaincre à moyen terme de réduire la pratique de l’élevage alimentaire.
Même si les risques sont minimes, une pandémie mondiale constituerait un véritable désastre pour notre civilisation. Certaines menaces que fait peser l’élevage intensif sont toutefois bien réelles. La plus notable est peut-être celle d’une crise provoquée par la résistance humaine aux antibiotiques, un problème que de nombreux professionnels de la médecine et de la santé publique attribuent à l’élevage. Aux États-Unis, près de 80 % de l’ensemble des antibiotiques en circulation sont administrés aux animaux d’élevage, non pas pour traiter d’éventuelles maladies, mais de manière non thérapeutique, afin d’accélérer la croissance des animaux tout en prévenant les risques de pathologies, extrêmement élevés dans ces fermes industrielles pleines à craquer. Préoccupée par cette consommation de produits qui sauvent littéralement des vies dans le cadre de la médecine humaine, l’American Medical Association exige aujourd’hui l’interdiction fédérale de l’utilisation des antibiotiques pour la croissance des animaux dans les exploitations. Mais en raison de la pression des lobbys agricoles et pharmaceutiques, l’appel des médecins n’a pas été entendu par le gouvernement.
À l’heure où la demande en produits carnés augmente à mesure que les pays en développement sortent de la pauvreté, nous savons que les ressources finies de notre planète ne permettront pas à d’autres pays d’adopter le mode alimentaire riche en viande auquel sont habitués les Américains et les Européens. Historiquement, les pays les plus riches avaient les moyens d’entretenir une consommation élevée de produitscarnés, tandis que les plus pauvres tiraient principalement leur subsistance des céréales, haricots et légumes, et réservaient la viande pour les grandes occasions.
Même si les Américains consomment relativement moins de viande depuis quelques années, la demande augmente en parallèle à la hausse des revenus des ménages dans des pays tels que la Chine et l’Inde. À titre d’exemple, la consommation de viande par habitant en Chine s’est multipliée par cinq durant ces trente dernières années. Dans un pays où il était autrefois surnommé la « viande des millionnaires », le bœuf est désormais consommé quotidiennement par des centaines de millions de citoyens chinois.
Depuis au moins 1971 et la publication de Sans viande et sans regrets : un régime alimentaire pour une petite planète de Frances Moore Lappé, on sait que la Terre n’est pas assez vaste pour supporter une population globale adoptant le même régime carné que les Américains. « Imaginez-vous, assis devant un steak de deux cents grammes. Imaginez ensuite cinquante personnes, un bol vide devant elles, écrivait Lappé. En échange de la nourriture pour produire cette tranche de steak, chacun de leur bol pourrait contenir une tasse de céréale cuite. »
Si, aux États-Unis, l’externalisation des coûts de production contribue artificiellement à rendre bon marché les produits animaux à la caisse du supermarché, la production de viande constitue un mode d’alimentation excessivement cher. Bien avant la parution du livre de Lappé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le président Harry Truman encouragea les Américains à réduire leur consommation de viande (y compris le poulet) et d’œufs en éliminant les protéines animales les mardis et les jeudis afin de préserver les ressources nécessaires à la reconstruction de l’Europe.
Si l’on retourne à notre époque, son message reste sans équivoque : « C’est une réalité : la production de viande nécessite des quantités considérables de terres, d’eau, d’engrais, de pétrole et d’autres ressources », déclare l’organisation humanitaire Oxfam. « Ces quantités sont beaucoup plus importantes que les ressources nécessaires à la culture d’autres aliments tout aussi délicieux et nutritifs. »
Dans le secteur de l’élevage industriel, les dépenses les plus importantes concernent la nourriture des animaux eux-mêmes, qui représente un volume considérable. Le soja vous évoque peut-être le tofu ou le lait de soja, mais partout dans le monde, la culture de cette légumineuse est principalement destinée à nourrir les animaux et monopolise des surfaces immenses. L’alimentation du bétail est malheureusement la cause principale de la déforestation des forêts vierges, et par conséquent de la lente asphyxie de notre planète. Le WWF (World Wildlife Fund) a soulevé ce problème, notant que « l’expansion de la culture de soja pour répondre à la hausse de la demande mondiale en produits carnés contribue fréquemment à la déforestation et à la disparition d’autres écosystèmes précieux en Amérique du Sud ». En d’autres termes, un slogan tel que « Sauvons la forêt vierge » serait plus instructif si on le complétait par la mention « Mangeons moins de viande ».
Le Center for Biological Diversity reconnaît ce lien essentiel qui unit ce que nous mettons dans nos assiettes et l’avenir incertain de nombreuses espèces de notre planète. C’est ce qui a poussé cette ONG œuvrant à la protection des espèces menacées à lancer une campagne nommée « Take Extinction Off Your Plate » (« Ôtons l’extinction de nos assiettes »), qui incite les consommateurs soucieux de l’environnement à agir à chaque repas. Son unique recommandation : « Pour préserver la planète et sa vie sauvage, réduisons notre consommation de viande. »
L’impact environnemental désastreux de l’élevage intensif est encore plus visible si l’on songe au changement climatique. « Pour atténuer les effets catastrophiques du réchauffement, il faudrait s’attaquer à la consommation de viande et de produits laitiers. Malheureusement, très peu d’efforts sont entrepris dans le monde », avertit le Royal Institute of International Affairs, un think tank britannique parmi les plus prestigieux d’Europe. Également connu sous le nom de Chatham House, ce groupe de réflexion remarque en effet que l’agriculture animalière est l’une des causes premières des émissions de gaz à effet de serre, ajoutant qu’il « est peu probable qu’on parvienne à maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de la barre des 2 °C sans modifier notre consommation de viande et de produits laitiers ».
En résumé, l’exploitation des ressources dans le seul but de cultiver des céréales pour nourrir les animaux que nous mangeons est une méthode grossièrement contre-productive. De plus, comme la quasi-totalité des animaux d’élevage des États-Unis sont nourris avec des céréales, des quantités astronomiques de nourriture sont en train d’être gaspillées au seul nom de la consommation de viande.
Même si l’on songe à la viande la plus rentable à produire – à savoir le poulet –, celle-ci a de quoi pâlir comparée aux protéines végétales. Le poulet d’élevage nécessite tellement de céréales qu’il faut lui fournir neuf calories pour qu’il nous en donne une seule, et une fois encore, nous parlons de la viande la plus rentable. Une grande quantité de ces calories sert à des processus biologiques parfaitement inutiles pour le consommateur : croissance du bec, appareils respiratoire et digestif, etc.
Nous ne voulons que la viande, mais nous devons gaspiller énormément de nourriture pour l’obtenir. Selon Bruce Friedrich, directeur exécutif de GFI, élever un seul poulet équivaut à jeter neuf assiettes de pâtes directement à la poubelle à chaque fois que vous voulez manger un seul plat de spaghettis. Peu d’entre nous seraient prêts à commettre un tel gâchis, mais c’est plus ou moins ce que nous faisons à chaque fois que nous achetons un morceau de viande.
Et pourtant, malgré toutes les preuves de cette rentabilité déplorable, la population habituée à un régime riche en viande a beaucoup de mal à se tourner d’elle-même vers les aliments végétaux. Beaucoup de gens raffolent de la viande, c’est aussi simple que ça. Je peux moi-même en témoigner : lors des buffets végétariens, les substituts de viande végétaux (burgers végétariens, « poulet » végane, etc.) sont généralement les mets les plus populaires auprès des invités, alors que les raviers de houmous et de légumes sont à peine entamés.
Malgré les campagnes menées depuis des décennies par les organisations végétariennes et les associations pour la protection des animaux, le pourcentage de végétariens aux États-Unis plafonne entre 2 et 5 % depuis ces trente dernières années. Certes, la consommation de bœuf, porc et volaille par personne et par an est passée de 100 kilos en 2007 à 97 kilos en 2016, mais cette modeste diminution fait toujours figurer les Américains parmi les plus gros mangeurs de viande au monde.
Les pionniers des protéines végétales tels que Pat Brown, PDG d’Impossible Foods à qui l’on doit un stupéfiant steak végétarien, cherchent à aider les omnivores à réduire leur consommation de viande sans rien sacrifier au goût. Avant même d’avoir commercialisé un seul produit, Impossible Foodsavait levé 182 milliards de dollars auprès de Google Ventures, de Bill Gates et d’autres investisseurs. Professeur de biologie à Stanford, Brown avance qu’une réduction significative du changement climatique – sans parler d’une inversion – passera nécessairement par une diminution radicale de la consommation de produits animaux. « Prenez l’ensemble des voitures, des bus, des camions, des trains, des bateaux, des avions et des fusées de la planète, lance Brown. Leurs émissions cumulées de gaz à effet de serre sont inférieures à celles du secteur de l’élevage industriel. »
Imaginez cependant une seconde que nous puissions continuer à manger de la viande sans devoir en subir les conséquences. Imaginez que nous puissions manger de la viande et utiliser du cuir sans devoir nous soucier des problèmes environnementaux et éthiques qui leur sont associés.
Andras Forgacs et ses collègues qui œuvrent au sein de l’industrie émergente des produits animaux de culture sont fermement décidés à faire de ce rêve une réalité. Les retombéesenvironnementales escomptées sont flagrantes. Selon une étude menée en 2011 par Hanna Tumisto, chercheuse à l’université d’Oxford, publiée dans la revue Environmental Science & Technology, la viande bovine de culture représenterait une économie de 45 % en énergie, 99 % en surface et 96 % en eau par rapport à son homologue industriel. Effectuée à un stade aussi précoce, toute analyse de cycle de vie comporte évidemment des limites, étant donné qu’on ignore encore la nature des technologies à inventer qui permettront d’obtenir des produits de l’agriculture cellulaire commercialement viables. Toujours est-il que la culture de produits animaux, par opposition à l’élevage, promet d’être immensément moins gourmande en ressources. Une étude comparative des impacts environnementaux de la viande d’élevage et de la viande cultivée menée en 2015, et publiée dans le Journal of Integrative Agriculture, concluait notamment que « le remplacement de l’élevage par la viande cultivée peut réduire de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la demande de terres agricoles ».
D’autant plus que le gouvernement chinois se montre particulièrement intéressé. En septembre 2017, le quotidien d’État China Science and Technology Daily a publié un reportage sur les efforts d’une compagnie américaine qui cherchait à mettre la viande propre sur le marché de la République populaire. L’article invitait ses lecteurs à imaginer un monde dans lequel « vous avez deux produits identiques ; pour obtenir le premier […] vous devez abattre du bétail. “L’autre”, quant à lui, est absolument identique au premier, il est moins cher, ne produit pas d’émissions et ne nécessite pas d’abattage. Lequel choisiriez-vous ? »
L’espoir d’offrir un jour la possibilité d’un tel choix constitue la raison d’être de toute une variété de startups – parmi lesquelles Modern Meadow, Hampton Creek, Memphis Meats, Mosa Meat, Finless Foods, SuperMeat, Future Meat Technologies, Perfect Day, Clara Foods, Bolt Threads, VitroLabs, Spiber et Geltor. Toutes ambitionnent de révolutionner nos industries alimentaires et textiles, un pari lancé par les investisseurs en capital-risque qui les soutiennent. « Une fois perfectionnée, la technologie de la viande cultivée est vouée à complètement remodeler la filière mondiale de la viande. Nos produits seront fabriqués grâce à la science, et non avec des animaux », m’a confié Michael Rowland, ancien vice-président senior de Morgan Stanley et journaliste à Forbes.
Voilà précisément pourquoi de si nombreux défenseurs de l’environnement et de militants de la cause animale accueillent favorablement ces entreprises. À leurs yeux, l’agriculture cellulaire s’inscrit dans le prolongement de l’énergie propre. « L’élevage industriel a de nombreux points communs avec l’extraction du charbon », explique Isha Datar, PDG de New Harvest, une association à but non lucratif dédiée à la promotion des technologies liées aux produits animaux cultivés. « C’est un secteur qui pollue et qui nuit à notre planète, mais qui donne des résultats. L’agriculture cellulaire ressemble encore à l’énergie renouvelable dans sa phase précoce. Elle renferme la promesse d’obtenir les mêmes résultats sans tous ces terribles dégâts collatéraux. »
Conscients de l’impact qu’ils pourraient avoir, les femmes et les hommes engagés dans l’agriculture cellulaire font preuve d’un optimisme presque sans limite envers les possibilités offertes par ces nouvelles applications technologiques. Chose intéressante, la plupart ne se considèrent pas comme des rivaux, mais comme des concurrents amicaux qui partagent le même but : produire de la viande et d’autres produits animaux grâce à une méthode qui permettra un jour de réduire notre dépendance à l’exploitation des poulets, dindes, cochons et vaches.
En tentant de commercialiser une technologie majoritairement inédite aux yeux du public, chacune de ces entreprises adopte sa propre philosophie sur la manière de mener ses projets. Dans le secteur de la viande, faut-il commencer par cultiver du bœuf, dont la production actuelle est la plus dévastatrice pour l’environnement ? Ne devrait-on pas plutôt commencer par le poulet – l’animal abattu en plus grand nombre (peut-être à l’exception des poissons) ? Doit-on à la place se concentrer sur le lait, plus facile à fabriquer ? Ne vaudrait-il pas mieux oublier la nourriture et se lancer dans la production de cuir en laboratoire, un produit probablement plus facile à « digérer » par le public que la viande cultivée ?
Ces entreprises ont un long chemin à faire avant de pouvoir réaliser leurs ambitions. À ce stade, on peut vraisemblablement imaginer l’arrivée prochaine d’une gamme réduite de produits animaux sur le marché, mais il leur faudra des années pour proposer des viandes propres à un prix compétitif. Il y a quelques années, Jason Matheny, l’un des pionniers du mouvement de la viande cultivée, m’a confié en plaisantant qu’à chaque fois qu’on l’interrogeait sur la commercialisation de la viande cultivée en supermarché, il répondait systématiquement :« Peut-être dans cinq ans. » Au vu des projets décrits dans ce livre, ce délai semble cependant diminuer à vue d’œil.
Plusieurs obstacles de taille barrent la route des entrepreneurs présentés dans cet ouvrage et il leur faudra surmonter chacun d’entre eux pour espérer avoir un impact. Le premier est tout simplement la nécessité de réduire fortementles coûts. Tous se pensent capables de relever le défi (sinon pourquoi se lancer dans un tel projet ?), mais cette conviction repose sur des avancées technologiques qui doivent encore être réalisées.
Ils veulent aussi sensibiliser le public aux obstacles qu’ils essaient de surmonter. Avant de persuader les consommateurs de goûter un de leurs burgers, ils leur faudra avant tout trouver un moyen de les produire à grande échelle. Étant donné que la technologie qu’ils utilisent se destinait principalement au domaine médical, l’échelle et le coût de leur travail sont relativement contraignants. Ils devront par exemple inventer de meilleurs échafaudages – les « os » artificiels autour desquels les muscles se développent –, car les dispositifs actuels sont chers et ne permettent pas de produire autre chose que de la viande hachée. (Des boulettes et des hamburgers, donc, mais pas de blanc de poulet ni de steak.) Ils ont également besoin d’inventer des bioréacteurs (autrement dit des cuves de fermentation) industriels permettant de développer du muscle à une échelle commerciale – des équipements qui n’existent pas encore, ce type d’appareil étant pour l’instant réservé à l’usage médical.
Même s’ils parviennent à s’agrandir et à proposer des prix compétitifs, un autre obstacle réside dans les législations gouvernementales et autres barrières administratives susceptibles de leur bloquer l’accès au marché. Les applications alimentaires de la biotechnologie existent depuis des décennies, mais les parlements peuvent se montrer sceptiques sur ces avancées à cause de la nouveauté qu’elles représentent intuitivement – un facteur qui risque de ralentir les demandes d’autorisation.
Reste enfin la question essentielle des consommateurs. Accepteront-ils ces aliments, aussi haut de gamme et abordables soient-ils ? Au vu du développement d’un public à la recherche de produits « naturels » ou peu transformés, faudra-t-il se préparer à un retour de bâton contre les produits animaux de culture et ce qu’on a surnommé la « Frankenfood » – pour désigner notamment les organismes transgéniques ?
Mais à la différence des géants de l’agrobusiness comme Monsanto et Dow AgroSciences qui, ces dernières décennies, ont mis le plus discrètement possible des OGM sur le marché, ces startups d’envergure relativement modeste mettent un point d’honneur à informer le public sur tous les aspects de leurs activités. C’est une question de « transparence radicale », pour reprendre une formule régulièrement brandie par ces entreprises soucieuses de tout dévoiler sur leurs méthodes. Elles en sont convaincues : si les consommateurs comprennent que leurs produits sont très proches d’autres aliments ou d’interventions médicales qui ont déjà intégré leur quotidien, alors l’approbation et même l’envie seront au rendez-vous.
Parmi les détracteurs du mariage de la biotech et de notre système alimentaire, certains voient assurément d’un mauvais œil l’arrivée des produits animaux créés en laboratoire. Leurs arguments seront détaillés dans les chapitres suivants. Notons toutefois que Michael Pollan, l’un des plus illustres défenseurs de l’alimentation durable, auteur de The Omnivore’s Dilemma et de Manifeste pour réhabiliter les vrais aliments, soutient le travail de ces entrepreneurs. « D’une manière générale, tous les efforts pour trouver des substituts à la viande sont louables, car d’une manière ou d’une autre, nous allons devoir réduire notre consommation pour des raisons d’ordre environnemental, moral et éthique », m’a répondu Pollan quand je lui ai demandé ce qu’il pensait de la viande cultivée. « On ne sait pas encore à quoi ressemblera le meilleur substitut, mais étant donné l’ampleur du problème, mieux vaut mener des recherches tous azimuts. »
Certains groupes et individus qui ont mené campagne contre les OGM n’ont pas forcément la même ouverture d’esprit que Pollan sur l’agriculture cellulaire. Bon nombre d’entre eux se préoccupent à juste titre de la manière dont l’utilisation de certaines technologies a abouti à un système alimentaire moins durable par le passé. Mais la technologie est semblable à un couteau : on peut s’en servir pour cuisiner un plat avec amour pour ses amis comme pour tuer, tout dépend de nos intentions. Une chose reste certaine : le succès de la viande propre contribuerait énormément à la réduction du nombre d’OGM existants. À l’heure actuelle, 90 % des OGM plantés aux États-Unis servent à nourrir les animaux d’élevage. Dans l’ouvrage Food Fight : GMOs and the Future of the American Diet, McKay Jenkins, virulent critique de l’agriculture industrielle, avance les arguments suivants :
« Le grand prix – cultiver de la viande à partir de cellules et non plus à partir du bétail – pourrait entraîner de nombreux changements radicaux dans l’agriculture industrielle. Nous n’aurions pas besoin de maïs OGM bourrés de pesticides, d’abattoirs industriels ou d’essence, parce que nous cesserions de nourrir, d’abattre ou de transporter des animaux partout dans le pays. Nous n’aurions également plus besoin de devoir gérer les montagnes (ou les lacs) de déjections animales qui contaminent nos mers et nos rivières, ou les nuages de méthane qui contribuent au changement climatique. Enfin, nous n’aurions plus besoin de tuer des milliards d’animaux pour satisfaire notre désir insatiable de protéines. »





























