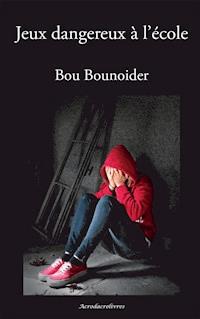Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acrodacrolivres
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce roman croise le destin de trois femmes issues de trois continents au destin lié à la nourriture.
L’histoire s’ouvre sur un paysage désertique, où vit la famille Tarik. Ibrahim et Fadhila ont donné naissance à Soraya. À 12 ans, cette dernière est chargée de trouver de l’eau, tandis que ses parents s’occupent de chasser. Sonia, 32 ans, est coiffeuse dans le monde de la haute couture et vit à Bruxelles avec Franck, un musicien. Débordée par son travail, elle vit dans un stress permanent. Jessy, récemment séparée de son mari, travaille au siège de l’ONU à New York. Seule et déprimée, elle se nourrit surtout de fastfood.
Dans ce roman, l’auteur prend un réel plaisir à alterner les trois histoires qui trouveront le même point de chute dans un hôpital de Bruxelles.
EXTRAIT
Ibrahim détenait un secret depuis son plus jeune âge. Les ancêtres lui transmettaient les principes de vie dans le désert et les lois auxquelles ne pas déroger. Le soleil était présent le jour pour punir ceux qui ne respectaient pas ces enseignements reçus. Les sages disparus se changeaient en étoiles et revenaient la nuit pour veiller sur leurs enfants. En bon père de famille, Ibrahim enseigna ces croyances aux siens. Un jour, son dévouement ne s’adressa plus exclusivement au ciel, car une rencontre plutôt singulière lui apparut comme un signe.
Avant chaque départ, il camouflait l’entrée de la grotte. Les filles étaient parties depuis bien longtemps avant que l’astre ne chauffe. Il prenait la direction opposée pour atteindre de larges plaines où le danger était permanent. Un jour, il y avait bien longtemps de cela, son chemin le conduisit vers une autre destination. Il s’égara sans doute et ne reconnut pas l’endroit.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bou Bounoider, auteur belge né à Bruxelles, écrit et décrit le monde qui l’entoure et qui nous est commun à tous.
Sa plume reflète son parcours atypique. Entre Bruxelles et Santiago du Chili, en passant par Los Angeles et San Francisco, ses mots ont beaucoup à nous raconter. Il pratique différents genres littéraires, du roman à la comédie, il prend le temps d’écrire des polars mais également des contes pour enfants, des chansons, des sketches et des spectacles. De ses nombreuses rencontres avec le genre humain naissent des histoires pour tous.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé serait purement fortuite.
À Laura, Étienne, Célia, Cristina, Bruno, Mireille
Préface
Le bien-nommé Bou Bounoider Bouillonne de vitalité. Entre le Maroc, le Chili et les États-Unis, c’est un Belge du Bou… du Monde comme je les aime. Un esprit sain dans un corps sain, il passe de l’école du cirque à l’écriture avec une aisance déconcertante et un sourire permanent.
La première fois que je l’ai croisé, il courait et coachait un jeune sur un terrain de sport. Quelques heures plus tard, il m’envoyait un manuscrit dans lequel j’apparaissais au micro de La Première avant de me proposer d’imaginer un bouquin sur les recettes que je préfère outremer. Ce gars n’est jamais à Bou d’idées et comme il déborde d’énergie positive et d’enthousiasme contagieux, c’est difficile de lui dire non ! Le temps que je pense à sa préface, il aura rédigé trois nouveaux romans, tout en bouclant deux marathons. Ah, j’oubliais, il a aussi deux enfants et un job de prof dans le secondaire et un autre d’assistant dans une université libre, comme lui…
Dis, Bou, tu dors parfois ? Cela dit, t’as raison, la vie est trop courte pour s’ennuyer. Fonce mon Bourlingueur, il y a encore tant à voir et à faire ici-bas…
ADRIEN JOVENEAU
Afrique
Le désert
Le désert.
Des collines silencieuses, rocailleuses.
Des pierres. Des roches. Des cailloux.
Le sable. La poussière. Les nuages de poussière.
Le désert, stérile, aride, ennemi de l’eau, poison de la soif, complice du soleil.
La vie y est impossible. Seule la mort a le droit de régner.
La terre poussiéreuse sur de vastes espaces infiniment riches de sècheresse. L’humidité n’est pas absente, elle est seulement ailleurs.
Il n’y a personne à des kilomètres à la ronde ou presque.
Le désert est beau. Le désert est la mort. Le désert tue. Il est la sirène qui ne chante pas. Il attire les âmes en silence, sèche la peau, irrite la gorge et déshydrate le corps qui tombe finalement à terre et vient insidieusement transformer ses restes en poussière quand les charognards ne sont pas au rendez-vous.
Un endroit trop chaud où il n’y a personne à saluer. Une étendue désertique qui grandit à chaque instant grignotant la terre verte qui l’entoure pour la transformer en terre aride et stérile. Seules les pierres, les roches et les montagnes peuvent l’arrêter.
La vie meurt. La mort vit. Rien ne règne ici. Il n’y a rien à des kilomètres. Le néant est partout.
Le soleil n’illumine pas le jour, il le brule. La lune n’éclaire pas la nuit, il fait trop froid. Les tempêtes de sable effacent tout sur leur passage si toutefois il y a quelque chose à effacer. Le sable couvre les moindres détails en bouchant les plus petits orifices et en assassinant à petits grains. Le désert perd les âmes égarées. Le soleil les désoriente. S’il ne l’a pas fait, la nuit tuera tout ce qui y traine.
Tarik
Cependant, le désert était la demeure de certaines gens. La famille Tarik y vivait depuis plusieurs générations en se transmettant les précieuses connaissances. Depuis son plus jeune âge, Ibrahim connaissait tout sur le désert et repoussait les limites de la mort aux extrémités invisibles de celui-ci. La fin du désert, il en avait déjà entendu parler, mais jamais il n’osa s’en approcher par crainte des histoires que racontaient les anciens. Il évitait tous les dangers pour sauvegarder sa vie et celle de sa famille. Toutes ses connaissances, il les détenait de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Il ne se souvenait plus dans quelles circonstances il avait rencontré la fille qui devint sa femme. De leur amour, Fadhila lui donna une belle et superbe petite Soraya, princesse du désert. Ils vivaient tous les trois au pied d’un mont, dans une caverne. Le jour, à l’abri du soleil. La nuit, à la protection du froid. Les nombreuses tempêtes de sable épargnaient depuis toujours les ancêtres d’Ibrahim.
Pour vivre, ils s’organisaient méthodiquement. Loin de la survie, ils affrontaient leurs besoins. Dès l’aube, Fadhila se mettait à escalader la montagne à la recherche du bois pour chauffer la grotte et les aliments. Son corps amaigri, carencé, et ses jambes de cinquante ans devaient marcher toujours de plus en plus loin. Le bois sec se faisait rare et au retour, il y avait plus de racines que de bois. Cinq à six heures lui étaient nécessaires pour parcourir son périlleux trajet. Sa peau présentait les marques du soleil agressif renvoyé par les pierres. Le bois que rapportait Fadhila ne suffisait pas. La famille séchait ses excréments au soleil et les réutilisait comme combustible.
À douze ans, Soraya connaissait tous les chemins enseignés par son père dans le désert. Elle savait comment déjouer les dangers. Elle se chargeait de remplir les gourdes en peau de chèvre. Pour cela, elle marchait six heures dans le sable en longeant les flancs de montagne. La route était longue, mais sans risque. Ibrahim avait pris soin de lui dresser un itinéraire sur lequel elle ne pouvait pas se perdre. Il lui avait aussi enseigné des techniques de survie telles que sucer un caillou pour apaiser les sensations de soif, marcher à une allure constante et se cacher en cas de rencontre avec un prédateur. À cinquante-cinq ans, le courageux patriarche se chargeait d’apporter la nourriture pour sa femme et sa fille. Il lui arrivait de les abandonner pendant plusieurs jours, car la nourriture se faisait toujours plus rare. Elles restaient seules et avec suffisamment de quoi se nourrir. Pendant cette longue absence, la fille et la mère chassaient dans les pierres des montagnes. Elles étaient expertes en capture d’insectes, de petits rongeurs et de reptiles. Il leur arrivait de temps en temps d’attraper un serpent. Soraya ne se lassait pas de regarder avec quelle dextérité sa mère l’attrapait, l’assommait et lui tordait le cou. Tous les gestes étaient précis et s’enchainaient rapidement. À l’aide du bord tranchant d’une roche, elle lui entaillait la peau et enlevait vigoureusement toute la peau d’un geste fort transformant le serpent en un vulgaire ver dénudé. La précieuse viande allongée s’entreposait au frais à l’abri du soleil au fond de la grotte. Les pièges montés soigneusement par Soraya emprisonnaient de temps à autre une petite souris, mais c’était rare. Elle s’était faite spécialiste de la purée d’insectes avec deux pierres plates qu’elle gardait constamment sur elle.
Ibrahim avait du mal à s’en souvenir avec précision, mais sa famille vivait il y avait très longtemps avec un troupeau de plusieurs têtes subvenant aux besoins vitaux. Viande, lait, peau et laine agrémentaient les différents repas et les saisons. Suite à un dérèglement naturel, les dieux très fâchés prirent la totalité des bêtes dans une tempête de sable qui dura trois jours. Ibrahim, Fadhila et Soraya s’abritèrent dans une grotte sans sauver leurs animaux. Ceux-ci ne laissèrent aucune trace permettant une infime chance de les retrouver. Ils remercièrent la providence de cette grotte et décidèrent de s’y installer. Les parents devenant vieux désiraient protéger leur fille et ne plus l’exposer aux terribles dangers du désert mortel. De nombreuses semaines furent nécessaires pour la reconnaissance des lieux et de la sécurité qu’ils offraient. Un point d’eau fut repéré à quelques heures de marche.
La grotte était enchâssée au bas d’une colline derrière laquelle plusieurs autres formaient un massif montagneux et rocailleux. La grisaille de ses chapiteaux de pierre renforçait la sècheresse désertique. Ibrahim les vénérait. Il rendait hommage à ces chasseurs de rêves, de proies, de survie peuplant les vieilles histoires de ses aïeux, cherchant la nourriture pour combattre la faim, ne trouvant que désolation, désespoir et mort. Ces chasseurs de l’impossible terminaient dans une partie du désert où tous ces êtres se retrouvaient pétrifiés formant ces étonnantes élévations stellaires vers le ciel. Ibrahim les trouvait belles. Tous les jours, il regardait l’étendue sableusement1 poussiéreuse : hôte de la faim. Le jour, le ciel brulant et impitoyable le défiait de survivre. La nuit, les étoiles glaciales le protégeaient.
1 Mot inventé par l’auteur signifiant l’abondance de sable.
L’arbre et le rhinocéros
Ibrahim détenait un secret depuis son plus jeune âge. Les ancêtres lui transmettaient les principes de vie dans le désert et les lois auxquelles ne pas déroger. Le soleil était présent le jour pour punir ceux qui ne respectaient pas ces enseignements reçus. Les sages disparus se changeaient en étoiles et revenaient la nuit pour veiller sur leurs enfants. En bon père de famille, Ibrahim enseigna ces croyances aux siens. Un jour, son dévouement ne s’adressa plus exclusivement au ciel, car une rencontre plutôt singulière lui apparut comme un signe.
Avant chaque départ, il camouflait l’entrée de la grotte. Les filles étaient parties depuis bien longtemps avant que l’astre ne chauffe. Il prenait la direction opposée pour atteindre de larges plaines où le danger était permanent. Un jour, il y avait bien longtemps de cela, son chemin le conduisit vers une autre destination. Il s’égara sans doute et ne reconnut pas l’endroit.
Il tomba nez à nez avec un rhinocéros et un majestueux arbre. La bête était énorme et immobile, les cornes tournées vers l’arbre. Ils semblaient s’entendre. Un animal et un arbre en pleine union sacrée. Ibrahim leur rendit hommage en se prosternant. L’animal était paisible. Ses oreilles bougeaient de temps en temps et quelques oiseaux apparaissaient de nulle part pour venir se déposer sur son robuste dos. Un souffle échappé de ses larges naseaux se fit entendre et effraya quelque peu Ibrahim.
L’arbre puissamment enraciné en terre était imposant. Ibrahim n’avait jamais vu taille pareille. Bien sûr, il se rappelait d’histoires ancestrales évoquant cet immense arbre atypique, le baobab. Désormais, il vint régulièrement parler à ses nouveaux dieux, leur demander de veiller sur les siens et de bénir ses chasses. Il essayait de revenir par le même chemin le plus souvent possible, mais il ne pouvait pas laisser trop longtemps les filles seules. La nuit tombait si vite et il comptait toujours sur les étoiles pour l’accompagner. L’arbre était magique, car Ibrahim assistait une fois par an à un étrange phénomène. Des feuilles apparaissaient pendant un seul moment de l’année. Il lui demandait la permission de ramasser ses feuilles mortes. Dans leur extrême bonté et leur générosité, le rhinocéros et l’arbre ne bronchaient pas lorsque l’homme s’approchait d’eux pour ramasser les feuilles et les fruits offerts.
L’arbre ne souffrait pas du soleil et protégeait la bête de ses grosses ramifications. Un soir où il se risqua à rester très tard, Ibrahim fut ébloui par la magnificence du coucher de soleil qui baignait l’arbre et le rhinocéros dans un rideau aux chaudes couleurs de feu. Les trois personnages étaient éblouis par une clarté divine. L’homme se dit qu’il devait partager ce spectacle merveilleux avec sa femme et sa fille. Depuis lors, la famille entretenait ses secrets et ses croyances. Une fois par an, il les emmenait prier non loin de là. Ils contemplaient l’arbre, le rhinocéros, le soleil et ils rentraient sous la bénédiction des étoiles.
Ce pèlerinage annuel permettait de ramener des feuilles et des fruits de l’arbre magique. Les excréments séchés du rhinocéros étaient emportés également. Fadhila se souvenait des enseignements de ses mères dans les nombreuses utilisations des végétaux. Elle prenait soin de préparer trois tas de sa précieuse récolte. Le premier avec les plus belles feuilles destinées à une décoction. Le deuxième paquet destiné aux feuilles séchées servirait à fabriquer une semoule. Le dernier héritait des moins belles feuilles et du reste de la décoction pour concocter une bouillie que Soraya touillait avec délicatesse.
Ibrahim se chargeait de traiter les fruits généreusement offerts par l’arbre. Il transformait la pulpe en bouillie et faisait sécher l’écorce pour une utilisation médicinale. Les transmissions de ses pères lui donnaient la faculté de remédier aux maladies survenues depuis qu’il était chef de famille. Grâce aux offrandes de l’arbre, il avait observé un changement positif parmi les siens. La fièvre stoppait d’un coup dès l’application des écorces. Ils n’avaient plus aussi souvent de fortes diarrhées. Les plaies cicatrisaient plus rapidement. Cette source de nourriture et de médicaments apaisait Ibrahim dans ses recherches perpétuelles contre la faim. Ils étaient maigres, mais en bonne santé. Ils vieillissaient tout en sagesse.
Soirée autour du feu
La famille se retrouvait tous les soirs autour du feu. Un feu signifiant le bienêtre, la fin du repas, la journée réalisée et les ventres hydratés et nourris en suffisance, mais sans abondance. Les visages creusés, la luminosité causée par les flammes accentuaient les fossés créés par des joues et des pommettes proéminentes. La coutume ancestrale entretenue par Ibrahim se perpétuait depuis la nuit des temps. Les histoires des sages revivaient dans des contes légendaires. Le rhinocéros et l’arbre étaient mis à l’honneur chaque soir avec de nouvelles perceptions.
Ibrahim racontait comment il avait capturé le petit rat qu’ils mangèrent au soir. Il décrivait les paysages arides et les nouveaux endroits du désert infini. Il mimait comment il rampa pour voler l’œuf d’une autruche lorsqu’il était jeune.
Fadhila décrivit les nouveaux chemins explorés pour trouver des brindilles et du bois. Elle marchait depuis tant de temps qu’elle n’avait encore jamais vu le sommet de la montagne. Les sages racontaient que plusieurs soleils devaient se succéder avant que quelqu’un atteigne le sommet. S’aventurer aussi loin et si longtemps aboutissait à la mort. Sacrifier un membre de la famille en abandonnant les deux autres était exclu.
Elle raconta comment, en trébuchant sur une pente rocailleuse, elle rattrapa un petit reptile qui s’échappa du tissu qu’elle avait pris soin de nouer. Elle dévala sur cinq mètres et les stigmates de sang séchés et nettoyés par Soraya étaient encore visibles à la lueur des flammes. Son mari la soigna à l’aide d’écorce séchée du divin arbre. Elle n’avait jamais gravi la montagne à une telle hauteur. Sur un renfoncement, elle entendit un bruit et fut distraite en essayant d’en trouver la source. Juste avant de glisser, elle aperçut un nuage noir qui semblait sortir de la pierre et flottait comme par magie. Blessée, elle renonça à pousser ses recherches plus loin et rebroussa chemin emportant un maigre fagot de brindilles suffisant pour démarrer un feu et un reptile rebelle.
Soucieux de l’importance que prenait leur fille dans cette vie difficile, les parents n’oubliaient jamais de lui poser des questions sur son itinéraire et sa quête de l’eau. Ibrahim clôturait généralement la cérémonie familiale en la félicitant pour son courage et sa force à rapporter tous ces litres de vie.
La nuit portant conseil, le chasseur du désert, la chineuse des montagnes et la porteuse d’eau laissaient venir à eux des rêves où dieux, soleil et ancêtres jugeaient leurs actions. Le bien résidait dans cette famille. Les étoiles montraient le chemin à suivre, le rhinocéros et l’arbre transmettaient la force utile à vaincre le désert brulant.
Le miel
Fadhila se réveilla la première. Elle fit sécher les déchets organiques pour le feu du soir et évalua la quantité de nourriture et de combustible. Ensuite par habitude, elle réveilla sa fille pour la préparer à partir à la quête de l’eau. Ibrahim se leva d’un geste brusque.
– Nous t’avons réveillé ! s’inquiéta la femme. J’en suis désolée. Repose-toi encore mon aimé.
– Non, Fadhila. Ne te préoccupe plus. La nuit m’a porté conseil. Les sages sont venus me rendre visite pendant mon sommeil.
– Que t’ont-ils dit ?
– Emmène-moi au nuage noir !
– Aujourd’hui ?
– Sans plus attendre ! Soraya nous accompagnera aussi. Nous prendrons un maximum de brindilles pour plusieurs jours.
– Et pour l’eau ? demanda-t-elle.
– Demain, tu iras la chercher avec notre fille pendant que je partirai pour la chasse.
– Allons-y sans plus tarder. Le soleil brule fort sur les sommets, ajouta Fadhila.
Ibrahim prépara un sac de peau de chèvre avec une poche d’eau pour le voyage, quelques aliments séchés et des écorces à mastiquer contre les douleurs de la marche.
Cela faisait déjà quatre heures que l’étrange cortège avançait en silence. La mère en tête, la fille au milieu et le père fermant la marche. Il se rendait compte de la difficulté journalière que sa femme supportait sans se plaindre. Sa courageuse fille suivait à bonne allure. Il était fier d’elles. Sans prévenir, Fadhila stoppa net. Habitués au moindre signe, Ibrahim et la fille firent de même. Les respirations se faisaient discrètes. Leurs mouvements étaient paralysés. Sur la montagne ensoleillée et brulante, trois statues de sel se figeaient en attente d’un danger potentiel. Puis, à la vitesse d’un éclair, la meneuse plongea sa main dans un interstice entre deux grosses pierres. Elle resta un moment immobile. Ensuite, elle en sortit un serpent gesticulant dans tous les sens tant sa tête se trouvait coincée entre les doigts de Fadhila. D’un geste précis, elle étira le serpent d’un coup sec avec ses mains et l’assomma. Le sourire de ses deux témoins signifiait qu’ils auraient de la viande au retour. Le reptile placé dans un sac avant qu’il ne se réveille balançait entre les rythmes des trois vaillants continuant leur route. Ils arrivèrent enfin à l’endroit où Fadhila avait aperçu le nuage noir. Ibrahim leva la tête et tourna sur lui-même, analysant les roches qui s’élevaient et s’agençaient en un coin de muraille infranchissable. Son regard se figea sur un endroit précis.
– Soraya, ma princesse ! dit-il sans perdre de vue ce qu’il repéra. Donne-moi une pierre.
Il saisit le projectile, évalua son calibre sans le regarder et le lança. Celui-ci disparut dans une cavité et provoqua le sourire d’Ibrahim confirmant son intuition. Il déposa son sac et y prit une lamelle de bois et une peau qu’il enroula et glissa dans la ceinture de son pantalon en lambeaux.
– Qu’as-tu vu papa ? demanda Soraya.
– Des magiciennes de douceur !
– Les sages ?
– Il y a bien longtemps, je me souviens en avoir vu avec mon grand-père. Je ne pensais jamais plus en rencontrer. Ma chérie, tu vas avec ta maman ramasser du bois. On se retrouve très vite.
Commença alors une longue et périlleuse escalade pour Ibrahim, sur une paroi escarpée aux gros rochers. Il se servait de tous les interstices pour grimper et atteindre son but, mains et pieds nus. La corne formée sur ses paumes lui permettait de ne pas sentir la douleur. Ses callosités saillantes témoignaient de longues années à marcher sur les terres arides, rocailleuses et cuisantes. Ses durillons épaissis attestaient de nombreuses décennies à faire du feu, à attraper des insectes ou à porter des charges lourdes. Ibrahim atteignait les trente mètres de hauteur. Il aperçut sa douce femme et sa tendre chair ramasser des brindilles et du bois mort pour le feu. Une roche délogée de la falaise présentait une surface sur laquelle le courageux homme pourrait se tenir accroupi. Ce faisant, il se trouvait désormais à portée de l’ouverture. Le nuage noir ne flottait plus à l’extérieur. Se hissant à l’aide de ses mains, Ibrahim put contempler un spectacle inouï. De petites bêtes se tenaient par magie dans les airs. Il aperçut de petites étoffes transparentes qui battaient rapidement au-dessus du petit corps coloré jaune et noir. Maintenant, il était certain du souvenir de son grand-père avec lequel il grimpa sur un arbre immense pour cueillir un sirop épais et sucré. Le risque en valait bien la chandelle. Le trou permettait de n’introduire qu’un bras. La première tentative échoua et récolta des piqures qui déstabilisèrent le curieux. La deuxième tentative s’avéra plus délicate dans son approche. En aveugle, la main hésitante effleura des rugosités régulières et collantes. Elle s’arrêta et les doigts se mirent à gratter. Une plaque d’un gel orangé avec de minuscules alvéoles sortit de la cavité. Ibrahim la porta à son nez et huma une odeur qui le plongea dans son enfance où la vision d’un grand-père héroïque lui enseigna comment survivre dans le néant. Il gratta sa trouvaille avec la lame de bois et laissa couler le produit sur la peau déroulée. Il plaça son trésor dans sa besace et tenta de prendre une seconde plaquette dorée. Il réédita plusieurs fois ses gestes. Aussitôt fait, le chanceux descendit rapidement, car les bestioles commençaient à s’agiter nerveusement et quelques estocades sur le bras décidèrent de la suffisance du butin. Les conseils de ses aïeux résonnaient encore en lui.
– Petit-fils, tu dois te méfier de ces petites bêtes. Elles sont furieuses et n’aiment pas les visiteurs. Elles peuvent te pourchasser et te tuer. Prends le strict nécessaire pour vos besoins et ne traine pas dans les parages. Souviens-toi, ne dérange pas trop leur équilibre.
Arrivé au bas de son mur de pierre, il retrouva femme et enfant. Tous les trois chargés de brindilles, de bois mort et d’un trésor céleste, ils descendirent vers leur caverne. Ibrahim mâchait l’écorce du baobab et sentait la douleur des piqures s’amoindrir. Le soleil chauffait, mais il ne but pas pour permettre aux filles de boire à satiété. La descente arrivait à sa fin et le patriarche ne sentait plus aucun élancement. Seules restaient de petites boules rougeâtres sur la peau calcinée par tant d’années ensoleillées.
De retour dans leur habitat, un cérémonial naturel s’opérait. La fille alluma un feu à l’aide des fientes séchées, de brindilles et de quelques branches. La mère prépara le serpent pour la cuisson. Elle l’enveloppa de feuilles magiques de l’arbre majestueux en y incorporant des graines de son fruit et de poudre odorante. Semoule, feuilles et pulpes constituaient une mélasse d’accompagnement. Le père préparait son équipement de chasse pour le lendemain. Lance, arc, flèches et brins tressés en liane s’enfournaient dans une peau enroulée formant sa fidèle besace. Ayant assez de combustible pour plusieurs jours, Ibrahim s’absenterait trois jours pour chasser une plus grosse proie.
Le feu chauffait la caverne et cuisait le festin. La couleur du foyer illuminait leur intérieur par des teintes orangées et jaunes. Le fumet embaumait les narines. Le trio s’asseyait autour du point de cuisson et de chaleur et partageait un repas délicieusement mérité d’une chaude ascension. À la fin du repas frugalement ingéré, Ibrahim se leva. Les filles le suivaient d’un regard plein d’espoir et impatient. Les sourires et les pupilles rayonnants traduisaient la délivrance d’une attente de la révélation du trésor des sages. Leur héros déballa la divine surprise et tous les yeux découvrirent une magnifique substance gluante, dégoulinante et collante invitant à la délectation.
Sans réfléchir et répétant des gestes ancestraux, Ibrahim prit une feuille de baobab par personne et approcha le miel près des flammes. Un liquide brillant commença à couler et se déposa sur chaque feuille. Les yeux ébahis de ses compagnes assistaient à cette opération comme à un présage des ainés célestes. Goutant le divin nectar, il leur distribua le reste. La saveur sucrée tapissa l’intérieur de leur corps de joie, rires et volupté. Les histoires des anciens tapissaient les aspérités de leur cache dont les ombres ardentes dansaient dans des scènes de chasses. La nuit se passa sous le gout prononcé sucrement2 délicieux qui les transportait en de doux rêves onctueux.
2 Mot inventé par l’auteur signifiant une extrême douceur sucrée.
Bruxelles
La ville
La ville.
Des rues silencieuses, macadamisées. Des rues bruyantes, meurtries de nids-de-poule.
De la rocaille volant sur les pare-brises.
La pollution. Des nuages de pollution.
Une abondance, une richesse, une humidité, une condensation. La pluie. Le soleil se cachait derrière cette pluie.
La vie était partout, dans les maisons et dans les rues.
On mourait à l’intérieur où la vie était agréable. On mourait à l’extérieur où l’on avait du mal à vivre.
Rien ne poussait sur le macadam. Sauf des montagnes d’immeubles et d’habitations.
Alors, pour oublier cet aspect brut, des aménagements verts étaient mis à la disposition des rêveurs, des promeneurs, des enfants, des parents qui les accompagnaient. Ces endroits servaient à oublier cette abondance de richesses et à profiter d’un bol d’air.
En ville, on se plaignait qu’il pleuve beaucoup, trop.
Les gens se réunissaient nombreux par kilomètre carré.
La ville les tuait à petit feu. Elle tuait par sa pollution. Elle tuait par ses complications.
La rue était traitresse.
La ville était belle. Elle était laide.
La ville était la vie par sa médecine. Elle était la mort par sa technologie.
La ville était propre. Elle était sale. Elle était la mort par ses travers.
La ville blanchissait la peau et irritait les yeux. Les corps tombaient par trop de stress. Ils s’écrasaient sous des tonnes de tôles roulantes. Au final, l’homme retournait à la terre, à la poussière et peut-être dans les étoiles.
En ville, il y avait énormément de monde à saluer. Personne ne se disait bonjour. Même les voisins ne se connaissaient plus. Cette étendue révoltante grandissait chaque jour. Elle détruisait la nature un peu comme un désert de briques. Elle recouvrait des ruisseaux, transformait des terres fertiles en asphalte. Seules les restrictions légales pouvaient freiner son expansion. La vie se répandait. Le soleil éclairait le jour sans le réchauffer. La lune décorait la nuit froide de sa luminosité.
L’argent couvrait les moindres détails gênants.
Le pouvoir assassinait les problèmes trop embarrassants.
La ville imagina des maladies sans remède.
Sonia
Sonia était une jeune fille de trente-deux ans, filiforme et belle de surcroit. Elle avait de longs et soyeux cheveux bruns. Elle avait réussi des études de coiffure, haut la main. Elle avait accompli ses stages chez tous les grands du cheveu. Ayant gagné plusieurs concours de chignons architecturaux, elle fut remarquée et engagée chez la grande reine de la haute couture belge, Karen Lagerfled. Heureuse de travailler le cheveu dans la créativité au fil des saisons, elle n’aurait échangé son emploi pour rien au monde.
Être mannequin ne l’intéressait pas. Elle en avait pourtant les traits, l’élégance, la chevelure, la minceur. Elle ne souhaitait pas ressembler à ces filles continuellement sous les peignes, les brosses et les bombes de laque. Sans cesse pendues à leur GSM, elles profitaient de ces uniques moments pour téléphoner à leur fiancé. Elles enchainaient les essayages, les séances photo, les défilés, les soirées mondaines, les spots publicitaires et les transits d’un aéroport vers un autre. Ces filles-là n’avaient pas de vie privée. Stressées par ce rythme infernal, elles finissaient épuisées et encore plus amaigries. Elles mangeaient trop peu pour garder leur ligne et leur place d’égérie.
Le stress était bien présent, mais cela ne gênait pas Sonia. Elle était heureuse dans son travail de création. Elle aimait rendre belles ces grandes déesses pour qui elle avait de la compassion. La beauté était partout. Sonia la déchiffrait avec son cœur. Les filles, bien que jolies, ne souriaient pas souvent dans leurs défilés. Or, pour la coiffeuse, la beauté se trouvait dans le sourire. Les traits enjolivés par un sourire créaient la clarté, la candeur, la beauté des visages. Sonia désirait faire sourire tout le monde, tout le temps. En dehors de la haute couture, Sonia travaillait comme coiffeuse-visagiste dans des salons bruxellois de grande renommée.
Elle partageait sa vie avec Franck. Il était musicien et travaillait dans son petit studio d’enregistrement au centre-ville de Bruxelles. Ils avaient emménagé dans un somptueux loft du boulevard Anspach en plein quartier De Brouckère au troisième étage d’une ancienne usine de textile reconvertie en habitation. Grâce à l’aide de plusieurs amis, ils aménagèrent ce bel appartement en un espace de vie agréable. Amoureux des grandes pièces, ils épuraient les lieux sans trop le charger de lourdes décorations, se contentant des indispensables meubles de confort et de fonctionnalité. Un poêle à bois en fonte rendait l’ambiance chaleureuse dans leurs cent vingt mètres carrés. Ils gardèrent les anciens radiateurs industriels qui se trouvaient sous les trois grandes fenêtres principales. Le magnifique plancher de la joyeuse époque manufacturière, poncé, rafraichi et teinté, créait une note de bienêtre sous les pieds. Des céramiques aux teintes de bon gout, une cabine de douche aux multiples jets, un jacuzzi et des vasques offraient une salle d’eau aux allures d’oasis paradisiaque.
Les escapades culinaires
Le somptueux loft se réveillait régulièrement sous des notes boisées, fumées et aromatiques. Le poêle à bois rayonnait encore de ses dernières poussées de chaleur. Dans son antre, quelques braises subsistaient encore faiblement jusqu’à mourir à petit feu.
Franck adorait manger et cuisiner. Il préparait toujours de bons petits plats qu’il mangeait la plupart du temps seul, vu que Sonia menait une vie au rythme des défilés, des salons de coiffure et des caprices de sa patronne, Karen. Il adorait suivre les émissions des escapades de Jean-Luc Petirenaud. Il regardait son programme préféré à la télévision ou sur internet. Amoureux du langage gastronomique, de la bonne chair, du bon vin, du fromage des caves, de la pâtisserie, il admirait cet homme élégamment généreux avec ses invités.
Petirenaud rendait hommage aux mains expertes de ces talentueux cuistots possédant l’art et la manière. Il montrait les doigts magiques de ces pianistes de la cuisine française, de ces virtuoses de la délicieuse table perpétuant son histoire. Grâce à la présentation de cet habile animateur, les sourires fleurissaient sur la bouche des passants. Sa belle géographie gustative s’étalait sur les écrans. La vie était merveilleuse dans ses escapades. Tantôt Petirenaud, tantôt petit renard par l’odeur alléchée, il embrassait, il saluait bien bas les artistes. D’escapades en brasseries, magico3 Jean-Luc, rendait sa France belle. Il transformait la vie de tous ses enfants-téléspectateurs en rêve. Ses hymnes aux gens les rendaient beaux. De marchés en restaurants au grand cœur, quel bonheur quand son phrasé donnait l’eau à la bouche. Tant d’hommages à tous ces mages tout au long de ses voyages. Derrière les bonnes tables, il se frottait les mains. Au bar, au bistrot, aux fourneaux, tous devenaient ses commis dès que sonnait la fête aux douze coups de midi. Franck le nommait président de la gastronomie, mayeur du régal à vie. Ses photos de famille invitaient à le rejoindre. Les filles ressemblaient à des rayons de soleil entre ses mains pleines de compliments à chaud. Vigneronne, fromagère, fille de chef, toutes de jolies artistes au cœur pressé d’épices. Ses belles balades gourmandes escapadaient4 les régions françaises de savoureuses histoires de cuisine et de maitres-cuisiniers.
Ayant toujours l’intense regret de ne pas partager ces plaisirs de la bouche avec sa bienaimée, Franck regrettait que son émissaire de la bonne saveur ne vienne pas en terroir belge.
3 Mot emprunté à l’espagnol.
4 Mot inventé par l’auteur à partir du mot escapade.
Finesse
Après chaque émission de Petirenaud, Franck se mettait aux fourneaux. Il était investi de la magie transmise par les escapades aux sourires et aux joies de tous ces créateurs, peintres, sculpteurs de l’art culinaire. Le dimanche, Sonia essayait le plus possible de partager la table de son amoureux musicien mijotant de bons petits plats au son des becs de gaz. Il avait pris l’habitude d’adoucir ses plats avec une cuillérée d’onctueux miel, la douceur favorite de sa tendre Sonia.
Elle adorait le miel et les abeilles. Elle était marraine d’une ruche dont elle avait suivi les différentes phases de construction et de colonisation. Sarah, une charmante apicultrice avait lancé le pari fou de recoloniser les forêts, les champs et les villes d’abeilles. Ces petits insectes disparaissaient en entrainant avec eux l’extinction de plusieurs fleurs, dont les coquelicots. Le défi fou de cette jeune amoureuse de la nature consistait à placer des ruches un peu partout. En ville, sur les toits des immeubles pour la fécondation des fleurs des balcons et des parcs. Dans les bois et les forêts, pour enrichir les espèces fleuries. Dans les champs, pour que les fleurs disparues renaissent de leurs graines. Ce chalenge presque impossible vit un premier parrain. Puis, un deuxième. Ensuite, ils furent des dizaines à encourager cette apide5 action. Sonia, bien que constamment prise par son boulot qu’elle adorait, s’enticha de ce projet et en retira les joies et les bienfaits d’un loisir.
Elle participa à la conception de la ruche. Sarah et elle dessinaient les plans de la nouvelle ruche urbaine constituée de cadres mobiles qui permettraient de les ôter sans endommager la structure générale. Elles choisirent l’immeuble sur lequel les futures abeilles éliraient domicile, non loin de son loft du boulevard Anspach. Plusieurs toits abritaient de nombreuses ruches. L’abeille à miel trouvait un espace pour équilibrer à nouveau le processus de pollinisation mis à mal par le rendement agricole. Un véritable enseignement s’offrait à Sonia.
– Regarde ! dit Sarah. Ces ruches-ci sont déjà installées depuis deux ans.
– Il y en a énormément ! s’étonna Sonia.
– Quelques milliers par ruche. Je connais des ruches abritant plus de trente mille individus. Le plus incroyable est qu’il n’y a qu’une seule reine.
– Comment la reconnait-on ? demanda Sonia.
Reine, ouvrières, larves, faux bourdons résonnaient dans la tête de Sonia apprenant à reconnaitre chaque individu. Elle pouvait même étudier leur mode de communication en observant leur façon de frétiller ou de danser.
– Les abeilles en ville vont produire du meilleur miel, moins pollué qu’à la campagne, car en ville on ne déverse pas de pesticides ou fongicides…
Quel bonheur de s’évader entre ciel et toit pour se trouver au-dessus de tous les stress et les strass du travail ! Une fois la ruche construite, elle était amenée auprès d’autres déjà en pleine activité. La plateforme, donnant sur la place De Brouckère, était spacieuse et un auvent protégeait les insectes des pluies trop souvent abondantes. Les quartiers adoptés par Sarah et les abeilles étaient richement fleuris de balconnières, de bosquets, de parterres. Un fleuriste adhéra au programme en installant chaque jour de merveilleux bouquets aux subtiles senteurs attirant les ouvrières du miel. Sonia apprenait tous les procédés de récolte du miel et ne ratait jamais un rendez-vous avec Sarah. Une sincère amitié naissait entre les deux femmes et elles se retrouvaient de temps à autre dans le quartier Saint Géry à papoter en sirotant une bonne Pécheresse.
Sonia se souvenait de la première récolte de sa propre ruche. Déguisée en astronaute du miel, elle enfumait ses petites filleules volantes et paniquait à l’idée de se faire piquer. Elle comprenait maintenant qu’on n’endormît pas les abeilles, mais qu’on enfumât la ruche. Occupées par la fumée annonçant un feu, les abeilles s’occupaient du premier danger, laissant l’apiculteur réaliser sa tâche. Quel plaisir de prendre les tablettes et de laisser la substance liquoreuse s’écouler dans les seaux en reflétant le soleil !
– Ne t’inquiète pas, rassura Sarah, elles sont occupées à sauver leur ruche. Tu ne risques rien. La fumée les empêche aussi de communiquer. On a bien le temps !
Ce miel qui coulait sous ses yeux, remontait dans ses narines et remplissait tous ses sens, elle le retrouvait dans les plats mijotés de son Franck. Elle ne passait pas beaucoup de temps avec lui. Accaparée par son boulot, elle s’en voulait de ne pas se donner pleinement à son compagnon. Ensemble, ils essayaient de profiter de chaque instant, toujours trop rare. Lui travaillait beaucoup et rentrait le plus souvent avant Sonia dans leur grand loft. Il avait quelques amis qu’il voyait régulièrement et son passetemps culinaire l’occupait principalement à la maison. Ils tentaient de se réserver le dimanche pour se retrouver, mais la musique et la mode avaient souvent le dessus.
5 Adjectif obtenu à partir du nom masculin apidé.
Défilé de mode
Cela faisait longtemps que Sonia avait quitté son lit et son amant. Il était cinq heures du matin lorsqu’elle ferma doucement la porte derrière elle. Arrivée à l’atelier, elle découvrit Karen finalisant ses dernières créations destinées au défilé de midi. Le matériel de coiffure devait être vérifié et préparé. Les assistantes de Sonia arrivèrent en délégation. Attentives et motivées, elles écoutaient avec passion toutes les recommandations de leur experte coiffeuse.
En équipe, les décorateurs achevaient le podium sur lequel les mannequins déambuleraient. La salle nettoyée, les chaises rembourrées en velours rouge dessinaient un arc de cercle lovant la scène. Un technicien s’assurait du bon fonctionnement de l’éclairage. La sono vérifiait le bon ordre des musiques d’ambiance.
Les premières filles entrèrent dans les loges. De grandes, minces et belles filles. Toutes longilignes. Aux longs cheveux. Aux jambes fines et allongées. Elles cachaient leurs yeux derrière d’énormes lunettes de soleil. Un sac pendait au bout de leur bras et se balançait au bas d’anses aussi effilées que leurs jambes. Telles les habitantes d’une ruche, les maquilleuses, les coiffeuses, les habilleuses et les accessoiristes bourdonnaient autour et entre les amazones de la mode.
Agenda électronique, téléphone portable ou magazine à la main, ces déesses mystérieuses plongeaient leurs yeux dans leur emploi du temps chargé de textos et d’articles aussi légers que l’alimentation qu’elles s’obligeaient à ne pas ingurgiter pour garder leurs corps de poupées. Les sèche-cheveux vrombissaient sur les bigoudis enroulés. Les longues tignasses prenaient des formes architecturales en fonction de la robe portée. Les fards, les rouges, les fonds de teint illuminaient les visages. Les paupières et les cils se prêtaient au jeu d’un regard ténébreux. Toutes plus belles, il leur manquait un peu de poids et de sourires. Certes, on les voyait s’amuser dans les soirées fashion6, discuter entre elles, boire un petit verre et danser, mais elles souriaient gênées, timides et complexées. D’être trop maigres ? D’avoir faim ? De ne pas oser manger devant les autres, de peur de perdre leur place d’égérie en prenant quelques kilos de trop. Leur corps sublimé par tous n’était pas si idéal que ça ! Elles comprenaient progressivement que cette anatomie déifiée par les magnats de la mode ne serait qu’éphémère. Certaines craquaient, abandonnaient et mangeaient quand elles ne sombraient pas dans une profonde dépression. D’autres envisageaient une nouvelle carrière et s’inscrivaient dans les agences où elles étaient acceptées malgré des kilos supplémentaires. Cela devait changer, car elles ne se sentaient pas bien dans leur peau.
Une rumeur se propageait. La maigreur des mannequins ne faisait plus recette. Dans quelques semaines, l’Espagne accueillerait la semaine de la mode. Le gouvernement y interdirait les filles jugées beaucoup trop maigres. L’argument avancé par les autorités hispaniques était l’influence néfaste de cette maigreur sur les jeunes filles. Une étude récente, dans les écoles et dans les familles, révélait que les adolescentes se trouvaient trop grosses. Elles changeaient leur comportement face à la nourriture. Elles désiraient ressembler à toutes les stars, mannequins et belles filles exposées en couvertures et présentées sous les feux de la rampe à la télévision.
C’était justement un article expliquant tout ceci que tenait la grande Béatrice, une fille de l’Est qui pratiquait le mannequinat depuis ses seize ans. Se promenant dans un shoping, elle fut remarquée par des photographes chasseurs de corps.
Tanya, la rédactrice en chef du célèbre magazine PLUS BELLES remarqua l’agitation dans les rangs des maigrichonnes.
– Ne croyez pas à toutes ces sornettes que raconte la presse à scandale, dit-elle d’un ton rieur et critiqueur tentant de les baratiner.
– On parle quand même de nous interdire l’accès, s’inquiéta un mannequin.
– Ils ne le feront jamais ! affirma la rédactrice. Trop d’enjeux financiers. De plus, les formes longilignes comme les vôtres restent la seule et unique règle.
– De plus en plus de créateurs choisissent des filles plus en chair, dit timidement un autre mannequin.
– Oui, et elles perdent leur boulot et toutes les facilités qui l’accompagnent, insista Tanya. Allez-vous continuer à discutailler ? La porte est grande ouverte. Sinon, il y a un défilé qui se prépare !
La discussion se terminait sur un gout amer. Tanya était remontée. Au défilé, les filles étaient gagnées par la peur, le stress et les crampes au ventre. Peur d’une interdiction de parader et de tomber de ces hauts talons peu faits pour marcher et de se retrouver au bas de l’échelle. Certaines n’en pouvaient plus de cette vie et ne tenaient que par les médicaments ou la boisson. La réalité était loin de leur rêve. Quelle vie ! Stressées de continuelles remontrances et injonctions des dirigeants des agences et de tout ce remue-ménage répétitif à longueur de temps. Affamées, affaiblies et continuellement sur la réserve. Les corps se métamorphosaient en cachexie. Les cheveux se multipliaient entre les dents des brosses.
Cependant, le défilé de Karen se déroulait au mieux, car il était bien rodé. Les lumières, les collections de la créatrice et les mises en couleurs des visages montraient le rêve de la sublimation de la maigreur dans toute son horreur. Les gens aveuglés par les nombreux flashs se plongeaient dans une espèce de magazine vivant où les photos prenaient vie en déambulant sur une longue bande rouge feutrée au son d’une musique assez forte empêchant d’entendre les plaintes de ces corps fragilisés.
« In 3’ s »7, le morceau instrumental funky des Beastie Boys rythmait formidablement les marches, les arrêts et les retours des vêtements hauts de gamme. Les synthétiseurs transcendaient la salle. Les pas et les déhanchements des fines créatures se calquaient sensuellement sur la percussion de la musique. Les sourires absents, les regards froids, la désinvolture et l’impersonnalité rivalisaient avec la chaleur entraînante de la musique.
Dans les loges, l’effervescence était à son paroxysme. Après le tirage et le lissage de cheveux, les visages maquillés étaient retouchés entre chaque passage. Personne ne paraissait heureux d’être là tant il fallait se dépêcher. Les artistes du beau s’affairaient autour de ces corps de plus en plus fragilisés par la fatigue et le rendement imposé des défilés répétitifs.
Présentes physiquement grâce à celles qui les rendaient égéries et moins fatiguées, absentes et isolées par des écouteurs diffusant des mélodies qui les aidaient à surmonter le stress, les mannequins ne se parlaient que très peu et ne se prêtaient guère attention, lorsqu’elles étaient occupées à répondre à des messages reçus de leur famille d’un autre continent. Les bruits des accessoires de beauté rimaient avec les sonneries des appareils téléphoniques.
Dans une coulisse du hall de présentation, une discussion se tenait entre Tanya et Guérand, un jeune agent artistique efféminé.
– Toutes de petites effrontées ! s’insurgea la rédactrice.
– Que se passe-t-il encore ? demanda le jeune agent.
– Elles sont toutes les mêmes. Il n’y en a pas une pour excuser l’autre. Elles rêvent de perdre leur job.
– Comment ça ? demanda l’agent.
– Elles souhaitent prendre du poids.
– On les vire, c’est simple !
– Déjà que minces, elles sont encore grosses. Nous devons sans cesse retoucher toutes les photos des magazines. Les lumières et les maquillages font d’elles ces beautés qui font rêver toutes les filles de la terre qui nous achètent nos papiers.
– De toute façon, nous avons une mine d’or grâce à toutes les filles de l’Est que nous racolons en leur faisant miroiter la renommée et la richesse.
– La première qui moufte, je la vire et elle retourne là où on l’a trouvée.
Karen, passant par les coulisses, interrompit le débat houleux. Les regards étaient interrogatifs et Tanya masqua la tension par un sourire digne des actrices américaines.
6 De l’anglais signifiant mode.
7 Morceau instrumental de l’album des Beastie Boys « The In Sound From Way Out » sorti en 1996.
New York
Ville riche par son excellence, par sa richesse, par son multiculturalisme et par ses tours de Babel. Ville meurtrière par sa circulation, par son stress, par ses banqueroutes, par ses gangs. Ville meurtrie par ses attentats, par ses jumelles écrasées, par ses larmes de sang. Métropole colorée par ses citoyens, ses touristes, ses affichages publicitaires et ses taxis. Des quartiers aux gouts, aux teints et aux senteurs exotiques. Des villes dans la ville. Des pays à forte concentration d’habitant dans la ville.
Jessy travaillait en tant que secrétaire au siège des Nations Unies à Manhattan. Elle s’occupait de l’aide aux pays les moins avancés en matière d’économie, de développement et de technologie. Son bureau avait la charge des pays africains. Les tâches étaient nombreuses pour sortir les populations les plus défavorisées de la misère. Tout le monde aidait l’Afrique, mais le continent ne sortait toujours pas de son terrible marasme. Entre les dossiers des ONG8, les pays membres, les organisations humanitaires et les conférences mondiales, guérir la pauvreté ne suffisait plus. Les conférenciers émettaient l’idée de considérer l’Afrique, en lente progression, comme un immense réservoir de potentiels. Le développement durable serait et devrait être la solution.
Séparée depuis peu de son mari, Jessy trouva un joli appartement sur Leland Avenue. Depuis toujours, elle vivait dans le Bronx où elle avait grandi. Elle vit son quartier, considéré comme pauvre, se modifier considérablement grâce à toutes sortes de campagnes de sensibilisation et d’importants travaux d’aménagement. Elle ne voulait en aucun cas le quitter, car elle aimait son ambiance, sa couleur métissée, ses odeurs et ses bruits. La musique s’écoutait à tous les coins de rue et s’accompagnait de matchs de baseball ou de basket dans les nombreux parcs et cours grillagés. Chaque matin, elle empruntait le métro de la ligne 6 jusqu’à l’ONU9. Quel plaisir, chaque jour de prendre les transports et de se remémorer les nombreux souvenirs d’enfance le long de l’itinéraire. Le centre médical, le club de fitness, l’école, la maison de ses parents et celles de quelques amis agrémentaient son voyage de quelques sourires. Le bureau de Georges, son mari, de l’église où ils se marièrent et divers endroits où ils partagèrent des moments intimes libéraient des larmes de remords. Toutes ces pensées occupèrent la totalité du trajet et les dernières minutes de son parcours se firent à pied. À Grand Central, sa dernière bouffée d’oxygène lui permit de mettre ses idées en place pour organiser sa journée. Elle s’arrêta pour prendre un café et en termina les ultimes rasades devant les haies admirant avec des yeux d’enfant les drapeaux claquant dans le vent.
8 Organisation non gouvernementale.
9 Organisation des Nations Unies.
Central Park
Par quelle force, quelle énergie, quelle conviction, quel dessein ou quelle détermination une abeille africaine se retrouvait-elle dans un interstice d’un avion long-courrier ? Par cette même force qui lorsqu’elle répondrait à une agression lui permettait de poursuivre sa cible sur plusieurs centaines de mètres. Cette abeille n’arrivera pas à destination, mais pondra des larves qui résisteront à ce long voyage. D’énormes ailes pour les guider en attendant que les leurs se développent. Freinées dans leur genèse et refroidies par l’altitude, ces petites pelotes blanches recroquevillées reprirent vie à la chaleur de l’atterrissage. Parachutés de leur logis, ces insectes clandestins planèrent au hasard du vent. Forêts, jardins, zoos, parcs, balcons, fermes, champs réceptionnèrent ces êtres encore inoffensifs. Les saisons se succédant, la sélection naturelle s’opérait : les plus fortes se développaient. Plus résistance que les autres espèces, l’abeille africaine vit ainsi le jour sur le continent américain. Elle envahit les ruches de ses congénères et se multiplia. L’éclosion précoce des reines permit de tuer leurs rivales royales et de créer une lignée de tueuses.
Une vache fut retrouvée morte au bord d’un champ. Ce phénomène resta inexpliqué. Plusieurs semaines plus tard, d’autres bovins furent découverts morts dans les mêmes conditions mystérieuses.
Central Park, poumon de Manhattan, aux fleurs bien entretenues réjouit les yeux des promeneurs. Respecté par les gens où les chiens sont tenus en laisse libres de jouer dans des endroits bien clôturés leur étant réservés. Les canins sont admis dans ce parc aux conditions de ne pas creuser, de ne pas uriner partout et d’offrir leurs excréments aux jardiniers les récupérant pour leur compost. Des centaines de mètres cubes de feuilles mortes automnales disposées en ligne pour permettre une décomposition plus rapide et régulièrement retournées et mélangées à la fourche par les bénévoles. Serait-ce le secret d’une luxuriante flore et d’une verdoyante pelouse ?
L’automne, la saison préférée de Jessy. Que de couleurs pour remplir les yeux et la tête ! Elle aimait bien se promener et fouler des pieds les tas de feuilles fraichement tombées du matin, un vrai tapis de couleur feu. Elle adorait le bruit que cela produisait. Elle désirait, rien que pour un instant, être une feuille à la chaude couleur prête à quitter sa branche à tournoyer dans une ronde folle et à planer en surfant sur l’air pour venir se déposer en douceur sur les autres fleurs jaunies, brunies, séchées, humides ou molles. Elle aimait plonger ses yeux dans les plans d’eau, il y en avait sept, et regarder avec envie tous ces amoureux en barque. Seule, assise sur un banc, elle ne se trouverait jamais dans une embarcation, face à sa moitié ramant avec ce sourire pour elle.
Isolée sur ce banc. Les souvenirs du projet d’adopter un banc avec Julian lui revenaient à l’esprit. Choisir un banc conforme à leur désir, leur amour, leurs projets de vie. Venir s’y installer, se reposer, parler de voyage, s’embrasser, contempler le parc, s’admirer dans les yeux. Ils voulaient posséder un des neuf mille bancs publics et se l’approprier. Une jolie plaque gravée à leurs deux noms y figurerait. Ils auraient choisi un banc style canapé au design sobre et humble, vieux banc qui compte dans l’histoire du parc faisant partie des paysages bucoliques ou bien un de ceux conçus pour l’exposition universelle de 1939 au bois plus noble et à l’armature en fonte avec de jolis accoudoirs, installé dans les places ou alors ceux destinés aux couples désireux de fonder une famille, un de ces bancs blancs en béton, assise durable dans le temps et qu’ils offriraient à leurs enfants qui, eux-mêmes l’offriraient à leur tour à leurs enfants en les regardant jouer dans les plaines de jeux dont ils constituaient les abords, et s’ils ne trouvaient pas leur bonheur, ils pouvaient encore jeter leur dévolu sur un banc rustique fabriqué à la main dans le parc même. Chacun se trouvait alors un modèle unique. Les bancs publics étaient des bancs protégés par la noblesse de ce magnifique parc en constante effervescence. Les amours y commençaient et y perduraient. Les regards des passants étaient toujours souriants. Les enfants aimaient à signaler aux parents les baisers langoureux des bancs publics et à demander si eux aussi s’embrassaient de la sorte. Malheureusement, la tristesse et la solitude étaient les seules compagnies de Jessy sur ses plates planches en bois ou en béton. Elle n’y sentait plus l’amour, la joie, les rires, les négociations et les silences passionnels. Le silence était devenu cruel, injuste et sans doute éternel. Au lieu d’une belle plaque métallique avec leurs deux noms gravés, ses larmes étaient absorbées par le béton ou le bois et impossible d’y lire quoi que ce soit. Ni aimante, ni amante et pas même d’enfants à tenir par la main, juste à en regarder jouer dans les plaines de jeux, mais ceux des autres couples heureux. Oui, ces bancs auraient pu garder les meilleurs moments de leur amour.
Avec sa vingtaine de milliers d’arbres et de fleurs, les jardins de Central Park étaient d’une splendeur rarissime pour une grande ville comme New York. La faune bien représentée et la sauvegarde d’une telle biodiversité étaient assurées par tous les experts et les bénévoles amoureux de la nature. Plusieurs arbres accueillaient des ruches. Quelle poésie de voir virevolter les abeilles de fleur en fleur ! Les libellules rebondissaient dans les airs. Les papillons déployaient leurs éphémères ailes et impressionnaient les regards pensifs. Un enfant fut piqué par une abeille. Le terrible gonflement de la peau qui en résulta fut attribué à une allergie à haute sensibilité à la piqure d’insecte. Plusieurs semaines suivirent sans incident particulier jusqu’à ce que l’on découvre dans une clairière du parc, une petite fille sans connaissance aux côtés de son chien mort. Le seul lien qui les unissait encore dans leur inconscience était la laisse obligatoire pour tous les amis canins. Emmenée aux soins intensifs, la petite se trouvait entre la vie et la mort. Sur les deux corps, on pouvait distinguer, par centaines, des boursoufflures ressemblant fortement à des piqures d’insectes.
Qu’il était encore si proche le temps où elle courait avec Julian ! Jessy aimait ces moments de jogging pendant lesquels son corps transpirait de toutes parts. Qu’il était agréable de parcourir le parc en empruntant les différentes pistes prévues aux coureurs ! En fonction du temps, de la fraicheur matinale, de la luminosité de fin de journée, de la circulation ou de la fréquentation, ils choisissaient tel ou tel trajet. Il aimait courir sur le chemin de halage et côtoyer les chevaux. Ils profitaient des beaux sites et panoramas sur un autre itinéraire. Quel bonheur de sentir et voir les cerisiers fleuris en été ! Elle se souvenait du jour où ils couraient paisiblement, gênés par les gaz de la circulation. Puis, devant eux, un homme d’une cinquantaine d’années, en quinte de toux, ayant du mal à récupérer son souffle, s’écroula. Lorsque les secours arrivèrent, il était trop tard. Le jogger était mort d’une asphyxie au monoxyde de carbone trouvé en forte quantité dans son sang. Dès lors, le parc invita les sportifs à s’entrainer le plus possible en dehors des horaires d’ouverture à la circulation. Maintenant, tout était différent. Jessy ne courait plus. Sa tenue avait été jetée au fond de la buanderie. De toute façon, elle devenait trop petite, car son corps enflait. Néanmoins, elle continuait à s’y promener et redécouvrir tous les beaux sites, les rencontres sportives, les belles architectures et les différentes œuvres d’art exposées.
Plusieurs possibilités de se restaurer se présentaient et Jessy ne se privait pas de faire une halte gourmande. Restauration rapide, méditerranéenne et crème glacée composaient un menu improvisé.
La fraude impérissable
Cela faisait plusieurs mois que Khar Nassier volait de ses propres ailes et en fonds personnels. Les prêts étaient entièrement remboursés. Les banquiers contents de récupérer leurs créances voyaient d’un triste œil des milliers de dollars qu’ils ne pourraient pas brasser dans leurs coffres-forts. Maintenant, tout lui était permis. Son unique objectif était de vendre chaque jour la totalité de sa marchandise. Ses inspections régulières en cuisines terrorisaient les cuistots et les apprentis. Les hamburgers destinés à la vente restaient vingt minutes sur le présentoir. Passé ce délai, soit ils étaient emportés et consommés froids, soit redirigés sur un étalage à l’abri de la vue de tous. Seul le patron avait le droit de fréquenter cette zone. Ces sandwichs invendus revenaient dans le circuit après un passage en douceur dans un four à microondes. Les salades étaient recomposées en ôtant les quelques éléments défraichis et en arrosant subtilement de gouttelettes d’eau l’intérieur des boites plastifiées pour en vanter les propriétés maraichères. Les emballages des gâteaux étaient continuellement étiquetés. La congélation des viandes crues et cuites était une pratique courante. Une machine injectait des produits dans les aliments. Les résultats découlaient d’une ambition sans limites, d’une convoitise immodérée.
Vendre vite et à un prix défiant toute concurrence se trouvait dans les lettres et les gênes de Khar Nassier. Ses enseignes lumineuses, ses promotions, ses guets-apens attiraient les foules. Le restaurant ne désemplissait pas de la journée. Tout était manigancé. Dès le départ, les dés étaient pipés. Quand, chez les concurrents, un clown attirait l’attention et hypnotisait les enfants pour qu’ils encouragent leurs parents à venir manger, Khar-food jouait la carte de la séduction féminine. Ainsi l’avenir alimentaire de la malbouffe était assuré pour les prochaines générations.
Des concours séduisaient les habitués et les fidélisaient. Ainsi, des concours de dessins, des tours de chant ou des castings publicitaires s’organisaient au sein même de l’antre nuisible à la santé.
Des écrans géants vantaient la qualité de la nourriture et la bonne ambiance que générait le plus grand fastefoude10 de New York. La stratégie consistait à utiliser les enfants pour réaliser les spots publicitaires. Ils louaient le côté délicieux de cette nourriture pourtant infecte. Ils associaient le fastefoude à un réel restaurant dans lequel on avait le choix d’établir son propre menu. Ils soulignaient la disponibilité des menus à n’importe quelle heure de la journée. Ils incitaient les parents à choisir le fastefoude pour passer du temps en famille. Ils les conseillaient en nourriture. Ainsi, les parents déculpabilisaient en prétextant qu’ils se rendaient au fastefoude pour faire plaisir à leurs enfants. Ces derniers, en général, ne mangeaient pas énormément et terminaient rarement leur menu dans l’intégralité. Les parents ne se privaient pas de prendre en plus de leur menu principal, un second sandwich et des nuggets et terminaient le repas de leurs chers petits. Les enfants mangeaient mal, peu, et ne bénéficiaient pas des apports nutritionnels journaliers recommandés. Les parents mangeaient mal, trop, et accumulaient des quantités nutritives non recommandables.
10 Mot emprunté à Bernard Weber.
Viande ou ne pas viande
Khar Nassier était un homme foncièrement mauvais. Tout ce qu’il désirait, il le réussissait. Mais tout ce qu’il réussissait était au détriment des autres. Ce personnage, fraichement diplômé en markéting avec ses projets d’envergure provoquait une course au profit. Vaniteux, il ne manquait jamais de claironner ses exploits. Il ouvrit le plus grand fastefoude de New York. Le plus grand macrophage du monde. Toute la chaine avait été scrupuleusement et malhonnêtement bien pensée. Ne dépendant pas des autres grandes marques de la restauration rapide, il était le seul maitre à bord. Il était indépendant et avait remboursé ses prêts bancaires en cinq ans. Il fonctionnait de manière autonome et s’enrichissait non pas sur le dos des gens, mais plutôt sur leur système digestif. La confiance aveugle des banquiers résidait en la teneur des beaux projets sur papier que présentait le jeune entrepreneur.
Il promettait un commerce équitable avec des fermiers. Il assurait une nourriture naturelle pour les bovins. Il exigeait des poulets élevés en plein air. Il favorisait les agriculteurs qui cultivaient les légumes bios. Il limitait le sucre dans les boissons. Il mettait en avant la qualité des produits à un prix démocratique.
Toutes ces belles promesses tinrent le temps d’honorer ses créanciers. Ensuite, l’heure fut à la course sans pitié, sans partage et sans regret. Le Khar-food proposait la plus horrible malbouffe sublimisée dans des boites aux couleurs vives et aguichantes. De petits corbillards en carton enfermaient des milliers de germes se multipliant dans une course contre la montre. Des boites plastifiées offraient des salades fraiches afin de montrer un visage plus végétarien. La quantité de sucre contenu dans les pains, les boissons, les sauces et les desserts caramélisait toutes les supercheries de gouts trompeurs. La mort cancérigène entre dix doigts s’engouffrait facilement et rapidement entre les dents pour plomber l’estomac et y siéger pendant une lente, longue et lourde digestion. Où était le plaisir de manger si vite ? Quel était l’avantage de remplir sa bouche et de s’empêcher de mâcher en savourant son mets ? Pourquoi, ce pain si joli et cette viande si légère plombaient-ils le ventre ? Oui, pourquoi ?
Le piège fonctionnait à merveille, les gens tombaient dans ses filets de viande honteuse. Ses fermiers équitables étaient devenus des esclaves. Au lieu de s’enrichir honorablement, ils s’endettaient. La grande demande de Khar en bétail les obligeait à acheter plus de bêtes mangeant toute la pâture. Les terres perdaient de leur vigueur et le brulis était la seule solution pour créer de nouvelles cultures. Finalement, leurs terrains étaient rachetés à perte par leur mentor aux promesses utopiques. Il cultivait la gloutonnerie des terres, des herbages et de ses milliers de clients. Les bovidés dopés par des farines aux hormones étaient vendus dans un marché parallèle. Grâce aux bénéfices très juteux, Nassier achetait à bas prix les carcasses des animaux dans les abattoirs. À leur insu, les clients devenaient des charognards à l’appétit féroce. Insatiables, les adultes superposaient les tranches de viande. Avec voracité, les plus jeunes dévoraient sans arriver jusqu’au bout de leur proie sans vie.
Tout lui était dû. Il avait inventé une nouvelle façon de nourrir la population. Son alimentation était cachée dans des box magiques. Les clients entraient dans un palace aux mille pièges pailletés et les enfants étaient hypnotisés par les espaces de jeu, les couleurs des chocolats décorant les crèmes glacées et les cadeaux abrutissants. Chaque jour, cet orgueilleux gérant accueillait ses carnivores pour se montrer et entendre complimenter son œuvre. Les bruits sourds des poulets tués en batteries résonnaient à l’intérieur des murs. Son bâtiment était scellé de sang.