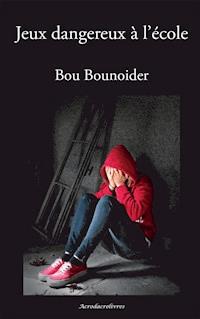Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acrodacrolivres
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’enfant qui courait est un roman basé sur une histoire vraie. Cette dernière tente de retracer le récit de Sacha qui ne connaîtra jamais l’amour maternel.
Privé de père, il partage sa vie avec un frère aîné brutal et un cadet très souvent absent.
Courir est l’unique échappatoire face aux nombreuses violences jalonnant les étapes de sa vie. Une violence familiale qui n’a aucune peine à exister par l’absence de cellules de défense pour les enfants dans les années soixante-dix. Entre la recherche de liberté et de bonheur, Sacha court pour échapper à ses multiples bourreaux.
Un roman bouleversant sur un enfant qui court pour fuir son mal-être familial
EXTRAIT
Je suis né dans les bras inexpérimentés d’un vieil homme, un beau jour pluvieux de l’année 1968. Cette année baignait aussi sous les pavés des étudiants révoltés, un peu partout dans le monde. L’île Maurice devenait indépendante, Martin Luther King avait fait un rêve pour la dernière fois, les Vietnamiens étaient massacrés par centaines, l’Europe était divisée par un rideau de fer et novembre m’accueillait après un printemps situé plutôt à Prague que sous les fleurs et le soleil. Tous ces événements visaient un seul et même but, la liberté, signe sous lequel je naquis.
Nous vivions d’appartement en appartement dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles. Nous avions connu trois habitations différentes. Mes souvenirs ne reviennent que de deux d’entre elles. Mon enfance se partageait entre la rue de l’Église et la chaussée de Waterloo. Amira nous élevait d’une main de fer et la distance entre elle et moi pouvait se comparer à un rideau de fer. Très vite, je me rendais compte que son préféré était Azziz, le bien-aimé.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bou Bounoider, auteur belge né à Bruxelles, écrit et décrit le monde qui l’entoure et qui nous est commun à tous.
Sa plume reflète son parcours atypique. Entre Bruxelles et Santiago du Chili, en passant par Los Angeles et San Francisco, ses mots ont beaucoup à nous raconter. Il pratique différents genres littéraires, du roman à la comédie, il prend le temps d’écrire des polars mais également des contes pour enfants, des chansons, des sketches et des spectacles. De ses nombreuses rencontres avec le genre humain naissent des histoires pour tous.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Préambule
Encore dans mon dernier sommeil, je sentais le soleil illuminer la pièce et sa chaleur me picorant la peau. Quel délice d’émerger de cette léthargie dans de telles conditions de bien-être ! La cerise sur le gâteau, c’était lorsque maman venait me réveiller !
– Bonjour mon cœur !
– … (je me réveillais)
– As-tu bien dormi ?
– Bonjour maman !
Clémence me faisait toujours une batterie de douceurs et de câlins au réveil et j’adorais ces moments privilégiés de tendresse. Elle m’enlaçait de ses tendres bras et sa longue chevelure blonde se posait sur moi, tel un plumeau, pour prendre le relais de la couette. Nos longues vacances permettaient ces réveils affectueux et nous prenions un petit-déjeuner avec papa et mes frères déjà en train de nous attendre sur la terrasse. Tous les trois étaient déjà assis à table et j’arrivais comme un prince dans les bras de notre reine, sous leurs yeux et leurs sourires nous invitant à nous joindre à eux. Nos chiens, de magnifiques goldens retrievers, profitaient des premiers rayons de soleil. Leur queue battait en signe de contentement à nous voir tous réunis. La piscine, devant nous, scintillait sous le soleil et attendait nos plongeons et nos jeux aquatiques. Encore une journée agréable à passer en famille et avec des amis dans les rires et la bonne humeur. Une vie agréable où le bonheur était fait de petites choses quotidiennes retrouvées dans l’amour de mes proches.
Je me réveillais sur ce rêve de bonheur inaccessible pour le petit bonhomme que j’étais. Je ne m’appelais pas mon cœur. Les chiens n’étaient qu’illusions comme tout le reste du rêve. À la place de la piscine étincelante, il y avait juste des marais sombres et périlleux à traverser ma vie durant à la constante recherche du bonheur.
Prologue
Qu’est-ce donc le bonheur ? Je m’appelle Sacha. Je suis né à l’issue d’un voyage d’immigration, porté tel un supplément de bagages dans le ventre de ma mère. Je vécus ce périple de l’intérieur comme un clandestin privé de soleil tant réclamé par la couleur de sa peau.
Ce voyage était lié à une vague d’immigration qui apportait en Europe une main-d’œuvre supplémentaire pour son industrie en pleine expansion. Les immigrés rêvaient d’un Eldorado aux immenses richesses et aux mille délices. Ils découvraient à leur arrivée une tout autre réalité. Ils acceptaient faute de mieux, des emplois manufacturiers ou de services sans soleil à la clé.
Ma mère avait suivi ce courant vers la terre promise. D’origine inconnue, elle était une petite orpheline prise en charge par une famille berbère. Elle hérita du nom d’Amira, signifiant en berbère : princesse. Une belle histoire sortie directement d’un conte des mille et une nuits. Sa famille adoptive vivait dans un décor féerique. Amira avait l’étoffe d’une vraie princesse. Elle était forte, combative, résistante et courageuse. Il ne lui manquait qu’un royaume et un prince charmant.
Elle abandonna sa famille d’adoption au moment où elle le rencontra. Elle renonça aux produits fermiers et aux hauts plateaux marocains du Rif. Elle quitta ainsi à tout jamais ses parents adoptifs laissant derrière elle les immenses montagnes de l’Atlas dont les neiges éternelles faisaient oublier le climat méditerranéen du nord du continent africain. Ces hautes cimes blanches étaient prisées par les touristes fortunés venant souiller cette surréaliste carte postale en gênant la vie naturelle et paisible des gens des collines. De leur vie champêtre et montagnarde, les autochtones, vivant de l’agriculture et de leur bétail, voyaient au loin les meurtrissures de leurs blancs sommets ensoleillés.
Amira et son amant disparurent mystérieusement pendant quatre années et donnèrent naissance à deux bambins. Puis, pris par une envie d’un monde meilleur, ils accompagnèrent la vague d’immigration vers une Europe prometteuse de travail et d’or. Ils s’envolèrent en laissant leur belle contrée chaleureuse pour monter plus au nord. Ils laissèrent derrière eux cette belle Méditerranée, bleue, pleine de richesses, gorgée à souhait de rayons chauds. Ils avaient survolé les terres d’oliviers et leurs barriques d’huile. Ils ne s’arrêtèrent même pas pour goûter aux fruits des vignes du pays passé maître dans l’alchimie de leur rouge et enivrant élixir. Ils arrivèrent sous les pluies battantes du plat pays, la terre promise où ils ne trouvèrent que la dure et triste réalité d’un travail difficile et insuffisant pour vivre de manière décente. Ils avaient emmené dans cette échappée, Assad le lion et Azziz l’être aimé.
Naissance
Et moi ? Savaient-ils que j’étais avec eux ? Depuis quand, avais-je participé à cette différence de température ? Depuis mon marais amniotique, j’arrivais bon dernier dans une pluie battante. L’eau engorgeait depuis des heures les ruelles de la ville. Amira était restée bloquée sous un abri de fortune attendant une accalmie. Des douleurs au ventre la tiraillaient déjà depuis longtemps. Était-ce la pluie ou les douleurs qui l’empêchaient de continuer son chemin ? Amira ne laissait rien paraître de ses émotions. Elle n’était pas du genre à s’arrêter à cause de simples douleurs. Elle ne savait pas exactement depuis combien de temps elle était enceinte, mais elle était certaine que ce n’était pas pour maintenant. Elle avait bien supporté le vol en compagnie de ses deux fils et du fœtus qui se développait en elle. Elle pouvait encore réaliser quelques efforts pendant quelques jours et ne pensait pas accoucher sous cette pluie. Le vent chassait l’eau sur cette future mère. Elle grelottait et laissait s’échapper un discret claquement de dents. Soudain, prise d’un malaise, elle se laissa glisser contre le mur. Le travail avait déjà commencé et les contractions se faisaient de plus en plus rapprochées. Se mélangeant à l’eau inondant le trottoir, un filet de sang s’échappait de sa robe et suivait la courbure des jambes pour rejoindre le flux de pluie qui ruisselait le long de la rigole. Sans exprimer de douleur, Amira contrôlait ses spasmes dans une sérénité absolue. Elle commençait à sentir une ouverture plus importante et sentait le contact de la tête progressant entre ses cuisses à peine entrouvertes. Dans une position plus étendue, ses jambes n’étaient plus à l’abri de l’humidité. Le ruissellement sanguin éclaboussé par la pluie ne formait plus un ru au courant régulier.
Attiré par ses gémissements, un vieillard s’arrêta pour porter secours à cette mise au monde anonyme. Sans perdre son calme, il s’appuya sur sa canne pour s’asseoir entre les jambes de la malheureuse. Ignorant la pluie qui tombait de plus belle, il prit son manteau et le posa au sol pour réceptionner le petit ange de la pluie. D’un geste assuré, il réconforta la femme et encouragea les mouvements permettant d’expulser de manière continue le nouveau-né. Troublé, le vieil homme portait un petit garçon entre ses mains. Dans un dernier effort, le placenta suivit. Alors d’un geste naturel, Amira rompit le lien qui les reliait depuis neuf mois et noua ce qui en restait sur le petit ventre. Alertés par ses petits cris, des passants s’arrêtèrent et appelèrent les secours. Le bébé et la maman étaient sauvés grâce à ce grand-père providentiel. Suite à cet accouchement imprévu, j’étais le dernier à passer la ligne d’arrivée d’un long voyage.
1968
Je suis né dans les bras inexpérimentés d’un vieil homme, un beau jour pluvieux de l’année 1968. Cette année baignait aussi sous les pavés des étudiants révoltés, un peu partout dans le monde. L’île Maurice devenait indépendante, Martin Luther King avait fait un rêve pour la dernière fois, les Vietnamiens étaient massacrés par centaines, l’Europe était divisée par un rideau de fer et novembre m’accueillait après un printemps situé plutôt à Prague que sous les fleurs et le soleil. Tous ces événements visaient un seul et même but, la liberté, signe sous lequel je naquis.
Nous vivions d’appartement en appartement dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles. Nous avions connu trois habitations différentes. Mes souvenirs ne reviennent que de deux d’entre elles. Mon enfance se partageait entre la rue de l’Église et la chaussée de Waterloo. Amira nous élevait d’une main de fer et la distance entre elle et moi pouvait se comparer à un rideau de fer. Très vite, je me rendais compte que son préféré était Azziz, le bien-aimé.
La télévision, les jeux de société ou le football au parc étaient nos principales activités de gamins.
Mes deux frères ne se disputaient pas ou évitaient de le faire. La confrontation était rare et comme deux promis au trône princier, ils se regardaient en chiens de faïence. Inutile dès lors d’engager une véritable boucherie où se perdraient des coups de poing, de pied et des embrassades de luttes acharnées qui déboucheraient sur un statu quo. Dans les moments de tensions, il émanait d’eux une certaine énergie qui emplissait l’espace d’un silence inquiétant, d’un calme avant la tempête, il ne faisait pas bon traîner dans les parages. Azziz ne se laissait pas commander et devait l’avoir bien fait comprendre à Assad. J’étais donc le maillon faible face à un prédateur démuni de bon sens. Son prénom le destinait à se coucher tard et se lever tard, ce qui rendait ma vie paisible pendant une bonne partie de la journée.
Moi, les pavés je les foulais de mes pieds. Bien fixés au sol, ils ne volaient plus depuis longtemps. Je courais après mes rêves et j’espérais qu’ils n’allaient pas me mener à ma perte.
La vie de famille
Avec Assad, Amira entretenait une relation intensément remuante entre revendications et désaccords. Les injures qu’ils se lançaient l’un à l’autre étaient semblables à de lourds pavés blessants. Le lion et la princesse auraient été de beaux protagonistes d’une belle histoire, s’ils n’avaient pas vécu comme deux ennemis en perpétuel conflit pour le pouvoir. Pendant son absence, la relève de l’autorité maternellement inflexible était assurée par le fauve princier. Notre princesse, entendez des lieux et pas de cœur, ne passait pas beaucoup de temps à la maison et nous laissait sous les griffes d’Assad, lequel pensait avoir carte blanche dans notre éducation fraternelle et dont le pouvoir montait vite à la tête. Tel un vizir sans son sultan, il me mettait à mort. Ces sacrifices, je les subissais sans broncher. Mais l’absence de représailles de notre mère le réconfortait dans un état d’impunité. Qu’elles étaient longues et nombreuses toutes ces journées avec mon névrosé de frère à la crinière chatoyante ! Cette chevelure, marque de virilité absolue, me causera bien des soucis.
Azziz, le cadet, était le roi du sport. Toujours accompagné d’un ballon ou d’un autre accessoire sportif, il prenait la chambre pour un terrain de jeux. Il était doué au football et revenait malheureusement souvent avec des chevilles abîmées par des adversaires peu scrupuleux qui blessaient les bons joueurs au lieu de participer à l’excellence d’un beau jeu. Il était souvent absent de la maison et ne participait donc pas vraiment à tout ce qui se passait dans notre famille. Il ne s’en inquiétait pas non plus et il était plutôt insouciant. Il avait beaucoup de succès auprès des filles. Chaque année, il changeait de petite amie. L’école ne le préoccupait pas beaucoup.
Je n’eus pas le plaisir d’être présenté à mon père. Il ne s’était sans doute pas habitué au climat de cette accueillante Belgique et opta pour un autre Eldorado. Il laissa en héritage sa place de chef de clan à Assad. Un papa inexistant, absent, dont je ne connaissais rien. Je n’avais pas de modèle de père, j’aurais aimé avoir un père sévère, un papa gaga, un papounet aux secrets échangés, un paternel éternel. Mon papa à moi avait disparu. Mais ma mère valait tous les pères du monde. Elle en avait la sévérité, la poigne et elle ne laissait rien passer. Il lui manquait toutefois cette douceur maternelle qui inondait mes rêves. Ce père fantôme ne fut pas remplacé par un autre homme, mais par deux autres qui ponctuaient cette vie orientée au féminin.
Le premier ami de la famille s’appelait Michel. Maman était sa confidente et il partageait avec elle tous ses secrets d’homme marié. Il était le père d’une charmante petite fille et le joli cœur d’une maîtresse importée du Danemark.
L’ami suivant était Pascal, d’origine italienne que je soupçonnais être amoureux d’Amira, mais dont l’âge très avancé faisait de lui notre grand-père adoptif. Il m’avait évité, comme un pavé, de tomber dans la mare, le jour de ma naissance. Pascal venait souvent terminer le dimanche à la maison. Ces deux hommes prenaient une importance majeure dans ma vie de lionceau.
Amira avait encore des amies partagées entre trois familles où les visites de courtoisie ponctuaient mon quotidien souvent bousculé. Régulièrement, nous participions à des expériences extraordinaires entre voyance, magie, superstitions et sorcellerie.
Je n’étais pas un enfant comme les autres. Je n’avais pas appris à rouler à vélo, je n’avais pas de parrain ou de tante, je ne passais pas non plus l’après-midi chez des copains. Mais j’avais érigé une carapace invisible, inébranlable qui me protégeait de tous les sarcasmes familiaux. J’avais la capacité de me réfugier dans mon propre monde où tous mes rêves, mes envies et mes projets étaient cachés avec le désir de les réaliser un jour. Mes mésaventures n’y entraient guère, mais mon blindage n’empêchait pas de les oublier pour que mes enfants n’aient jamais à souffrir plus tard d’un tel déshonneur.
Je voulais rejoindre tous ces jeunes criant leur mécontentement et réclamant plus d’égalité. Je voulais aussi plus de fraternité et plus de liberté.
Les week-ends, nous les passions sur les lieux de travail de notre mère, transformés en une immense cour de récréation. Entre religion et capitalisme, nous suivions notre cheftaine d’églises en bureaux d’entreprises. Le ménage n’avait aucun secret pour nous, aucune poussière ne nous échappait, nous étions les rois du maniement de la raclette et du balai-brosse. Je m’évadais à travers les océans du labeur, découvrant de Nouveaux Mondes et rencontrant sur ma route de fantastiques créatures que je combattais et anéantissais à chaque rinçage de ma serpillière. Ces mares anderlechtoises, sans pavés, que j’étendais pour rincer les différents sols souillés par de plus riches personnes, reflétaient mes songes.
Le trajet pour y arriver était déjà un voyage sans fin. Je prenais le tram 103 que l’on trouvait après avoir atteint la Gare du Midi par le tram 81 qui descendait toute la rue Théodore Verhaegen pour bifurquer ensuite vers l’avenue Fonsny. J’adorais m’installer au milieu du tram sur la plaque pivotante de la machine. On n’y restait jamais en place à cause de tous les virages. Je me rappelle de la belle rue Wayez avec tous ses commerces. Je rêvais d’y faire du lèche-vitrine et même d’y entrer pour admirer les belles marchandises. Elle débouchait sur la jolie place Saint-Guidon où se dressait majestueusement une magnifique église. On passait ensuite le long du Parc Astrid où il nous arrivait de jouer de temps en temps. Les grands immeubles de l’avenue Marius Renard, dressés comme des colosses, annonçaient déjà la fin du voyage. C’était notre repère pour ne pas manquer l’arrêt pour nous rendre à l’église afin de rejoindre Amira et l’aider à tout nettoyer. Il nous arrivait de faire le voyage ensemble, quand elle ne partait pas si tôt. Assad, dans ses jeux de force, eut un jour le pied écrasé par une pierre ornementale de plusieurs dizaines de kilos. Entre les jeux et les disputes, nous réalisions toutes les tâches ménagères imposées par notre sainte mère.
Le quartier De Brouckère m’était destiné, car Amira n’avait pas vraiment le temps de nettoyer tous les endroits, qui lui étaient octroyés grâce à sa notoriété de bonne ménagère. Plusieurs trams me permettaient de rejoindre la station souterraine De Brouckère et j’en débouchais par le grand Escalator, me laissant éclairer par toutes les lumières du cinéma ou bien de l’hôtel Métropole. Je passais quelques soirs en semaine pour dépoussiérer quelques bureaux dans un immeuble situé derrière le boulevard Anspach. Je fus récompensé de mes nombreux services par une enveloppe pleine de billets, trouvée au bas de cet immeuble où je nettoyais les bureaux. Ce trésor bien mérité, je l’avais caché pendant longtemps pour le dépenser à petites doses.
Les vacances
Grâce à tous ces petits boulots, nous pouvions partir chaque année en vacances. Nous les passions à la mer du Nord où nous profitions de quinze jours pour nous ioder la vie. Amira avait porté son choix sur la belle ville balnéaire de Westende où elle loua un appartement, en restant fidèle pendant dix années à la même agence immobilière, l’agence Muyle. Un souvenir marquant en est le château d’eau qui annonçait la fin d’un long périple commencé tôt le matin. Nous prenions le tram de la S.T.I.B., le train et ensuite le tram de la mer, comme on disait. Le tram de la société de LIJN nous conduisait jusqu’à ce château d’eau qui était la ligne d’arrivée clôturant notre trajet de plusieurs heures avec tous nos bagages.
Il m’arrive encore de nos jours, quand je m’échappe au littoral, de fixer longuement cette tour d’eau et de me laisser envahir par mes souvenirs du temps où, en maillot, ma peau bronzée était recouverte de plaques de sable collé et séché. Toutes nos journées, nous les passions sur la plage et dans l’eau. Armé d’un sceau et d’une pelle, je creusais ou je bâtissais des châteaux issus de mes rêves.
L’enfant qui courait
En ville, je connaissais ma commune saint-gilloise dans ses moindres détails, car j’en parcourais tous les recoins et les rues. De parcs en quartiers, de façades en vitrines, aucun endroit ne m’était inconnu. Mes connaissances géographiques s’étendaient au-delà des frontières de mon territoire. Je parcourais toute la cité au cours de mes expéditions à pied et la plupart du temps, je courais, je sprintais à perdre haleine, je cavalais en bondissant de trottoir en trottoir, de rue en rue, de passages pour piétons en rails de trams, de feux de signalisation en passages doutés. Ce domaine, mon domaine, mon champ de courses m’appartenait. J’étais rapide comme Nathaniel, le dernier des Mohicans, courant sur les chemins de la liberté, sautant des rochers, dévalant des pentes, bondissant et éclaboussant ses mocassins dans l’eau des gués. Comme lui, j’étais rapide ; comme lui, je rattrapais le temps ; comme lui, j’étais libre de courir après la liberté.
Ma recherche de bonheur éphémère résidait dans ces courses urbaines. Pour profiter d’un maximum de bonheur en un minimum de temps, je courais.
1973
1973, l’année de mes cinq ans. On parlait de plus en plus d’un Colonel Kadhafi, et celui-ci s’invita un jour à ma table. L’Afrique avait déjà faim et les Chiliens mouraient d’un coup d’État plongeant le pays et nos télévisions dans un bain de sang. Pinochet était un nouvel Hitler et les pays libres le laissaient faire. La Tour Montparnasse, qui ne se doutait pas encore qu’un jour elle deviendrait infernale, était inaugurée. Les Américains se retiraient du Viêt Nam et se préparaient à inaugurer leur World Trade Center en préparant le scandale du Watergate. La guerre du Kippour n’était pas une bonne nouvelle pour la communauté musulmane et Assad perdait son idole, Bruce Lee, me causant bien des soucis à titre posthume. Tous ces faits historiques n’altéraient pas mon premier souvenir inoubliable sur le chemin de ma destinée scolaire.
À cette époque, nous habitions au troisième étage d’un joli appartement situé au numéro 1, de la rue de l’Église. Le début de la rue se joignait à la chaussée de Forest. Notre appartement s’étendait en longueur depuis notre chambre, séparée par un palier, au reste des pièces, composées du salon, de la salle à manger et d’une cuisine. La dernière pièce était la chambre à coucher de maman. Je ne me souviens pas de nos voisins aux étages inférieurs.
Par contre, ceux qui fréquentaient le rez-de-chaussée ne m’avaient pas laissé indifférent. Il communiquait avec l’immeuble voisin dont les sympathiques occupants géraient un restaurant aux exquises saveurs grecques. Ils avaient deux magnifiques, belles, grandes et jeunes filles qui dans mes plus lointains souvenirs d’enfance furent mes premières idoles féminines faisant à chaque fois se retourner mon cœur quand je me trouvais en leur charmante compagnie. Nous passions beaucoup de temps à jouer ensemble sans jamais violer l’intimité de leur domicile. Nous restions au bas de la cage d’escalier dans le couloir reliant nos deux bâtiments. Au début, chacun restait de son côté. Elles restaient près de leur rez-de-chaussée et moi, perché sur la rampe supérieure, j’avais vraiment l’espoir de les approcher un peu plus. Nous jouions donc à distance, de peur de franchir la frontière sociale qui semblait nous séparer. Mon amour pour elles resta toujours secret. Mes seuls concurrents étaient mes frères qui avaient l’avantage de leur âge plus avancé pouvant faire la différence et faire chanceler ces deux cœurs purs helléniques. Cependant, je ne m’avouais pas vaincu et dans ce cas-là, il n’y avait pas de frères. Ma ténacité et ma patience me permirent de vaincre les barrières et nous finissions par déambuler ensemble sur le trottoir. J’étais aux anges avec mes deux déesses.
De retour à notre étage, nous dormions, mes frères et moi, dans la même chambre. Nos lits étaient pliables, ce qui permettait de profiter au mieux de l’intégralité de l’espace de notre pièce pendant la journée. En face de l’appartement se trouvaient deux grands immeubles identiques. De notre fenêtre, je m’imaginais gravir à toute vitesse les nombreuses marches des grandes tours jumelles. Elles se dressaient face à la chaussée de Forest et maîtrisaient de leur hauteur tout le voisinage. Je me voyais surgir sur le toit plat du premier immeuble et reprenant quelques instants mon souffle, me tenais au bord, surplombant toute la ville. Les mains aux hanches, j’avais une sensation de liberté et de puissance après avoir terrassé des dizaines de paliers. Je me sentais grand. Je ne m’arrêtais pas seulement là, je voulais dompter l’autre tour. Je prenais mon élan et d’un bond magistral, je m’envolais le plus haut que pouvaient m’élever mes jambes. De ma nouvelle position aérienne, je contemplais le monde au-delà de mon imagination. Je volais, j’étais léger, j’étais libre. Puis, au moment de l’impact, j’atterrissais sur le toit de la jumelle voisine… et ma tête se cognait contre la vitre de la fenêtre de ma chambre. Les deux tours étaient toujours là, devant moi, parallèles et immobiles, et sous mes pieds, le toit s’était changé en lino, celui de ma chambre.
Premier souvenir
Ce premier souvenir s’était donc construit sur cette chaussée de Forest qui fut le chemin conduisant à ma première école. Encore aujourd’hui je n’ai aucun souvenir antérieur à ce jour. La première photographie qui sort de ma mémoire est ce long chemin et cette main, celle d’Amira, serrant la mienne. Ma guide cadençait la marche difficile à suivre pour mes petites jambes. Je ne savais pas vraiment où nous allions, mais toutes les façades s’imprimaient dans mes yeux intrigués par cette sortie bien matinale. Les rues que nous traversions s’étendaient de la rue d’Andenne à la rue du Danemark qui dévoilait l’entrée principale de l’École Numéro Quatre, trônant majestueusement sur la superbe place Bethléem. Durant cette expédition dont je ne connaissais pas le but, je découvrais aussi un monde bariolé brassant des commerçants originaires des rivages méditerranéens.
Arrivé devant cette immense bâtisse, j’étais comme un aventurier découvrant un temple oublié. Ma taille se réduisait devant cette grandeur. Ce magnifique bâtiment se dressait sur sa place comme un château fort fièrement dressé sur sa roche. Un bruit effrayant me fit reprendre ma taille et mes esprits. Une traînée jaune passa non loin de là comme une boule de feu craché par les canons assiégeant une forteresse infranchissable. C’était le tram 81 de la rue Théodore Verhaegen.
À l’intérieur de ce bastion, il y avait une belle et vaste cour de récréation où trônait une tour géante en briques rouges qui transperçait les nuages. Je m’imaginais en trouver l’ouverture et serpenter en grimpant toutes les marches pour arriver à son sommet et y respirer les nuages. Ne trouvant pas de porte pour y pénétrer, j’escaladais la façade arrondie en introduisant chaque doigt et chaque orteil dans les joints vieillis par le temps de cette ascension de briques rouges. J’ambitionnais d’atteindre les nuages. J’appris avec beaucoup de déception qu’il ne s’agissait que d’une ancienne cheminée d’un incinérateur faisant partie du passé depuis bien longtemps. La salle de gymnastique était accessible par la rue Théodore Verhaegen et à l’opposé, le préau se situait du côté de la rue du Danemark.
Les photos des écoliers modèles y étaient prises. Les bâtiments des classes formaient les façades latérales. Nous aimions courir dans les beaux escaliers de l’école. Ces larges marches s’offraient sous nos sauts amortis par le chêne des paliers. La boiserie rimait avec les balustres et les contremarches en fonte. Je me souviens encore d’un autre escalier en colimaçon menant au bureau de la directrice dans lequel nous bravions l’interdiction en nous cachant pendant nos jeux d’apprentis aventuriers.
Ce premier voyage scolaire m’avait transcendé. Déjà avant de gagner cette belle architecture, mes sens s’étaient perdus près des épiceries aux mille et douces saveurs baignées par le soleil du Sud. La place Bethléem reflétait également ses couleurs chaudes grâce aux dizaines d’enfants qui y déployaient leurs jeux de tous leurs cris. Un voyage supplémentaire après celui de mon immigration amniotique. Le chemin d’un souvenir plein de saveurs faites de centaines de pavés défilant sous mes pieds. Ils avaient peut-être volé un jour de 68, mais maintenant, ils réfractaient des arômes chaleureux de cumin, d’olives, de menthe et de chorizo.
Abandon
Finalement, je me trouvais seul, abandonné par ma mère dans cet espace inconnu que je découvrais pour la première fois. J’étais enivré des images et des odeurs de ce chemin cadencé par le silence d’Amira.
Plus tard, je revivais un abandon lors d’un petit-déjeuner. C’était une journée ensoleillée. Le soleil chaud brillait depuis le matin. Cela se passait pendant des vacances scolaires. Depuis toujours, nous étions laissés seuls à la maison. Cela sonnait comme un constat. Un état de fait. Une évidence. Amira partait-elle l’esprit tranquille en nous laissant toute une journée sans tuteur ? Elle travaillait pour nous faire vivre. N’avait-elle pas peur qu’il nous arrive quelque chose d’imprévu ? J’étais encadré de mes deux frères plus âgés et que mes six années n’avaient pas à s’inquiéter. Chose exceptionnelle ce jour-là, nous avions un petit-déjeuner royal composé de petits pains au beurre. Je me souviens bien de cette tendre texture et de l’épaisseur aérée du petit pain entre mes doigts collés par la croûte caramélisée. Le régal avait rendez-vous avec mon palais. Au moment d’approcher mon festin beurré, mes lèvres se sont écartées de part et d’autre de cette merveille. J’étais envahi de la bonne odeur de pain frais encore tiède. Amira était allée à la boulangerie pour nous offrir ce joli festin. Après nous avoir réveillés, elle était partie travailler. Mes mâchoires se refermaient tendrement pour déchiqueter délicatement le petit pain. Maman était déjà au rez-de-chaussée, car j’entendais la porte d’entrée claquer derrière elle. Au moment de la première morsure, je laissais une dent dans la mie et ceci me figea de stupeur. Cette paralysie momentanée m’avait ôté la parole et je me sentais comme prisonnier d’une force invisible qui m’empêchait d’agir. Mes larmes coulaient, non pas de douleur, mais à cause du manque de solution. Tout à coup, je réalisais que la seule personne pouvant venir à mon secours était en train de fouler le trottoir d’en face. Je sortis de ma torpeur pour ouvrir la fenêtre et exprimer ma douleur dentaire. Malheureusement, celle en qui je croyais encore était déjà loin et mes appels de détresse ne l’atteignaient pas et s’évanouissaient dans les airs. Elle me laissait entre les mains de mon Pinochet personnel avec lequel j’avais peur d’alimenter les actualités déjà désastreuses de l’époque. Ce fut mon dernier regret d’abandon. Cette première dent et celles qui suivirent étaient déposées sous mon oreiller le soir et se changeaient miraculeusement le matin en pièce de monnaie.
Marie
J’étais abandonné pour la première fois, dans un nouvel espace inconnu où deux rangées d’arbres formaient une haie d’honneur pour saluer ma joyeuse entrée. Très vite, je m’habituais à cet espace et les arbres se dressaient pour saluer mes relais héroïques. Pour cette première rentrée, une sensation envahissait tout mon corps. Je ne courais pas, ça courait en moi. Mon deuxième coup de foudre explosa en moi en un vrai bouquet aromatisé d’un doux parfum quand ma maîtresse s’approcha. Une odeur d’amour m’adressa la parole.
– Bonjour Sacha, es-tu le frère d’Assad et Azziz ? Tu leur ressembles.
– Oui, madame.
– Je m’appelle Marie.
Et elle me donna une main que je ne lâchais pour rien au monde. Je n’avais pas besoin de lui demander sa main, je l’avais. Ma maîtresse… s’appelait Marie. Je répétais, dans ma tête, cette belle phrase, indéfiniment. Le mot Marie résonnait en moi comme des battements de cœur. Elle le faisait battre en chamade. Notre relation était passionnelle. Elle était belle et j’étais tombé amoureux dès cette première rencontre. J’entretenais avec elle un amour platonique. M’aimait-elle comme je l’aimais ? En tout cas, elle m’aimait, bien. C’était certain. Nous avons partagé quatre belles années de complicité. Sa chevelure mi-longue, noire et lisse entourait un visage d’une extrême candeur. Je n’avais pas d’idée de mariage avec ma maîtresse, mais je voulais passer du temps avec elle. Très vite, je déchantais, car un autre homme partageait sa vie et quelques années plus tard, leur union donnait naissance à un petit garçon. Était-ce cette rupture qui dicta mon attitude en classe ? J’aspirais à perturber le bon déroulement du travail scolaire. J’attirais trop souvent l’attention par mes bouderies.
– Encore à bouder Sacha ?
Quel phénomène me poussait aussi à entrer dans des crises extériorisant ma colère ? Le seul remède à mes manifestations troublantes me conduisait à la douche froide. Marie me conduisait manu militari sous le robinet de la classe assez haut perché sur le mur pour m’y bloquer et passer toute une partie de mon corps pour en arroser ma grosse tête. Au début, c’est sûr, je revenais vite à la raison et mes idées s’éclaircissaient rapidement. Il était évident que cela me calmait instantanément. Ces séances répétitives de douche froide ne me firent plus à la longue ni chaud, ni froid. La douche entière, en habit, était l’unique solution à mes hystéries explosives. Un vestiaire équipé de douches m’attendait comme une sentence chaque fois que nous nous rendions au cours de gymnastique.