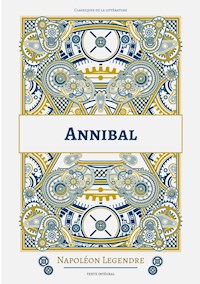14,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
En parallèle à sa profession, il porte un intérêt marqué pour la littérature et le journalisme. Entre 1870 et 1871, il publie une série de textes intitulée Chroniques de Québec dans le journal L'Événement. En 1877, Napoléon Legendre fait paraitre ces même chroniques dans son recueil en deux volumes Échos de Québec. De 1873 à 1875, il collabore au Journal de l'Instruction publique à titre d'assistant rédacteur. Il y publie des courtes histoires éducatives qu'il rassemblera en 1875 dans l'ouvrages À mes enfants3 Au début des années 1890, il collabore également à la revue Canada Artistique éditée par Aristide Filiatreault. Durant sa vie, il s'adonne ainsi au journalisme amateur en faisant paraitre des chroniques dans divers périodiques, dont L'Électeur, Le Soleil, et L'Opinion publique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Napoléon Legendre
Contes et nouvelles
table des matières
Première partie Le voyageur
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Deuxième partie Les vingt sous de Gabrielle
Troisième partie Monsieur Saint-Georges
Quatrième partie L’encan
Cinquième partie Travail et talent
Sixième partie Les déceptions de Jacques
Septième partie Le collier bleu de Mariette
Huitième partie Corinne
Chapitre 1
Chapitre 2
Neuvième partie Jean-Louis
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Dixième partie Paul et Julien
Première partie Le voyageur
Chapitre 1
A quelques lieues en deçà de la frontière des États-Unis, dans le comté de Shefford, se trouve un petit lac aux flots bleus, perdu dans la forêt. Ce lac, ou plutôt cet étang, comme son nom l’indique d’ailleurs, RoxtonPond, occupe un espace d’environ trois milles de circonférence, boisé de tous les côtés, et n’a, pour toute issue, qu’une petite rivière, ou mieux un ruisseau qui a conservé son nom sauvage de Makouke.
Rien de plus pittoresque, au clair de lune, que cette nappe unie, reflétant dans ses eaux dormantes les sombres bois qui l’entourent.
Aujourd’hui, l’endroit est colonisé ; un petit village s’est élevé à l’embouchure de la petite rivière qui alimente plusieurs manufactures florissantes. La hache infatigable du colon a déjà fait des percées qui laissent apercevoir, çà et là, le miroir du lac. Le bruit commence à se faire autour de ces solitudes poétiques que le souffle envahissant de l’industrie transformera bientôt en un foyer de fiévreuse activité. À mesure que le village augmente, la nature y perd de ses sauvages beautés, et le caquetage des commères remplace la chanson du chasseur et le bruit de sa pagaie qui seuls éveillaient les échos du lac.
Il y a trente ans, cependant, Roxton Pond était encore une solitude, où trois ou quatre colons seulement, plus hardis que les autres, avaient élevé leur log house, au milieu de la forêt. Le printemps, toutefois, cette petite colonie s’augmentait d’une dizaine d’habitants des bas qui venaient, au commencement d’avril, passer une quinzaine dans le bois pour faire les sucres.
Ce territoire était alors composé, en partie, de lots blancs c’est-à-dire de terres qui étaient censées n’avoir pas de propriétaires, et sur lesquelles le premier venu, pouvait à un moment donné, s’établir, pour exploiter, soit les bois francs, en y faisant du sucre et du sel de potasse, soit les pruchières où les cédrières en y faisant de l’écorce ou des perches. Plusieurs même s’établissaient définitivement sur un lot blanc, quitte à l’acheter plus tard du propriétaire, si jamais ce dernier se présentait.
Or, en l’année 1846, le nommé Joseph Jean était venu s’établir de bon printemps, sur un de ces lots blancs, dans une petite cabane en troncs d’arbres, bâtie en pleine forêt, à quelques arpents du lac. Jean était un cultivateur ruiné des anciennes paroisses.
Nous avons, Dieu merci, de belles et bonnes qualités, mais nous avons aussi, et malheureusement, de grands et de sérieux défauts. L’un de ces défauts, le principal, est l’entêtement dans la routine, et une horreur inexplicable pour tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une amélioration. « Mon père a fait ainsi, je dois faire de même. » Quand un de nos cultivateurs a lâché cette phrase suprême, c’est son dernier mot, sa raison finale, il n’en revient plus.
Ainsi, vous voyez une foule d’ habitants, qui, depuis trente, quarante, et même cinquante ans, sèment toujours le même grain dans la même pièce de terre, et mettent leur mauvaise récolte sur le compte des mauvaises années, quoi que vous puissiez leur dire au contraire. D’autres labourent avec un couteau à la charrue, dans les terrains pierreux, ou feront des planches de six pieds de large, dans les terres élevées et bien égouttées, où des planches de trente pieds leur donneraient moins d’ouvrage et plus de profit. D’autres enfin, au lieu de mettre les pierres de chaque côté du champ et en faire une muraille sèche, ce qui est d’une grande économie sans guère plus d’ouvrage, s’obstineront à les mettre en tas au milieu du champ, et à labourer chaque année autour de cet obstacle grossissant, avec une constance désespérante. Indiquez-leur l’amélioration, tâchez surtout de la leur faire adopter : autant vaudrait leur parler de marcher sur la tête.
Joseph Jean était malheureusement un de ces hommes encroûtés.
Possesseur d’un bien considérable, mais à demi épuisé par une mauvaise culture il avait toujours persisté à suivre la vieille routine ; et la récolte, de mauvaise qu’elle avait été d’abord, avait fini par devenir à peu près nulle. Comme, cependant, sa femme et ses deux grandes filles, moins routinières que lui, avaient adopté toutes les améliorations survenues dans les robes, les ombrelles et les chapeaux, il arriva ce qui arrive toujours : la chandelle, brûlée par les deux bouts, s’éteignit d’elle-même. Les chapeaux de haute couleur et les jupes à volants, au lieu d’attirer les maris, ouvrirent la porte aux hypothèques. Une fois qu’un cultivateur est réduit à emprunter, généralement, c’est un homme fini.
La terre de Joseph Jean fut vendue. Il prit alors le chemin du bois : triste fin pour les chapeaux à plumes des deux filles Célestina et Adamanta, et pour le superbe castor du fils unique Adjutor. Joseph Jean ressentit durement le coup qui le frappait ; mais il refoula les larmes du découragement prêtes à jaillir, et fit bonne contenance en face du malheur.
— Il est pénible, se disait-il, d’être mis dans le chemin à quarante-cinq ans ; mais avec du courage, et surtout avec l’aide de Dieu, je pourrai peut-être arriver à me tirer d’affaire.
Il y avait six mois qu’il était établi sur son lot, à Roxton Pond, le soir du deux novembre, où nous prenons la liberté de faire pénétrer notre lecteur sous son modeste toit.
Durant l’été, Jean et son fils avaient abattu trois ou quatre arpents de bois et avaient vendu du sel de potasse pour une valeur de quatre dollars.
On ignore peut-être ce qu’était alors cette petite industrie. Le colon choisissait un endroit bien fourni en bois francs. Il en abattait les arbres qu’il réduisait en cendres. C’est avec ces cendres que se fait le sel qu’il fallait aller vendre à neuf milles, et souvent à quinze ou vingt milles de l’endroit, aux commerçants qui en font de la perlasse.
Le colon faisait ce trajet à pied, à travers les bois, avec une auge remplie de sel, sur la tête. Le voyage durait de deux à trois jours et ne rapportait que quelques chelins.
Pendant ce temps, la famille se nourrissait de fruits et de gibier, l’été ; mais l’hiver, on jeûnait de deux jours l’un, et souvent on n’avait pour toute nourriture qu’une fort vilaine soupe faite avec des bourgeons de liard ou de bois-blanc.
La famille de Jean, cependant, avait été un peu moins à plaindre.
Autour du lac, les fruits et le gibier abondaient, et c’était une ressource précieuse pour les temps de gêne, qui forment la plus grande partie de toute l’année.
Les finances de Joseph Jean, néanmoins, étaient loin d’être prospères, et il voyait s’approcher, avec une certaine anxiété, la rude saison de l’hiver, pendant laquelle les fruits manquent, et la chasse rapporte peu.
Or, le soir du deux novembre, comme nous l’avons dit, la famille était réunie autour du poêle en tôle qui occupait le centre de la maison, et Joseph Jean fumait mélancoliquement sa pipe de terre cuite, pendant que sa femme, assise sur une pile de bois, s’occupait à raccommoder le linge de la maison.
Il était huit heures.
Au dehors, il faisait nuit noire, et une pluie froide, poussée par un vent violent, battait avec fureur contre la porte mal assujettie.
Les grands arbres craquaient sous l’effort de la bourrasque et mêlaient leurs plaintes monotones à tous les bruits sinistres du dehors.
Tout à coup, la porte s’ouvrit, – dans ces modestes demeures, on entre presque toujours sans frapper, – et un homme pénétra dans la maison, en refermant vivement la porte derrière lui.
— Tiens ! c’est Grignon, dit Jean, qui avait relevé sa tête ; entre, mon ami, et viens te réchauffer un peu. Quelles nouvelles ?
Grignon était le plus proche voisin, demeurant à un mille sur la route.
— Il fait un temps de chien, dit-il, en secouant son bonnet tout trempé ; ce n’est pas de refus ; car le poêle s’endure, ce soir.
Il prit une bûche, et s’assit dessus, près du feu.
— Hum ? dit-il, tout en bourrant et allumant la pipe traditionnelle, des nouvelles, il n’y en a pas beaucoup ; seulement que je voudrais nous voir rendus au mois d’avril ; l’hiver s’annonce dur.
— C’est justement, ce que me disait, tout à l’heure, ma femme Hélène, fit Jean ; il y a bien du pauvre monde qui va souffrir. Encore, si le sel pouvait payer un peu ; mais en hiver, on n’en fait pas beaucoup, et on ne va pas le vendre comme on veut.
— Les deux gars de Michel à Pierre partent de demain en quinze pour les hauts. On dit qu’il va se faire bien du bois, cet hiver, à Bytown, et qu’il y aura de l’argent à gagner.
— Oui, oui ; j’ai entendu parler de ça, dit Jean, pas plus tard qu’hier, par le p’tit Cabana qui a envie d’y aller. Il paraît que les bourgeois veulent faire gros d’ouvrage. On parle de dix piastres par mois, avec la nourriture.
— Les petits Michel m’ont dit douze ; mais dix est déjà beau ; quoique, au fond, c’est rudement gagné. Même que j’étais venu pour vous dire un mot, quoique ma bonne femme soit contre.
— Et elle a bien raison, dit Hélène, en s’approchant ; pour les jeunesses, passe ; mais pour les gens de votre âge, c’est pas un métier.
— Voyons, voyons, la femme, dit Jean, d’un ton doux, c’est pas un plaisir ; mais faut vivre, ça c’est une chose sûre.
— Moi, j’aime mieux plutôt aller travailler dans les facteries, dit Adamanta.
— Et moi aussi, dit Célestina ; ça fera deux bouches de moins, et on gagne gros par là…
— Pas toujours tant que je vivrai, interrompit Jean. Il en part plus sages qu’il n’en revient. Et puis, d’ailleurs, qu’est-ce que dirait Pitre, s’il te voyait partir pour là-bas ?
Adamanta, à qui s’adressait cette dernière remarque, rougit jusqu’aux yeux et pencha la tête sur son ouvrage.
Les deux hommes se mirent ensuite à l’écart et parlèrent longtemps. La nuit était fort avancée et toute la famille était couchée lorsqu’ils se séparèrent.
Joseph Jean avait été reconduire Grignon jusqu’en dehors du seuil.
— Ainsi, dit ce dernier, en donnant une poignée de main à Jean, c’est entendu ; quoi qu’en disent les femmes, je puis compter sur tout.
— Tu as ma parole, et tu sais ce que ça vaut.
Grignon s’éloigna en sifflotant, et Jean alla se coucher sur une peau de buffle, près du poêle dans lequel il mit une bûche de hêtre sec.
Chapitre 2
Quinze jours après, Joseph Jean et Grignon, accompagnés de Pitre et d’Horace, les deux fils de Michel à Pierre, après avoir fait leurs adieux à leurs familles, laissaient Roxton Pond et descendaient, à travers les bois, par la route de pied qui conduisait au Grand-Maska (Saint-Hyacinthe).
Il était neuf heures du matin.
Le temps était froid et sec, et une légère couche de neige, tombée durant la nuit, couvrait partout le sentier.
Les quatre hommes, portant chacun ses hardes et ses provisions de voyage sur l’épaule, dans un petit sac passé au bout d’un bâton, marchaient allègrement, en causant des chances de leur expédition.
À cause des détours qu’ils devaient faire, ils avaient au moins huit lieues pour se rendre au Grand-Maska, où ils comptaient arriver sur les six heures du soir.
À deux heures ils atteignirent le village de Saint-Pie, qui se trouvait sur leur route.
Ils entrèrent dans une petite auberge pour se reposer un peu et manger un morceau.
Pendant qu’ils prenaient tranquillement leur repas sur un banc, près de l’immense poêle à deux ponts qui occupait le centre de la salle, la porte s’ouvrit brusquement pour livrer passage à un nouvel arrivant.
C’était un homme de six pieds, gros et carré en proportion.
Il portait un habillement complet en étoffe du pays, et ses reins étaient serrés par la traditionnelle ceinture fléchée du voyageur canadien. Sa barbe noire, à tous crins et ses cheveux de même couleur, plantés dru et un peu crépus, donnaient à sa physionomie un air dur et même féroce.
Il entra sans cérémonie, déposa son sac et son bâton dans un coin et demanda un verre de rhum, avec l’accent d’un homme accoutumé à se faire obéir.
— Ah ! ah ! du monde des hauts, dit-il en avisant nos quatre voyageurs ; bonjour ces m’sieus ! Ma’m Friquet ! cinq verres de rhum, puisqu’il y a des amis ; c’est moi qui régale ; et vous, mes vieux, j’espère que vous ne me ferez pas celle de me brûler la politesse.
— Ça n’est pas de refus, dit Grignon, qui avait déjà voyagé et qui connaissait les usages ; d’autant plus que le pain n’est pas mou comme du pain bénit.
— Et où donc que vous allez, comme ça, mes vieux ? dit l’homme après que les verres furent vides.
— Dam ! pas mal loin ; on se rend à Bytown.
— Pas possible ! Dans ce cas-là, nous allons faire route ensemble. Avez-vous un bourgeois ?
— Pas encore ; mais il paraît que l’ouvrage ne manque pas.
— C’est égal ; c’est toujours mieux d’avoir son homme d’avance. Voulez-vous travailler pour mon boss ?
— Qui ça ? vot’boss.
— Un homme propre, je vous en réponds, aussi vrai que je m’appelle William Lafarge ; ça n’est pas trop dur au pauvre monde, et ça paye comme un Anglais. Tel que vous me voyez, je suis un de ses foreman ; et les bons hommes sont bien traités. M’am Friquet me connaît pour un homme qui ne ment pas.
— Je ne dis pas non, dit Grignon ; seulement, il faut que j’en parle avec mes amis et qu’on voye les prix. Et puis, si nous faisons la route ensemble, il y aura toujours moyen de s’arranger.
— À votre aise, dit Lafarge ; pensez-y ; j’aime les gens qui soignent leurs affaires et qui ne brodent pas leur nom sur un papier, sans voir ce qu’il y a au-dessus.
Une demi-heure après, les cinq hommes reprirent ensemble le chemin du Grand-Maska, où ils arrivèrent sur les sept heures et où ils se couchèrent.
Bref, huit jours après, nos quatre amis entraient dans la petite ville de Bytown, toujours sous la conduite de Lafarge, lequel, en route, les avaient bien et dûment engagés au service de son bourgeois, Jeremiah-John-James Fusting, à raison de douze piastres par mois ; ce qui faisait dire à Grignon qu’il n’y a rien comme un marché fait en marchant.
Que voulez-vous, Grignon passait pour un homme spirituel ; il fallait bien qu’il fît honneur à sa réputation.
Du reste, Lafarge avait été parfait à l’égard de ses recrues ; et, pendant le voyage, sa présence leur avait souvent épargné de sérieux embarras.
Lafarge les conduisit dans une auberge de la rue Rideau, où, à leur entrée, ils trouvèrent une nombreuse compagnie.
Il était sept heures du soir, et nos gens avaient faim.
Lafarge, après avoir salué l’honnête assistance, s’approcha de l’hôte qu’il semblait connaître depuis longtemps, et demanda à souper pour cinq.
— Le souper n’est pas encore fini, dit l’hôte, passez dans la salle, vous trouverez tout ce qu’il faut.