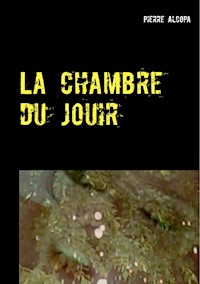Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mourir à la toute-puissance immémoriale des images, pour renaître du plus profond de soi sous le soleil de la vérité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur n’est pas le mieux placé pour les corrections. Aussi demande-t-il au lecteur à l’œil sagace un peu d’indulgence.
Garde toujours dans ta main la main de l’enfant que tu as été.
Cervantès
Sommaire
PARTY-GIRLS ONE
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
PARTY-GIRLS TWO
Chapitre 1
Libre je suis
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
MARE TRANQUILLITATIS
PARTY-GIRLS THREE
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Halètements d’un train à vapeur dans la nuit tendre. La palpitation de la lumière animait sur le plafond d’une chambre d’enfant l’image vaporeuse d’une longue fenêtre à rayures horizontales. La cadence régulière du train s’éloignait à mesure que la fenêtre aux contours fondus glissait se dissoudre dans l’angle obscur d’un mur. L’embrasure de la porte de la chambre se découpait sur un couloir flavescent, faiblement éclairé par le luminaire d’une autre pièce. Ombre furtive d’un homme dans le couloir rouge sang. Sons d’un corps féminin se mouvant dans la salle de bains : crissement du grand zip d’une paire de bottes en cuir brut ; chuintement des bas de soie végétale sur la peau ; craquements des articulations ; bruissement de la robe de tergal ; froufrous des sous-vêtements en tulle. Douces sonorités rendant sensible, les yeux grands fermés, la texture duveteuse de la peau d’une silhouette féminine, maintenant nue, se faufilant à la suite de l’homme dans la chambre à coucher mitoyenne à celle de l’enfant. Sans bruit, la porte se refermera à clef.
L’enfant regardait le mur sombre mitoyen derrière lequel le silence geignait aussi fort que cette étrange douleur qui naissait en lui : la jalousie.
Tard dans la nuit, dans l’embrasure de la porte de la chambre de l’enfant, petit à petit, se recomposait la silhouette de la femme nue, chevelure cuivrée remontée sur le haut du crâne, chignon habilement torsadé qui tenait avec une seule épingle coudée.
— Tu ne dors toujours pas mon fils ?
Pierre répondait non. La silhouette s’approchait doucement. Mouvement de bascule des hanches. Cris d’un train à vapeur dans la nuit. Les lattes de la fenêtre ondulaient sur le corps. Sur le plafond s’écoulait l’ombre dédoublée de la mère. Elle se penchait vers Pierre. Elle lui parlait, tandis que le train s’éloignait dans la nuit, tendre rumeur superposant à sa voix comme une autre voix. Pierre sentait s’exhaler de la bouche de sa mère – dans l’obscurité, ses lèvres fines paraissaient noir d’encre – l’haleine d’une autre personne. Il en éprouvait du dégoût.
— Tu sais, lui disait sa mère, si un jour, en allant aux toilettes, tu vois couler du sang, il ne faudra pas t’en inquiéter. Ce sera normal, car tu grandis.
En regardant sa mère qui lui parlait doucement, Pierre avait la sensation de voir en filigrane sur son visage celui d’une autre femme, un visage plus âgé, double figure qui s’approchait de lui pour l’embrasser sur la bouche. Sa mère lui murmurait qu’il fallait dormir maintenant, sinon, demain, il ne pourrait pas se lever pour aller à l’école. Puis elle ajouta qu’elle était trop fatiguée, ce soir, pour qu’il dormît avec elle : il bougeait beaucoup trop dans son sommeil. Derechef, elle voulut l’embrasser sur la bouche ; mais Pierre esquiva son geste. Alors elle lui baisa la joue, très fort, puis se retira. Pierre la regardait s’éloigner irrémédiablement de lui. Gêné, il détournait ses yeux de la large croupe bosselée de sa mère. Après qu’elle eut éteint la salle de bains, Pierre entendait le son mat de ses pieds nus sur le carrelage du couloir.
C’était désagréable d’être pris pour un idiot par sa mère. Pierre avait très bien compris que sa fatigue n’était qu’un mensonge derrière lequel se dissimulait l’homme qu’elle avait décidé de mettre dans son lit cette nuit-là. Et elle n’aurait pas besoin de lui dire, le lendemain matin, que cet homme qu’il avait entr’aperçu dans son lit en allant aux toilettes, cet homme tout de noir vêtu, c’était juste un ami qui se reposait. Car il savait très bien, malgré son jeune âge, ce qui se passait entre un homme et une femme dans une chambre à coucher : à l’intérieur du tiroir de l’armoire de sa mère, il avait découvert, parmi les entrelacs d’un sautoir de perles fines, une petite bague en argent au chaton finement ciselé en forme d’une femme et d’un homme nus, enlacés par l’étreinte sexuelle – cela avait été pour lui une découverte essentielle, une révélation, comme plus tard la découverte de la masturbation, avec cette étrange impression fugace, brutalement émouvante, de retrouver la mémoire d’un temps perdu depuis peu.
Pierre avait sorti de dessous son oreiller un magnétophone à cassettes, avec lequel il avait enregistré L’Oiseau de Feu. Lorsqu’il avait étudié en classe cette œuvre, des flots impétueux d’images fantastiques avaient surgi en lui. Cette musique lui donnait accès à d’autres mondes. Un jour, alors que le téléviseur était allumé sur l’image d’une pendule en forme de spirale infinie (sa mère allumait toujours la télévision une demi-heure avant le début des programmes de midi), reconnaissant l’air de L’Oiseau de Feu, Pierre s’était précipité dans sa chambre pour prendre son magnétophone. Le cœur battant, le micro plaqué contre le haut-parleur en façade du téléviseur, il écoutait attentivement chaque note de musique aller sauvagement se fixer à jamais – croyait-il – sur la bande magnétique qui se déroulait en couinant à l’intérieur de son boîtier en plastique bouton d’or.
La tête bien enfoncée dans l’oreiller rebrodé de ses initiales (PA), Pierre écoutait sourdre de la ouate une danse infernale. Scherzo ! Il s’abandonnait dans les bras des princesses qui lui chantonnaient au creux de l’oreille :
Être comme sa mère
Saigner comme une femme
Saigner comme la mère
Être comme une femme
N’aie pas peur, Pierre Pierre
Le voyage commence…
Une immensité noire. Le noir de l’origine. Peu à peu, des étoiles… des centaines… des milliers de milliards d’étoiles d’intensité variable… L’une d’elles grossissait, devenant beaucoup plus brillante à mesure qu’elle paraissait se déplacer, créant autour d’elle un halo vaporeux irisé de chaque côté de deux minuscules étoiles, en fait deux petits phares qu’arborait un vaisseau blanc en forme de sphère tronquée à la base et percée d’un large hublot ovale. Sur les flancs du vaisseau, quatre petites fusées directionnelles, disposées en croix, lui permettaient de pivoter sur lui-même, de se déplacer de haut en bas, sur les côtés et d’avant en arrière. Le vaisseau filait à travers l’espace à plus de 28 000 km/h.
À l’intérieur du vaisseau, un astronaute, engoncé dans un rutilant scaphandre rouge sang, manipulait quelques touches et manettes, tout en contrôlant des données chiffrées que des écrans lui affichaient. La visière de son casque reflétait tous les voyants lumineux du tableau de commande, créant sur son visage des sortes de maquillages primitifs qui variaient selon les parties du tableau qui s’activaient. Des bruits électroniques crépitaient. L’oxygène, qui alimentait la cabine et le scaphandre, chuintait en continu. L’astronaute, véritable Homo-Spatialis, paraissait faire partie intégrante de cette bulle de très haute technologie. Seule sa respiration, calme et rauque, rappelait son origine animale. Stoïque, tantôt il regardait droit devant lui l’immensité étoilée à travers laquelle son vaisseau filait ; tantôt il scrutait tel ou tel écran de contrôle, afin d’ajuster de nouveaux paramètres en pianotant sur quelques touches lumineuses. Ainsi occupé, sa dépense d’énergie ne dépassait pas 52 kcal/h.
Une inquiétude venait peu à peu assombrir le visage monolithique de l’astronaute. Ses sourcils épais se fronçaient. Son regard noir se fixait avec intensité sur une petite chose lumineuse, mais imprécise, qui se déplaçait doucement, perdue dans l’immensité étoilée. Une alerte s’alluma sur le tableau de commande. Une alarme se mit à hululer. L’astronaute regardait nerveusement chacun des écrans de contrôle. L’un d’eux affichait un point d’interrogation blanc sur fond bleu azur. Le tableau de commande clignotait de partout, comme affolé. À travers le hublot, l’astronaute voyait que le vaisseau, malgré les paramètres qu’il entrait dans son ordinateur quantique de bord, allait droit vers la chose lumineuse. Et à mesure que le vaisseau s’en approchait, la chose dévoilait ses formes. Frappé de stupéfaction, l’astronaute ne cillait plus. Les formes qui se révélaient doucement à lui, dans un bain de lumière crue très blanche, étaient celles d’un corps humain gigantesque.
Une multitude de points d’interrogation de toutes les couleurs clignotaient sur les écrans de contrôle avec précipitation, projetant des spectres d’angoisse animale sur le visage pétrifié de l’astronaute. Incapable de réagir, il laissait son vaisseau s’approcher lentement de ce corps humain géant, et dont les formes se révélaient être féminines. L’astronaute en était certain : il avait vu sur les écrans du loisir des corps féminins – certes surréels, car miniaturisés, découpés et cadrés pour en faire des images. Mais il était sûr de ne pas se tromper : ce corps était bien celui d’une géante. Et cela n’était pas une hallucination, puisque l’ordinateur réagissait en lui balançant des points d’interrogation dans les yeux et des alarmes dans les oreilles – à en devenir sourd et aveugle.
À l’aide de ses petites fusées directionnelles, le vaisseau évoluait lentement au-dessus du ventre, vaste plaine où les petits seins se dressaient comme des montagnes sauvages. Puis il obliqua sur un côté, et se retrouva sous le dos à suivre les pointillés osseux de la colonne vertébrale, jusqu’à l’opulente croupe, remontant ensuite face à la vulve, les puissants phares éclairant à travers la broussaille noire la béance rouge humide. L’astronaute enfonçait nerveusement les touches lumineuses. Mais le vaisseau ne lui répondait plus. De lui-même il survolait le visage de la femme, se dirigeant vers l’un de ses grands yeux pers, puis pénétrant à l’intérieur pour se perdre dans la vaste pupille. Et le noir le plus noir enveloppa le vaisseau.
PARTY-GIRLS ONE
1
— Pourquoi vous me matez comme ça ? s’écriait une jeune femme enveloppant sa nudité de latex dans un peignoir bleu turquoise.
— Parce que c’est mon travail ! répondait Pierre Aporia, l’enfant-homme, l’œil prédateur dissimulé derrière une grosse caméra Kalos Haute Définition, cette machine à disséquer le monde et le Temps.
Pierre Aporia venait de filmer – sans conviction aucune – un plan général d’une scène de lit, comme on disait par euphémisme dans le métier. Bien que le rapport sexuel fût totalement simulé – mêmes gestes, mêmes gémissements inlassablement répétés et filmés, sans que les acteurs fussent ensemble en dehors des plans larges (la scène comportait au total 43 plans) –, à la demande de Pierre Aporia, et pour des questions tout à la fois éthiques et artistiques, l’intimité de la jeune femme (Pierre Aporia avait choisi cette actrice pour de mauvaises raisons : ses grands yeux de biche et sa gouaillerie lui avaient rappelé sa jeunesse et sa passion-chaste avec une fille de sa Cité populaire) était protégée par un pourpoint de latex chair, reproduisant dans les moindres détails une généreuse poitrine aux larges aréoles sombres, un petit ventre rebondi, un sexe violâtre et buissonnant, des fesses pleines, des cuisses fuselées et satinées, un corps plus vrai que nature duquel les yeux les plus sagaces (trente paires d’yeux régnaient sur le plateau du tournage) pouvaient y discerner duvet, vergetures, plis, veines, fossettes cellulitiques et gouttes de sueur. Le partenaire masculin arborait un maigre corps de latex, imberbe et bien membré (l’organe brun-rouge avait l’étrange aspect grenu et veiné d’un objet contondant paléolithique, le méat obscur excrétant de violentes protubérances au teint d’albâtre). L’acteur portait une paire de lunettes à la monture noire et carrée, et dont les verres avaient été traités afin de refléter le visage et le corps de l’actrice lorsque la caméra était sur lui.
Les techniciens s’activaient à préparer le plan suivant : contre-champ du précédent très complexe, car l’on devait avoir, en premier plan, le lit d’acier chromé sur lequel le couple copulerait, et, dans la profondeur de champ, une large baie où ruissellerait du sang, ainsi que sur les buildings de carton-pâte se découpant sur une brume orangée d’hydrocarbures. Durant cette longue mise en place, la rumeur avait circulé que, lors de la prise de vue précédente (plan d’ensemble sur la femme de dos, accroupie sur l’homme, avec l’image murale noir et blanc, à la tête du lit, d’une explosion atomique), et malgré leurs combinaisons de latex, « les deux comédiens l’avaient fait pour de vrai ».
— Qu’ils ont fait quoi ? lançait Pierre Aporia, avec agressivité, à la femme qui se trouvait tout soudain près de lui.
Vexée, celle-ci se détourna pour dissimuler ses joues qui s’empourpraient. Honteux de sa réaction impulsive, Pierre Aporia lui disait :
— Pardonnez-moi… Je suis fatigué, fatigué… fatigué…
La femme se retourna et se rapprocha, doucement, pour lui donner un baiser sur la joue. L’empreinte sanguine de ses lèvres charnues luisait sur la peau garnie de poils gris, soyeux et fins.
— Tu en auras besoin, murmurait-elle en s’éloignant dans le décor de carton-pâte.
Elle portait une jupe droite mi-cuisse semée de grosses fleurs bleu turquoise sur fond carmin, et qui lui moulait au plus près sa croupe large et rebondie. Sa silhouette ondulante fondait dans l’obscurité d’une partie des coulisses du décor. Un rai de lumière, provenant d’un projecteur qu’un technicien manipulait, détourait du fond noir glacial sa chevelure aux belles boucles blondes. Pierre Aporia ne se souvenait pas avoir déjà vu cette femme. Pourtant, il avait l’impression de l’avoir toujours connue ; de tout savoir sur elle… jusqu’à son odeur.
En écoutant son pas cadencé s’éloigner, Pierre Aporia regardait le sang épais s’écouler doucement sur la baie vitrée et sur les buildings de carton-pâte. Une voix intérieure maligne lui murmurait que c’était pour de faux. Ce n’était pas du sang, mais de l’hémoglobine. Et il y en avait tout un camion citerne.
La comédienne était allongée à plat ventre sur le lit à coucher, le visage face à l’énorme caméra Kalos Haute Définition. Derrière elle, un accessoiriste pointilleux réglait sur le comédien impassible le mécanisme d’éjaculation de son faux sexe en érection perpétuelle. Sur le clap électronique, un assistant paramétrait les numéros en diodes rouges du plan et de la prise :
COSMOGONIE
PLAN 223 – PRISE 7
INTERIEUR / EFFET JOUR
Après avoir enclenché l’électrophone diffusant L’Oiseau de Feu, Pierre Aporia ajustait des trames de diffusion, de différentes densités, sur un petit projecteur qui éclairait le visage de la jeune femme, et sur lequel de grosses larmes irisées glissaient doucement.
— Pourquoi pleurez-vous ? demanda Pierre Aporia surpris.
— Pour vous ! répondit la jeune femme.
— Pour moi ? Mais pourquoi se faire du mal pour quelque chose qui n’existe pas et n’existera jamais ?
En regardant les larmes brûlantes s’écouler des yeux rougis par une blessure primitive réouverte, peu à peu, Pierre Aporia perdait pied.
— Bientôt, disait-il, vous me demanderez de vous gifler, de vous insulter, de comploter avec votre partenaire des choses à votre insu, pour vous faire sortir de vraies larmes, pour vous faire jouer comme dans la vraie vie. D’être manipulée par moi et violée par la caméra, ça ne vous suffit pas ?
— Je ne peux travailler autrement, pour que l’émotion soit juste et sincère…
— Mais moi, j’ai toujours pensé qu’au cinéma la vie prenait vie par le spectateur rendu voyant par le cinéaste. On doit proposer du symbolique…
— Peut-être êtes-vous entré dans le cinéma comme on entre en religion. Ce que le public veut maintenant c’est de la chair et du sang ; et je suis prête à me laisser dévorer par lui, comme je suis prête à aimer véritablement cet homme avec lequel vous voulez que je fasse semblant de baiser.
— En agissant ainsi vous allez vous faire du mal, vous allez vous détruire petit à petit. C’est un métier dangereux : il faut travailler avec la raison et non avec l’irrationnel. Tout cela doit rester ludique. Léger. Intelligent. Mettre sa peau en jeu, c’est bon pour les idolâtres du culte Judéo-Chrétien de la souffrance.
— Moi j’aime ce qui est gluant ! Je ne veux pas être une Icône asexuée. Je suis un corps-ouvert et je travaille avec ça ! Vous vous posez trop de questions. Et vous êtes dans le déni : vous ne vous rendez pas compte que vous ne croyez plus en la magie du cinéma : faire vrai avec du faux et faire faux avec du vrai. Alors, cette magie étant morte, prenez-moi Maître Pierre ; ceci est mon corps et là-dessus bâtissez votre œuvre.
« Je suis fatigué, fatigué… fatigué », se disait à part lui Pierre Aporia, l’enfant-homme. « Je crois que je ne suis pas fait… plus fait pour ce métier… » Fuir, en quatrième vitesse, de cette boîte de Pandore qu’était devenu ce plateau de cinéma. Fuir, non parce que la vue et les propos de cette jeune femme l’effrayaient soudainement, mais, parce que, comme un vertige venait vous saisir sans prévenir, c’était comme s’il venait de se réveiller d’un long sommeil. Que faisait-il ici ? Qui étaient tous ces gens qui le regardaient ? Où était-il ? Pourquoi avait-il si peur ? Et cette fatigue ? Cette douleur dans le plexus ? Que faisait cette femme en pleurs, les cuisses entr’ouvertes, les yeux révulsés ? Qu’attendaient tous ces gens autour d’elle ? Pourquoi la regardaient-ils ? Pourquoi regardaient-ils sa croupe comme le fruit d’un carnage ? Que voulait cet homme impassible, au phallus de latex dressé comme une arme et qui excrétait laborieusement une épaisse substance blanche, en émettant un son gluant, un bruit visqueux comme un corps en décomposition accélérée ?
Pierre Aporia, l’enfant-homme, sentait sur sa joue la chaleur sauvagine de l’empreinte du baiser disparaître en lui à mesure que le couple s’abîmait dans le tumulte d’une danse infernale. Et c’était comme si les fausses gouttes de sueur, qui perlaient sur les corps perdus au fond du lit à coucher et drapés d’un tissu de mensonges, s’écoulaient sur tout son visage ; puis, mélangées au faux sang de la baie panoramique, venaient ruisseler sur tout son corps. La bulle hypertrophiée de tout ce qui avait structuré son dogme des images venait d’éclater.
Pierre Aporia avait très froid. Il avait très peur aussi… de ce qu’il pouvait y avoir derrière les images. Il comprenait qu’il ne pourrait pas continuer à vivre sans le voile des illusions.
2
Pierre Aporia, l’enfant-homme, poussait un hurlement de panique dans cette obscurité qui l’enveloppait comme un linceul moite. Une voix féminine lui disait ces mots :
— Vous avez eu un accident ! Vous avez mal quelque part ? Pouvez-vous bouger ? Monsieur Laporia, vous m‘entendez ?
« Mais, que raconte cette femme à la voix âpre et rauque ? C’est Aporia mon nom. Pierrot, Pétrus, Vieux-Gars, Le Pierre, Monsieur Cinéma, Monsieur Pierre, ce sont les sobriquets-diminutifs usités par celles et ceux qui avaient – et qui ont encore – peur de m’appeler par mon prénom. Pourtant, Pierre, ça sonne plutôt bien… J’ai toujours aimé mon prénom. Enfant, le soir, dans mon lit, je me le répétais à l’infini… Pierre… Pierre… Pierre… jusqu’à sentir tout mon être s’incarner dans le son qui s’exhalait de ma bouche. Une petite extase contenue dans un monosyllabe. Et j’en retrouvais les traces fossiles, de cette extase, lorsque j’entendais une personne me nommer. Surtout lorsque c’était une voix féminine, car la voix féminine pénètre tous les mystères du monde, même ceux contenus dans ce monosyllabe de Pierre, me dévoilant ainsi cette vérité irréfutable : que c’était bien moi, moi seul, qui avais décidé de vivre une singularité de Pierre sur cette planète, et quels qu’eussent été mes parents. Même sans volonté divine, j’existerais. Et cela s’était toujours vérifié, même adulte, même tout de suite maintenant ce petit miracle d’avaler et d’être le son Pierre pourrait se produire, si cette femme à la voix âpre et rauque me nommait par mon prénom. Allez ! courage… Dites Pierre mon Pierre au lieu de me parler d’accident, d’hyperventilation, de tachycardie, de coma dépassé et autres barbarismes… Tiens ! le noir devient blanc… Petit à petit, cette voix âpre et rauque prend la forme d’une silhouette aphrodisiaque, galbée dans une blouse toute blanche, très belle silhouette vaporeuse penchée au-dessus de moi, les mains, asséchées par les désinfectants, appuyées sur mon plexus solaire, jolis petits seins dans l’échancrure de la blouse, un grain de beauté flottant sur la peau du sein droit dont la blancheur évoque l’illimité, blanc cosmique sur lequel de minuscules taches pourpres éclosent, tels des coquelicots dans un champ baigné de soleil ardent… Ô … de ma bouche vient de jaillir un flot rouge… Et sur le sol à damier noir et blanc s’étale la chute d’un drapé de sang, comme sur le ciel, au crépuscule, lorsque le Soleil meurt avant de descendre dans la Terre. Je n’ai qu’environ cinq litres et demi de sang ! Mon Temps est donc compté. »
À bord de sa D.S.Argo filant à très grande vitesse sur l’autoroute (l’aiguille rouge du compteur dépassait les 180 Km/h), Pierre Aporia, le front bas, regardait en dessous ce magnifique Soleil couchant qui se reflétait sur ses lunettes à monture noire et carrée. Il se souvenait, enfant, alors qu’il contemplait un coucher de Soleil pendant un embouteillage sur l’autoroute du retour des Juillettistes, avoir été saisi d’une fulgurance qui devait le réconcilier à tout jamais avec ce sentiment d’injustice lié à sa propre finitude : le Soleil, dans quatre milliards d’années, allait mourir. Ainsi, il n’y avait donc pas que lui de mortel. « Tout ça disparaîtra donc un jour ! » s’était-il dit en regardant ce monde qu’il avait cru être pour l’éternité, mais sans lui.
Pierre Aporia faisait corps avec sa D.S.Argo. Son vaisseau-bulle, comme il disait, était une sorte de cinéma-ambulant : le mouvement du paysage de par et d’autre de l’habitacle, la vitesse de défilement de la route et des bordures, le bourdonnement du moteur, la sono à plein volume le mettaient dans un état de transe hypnagogique dont il avait besoin, chaque jour, avant d’entrer sur un plateau. Se sentir plein d’images. Mais, à cet instant, Pierre Aporia, l’enfant-homme, ne se rendait pas aux Studios Scotchlood pour y travailler. Il roulait sans but. Le plus vite possible. Fumant cigarette sur cigarette, la colère roulait dans son cœur : ayant congédié la comédienne, le tournage était suspendu, au grand désespoir de sa productrice Marie Saint-Silver. Trouver une autre actrice, retourner toutes les scènes avec elle, reconstruire la baie panoramique de la chambre à coucher, parce que l’autre avait été souillée par des litres et des litres d’hémoglobine, cela allait prendre beaucoup de Temps, et, dans le cinéma, univers cruel où rien ne repoussait après son passage, le Temps c’était de l’argent. Mettre à profit ce Temps pour repenser tout le film ?
— Je suis fatigué, fatigué… fatigué, marmonnait Pierre Aporia, l’enfant-homme, une cigarette pendue à ses lèvres.
Sa D.S.Argo, son cinéma-laboratoire-ambulant, était devenue un véritable fumoir où les notes infernales de L’Oiseau de Feu flottaient de volute en volute, si glissant selon leurs formes, rejouant ainsi avec la Théorie des Ensembles, jusqu’à ce que l’ombre de la nuit recouvrît tout.
La Brasserie Ariane, où Pierre Aporia s’était arrêté pour dîner, était envahie par la fumée des cigarettes. Cela l’étonnait un peu de voir que tous les clients fumaient en mangeant. N’était-il pas interdit de fumer dans les lieux publics ? Mais Pierre Aporia n’avait d’yeux que pour la serveuse : elle était grande, de forte ossature, la bouche chevaline, la silhouette callipyge. Sa chevelure d’or, remontée sur sa tête en un chignon de boucles indisciplinées, était traversée par un crayon de couleur rouge sang.
— Un petit dessert ? lui demandait-elle, en se penchant en avant afin de retirer les couverts de dessus la table en formica rouge. Elle pouvait se voir dans le reflet des lunettes à monture noire et carrée de Pierre Aporia, lequel observait un grain de beauté se trémousser sur le dessus du sein droit satiné de sueur et libre de ses mouvements – comme celui de gauche – sous un chemisier de coton blanc échancré. Relevant ses yeux noirs par-dessus ses lunettes, Pierre Aporia demandait à la serveuse :
— Cela vous intéresserait-il de jouer dans un film ?
— Il plaisante ! riait-elle.
— Non, je suis très sérieux.
— J’n’ai pas l’temps de discuter : y a trop de monde. De toute façon, vous seriez très déçu : je ne suis pas photogénique et je suis très timide.
— La photogénie ou la cinégénie c’est mon problème…
— Je ne sais pas quelle idée vous avez derrière la tête, mais je dois aller travailler. Vous perdez votre temps, vous dis-je. Je ne sais pas jouer, moi !
— Vous jouez très bien votre rôle de serveuse… Je ne vous demanderai pas d’être comme une actrice avec une technique d’actrice, des tics d’actrice, des poses d’actrice, des caprices et des angoisses d’actrice, il nous faudrait des mois pour gommer tout ça. Non, je vous demanderai juste de ne rien faire. Être comme un modèle. Être neutre. Pour faire un peu pompeux : juste être l’égérie de l’imaginaire des spectateurs. Ce sont eux qui se joueront votre personnage. Vous serez le fil de tension qui les conduira au beau, à la magie de leur monde intérieur…
— Vous êtes fou ! Et c’est difficile de ne rien faire vous savez !
— Vous avez l’air d’une bête curieuse, pleine de ressources.
— La bête a du boulot sur la planche !
— Je comprends… Excusez-moi… Je vous laisse ma carte… Réfléchissez… Chacun peut, au moins une fois dans sa vie, laisser s’exprimer, sous un masque, le démon créatif qu’il a à l’intérieur de lui. C’est cette aventure que je vous propose : jouer avec votre démon. Être vous-même. Renaître à soi.
— Vous aimez jouer avec le feu, vous ! J’y réfléchirai… Il prendra un dessert ?
— Juste un café… Un café bien serré !
En regardant par-dessus ses lunettes la serveuse s’éloigner dans l’atmosphère embrumée de la Brasserie Ariane, Pierre Aporia écoutait sa petite voix intérieure l’interpeller : « Tu vois, mec, ce n’est pas bien difficile. Il suffit juste de laisser faire les choses, puisqu’il n’y a pas de hasard. Une serveuse dans un film à plusieurs millions de Dol’, ça va faire jaser : "Pas crédible ! Il se retranche ! Il se couche ! Il veut refaire comme quand il était jeune !" Depuis, en effet, tu t’es bien égaré, fourvoyé, trompé, englué, voire totalement embourbé dans l’Image. Mais comment faire un film autrement ? C’est-à-dire sans mentir, sans ajouter du mensonge au mensonge qu’est déjà une image ? Comment filmer toutes les choses à partir du Dire Véritable ? Comment offrir une mise à nu crue, frontale ? Comment représenter toutes les choses telles qu’elles sont, telles qu’elles nous apparaissent, sans aucune création qui aurait pour but de faire surgir une réalité cachée ? Il n’y a pas de réalité cachée, seulement une paresse de nos sens. Ne plus filmer ? Car filmer c’est truquer le monde, puisqu’on le réduit à un instant scellé, éjecté de l’espace-temps, du mouvement ; même si cet instant scellé garde l’apparence de la vie, il n’est qu’un simulacre, un phénomène qui ne peut prendre corps que dans la naïveté, la part infantile du spectateur : son aptitude séculaire à la croyance. L’Illusion cinématographique – et aussi photographique – fonctionne sur un besoin cognitif, collectif et idéologique de croyance. Te souviens-tu, enfant, tu croyais que ce que tu voyais sur l’écran de la télévision se déroulait véritablement dans un autre monde. Et que, inversement, dans cet arrière-monde des gens te voyaient sur un écran similaire, et pas seulement lorsque tu jouais aux cow-boys et aux indiens, à l’agent secret, à la guerre… mais aussi dans ta vie de tous les jours (sauf quand tu allais aux toilettes, car, dans l’autre monde, on ne les voyait jamais aller aux toilettes, ni se laver). Un soir, ton père t’a emmené voir un western (à cette époque, pour toi, cinéma c’était la même chose que télévision, mais en plus grand). À la fin du film, le héros meurt. Puis voilà que quelques jours plus tard, tu revois ce même acteur à la télévision. Comment cela était-il possible ? Puisque ce que tu voyais sur un écran était vrai, comment quelqu’un pouvait-il mourir un jour et être de nouveau vivant le jour d’après ? On t’en expliqua la raison : ce qu’il y avait sur les écrans, c’était du bidon. C’était du cinéma. C’était ça faire du cinéma. De la comédie. Du trucage. Le cinéma où la réalité convaincante du faux-semblant. À partir de cet instant, tu n’as pas cessé de regarder les films à travers l’œil critique de la technique : comment ce que tu voyais était-il fait ? Jusqu’à aller reproduire avec des maquettes de ta propre fabrication, une petite caméra et un instinct visuel infaillible, certains films que tu allais voir au cinéma – cette salle obscure où, petit, tu regardais derrière toi le trou d’où provenait le faisceau lumineux magique ; et où tu voulais poser ta main sur l’écran dans l’espoir puéril de récupérer de la poussière d’images perdues. D’une certaine manière, sans jamais te l’avouer, tu n’as plus jamais cru à ce que tu voyais au cinéma. Tu te retranchais derrière la technique. Et ce qui te fascinait, c’était cette possibilité de créer un monde auquel les autres pourraient croire – et c’était leur croyance qui ressuscitait la tienne. Et voilà que maintenant tout s’effondre comme un château de cartes biseautées. Tu ne sais plus. Tu ne sais pas. Tu as peur. Cependant, tu sais que tu ne peux plus continuer ce film ainsi. Tu ne peux plus te mentir à toi-même et aux autres. Cette serveuse, si elle disait oui, tu lui vampiriserais toute sa force de vie pour en faire une abstraction, un être-mort sur celluloïd : une starlette, une star, une superstar… une start-up ! Et pourquoi donc ne pas la filmer sans mettre de pellicule dans ta caméra-tombeau ?… Juste pour le geste… Pour le beau… Pour l’agir… Juste pour retrouver une authenticité du regard, perdue peut-être à jamais… Juste pour changer ton regard sur toutes les choses qui aménagent le monde, et non pour en conserver une trace qui se substituerait au réel. Tu ne sais plus. Tu ne sais pas. Tu as peur, car ton désir de cinéma repose depuis toujours sur un malentendu : pour toi, le cinéma passe par les femmes… Bel hommage mec, oui, mais cela revient à dire aussi que, pour toi, les femmes ne peuvent passer que par le cinéma. Tu ne peux les aimer qu’à travers l’œil mort du cinématographe : l’icône. Il y a très peu de femmes, dans ta toute petite vie névrotique, qui ne sont pas passées devant ta caméra. Au fait, en arabe, El Kaméra, cela veut dire le pénis ! »
Et dans la nuit, sous un choc violent, apparaissait en forme d’éclairs l’éclat du feu. Il y avait moins de personnes dans la Brasserie Ariane zébrée de puissantes lueurs d’orage. La patronne avait éteint les lumières du bar, auquel s’appuyait une femme brune, coupe au carré Lulu, vêtue d’une robe mini blanche entièrement rebrodée de cristaux, et remontée effrontément sur la cuisse droite, car la femme avait posé son pied chaussé d’un escarpin noir à talon aiguille sur le marchepied qui longeait le zinc. Le poids du corps, nu sous la robe, reposant sur la jambe gauche – au pied de laquelle se frottait un chat noir – abaissait l’épaule gauche et remontait le fessier, aux courbes pleines et harmonieuses. La femme terminait de boire un alcool fort, en tirant par moment sur son fume-cigarette en émail écru. Tels les filaments d’une nébuleuse cosmique, la fumée se déplaçait doucement devant son visage ovale, rehaussé de tons chauds par la crémation intermittente de la cigarette. D’une voix posée, douce et rauque, elle racontait à la patronne – laquelle écoutait en essuyant des verres – que des scientifiques électrocutaient des rats dès qu’ils entraient dans une chambre noire. Ainsi, après plusieurs électrocutions, les rats n’osaient plus entrer dans celle-ci. Une fois un des rats mort, les scientifiques prélevaient une substance dans son cerveau. Puis ils injectaient cette substance dans d’autres rats. En renouvelant l’expérience de la chambre noire, ils s’aperçurent que les rats injectés n’y entraient pas, alors que les rats non injectés y entraient. Les scientifiques en avaient déduit qu’il y avait une molécule de la peur du noir.
En observant par le triangle du décolleté dorsal le fin ciselé de la colonne vertébrale de la femme, Pierre Aporia revoyait un souvenir qui ne s’était jamais départi de lui, et auquel il pouvait volontairement faire appel pour repousser un vague à l’âme : dans un ancien abri antiatomique transformé en boîte de nuit monochrome, assis au fond d’un fauteuil bas au bord de la piste de danse, il avait passé un long moment, comme hypnotisé, à regarder en contre-plongée une jeune femme, moulée dans une robe de cuir blanc, se déhancher impétueusement au-dessus de lui, sur le rythme déchaîné d’une musique de métal-hurlant en fusion.
Au fond de la salle à manger de la Brasserie Ariane, dans la pénombre, la serveuse commençait à retourner des chaises sur les tables, pour passer plus facilement le balai et ensuite la serpillière. L’orage grondait. Chaque éclair illuminait la salle, la découpant d’ombres menaçantes. Un petit téléphone à cadran sonnait sur le comptoir. La patronne décrocha. Puis, elle fit signe à Pierre Aporia que l’appel lui était destiné. Surpris, il porta sa main sur sa poitrine, demandant si c’était vraiment pour lui, alors que personne ne savait qu’il se trouvait en cet endroit perdu. La patronne acquiesça. Alors, il se leva, et alla jusqu’au comptoir…
— Pierre… murmurait une voix féminine dans l’écouteur.
— Sol’Ange !… T’as une petite voix…
— C’est à cause… Nathalie Nathalicia…
— Oui ?
— Elle est morte…
— Morte ? Mais comment ?
— Suicide… On l’a retrouvée chez elle cet après-midi…
— … … …
Pierre Aporia n’arrivait plus à articuler un mot. Il ressentait une forte tension nouer sa gorge, et sa poitrine était comme perforée d’un trou par lequel s’échappait tout l’air de ses poumons goudronnés par le tabac. La Brasserie Ariane n’existait plus. Elle fondait dans l’obscurité. Seul existait ce revêtement de formica rouge du comptoir, où la lueur d’un éclair glissait lentement. Pierre Aporia regardait cette lueur avec intensité, comme si son être au monde en dépendait. Il n’entendait plus Sol’Ange lui dire qu’elle le rappellerait plus tard. Sans quitter des yeux le déplacement lumineux de l’éclair, il reposait le combiné. Le Temps avait dû s’arrêter. Des flots irrépressibles d’images mentales de Nathalie Nathalicia se télescopaient sur l’écran douloureux de la mémoire : elle riait ; elle pleurait ; elle jouissait ; elle parlait ; elle embrassait ; elle pissait ; elle caressait ; elle lisait ; elle criait ; elle écrivait ; elle écoutait ; elle vivait… Encore et encore… Les larmes aux yeux, Pierre Aporia approchait doucement son visage de la lueur de l’éclair qui se diluait, petit à petit, dans le formica rouge.
— Est-ce toi, Nathalie Nathalicia ? C’est toi, ô bel mannequin, qui viens me rendre un dernier salut ?
3
La D.S.Argo fonçait dans la nuit humide, toute constellée d’éclairs qui illuminaient, en de courts instants, la route longeant une côte escarpée, où de très hautes vagues chargées d’écume venaient s’y déchirer dans un grondement qui se mêlait à celui du tonnerre. À travers le pare-brise nimbé d’eau, Pierre Aporia distinguait à peine la route. À chaque éclair, sur sa droite, il voyait, avec une crainte primitive, la mer furieuse surgir des ténèbres, pour y être engloutie aussitôt. Un vent puissant secouait la D.S.Argo mugissante, et Pierre Aporia avait peur de se retrouver projeté en pleine mer. Penché en avant, tenant fermement le petit volant gainé de cuir, il essayait de bien fixer la ligne discontinue tracée sur l’asphalte et qui ondoyait sous la pluie battante, comme la courbe d’un sismographe. Il essayait, car les larmes qui noyaient par intermittence son regard – face auquel, en boucle, émergeait, puis se disloquait le beau visage de Nathalie Nathalicia – n’arrangeaient rien. Alors, après avoir relevé ses lunettes sur son front, il passait sur chacun de ses yeux, puis sur chacune de ses joues humides, le revers de sa main droite. Chaque crise de larmes entraînait avec elle son cortège d’images d’un passé révolu. Et Pierre Aporia ne cherchait pas à les réprimer : c’était comme un voyage dans le Temps, une négation de la mort de Nathalie Nathalicia, un déni plus fort que lui, une sorte de soupape de sécurité qui filtrait sa souffrance, qui l’aidait à tenir debout, à ne pas sombrer dans les affres d’un hurlement d’effroi infini, car la mort de Nathalie Nathalicia n’était pas dans l’ordre cosmique des choses qui organisent ce monde.
Telles des tours arrogantes de béton, d’acier et de verre s’effondrant sous un tremblement de terre dégageant une énergie colossale, le séisme intérieur, qui grondait en Pierre Aporia, lézardait le mur de briques rouge sang de sa mémoire, y dégageant, peu à peu, une chambre glaciale, au sein de laquelle Nathalie Nathalicia et lui avaient, jadis, perdu leur innocence en jouant avec le péché originel, à même un matelas élimé posé au sol à damier noir et blanc, grandes dalles froides qui recouvraient tout le petit appartement abandonné en l’état par la mère de Pierre – on disait qu’elle avait abandonné ainsi plusieurs appartements. Pierre fixait le beau visage de Nathalie Nathalicia. Il couvrait son corps plantureux de son long corps osseux. Sa verge, en déchirant Nathalie Nathalicia, allait puiser au fond des entrailles. C’était si chaud, qu’il pensait que son membre allait fondre. Pierre n’osait pas donner des coups de reins trop forts, même si Nathalie lui disait « plus fort ! ». Et sa belle bouche, aux lèvres charnues bleuies, restait grande ouverte. De petites volutes de vapeur s’en exhalaient. La chambre était froide, et cela stimulait l’ardeur et la fougue de leurs corps. Sur le voile de ses paupières closes, Nathalie voyait une mer primitive gigantesque s’épanouir dans son authenticité originelle. De hautes vagues aux sommets blancs d’écume s’enroulaient sur elles-mêmes, tandis que derrière elles, d’autres, poussées par un vent puissant, se dressaient, s’élevaient jusqu’au ciel de cobalt zébré d’éclairs silencieux. L’œil coruscant, Pierre regardait le ventre haletant de Nathalie Nathalicia, peau satinée duveteuse aspergée du foutre jailli de son membre empourpré. « Ne fais pas cette tête Ôméga-Man : c’est pas toi qui saignes, c’est moi ! C’est notre privilège à nous, les femmes vierges – paraît-il ! Tu viens d’offrir aux dieux une illustre hécatombe ! » disait Nathalie Nathalicia tout ébouriffée. Sur son visage, la sueur étincelait. Le feu flambait dans ses yeux pers. Elle regardait le sexe circoncis de Pierre. « Tu es Juif ? » demandait-elle. Circonspect, Pierre haussait les épaules. Les doigts longs et fins d’une main de Nathalie