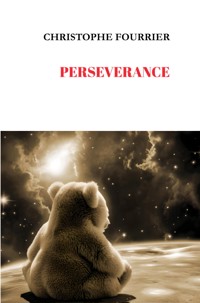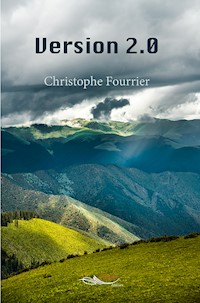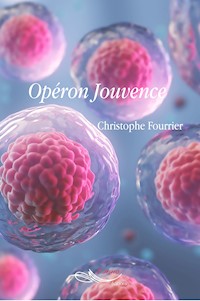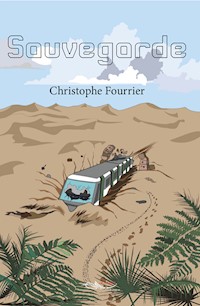Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un coup sous enveloppe est un coup non joué sur l’échiquier, mais placé dans une enveloppe scellée qui sera ouverte à la reprise de la partie. C’est exactement ce que fait Pierre, lycéen et joueur d’échecs, à la suite de son agression. Sa vie devient un échiquier sur lequel il planifie des stratégies, met en œuvre des tactiques, pour ses futures attaques. Claire, elle, joue aux dames avec sa mère, comme un refuge après son agression. Des années plus tard, les premières pièces adverses tombent… Trente-deux pièces d’échecs, trente-deux personnages, trente-deux chapitres.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Christophe Fourrier est personnel soignant dans un hôpital parisien depuis plus de 30 ans. Il publie depuis 2020 des romans, essentiellement d’anticipation. "Coups sous enveloppe" est son premier roman policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christophe Fourrier
Coups sous enveloppe
Si vous voulez détruire un homme, apprenez-lui à jouer aux échecs.
Oscar Wilde
Ouvertures
1 - Attaque
Mesure agressive contre le camp ennemi, par un ou plusieurs coups.
– L’échiquier est un champ de bataille ! C’est une guerre ! Une guerre totale. À moins d’un coup de chance phénoménal, votre adversaire sera de votre niveau. Donc, vous vous livrerez à des attaques, des coups, des contre-attaques, des ripostes. Vous perdrez des pièces, mais surtout vous en prendrez, vous tuerez les soldats de l’ennemi, vous affaiblirez ses forces en éliminant ses pièces. Le but n’est pas de contraindre, de négocier. Le but est la défaite complète de votre adversaire.
C’est une guerre à mort, vous désirez la destruction totale de l’ennemi : échec et mat ! Le voilà, votre objectif ! Aux échecs, il n’y a pas de prisonnier, vous devez gagner. Pour gagner, il faut faire preuve de stratégie, d’intelligence, de lecture du jeu de l’adversaire, de compréhension des pièces maîtrisées avec habileté, pour les empêcher, les cerner et… les détruire !
Il ne faut pas avoir un coup d’avance, il faut en avoir 2, 3, 6, et que des mauvais coups, des sales trucs qui font mal, qui minent le moral et ruinent les plans de l’adversaire.
N’attaquez jamais sans préparation, jamais avec une seule pièce. Soyez imperturbables dans vos stratagèmes. Ne vous réjouissez jamais. Prenez des pièces, causez des pertes, des dégâts et GAGNEZ !
C’est une guerre, je le répète. L’armée d’en face doit être anéantie !
Voilà, Pierre, ce qu’il faut faire pour gagner le prochain tournoi. Dans le jeu d’échecs, vous n’entendez que le mot « jeu », pas les échecs. Pensez « échecs », problèmes, être mis en échec, être bloqué, arrêté dans ses envies, frustré…
Pensez combats et non parties.
Car des combats, vous allez en faire, croyez-moi !
Octobre 1987, vendredi soir, banlieue sud de Paris.
Dans la salle du centre culturel où a lieu le cours d’échecs, le professeur termine sa tirade martiale en s’adressant plus particulièrement à un jeune lycéen qui lui semble prometteur, mais qui n’accorde pas assez d’attention à l’enjeu. Pierre est assis face au professeur, souriant. C’est un adolescent de 16 ans, qui fréquente ce cours d’échecs ouvert à tous, avec deux de ses camarades de classe. À côté de lui sont assis Patrice et Arnaud, eux aussi élèves en première S, classe spécialisée en mathématiques et sciences physiques. Les trois amis murmurent un peu en souriant, suite au « prêche » de leur coach. Pour eux, les échecs restent un jeu, une activité ludique, comme leurs jeux vidéo sur Commodore 64 ou Sinclair. À leurs côtés se trouve Émilie, elle aussi en classe de première, mais dans un lycée privé, parisien. La jeune fille est plus posée, moins facétieuse, moins légère. Elle a le goût de la compétition, elle envisage une classe préparatoire aux Grandes Écoles, de réussir des concours, puis bâtir une carrière. Avec les trois garçons, ce sont les élèves les plus âgés du cours d’échecs, qui a lieu chaque vendredi soir depuis la rentrée scolaire de septembre. Le professeur, un ingénieur chimiste, bénévole pour la mairie, est ravi d’avoir ces quatre-là dans son cours qui est en principe plutôt une activité d’initiation pour les écoliers ou collégiens. L’inscription des lycéens a été la bonne surprise de la rentrée ; de plus les trois gars s’entendent à merveille avec la jeune Émilie. En fait, au sein de ce cours d’initiation s’en est développé un second, plus sérieux, réservé à ceux-là qui enchaînent les parties deux par deux. Émilie apporte un peu de sobriété et de calme aux garçons, plus turbulents ; en retour ils lui offrent l’audace, la fougue pour attaquer, sortir des ouvertures classiques et convenues. Les quatre élèves ont déjà gagné une compétition locale. Le professeur ambitionne de les inscrire à des vrais tournois, si « seulement ils s’investissent un peu plus sérieusement ».
C’est la fin de la séance, il est 21 heures passées. Les parents sont venus récupérer les plus jeunes, les quatre ados ramassent leurs affaires. Le professeur les observe discuter entre eux, rire. Les trois garçons n’ont d’yeux que pour Émilie. Élégante, bien coiffée, un maintien qui révèle la pratique de la danse classique, la jeune fille « fait plus que son âge », comme il lui est souvent dit.
Pierre range son jeu d’échecs, qu’il apporte à chaque fois. C’est un jeu en bois, au plateau verni, les pièces sont d’une essence noble. Discrètement, il conserve la reine blanche dans sa main, la plaçant dans la poche de son blouson, tandis que les quatre amis sortent sur le trottoir.
C’est bientôt le moment de se séparer. Émilie attend sa mère qui doit venir la chercher en voiture, les garçons patientent avec elle. Pierre fanfaronne avec Arnaud, Patrice est plus réservé. Émilie les interroge sur leurs projets d’avenir, leurs envies de métiers.
– Je ne suis même pas sûr d’être dans la bonne filière, remarque Arnaud en riant.
– Tu n’as pas de bonnes notes ? demande Émilie très sérieusement.
– Si, si, ça va. Mais en fait, j’aime bien les lettres aussi, j’ai hésité à faire S. Bien sûr, tout le monde dit qu’avec un bac C tu fais ce que tu veux, mais bon. Je ne suis pas sûr que ce soit utile de se taper autant de maths, répond Arnaud.
– Et toi ? demande Émilie en regardant Pierre.
Le jeune la dévore des yeux. Il rougit d’être ainsi questionné sur sa volonté, ses projets. C’est du domaine de l’intime pour lui qui est plutôt secret et discret dans sa famille. Il n’y a qu’avec ses deux copains qu’il s’autorise autant d’espièglerie, de faire le plaisantin. Il sait qu’il a rougi, que ses deux amis ont deviné ses sentiments. Mais il sait aussi qu’aucun ne se moquera jamais de lui, comme le feraient son frère aîné ou quelques autres de sa classe.
– Moi ? J’aimerais enseigner, je pense. Apprendre toujours, faire de la recherche peut-être. Je n’ai pas vraiment réfléchi. Je voudrais continuer avec mes copains, je veux dire, dans les études, que nous progressions ensemble, explique Pierre plein d’optimisme.
– Pas une Grande École ? Centrale ou les Mines ? propose Émilie presque déçue.
– Mes parents n’auront pas les moyens de m’offrir une école, rétorque Pierre.
– Il y a des bourses je crois, argumente Émilie.
– Je n’en ai jamais reçue, nous ne sommes pas dans les critères. Patrice est boursier, il est seul avec sa mère, explique Pierre en souriant à Patrice.
– Je crois surtout que tu n’es pas celui qui recevra le plus de moyens de la part de tes parents, dit gentiment Arnaud.
La conversation s’arrête brutalement quand une voiture se gare le long du trottoir après avoir klaxonné. Émilie s’engouffre par la portière passager en criant un « à vendredi prochain ! » couvert par la musique classique qui s’échappe de l’habitacle.
Les trois copains restent encore cinq minutes à discuter puis ils se séparent. Arnaud et Patrice partent d’un côté de la rue, Pierre de l’autre.
Pierre sort son walkman à cassette et met son casque sur ses oreilles. Il a une trentaine de minutes de trajet pour rentrer chez ses parents, dans la résidence d’une ville limitrophe. Il doit passer devant le lycée intercommunal où il étudie, puis rejoindre l’arrêt d’un bus. Il met la main dans la poche de son blouson, serrant la reine blanche de son jeu d’échecs. Cette pièce de bois symbolise son attachement pour Émilie, cette jeune fille qu’il a rencontrée pour la première fois en septembre. Elle habite une autre commune, près de Paris, plus cossue. Scolarisée dans le privé, elle est issue d’un autre monde, très différent de celui de Pierre. Pourtant le jeune garçon se prend à rêver, à oublier ses origines modestes, sa place à part dans sa famille, coincé entre un frère cruel, moqueur, et des parents complices et admiratifs de cet aîné. Alors ce jeu, cadeau de son défunt grand-père, ce beau jeu d’échecs, incarne ses sentiments pour Émilie et sa foi en un avenir où il pourrait la séduire, peut-être. Elle serait sa Dame, blanche, de blanc vêtue…
À plusieurs centaines de mètres de là, trois autres élèves du même lycée marchent dans la nuit. Luc, Gérald et Frédéric rient en buvant des canettes de bière. Ils étaient à l’entraînement de handball jusqu’à 20 heures, mais ont décidé de boire avant de rentrer chez eux. Ils sont tous les trois dans la classe de Pierre, Arnaud et Patrice. Tout oppose ces deux groupes. Quand les joueurs d’échecs sont discrets et travailleurs, les trois autres sont railleurs, perfides, et tricheurs. Ils invectivent souvent les trois « bouffons », comme ils surnomment Pierre, Patrice et Arnaud, faisant hurler d’un rire gras et bête plusieurs filles du lycée. Les trois joueurs d’échecs occupent la tête de classe, sont nuls ou presque en sports collectifs, et « s’habillent comme des ploucs ». Mais le curé, comme ils appellent Pierre Lévêque, a tout de même de la répartie. Plusieurs fois, il a su rétorquer vertement aux trois agresseurs, mettant à mal leurs sarcasmes, retournant l’opinion de la classe contre eux. Si les choses n’en sont pas encore venues aux mains, c’est parce que les « pétasses choisiraient le camp des bouffons », comme l’a reconnu Luc en crachant au sol. Gérald, que tous nomment Delato, par son nom de famille, « vote pour casser la gueule franchement à ces merdeux ». Delato est une brute, sans aucune nuance. Il est dévoué à Luc, qui est son ami depuis l’école maternelle. Luc pense, Delato frappe fort. C’est ainsi depuis toujours, c’est un duo violent. Frédéric est plus sournois, il a plus de scrupules que ses deux amis, même si la réussite scolaire de ces « trois tapettes » l’agace.
Quand les trois handballeurs arrivent dans l’ombre de la cuisine centrale, fermée et plongée dans l’obscurité, ils aperçoivent Pierre qui marche dans leur direction.
– Putain, regardez, c’est l’autre tapette qui s’amène ! s’exclame Frédéric.
– Sur un plateau… commente Luc.
– Vous croyez que… commence Frédéric en regardant autour d’eux.
– Il est 21 heures passées, c’est la nuit, il n’y a personne. On le chope quand il arrive par ici, on se le fait derrière, c’est pas éclairé, explique Luc d’un air de défi.
Frédéric hésite. Il s’agit d’une attaque préméditée, ce n’est plus une embrouille de lycée qui dégénère en bagarre. Et puis c’est la rue, le dehors, la voie publique, ce n’est pas le lycée, et…
– T’as peur, couille molle, fait remarquer Delato en rotant bruyamment.
– Non, mais… commence Frédéric.
– T’inquiète, le but c’est qu’il ne nous reconnaisse pas. Gérald tu te planques là, quand il t’a dépassé tu le déglingues par-derrière. Nous, on le traîne par là dans le noir. Il ne verra rien. C’est le moment ou jamais, on n’aura jamais de meilleure occasion, explique Luc en terminant sa canette qu’il jette dans le jardin d’un pavillon.
Pierre marche rapidement, il sait par habitude que le bus passera bientôt à l’arrêt après la cuisine centrale. Il serre dans sa main droite la reine blanche, tandis qu’il écoute son groupe de new wave préféré. Pierre sourit. Il n’entend pas le bruit des pas derrière lui, la course de Delato qui frappe l’arrière de son genou. Pierre se cambre, projeté vers l’avant, sa tête basculant en arrière. Sous le choc et la douleur, il s’effondre devant lui. Il tente à peine de se relever quand un autre coup de pied l’atteint aux côtes, coupant son souffle. Puis des mains attrapent le col de son blouson, le tirant vers les quais de la cuisine centrale. Son walkman se détache de sa ceinture et tombe au sol, le premier agresseur shoote dedans, brisant l’appareil. Des rires fusent. Pierre profite de ce moment pour se mettre debout et frapper au hasard de sa main droite, la reine blanche renforçant son poing qui atteint le cou de Delato.
– Enculé de James Bond ! s’écrie le lycéen, utilisant l’autre sobriquet que le trio a donné à Pierre.
Frédéric comprend que l’anonymat de l’attaque n’est plus aussi garanti que ce qu’en disait Luc. Il comprend très vite qu’il faudrait s’arrêter maintenant pour éviter les ennuis ou bien… aller plus loin. Il choisit la seconde solution, frappant à son tour Pierre. Frédéric utilise un poing américain, en métal. Ses coups s’abattent terriblement sur la mâchoire de Pierre. Delato masse son encolure meurtrie et frappe de son talon la main de Pierre.
– Cet enculé avait un gadget dans la main ! Alors ça fait quoi maintenant, James Bond ? ! crie Delato en s’acharnant sur la main au sol.
Pierre a déjà perdu connaissance mais Luc poursuit ses coups de pied dans le flanc et le visage du jeune homme, avant de se ressaisir.
– Stop ! Stop ! Il a son compte, prend conscience Luc.
Aux ordres, Delato s’arrête, nullement perturbé par ce qu’ils viennent de faire. Il ramasse le sac à dos et commence à le vider au sol, brisant consciencieusement le jeu d’échecs, dispersant les pièces dans l’obscurité. Frédéric fouille les poches de Pierre, emportant un portefeuille en cuir.
– Vite ! on se casse ! Allez ! Allez ! ordonne Luc en soufflant de la vapeur dans la nuit froide.
Les trois agresseurs marchent rapidement dans la rue. Luc s’empare du portefeuille, déchire la carte d’identité, prend un billet de dix francs et une carte téléphone, puis jette le reste dans une poubelle de rue. Le lycéen s’est vite dégrisé des bières qu’il a bues.
– Bon, on va chez moi. Ma vieille est en train de dormir je pense… commence-t-il à expliquer.
– Putain, on va se faire attraper ! s’écrie Frédéric d’une voix paniquée.
– Faut le finir ! dit Delato en se retournant.
– Vos gueules ! répond Luc d’une voix ferme.
Les deux autres lycéens se figent devant le sang-froid démontré par Luc. Delato est habitué à lui obéir, Frédéric se tait, attendant une solution qui lui permette d’éviter la sanction. Pour aucun d’entre eux, l’état dans lequel ils ont abandonné Pierre ne leur pose un souci, en dehors des désagréments qui pourraient en découler pour eux.
– Donc, ma vieille dort, elle a pris des somnifères cet après-midi. On rentre chez moi en douce, sans la réveiller. On fait comme si on avait regardé une cassette en bouffant des chips. Vous allez m’aider à en avaler un ou deux paquets rapidos. Quand ce sera fait, j’irai la réveiller pour lui dire que nous avons faim et qu’elle avait promis de nous cuisiner des pâtes. Elle sera aux fraises, donc il faudra la convaincre qu’elle vous avait accueillis en rentrant du hand, et que vous aviez parlé avec elle, vers 20 h 15. Cela lui arrive souvent d’oublier qu’elle s’est réveillée. Elle jurera que nous étions à la maison bien sagement, on ne sait rien pour l’autre bâtard, explique Luc.
– Mais il va nous dénoncer ! s’exclame Frédéric.
– Pas sûr qu’il nous ait reconnus. Mais… ? Et ensuite ? Ce serait sa parole contre la nôtre. Nous étions avec ma mère, elle pourra en jurer. Personne ne nous a vus, on répondra qu’il nous en veut au lycée et cherche à nous faire porter le chapeau. Frédéric, tu vas balancer ton poing américain dans le prochain égout, tu l’essuies avant. On va vérifier nos pompes, s’il n’y a pas de traces, poursuit Luc.
Dix minutes plus tard, le trio arrive au pied de l’immeuble où habite Luc qui ouvre la porte du hall.
– N’allume pas, tête de nœud ! dit Delato en attrapant le bras de Frédéric.
Tous les trois grimpent silencieusement jusqu’au premier étage, sans croiser personne. Luc ouvre discrètement l’appartement, ses deux amis se glissent à sa suite. Ils attendent dans le noir tandis que Luc s’enfonce dans le couloir. Quand il revient, il allume la lumière du salon et hoche la tête en souriant. Tandis qu’il met le magnétoscope en route, appuyant sur la touche avance rapide, Delato ouvre des paquets de chips qu’il a pris dans le buffet du salon. Luc éparpille ses affaires et les sacs de ses copains, comme s’ils étaient arrivés depuis longtemps. Il complète la mise en scène en froissant le plaid du canapé, écrasant les coussins. Il arrête la cassette et affiche le temps à l’écran.
– Ok, nous étions là à 20 h 15. Nous avons regardé 1 h 21 du film. Il est 21 h 40, ça colle. Je vais réveiller ma mère. Vautrez-vous sur le canapé, recommande Luc.
Frédéric est silencieux, perdu dans ses pensées. L’idée d’être reconnu coupable, d’assumer ses actes lui est insupportable. Mais il n’a aucun scrupule d’avoir frappé Pierre. Delato est souriant, confiant dans le plan de Luc, comme toujours. Depuis qu’ils se connaissent il n’a jamais eu à se plaindre de l’amitié de Luc. En retour, il lui est d’une fidélité sans faille. Le dernier qui a tenté de séparer ces deux-là a fini la bouche en sang. C’était en classe de CP.
Luc entre dans le salon avec sa mère. La femme est âgée de 45 ans environ, elle a les cheveux ébouriffés. Divorcée, elle élève seule son fils qui va un week-end sur deux chez son père.
– Bonjour les garçons, dit-elle en bâillant.
– Re-bonjour Madame Mausky, répond gentiment Frédéric, tandis que Delato se lève en habitué et fait la bise à la femme.
– Re-bonjour ? Nous nous sommes vus tout à l’heure ? interroge la femme un peu perdue.
– Mais oui Maman, nous sommes rentrés du hand à huit heures et quart. Tu m’as dit de mettre un film en attendant que tu te réveilles pour cuire des pâtes… Mais il commence à être tard, dit Luc en regardant la pendule du salon.
– Oh là ! Oui. On est quand ? Vendredi ? Ah oui, tu n’as pas cours demain, et ce n’est pas le week-end de ton père. Je ne me souviens plus, désolée, je prends des somnifères en ce moment et j’ai du mal à émerger. Dès que je suis de nuit, je suis dans le cirage, dit la mère de famille en faisant référence à son métier d’aide-soignante.
– On peut rentrer chez nous madame, si vous préférez, dit Frédéric d’une voix de gentil garçon.
– Mais non, pas du tout, je suis contente de recevoir les amis de mon fils. Mais il est tard, c’est vrai, téléphone donc chez toi pour prévenir, mon garçon. Quant à toi, Gérald je vais appeler ta mère moi-même, propose la femme gentiment.
Tandis que Frédéric tourne le cadran du téléphone pour appeler ses parents, Luc et Gérald se regardent en souriant, sortant les assiettes du buffet du salon, serviables comme deux adolescents modèles.
*
Dans l’obscurité et le froid, Pierre est toujours inconscient. La boue du sol refroidit son corps, limitant les douleurs, et surtout les saignements.
C’est une guerre ! Une guerre totale…
Au-delà de la douleur, du froid, une lumière ténue semble briller. Pierre s’y agrippe comme un marin se tiendrait à un rocher glissant, dans une nuit de naufrage.
*
La mère de Luc sert les spaghettis à la louche, dans des assiettes creuses. Gérald tend la sienne de ses deux mains, il paraît affamé. La mère de famille rit et remplit son assiette à ras bord, souriant au jeune homme. Elle fronce les sourcils et fait remarquer.
– Dis donc mon grand, tu as un sacré bleu dans le cou. Que t’est-il arrivé ?
Frédéric devient blême, son regard ne peut quitter le visage de la mère de famille. Là encore, Luc sauve la situation, sans aucune hésitation, avec un naturel et un contrôle de soi qui impressionnent ses deux amis.
– Ah oui, tu as vu ça ? Il a pris un méchant arrêt à l’entraînement, le ballon a rebondi dans la cage et l’a touché sur le côté, explique Luc.
– Ouais, mais je l’ai bien arrêté ce tir-là ! surenchérit Delato.
– C’était vraiment un coup d’enfoiré, celui-là, fait remarquer Luc.
– Eh bien dis donc, c’est dangereux d’être gardien, dit la mère de famille en mangeant.
– Oui, mais t’inquiète, on s’est bien vengé après, hein les gars ? demande hilare Luc.
Les deux autres rient et acquiescent en avalant les spaghettis. La mère de Luc termine sa bouchée et regarde le cou de Gérald.
– Tout de même, c’est une méchante contusion, je te mettrai de la pommade après le dîner, sinon ta mère ne voudra plus être mon amie, plaisante la femme.
– Merci, madame, répond Delato tout sourire.
*
Pensez « échecs », problèmes, être mis en échec, être bloqué, arrêté dans ses envies, frustré.
La lumière est toujours lointaine, très lointaine. Il n’y a pas de bruit, c’est un silence total. « Soit une droite dans l’espace, passant par un point a, et… » le point lumineux, c’est le point a ? Pas de réponse. Le silence est toujours là, avec juste ce point de lumière au loin, et le… froid ? Oui, il fait froid. Et puis soudain, comme à travers une multitude de murs épais, un bruit, une rumeur ? Des aboiements ? Je ne sais pas…
*
– Oh ? Qu’est-ce que tu as trouvé là ? Pinocchio ? Où es-tu le chien ?
Le vieil homme marche dans l’obscurité, pas très rassuré. Mais son chien pleure et l’appelle. Il ne grogne pas, il ne doit pas y avoir de danger. Habitué à la lumière des réverbères, l’homme allume son briquet, qu’il tient devant lui comme une torche. Il sursaute quand il découvre une forme humaine au sol. C’est un jeune, le visage en sang. Pinocchio est couché contre lui, léchant une main qui est violette.
– Meeeerrrdeeee… murmure le vieil homme entre ses dents.
D’abord convaincu que la personne est morte, il prend conscience que le gars est vivant quand le corps est agité de tremblements. Le vieil homme attache son chien à sa laisse et le tire rapidement vers la cabine téléphonique du coin de la rue. Tremblant, il compose le 18.
Quand 8 minutes plus tard le véhicule de premier secours arrive, le vieil homme guide les pompiers vers le terrain derrière la cuisine centrale. Les lampes torches éclairent le corps ensanglanté.
– Merde, c’est un gosse, dit le vieil homme tandis que son chien geint à côté de lui.
– PS1 au rapport : besoin de l’intervention d’une Unité Mobile Hospitalière du SAMU au plus vite, pour victime inconsciente. Trauma de la face, respiration difficile, saturation 85, intubation nécessaire. Multiples contusions et fractures probables. Prévenez la police également, c’est une agression, annonce le chef d’agrès.
La police arrive après le véhicule du SAMU. Le brigadier regarde le terrain éclairé par le lampadaire démontable des pompiers. Le sol est boueux, c’est une bonne nouvelle, bien vite démentie par les innombrables traces de bottes des pompiers, des chaussures de l’équipe du SAMU. Le corps a été déplacé, installé au chaud dans le camion. Inutile de rechercher des empreintes éventuelles, la scène est définitivement polluée… Mais comment faire autrement ?
Le brigadier toque à la porte du camion du SAMU.
– C’est la police !
La porte s’entrouvre, l’ambulancier lui répond tandis que le médecin et l’infirmier sont en pleine réanimation. Le médecin tente d’intuber le patient, ses gants sont pleins de sang. L’infirmier pose une voie d’abord, une perfusion dans un bras blanc qui se termine par une main énorme, violacée, refermée sur un objet.
– Salut, bon il est vivant mais dans le coma. C’est une agression, il a été roué de coups. Nous n’avons qu’une chaîne en or avec une médaille de baptême, date 25/12/1971, et un prénom gravé : Pierre.
– C’est grave ? demande le policier.
– Très difficile à intuber, heureusement qu’il est jeune, le cœur tient bon. Il a un pneumothorax, une hémorragie interne, sans doute la rate, sa mâchoire est brisée, c’est pour ça que j’ai galéré. Sans doute d’autres fractures… On va au KB 1, la régul’ a prévenu… annonce le médecin aux policiers. Tu passes deux culots, ordonne-t-il à l’infirmier.
*
Chez le jeune garçon, ses parents sont assis devant la télévision, comme tous les soirs. La mère de Pierre regarde une fois de plus la pendule dorée sous son globe de verre. Trois boules tournent dans un sens avant de repartir dans l’autre. Les aiguilles affichent 22 heures trente. En chemise de nuit et robe de chambre, la femme souffle en donnant un petit coup de coude à son mari.
– Dis donc, il est de plus en plus en retard le vendredi. ça ressemble à rien de garder son assiette comme ça. Pfff ! Tout ça pour jouer aux échecs. Ah tiens, voilà François, dit la mère de famille en souriant.
En effet, le frère aîné de Pierre a ouvert la porte d’entrée et vient saluer ses parents. Il est âgé de 20 ans, étudiant en filière économie. Sa mère l’informe du retard de son petit frère.
– Il doit être avec ses copains, il ne devrait pas tarder, dit négligemment François.
– Ou avec une copine, propose la mère avec une lueur dans le regard.
– Lui ? Ce serait étonnant, répond François d’un air suffisant.
2 - Clouage
Action d’immobiliser une pièce adverse.
Vendredi, octobre 1987, banlieue de Chartres.
Aujourd’hui Claire fête ses huit ans. Papa et Maman lui offrent un jeu de dames, en plus d’une nouvelle peluche. La petite fille est la fierté de ses parents qui ont mis du temps pour concevoir cet enfant unique. C’était inespéré d’après le médecin de famille, mais quelle joie c’est de voir grandir et mûrir leur petite Claire. Vive, intelligente, pétulante, la petite fille fait preuve de dispositions particulières pour la scolarité. C’est une enfant que certains parents qualifieraient de surdouée, ou avancée. Ses parents sont peu enclins à faire évaluer les performances de Claire. La façon dont l’institutrice s’occupe d’elle, mélange d’exigence, de bienveillance et de respect de son âge, convient parfaitement aux parents de Claire, un peu déroutés par la personnalité de leur fille. Elle est intelligente et précoce, mais aussi mature dans ses relations avec les adultes. Claire est attentive à ses parents, c’est comme si c’était elle qui prenait soin d’eux. La psychologue de l’école, qui a fait une évaluation à la demande de l’enseignante, se demande si c’est parce que « ses parents l’ont eue tard », et que l’enfant fait en sorte d’être inconsciemment toujours à la hauteur de leurs espoirs. Ou bien, comme ils paraissent plus âgés que les parents de ses camarades de classe, peut-être Claire cherche-t-elle à les ménager, comme on prendrait soin de ses grands-parents.
– D’ailleurs, dans cette famille, il y a une absence totale de grands-parents présents, fait remarquer doctement la psychologue.
– Ah bon ? répond l’enseignante en servant deux tasses de café.
– Oui, c’est la petite qui me l’a confié. Elle ne les a jamais connus, ils étaient tous déjà morts avant sa naissance, explique la psychologue en tournant sa cuillère.
– Aïe ! Mais alors, elle va bien Claire ? Que doit-on faire ? demande l’institutrice un peu perdue, regrettant d’avoir demandé l’avis à la psychologue scolaire.
– Mais oui, elle va super bien, c’est une gamine formidable. Ne change rien, les parents n’ont pas du tout envie de la transformer en petit chien savant et de la faire sauter plusieurs classes. La petite t’adore, tu as la bonne méthode. Elle suit la classe et fait les exercices que tu lui donnes en plus sans rechigner. Ses parents sont satisfaits. Si ta question est : peut-elle encaisser un petit surcroît de travail pour prendre de l’avance ? La réponse est oui. Pour le passage avancé en classe supérieure, bien qu’elle en ait largement les capacités, je m’y opposerai, au même titre que toi. Personne ne le demande, ni elle, ni toi, ni ses parents, donc cela s’arrête ici. Tu as répondu à la demande du rectorat de signaler les élèves à potentiel, je l’ai évaluée, fin de la procédure, conclut la psychologue d’une voix chaleureuse.
L’institutrice rougit de contentement : son expertise est remarquée et en plus elle va conserver la petite Claire dans sa classe. Cette enfant concrétise tous ses espoirs d’enseignante. C’est pour ce genre d’élèves, issus d’une famille modeste, que l’école permet l’ascension sociale. Claire donne raison au système dans lequel croit l’enseignante.
*
Octobre 1987, nuit de vendredi à samedi, banlieue sud de Paris.
À l’hôpital du Kremlin Bicêtre, le jeune enregistré sous Pierre X est transféré de la salle de déchocage au bloc des urgences. Dans la pièce qui précède la salle opératoire, plusieurs chefs de clinique regardent les divers clichés de radio qu’ils posent sur un meuble lampe, un négatoscope. Le chef de chirurgie viscérale et son interne discutent avec le chirurgien plastique.
– L’urgence c’est la rate. Elle saigne, tout le sang transfusé s’accumule dans l’abdomen qui est ultra-dur. Il y a deux côtes pétées, je ne m’inquiète que de celle-là qui a déchiré la plèvre, d’où le pneumothorax, pris en charge par le SAMU. Les doigts brisés ont été immobilisés en déchoc, l’ortho a dit que ce serait suffisant pour le moment. À voir la reprise de mobilité… soupire le chirurgien.
– Est-ce que tu crois que je peux bosser sur la mâchoire pendant que tu t’occupes de la rate ? interroge le plasticien.
– Non, on va se gêner, et l’anesthésiste ne voudra pas changer l’intubation avant que ce soit stabilisé en bas. Tant que ça saigne, tu ne pourras pas intervenir… répond le chirurgien.
– Absolument ! annonce l’anesthésiste en entrant dans le poste de soins.
– Salut ! répondent les trois chirurgiens en chœur.
– Bon allez, il faut commencer, l’hémorragie s’accentue. 9 grammes d’hémoglobine, on va encore passer des culots de sang, il faut y aller, recommande l’anesthésiste-réanimateur.
– Quand ils auront fini la laparo 2, je m’occuperai de la mâchoire, ça te va ? propose le plasticien.
– S’il reste stable, c’est ok, conclut le réanimateur.
Pendant que le bloc opératoire s’active, une infirmière emporte des sacs en plastique avec les affaires du jeune Pierre. Elle va au sas d’entrée où l’attendent deux policiers en tenue.
– Tenez messieurs, voici le vestiaire du petit gars. Une chaîne de baptême donc, vous le savez déjà, une pièce de jeu d’échecs qu’il serrait dans sa main, elle est fissurée, et voilà son sac à dos qu’a rapporté le SAMU, dit la jeune femme en pyjama vert en tendant un sac à dos boueux sous plastique.
Les policiers commencent à ouvrir et fouiller, l’infirmière leur demande de sortir du sas, pour ne pas risquer de contaminer le bloc. Les policiers se retrouvent dans le couloir terne, désert à cette heure. Le brigadier examine le sac à dos, bien vide. C’est dans la petite poche du devant qu’il trouve un vieux ticket RATP jaune, avec un numéro de téléphone inscrit sous un prénom : « Patrice, nouveau numéro ».
Le policier retourne à la voiture, traversant la salle d’attente des urgences pédiatriques dans un silence soudain, suivi par des regards curieux. Son collègue comprend le silence gêné des parents en voyant les vêtements ensanglantés à travers le sac transparent du bloc.
Après avoir passé ses consignes, l’équipage de police retourne au commissariat. L’officier de police judiciaire de permanence appelle le numéro de ce Patrice. Avec un peu de chance ce sera une connaissance de Pierre. Avant de composer le numéro, le policier demande au chef de poste si aucune famille ne s’est encore manifestée. La réponse est non, il est près de 23 heures. Le policier hausse les épaules et téléphone.
– Allô ? Bonsoir Madame, c’est la police, le commissariat de Bicêtre. Pardonnez-moi de vous déranger, j’ai besoin d’un renseignement. Je suppose que votre fils s’appelle Patrice, c’est cela ?… Non, non, il n’a rien fait de mal. Nous avons trouvé votre numéro de téléphone dans les affaires d’un jeune garçon agressé ce soir, prénommé Pierre. Nous recherchons son nom et sa famille… Ah ! Parfait, je vous écoute… Je vous remercie. Lévêque ? Pierre Lévêque… Non surtout pas, non, donnez-moi le numéro seulement, c’est à nous de prévenir la famille. Je vous remercie madame. Je suis désolé, je n’ai pas le droit de vous donner les détails. Il est à l’hôpital, au bloc opératoire. Bonsoir madame, bonsoir, clôt le policier.
Son collègue raccroche lui aussi de sa conversation avec l’hôpital. Son regard n’annonce pas de bonne nouvelle.
– C’était la cadre des urgences. Le gamin est au bloc opératoire, pour plusieurs heures. Il a subi un traumatisme crânien et était toujours dans le coma avant de passer au bloc. Et toi, tu as son nom ? On appelle chez lui ? demande le second policier.
– Oui, Pierre Lévêque. Le Patrice sur le ticket de métro, c’est Patrice Martin, son copain de classe. J’ai eu la maman au téléphone, son fils était avec Pierre au club d’échecs jusqu’à 21 heures, au centre communal en bas. Pierre remontait à l’arrêt du 131, en passant par la cuisine centrale, ça se tient, c’est lui, c’est sûr. La mère m’a donné les coordonnées de la famille, explique le policier en ouvrant son tiroir à clef.
– Tu appelles ? redemande le second policier.
– Non, on y va, je préfère annoncer la nouvelle en direct, répond le policier en sortant son arme du tiroir pour la ranger dans son étui de ceinture.
*
Il est 23 heures 30. Les parents de Pierre entrent dans la chambre de François.
– Il n’est toujours pas là ! s’écrie la femme avec une voix de crécelle.
François regarde sa montre.
– Il fait fort, là, dit-il calmement.
– Tu connais ses copains ? Quelqu’un chez qui appeler ? demande le père agacé.
– Bah non ! Vous savez comment il est, toujours à tout cacher, à s’enfermer pour lire son courrier. Je ne les connais pas ses potes, j’ai quatre ans de plus que lui je vous rappelle, on n’a jamais joué ensemble, fait remarquer François.
– Oh la la ! c’est la chiotte ! vocifère la mère en retournant dans le salon.
Cinq minutes plus tard, la sonnerie de l’interphone retentit.
*
Pensez combats et non parties…
La lumière ténue semble se rapprocher, comme les bruits, qui paraissent plus distincts. Des bips de jeux vidéo. Pierre est toujours dans le noir, excepté le point lumineux qu’il ne lâche pas du regard. Sinon, c’est l’obscurité complète et le froid autour de lui. Sans douleur, il ne ressent plus de douleur, ça c’est bien. Et puis, plus rien…
*
Octobre 1987, samedi début d’après-midi, banlieue sud de Paris.
Marguerite, la mère de Patrice, progresse avec habitude dans le CHU de Bicêtre où elle a travaillé comme infirmière. Avec elle se trouvent Patrice, Arnaud et Émilie. Toute la matinée les trois adolescents ont multiplié les appels téléphoniques pour tâcher d’obtenir des nouvelles de leur ami Pierre et se relater leurs échecs. Personne ne répond chez Pierre et la police ne veut rien dire. Ancienne membre du personnel, Marguerite a proposé d’emmener tout le monde sur place pour tenter d’obtenir des renseignements.
Quand le petit groupe parvient aux portes de la réanimation, Marguerite se présente à un ancien collègue et explique son intérêt pour le jeune lycéen.
L’infirmier sort dans le couloir pour parler discrètement.
– Écoute, pour le moment je ne peux pas te dire grand-chose, la famille est dans le bureau du chef avec la police, commence l’infirmier.
– Mais comment va Pierre ? s’écrie Arnaud en l’interrompant.
– Il est vivant. Il est toujours dans le coma, il a reçu de nombreux coups à la tête, les chir’ l’ont opéré toute la nuit, il est ici en réa. Écoute, les parents devraient bientôt sortir, tu verras avec eux pour avoir des détails, explique l’infirmier à Marguerite.
*
Dans le bureau du chef de la réanimation sont assis la mère de Pierre et son frère. Debout sur le côté se tient un inspecteur de police qui a repris la procédure après ses collègues de nuit. Le médecin a fait le récit des interventions chirurgicales de Pierre. Devant l’air incrédule de la mère de famille, le réanimateur dresse à nouveau le bilan.
– Je vous le répète, il est stabilisé désormais. Nous avons arrêté toutes les sédations, votre fils n’a plus que les antalgiques, pour lutter contre la douleur. Pierre a reçu plusieurs transfusions de sang, nous avons dû lui retirer la rate, il pourra vivre sans, je vous rassure. Cela nécessitera quelques vaccins supplémentaires à l’avenir. Trois doigts de la main droite ont été fracturés, sans déplacement, des attelles et un plâtre ont été nécessaires. C’est tant mieux, cela aurait pu être pire. Je crains que les séquelles physiques les plus sérieuses soient dues à son maxillaire inférieur brisé, sa mâchoire du bas, simplifie le médecin.
– Et sa dent cassée, vous n’avez pas pu la recoller ? interroge la mère de famille, focalisée sur ce détail.
– Non, mais ce n’est pas le plus important, je pense. Pour réparer le maxillaire, le chirurgien a pratiqué une incision sur le bas de la joue, Pierre en conservera une cicatrice. Avec le temps, selon l’aspect, il sera possible de pratiquer des reprises, par un chirurgien esthétique. Mais ce sera à voir dans une ou deux années, pas avant. L’incisive pourra être appareillée par un dentiste en ville, ce n’est pas le plus délicat, tente de rassurer le médecin.
– Avec ce que rembourse la sécurité sociale ! réagit la femme.
– Madame, je ne sais si votre mari pourra venir me rencontrer, pour que je lui explique, mais… commence le médecin.
– Mon père ne supporte pas l’odeur de l’éther, des hôpitaux, il attend dehors, explique François très sérieusement.
Le médecin jette un regard au policier qui attend les bras croisés, adossé à une armoire de fer. Il hausse rapidement les sourcils en réponse au médecin qui reprend patiemment mais plus fermement, ses explications.
– C’est trop tôt pour se préoccuper de cela. Votre fils a subi un traumatisme crânien important, parce qu’il a reçu des coups de ses agresseurs. Pour le moment, il n’est pas encore sorti du coma. D’après l’imagerie, son cerveau ne montre pas de lésion, mais seul un examen neurologique complet permettra de s’assurer qu’il n’aura pas de perte de capacité. Ne restez pas fixée sur le détail de la dent cassée, madame, votre fils n’est pas encore hors de danger, il est en réanimation, les jours prochains seront décisifs, insiste le médecin.
– Heu, attendez, tout à l’heure, vous nous disiez qu’il était stabilisé, il faudrait savoir, fait remarquer la mère de famille d’un air pincé.
– Physiquement, oui, il est stable. Nous ne sommes plus inquiets quant à ses lésions physiques, elles ont été traitées par les chirurgiens. L’inconnu ce sont les dommages au cerveau, qu’il faudra apprécier au décours des semaines suivantes. Il faudra de la patience. Vous pouvez le visiter, lui parler, cela l’aidera à revenir parmi nous, recommande le médecin.
– S’il reste un légume, qui le prendra en charge ? Cela coûtera très cher ! s’exclame la femme paniquée.
Le médecin s’impatiente, s’agace devant le comportement de la mère de Pierre. Il décide de changer de stratégie et de s’adresser au frère aîné.
– Je dois retourner m’occuper de mes patients. Allez voir votre frère dans sa chambre, parlez-lui, soyez présent, il se peut qu’il vous entende. Madame, je vous laisse avec ce monsieur de la police qui a des questions à vous poser, dit le médecin en se levant pour sortir avec François.
Le policier s’assoit au bureau du médecin sur son invitation. Il prévient François qu’il lui parlera également, après sa mère. Il se présente puis fait le point sur l’enquête.
– Votre fils a été victime de plusieurs agresseurs, nous en sommes convaincus, entre trois et cinq nous pensons. Il n’y a pas eu de témoins de la scène, je vous avoue que ce sera difficile de progresser sur les simples éléments matériels. Votre fils a été volé, il n’avait plus le portefeuille dont vous nous avez parlé cette nuit. C’est possible que le vol soit le mobile, mais ses affaires ont été dispersées, brisées, je ne peux m’empêcher d’y lire de la rage, comme si Pierre connaissait ses agresseurs. Vous lui connaissez des ennemis au lycée, ou dans le quartier ? interroge le policier.
– Donc, si vous ne retrouvez pas les coupables, ce sera à nous de payer pour tous les frais, c’est cela ? demande la mère de famille sans répondre à la question.
– Madame, il y a les assurances, la vôtre comme celles des autres doit participer aux frais j’imagine et… poursuit le policier avant d’être interrompu.
– On les connaît les assurances ! vocifère la mère de famille.
Dans la chambre de Pierre, son frère François est assis sur la chaise à côté du lit de réanimation. Depuis le départ de l’infirmière qui l’a accompagné, il n’a rien dit. Pierre est immobile, un moniteur affiche ses rythmes cardiaque et respiratoire. L’adolescent a la tête bandée, ses yeux sont cerclés de noir, virant au jaune sale. La main droite est plâtrée, le bout des doigts violacés se distingue sur le drap jaune. François se concentre sur l’écriture du liseré bleu « Assistance Publique » qui est imprimé sur la longueur du drap. Depuis plus d’un quart d’heure, l’étudiant ne sait quoi dire à ce frère qu’il connaît si mal et n’apprécie guère en fait. Il finit par se lever.
– Putain, tu fais chier ! Dans quel pétrin tu t’es encore fourré ? ! s’exclame-t-il tout haut avant de sortir de la chambre.
François retrouve sa mère dans le couloir, en présence du policier qui lui demande à son tour s’il connaît des ennemis à son frère.
– Des ennemis ? C’est un peu excessif quand même, mon frère n’est pas si important que cela… Après, il a une capacité à se faire détester des autres, un air supérieur qui agace. Souvent dans sa scolarité cela a été comme cela, dit François très sûr de lui.
– C’est-à-dire ? Que voulez-vous dire ? interroge le policier.
– Pierre est très bon à l’école, ça énerve les autres, d’autant plus qu’il a tendance à se la raconter un peu, faire son premier de la classe, quoi, explique François.
– Réussir à l’école n’est pas une tare, non ? répond le policier sérieusement.
– Mon frère est prétentieux, il a tendance à prendre tout le monde pour des cons, cela n’aide pas à se faire des amis, remarque François.
La discussion en reste là, François se contente de répéter qu’il ne connaît ni les amis ni les camarades de classe de Pierre. Le policier regagne le poste des infirmières pour photocopier les comptes rendus pour son dossier d’enquête. François ouvre la porte de la réanimation pour sortir, sa mère rencontre Marguerite qui vient aux nouvelles. La mère de Patrice commence par se préoccuper de la santé de la mère de Pierre, ce qui constitue la meilleure des approches.
Tandis que les deux femmes discutent, François remarque Émilie entre Patrice et Arnaud, dont les visages lui disent vaguement quelque chose.
– Vous êtes potes avec mon frère ? interroge-t-il d’un air très mature.
– On peut le voir ? demande Arnaud, pas impressionné.
– Oui, mais à deux maximum seulement. Je peux t’accompagner, si tu veux ? demande gentiment François à Émilie.
La jeune fille accepte, laissant Patrice et Arnaud à l’extérieur. François désigne à Émilie les surblouses en papier et les masques à revêtir. Il ajoute aux amis de son frère, avant de refermer la porte :
– Vous n’aurez qu’à venir après nous, les gars.
Patrice et Arnaud se regardent en silence. Les deux fois où ils ont croisé le frère de Pierre, l’étudiant n’avait pas été chaleureux du tout, voire méprisant. Arnaud résume l’impression générale.
– Sans Émilie, il ne nous aurait rien proposé, c’est vraiment un connard, dit Arnaud en faisant attention de ne pas être entendu par les deux femmes qui parlent non loin de lui.
*
… il faut faire preuve de stratégie, d’intelligence, de lecture du jeu de l’adversaire, de compréhension des pièces maîtrisées…
Le bruit est revenu, mais lointain. La lumière est très faible. Pierre flotte toujours dans une semi-obscurité. Il entend des voix, comme si des gens parlaient dans une pièce à côté, derrière une porte. C’est un sentiment étrange. En se concentrant, les paroles deviennent audibles. C’est paradoxal ces deux voix associées, en principe leurs propriétaires ne sauraient se parler, pas même se rencontrer.
– Oh, mon Dieu ! C’est affreux ! Son visage !
– Le médecin a dit que ça s’arrangera avec le temps.
Puis il y a quelqu’un qui pleure.
– Je suis désolé. On va l’aider, il est fort, pas vrai mon frérot ? ! dit une voix familière.
– Il nous entend ?
– Je ne sais pas, le médecin disait que oui tout à l’heure, mais j’en doute. Il n’a aucune réaction. Tu es dans sa classe ?
– Non, au club d’échecs seulement. Je ne suis pas du même lycée.
– Tu es en terminale ? À Paris ?
– Non en première, mais oui, à Paris, dit une voix de jeune fille.
– Tu fais plus que ton âge. Moi je suis en première année d’éco’, à la fac. Tu es toute pâle. Nous allons laisser la place à ses amis, je t’emmène prendre un chocolat au distributeur. Je crois qu’il ne faut pas trop le fatiguer…
Les voix s’éteignent. Pierre retrouve la lumière dans la grisaille.
Où est la dame blanche ? Où est-elle ? Je l’avais dans la main, quand…
Des éclairs se déchaînent soudain. Pierre se réfugie loin, le plus loin possible dans le noir, dans un angle. Il faut se mettre à l’abri des attaques, un mouvement pour se cacher derrière sa tour, dans un angle. Le Grand Roque.
*
Quand Patrice et Arnaud sortent de la réanimation, tous les deux sont silencieux. Ils ne sont restés que 10 minutes dans la chambre de Pierre avant que l’interne ne les fasse sortir. Quand ils ont parlé à leur ami, ils ont eu l’impression que ses yeux remuaient. Marguerite leur dit que c’est sans doute vrai, que les patients de réanimation entendent tout, comprennent tout ce qui se passe sur le moment, même si certains oublient à leur réveil.
– Quand je travaillais en réa, je saluais mes patients à chaque prise de service, je me présentais, j’expliquais les soins. Je crois que c’est très important, vous avez bien fait de lui parler. Mon copain infirmier me tiendra discrètement au courant, il a vu que je m’entretenais avec la maman de Pierre à sa sortie du service. Vous pourrez revenir mercredi après-midi, sauf avis contraire, ou risque infectieux. Sa maman a autorisé les visites, à ma demande. Au fait, c’est elle qui a raccompagné Émilie chez elle, ils sont repartis tous les trois quand vous étiez dans la chambre, dit Marguerite en explication aux regards que jettent les garçons.
Dans le hall, Arnaud dit au revoir à Patrice et sa mère. Il habite à cinq minutes de l’hôpital et va rentrer chez lui à pied. En sortant, il voit le policier qui s’apprête à monter en voiture. Le jeune lycéen se met à courir puis toque au carreau au moment où le policier démarre.
– Je suis un ami de Pierre. Je pourrais vous parler, Monsieur ?
*
Octobre 1987, lundi matin, banlieue sud de Paris.
La rumeur s’est propagée à la vitesse de la poudre. Un élève du lycée aurait été agressé vendredi soir, puis les bruits ont été plus précis, les sonneries de téléphone ont retenti chez les uns et les autres. Dès samedi soir l’identité de Pierre était révélée, bientôt connue de tous ou presque.
En ce lundi matin, ceux qui savent informent les derniers arrivants dans la cour du lycée. Les conversations ne portent que sur cela, l’un des leurs s’est retrouvé à l’hôpital. Beaucoup d’élèves sont choqués, d’autres pas vraiment touchés. La violence fait partie de leur vie depuis longtemps, les agressions pour un mauvais regard existent depuis toujours.
Un groupe de trois filles discutent avec Frédéric et Delato, alors que Luc marche vers eux. Gérald va au-devant de son ami, hilare.
– Il paraît que James Bond s’est pris une raclée !
– Oui, je sais, les flics sont venus chez moi, dit Luc en souriant.
– Quoi ? ! dit une lycéenne.
– Hein ? ! fait une autre.
– Apparemment un petit malin a bavé que je pourrais être mêlé à ça, poursuit Luc, sûr de son effet, en serrant la main de Frédéric sans trembler.
– Vas-y raconte, dit une fille en lui faisant la bise.
Luc regarde aux alentours et voit Arnaud et Patrice qui l’observent un ou deux groupes plus loin. Il poursuit son récit, certain d’avoir l’attention de ses amis et de quelques autres curieux.
– Un connard a été chez les flics pour m’accuser de l’agression, les flics sont venus chez ma mère dimanche après-midi, pour nous interroger. Ce que le connard en question ne savait pas, c’est qu’à l’heure où James Bond s’est fait dérouiller, j’étais chez moi avec mes potes, qu’il a accusés également, dit Luc d’un ton méprisant.
– C’est dégueulasse ! dit une fille en allumant une cigarette en douce.
– C’est qui ce fils de pute ? interroge Delato d’une voix sourde.
– La police m’a demandé de ne pas le dire, ce sont des accusations sans fondement. Par respect pour la victime, je vais fermer ma gueule. Les flics ont minimisé la dénonciation, en disant que c’était la procédure de recueillir juste des « informations », je cite, et de les vérifier, explique Luc en mimant les guillemets.
– Ouais, bah c’est dégueulasse de faire ça ! répète la fille à la cigarette.
Plus tard, quand Luc, Delato et Frédéric sortent de la cantine, les trois lycéens montent dans le bâtiment numéro 3 par l’escalier extérieur. La position est dominante et avec le vent qui souffle, personne ne pourrait les entendre. Luc rassure ses deux copains.
– Ma mère a été parfaite, elle a remis les flics à leur place. C’est cette petite merde d’Arnaud Saran qui nous a accusés, révèle Luc.
– Tous les trois ? Ce con a vu juste, rit Delato.
– Il faut faire gaffe, les flics pourraient continuer à poser des questions aux autres. Tout le monde sait que nous ne pouvons pas blairer Lévêque, fait remarquer Frédéric.
– Oui, c’est pour ça que toi, tu vas laisser Arnaud Saran tranquille, dit Luc à Gérald.
– Moi ? dit Delato d’un air faussement innocent.
– Oui. Si lui aussi se fait dérouiller, autant se donner aux flics directement. Non, je vois quelque chose de plus subtil. Ce qu’a dit Fred est vrai : les flics pourraient interroger tous les autres, ils vont peut-être le faire, explique Luc.
– On fait quoi alors ? demande Delato.
– Ce que j’ai commencé ce matin, montrer que nous n’y sommes pour rien et que Saran a prononcé de fausses accusations. Bientôt toute la classe le traitera comme un mouchard et un menteur, poursuit Luc.
– Oui, mais tu n’as pas donné son nom, fait remarquer Frédéric.
– Je compte sur votre amitié pour que les filles soient au courant, discrètement bien sûr. Un secret pareil, ça ne restera pas longtemps un secret, sourit Luc.
– Il s’en sort encore trop bien ! s’écrit Delato en tapant son poing dans sa paume.
Luc regarde ses amis et devient froid et menaçant.
– Il ne va pas s’en sortir comme cela. On va lui foutre la pression, mais jamais devant un témoin. Il faut faire ça en douce, mais lui pourrir la vie. D’ici quelques jours tout le lycée saura que c’est une balance et en plus à tort, annonce Luc très sérieusement.
C’est l’heure des cours de langue vivante. Patrice rejoint la classe d’Allemand, tandis qu’Arnaud est en Espagnol, avec Luc et sa bande. Arnaud entre parmi les derniers retardataires dans la classe. Il s’assoit au premier rang. Luc et Delato sont au troisième rang, la table double sur leur droite est celle de Frédéric, qui la partage avec la jeune fumeuse du matin. La jeune fille tend son index pour désigner Arnaud. Frédéric hoche la tête. L’adolescente tourne la tête et mime un « c’est lui » avec ses lèvres en regardant sa meilleure amie.
Luc feint de ne rien remarquer, mais il est satisfait. Il comprend avec une acuité rare pour quelqu’un de son âge que la tendance est en train de s’inverser. L’agression de Pierre, l’absent, est en train d’être oubliée au profit de la trahison d’Arnaud, le présent, qui est assis là, devant toute la classe.
Frédéric ne lâche pas Arnaud de son regard. Abattre celui-là, c’est protéger son avenir. Si Pierre sort du coma et les accuse, il donnera raison aux accusations d’Arnaud. Mais si d’ores et déjà Arnaud n’est pas cru, ou mieux, considéré comme un menteur, le témoignage de Pierre ne paraîtra pas solide. Les trois ont un alibi, tout le monde témoignera de la haine d’Arnaud et Pierre à leurs égards. Frédéric se sent moins en danger, même si tout cela lui laisse un goût d’amertume. Mais « il ne faut pas se faire prendre, jamais ! » pense-t-il en fixant la nuque d’Arnaud devant lui.
C’est un regard de haine pure, une attention malsaine qui se met en place, se focalise sur un objectif. Arnaud est la nouvelle cible, Pierre ne peut pas intervenir, il est cloué dans son lit d’hôpital.
3 - Attaque double
Attaque simultanée d’une pièce adverse par deux pièces ennemies.
C’est toujours la nuit, l’obscurité. Loin, il y a la lumière pâle, toujours présente. Pierre pense parler tout haut. Il ne ressent rien, à part du froid.
J’ai perdu ma dame, c’est fichu. Je vais perdre la partie…
Une voix s’élève de nulle part, c’est celle du professeur d’échecs, l’ingénieur chimiste.
Parce que tu as perdu une pièce ? ! Dis donc Pierre, tu te laisses aller, là. Tu as perdu ta dame ? Et alors ? Joue sans elle ! De quoi as-tu peur ?
Pierre est surpris par la réponse. Il a l’impression de se retourner, de chercher autour de lui une présence, mais comment savoir si quelqu’un est là quand vous ne distinguez pas même votre main sous vos yeux.
On ne peut pas gagner sans sa dame, c’est pas poss…
Hé là ! C’est quoi cette mentalité de victime ? Et les autres pièces ? Tes cavaliers, ta tour blanche ? Ce sont des pions ? Une dame, ça se retrouve, on peut en fabriquer une autre, il faut se donner du mal c’est vrai, aller la chercher, la conquérir dans le camp adverse. Arrête de t’apitoyer Pierre, ta partie ne fait que commencer, si tu abandonnes dès les premiers coups, alors oui, tu vas perdre.
Est-ce que je n’ai pas déjà perdu ?
Non, sinon tu ne serais pas là à m’en parler. Le chronomètre est simplement arrêté, la partie reprendra quand tu le souhaiteras. N’abandonne pas, jamais !
Mais…
JAMAIS !
*
En cours de sport les deux classes de Première S sont réunies au gymnase pour deux heures de volley-ball. La première heure est consacrée à l’entraînement, l’apprentissage des différentes techniques. L’élève fait une passe au professeur qui est au filet et sert pour un smash. Dans la file en attente, Delato sourit.
Quand vient son tour, il n’a aucun mal à monter au filet et faire le geste qu’il maîtrise parfaitement. Avec la main en coupelle, il frappe la balle qui file à grande vitesse droit sur Arnaud, qui vient juste de faire l’activité et la reçoit en plein visage. L’élève porte sa main à son nez, visiblement douloureux. La seconde professeure arrête les tirs d’un geste de la main, son collègue se saisit de la balle qui lui est envoyée au lieu de la servir au filet.
La professeure se dirige vers Arnaud pour lui demander comment il va. Delato arrive en petite foulée et présente ses excuses.
– Désolé vieux ! J’ai pas fait exprès ! Ça va ? demande-t-il sans vraiment attendre une réponse.
L’essentiel est là pour les professeurs, l’auteur de la maladresse vient présenter ses excuses, sans ricaner, même si d’autres ne se gênent pas. Cela arrive au sport. Arnaud est envoyé aux lavabos se passer de l’eau froide sur le visage. Le coup a sans aucun doute été douloureux, l’élève Delato est plutôt doué ; mais rien de cassé, pas de saignement.
Patrice observe Arnaud qui revient sur le terrain. Il remarque que beaucoup sourient ou ont un regard méprisant pour son ami, ce qui est nouveau.
Arnaud rejoint Patrice à la fin de la file. L’activité continue.
– Depuis plusieurs jours, ils ne me lâchent plus… murmure Arnaud.
– Il faut en parler, recommande Patrice.
– Après ce que j’ai dit aux flics ? Je ne suis plus crédible, le lycée pensera que j’ai une rancune contre ces trois-là. C’est foutu, personne ne me croira. Ils me tombent dessus quand je suis seul, jamais devant les autres, explique Arnaud.
L’activité change, ce sont maintenant des passes entre deux élèves. Patrice et Arnaud restent ensemble. Une balle atterrit à leurs pieds, Frédéric arrive en courant pour la ramasser. Au passage il chantonne à côté d’Arnaud.
– Saran, Saran, ça-rend-dingue-eu ! !
Puis il repart, sans même avoir jeté un regard, mine de rien. À part les deux amis, personne n’a remarqué l’incident, la provocation.
– Je vais aller en parler, moi, dit Patrice à Arnaud.
– Non ! Non, ne fais rien. À part attirer l’attention sur toi, c’est tout ce que tu obtiendras. J’ai parlé trop vite, j’aurais dû attendre que Pierre se réveille… commence Arnaud avant de s’interrompre, submergé par l’émotion.
Patrice comprend l’angoisse qui étreint Arnaud. Et si Pierre restait dans le coma pour toujours ?
*
François et sa mère sont debout dans la chambre de Pierre. Le médecin vient de les recevoir dans son bureau. Pierre n’est toujours pas sorti du coma, cela est dû aux chocs qu’il a reçus à la tête. Le cerveau a cogné à l’intérieur de la boîte crânienne, ce qui lui a causé des commotions, des coups. C’est ce qu’a compris François, sa mère n’a pas vraiment écouté. Elle reste focalisée sur le coût des soins, pourtant très hypothétique.
La mère de famille semble perdue, incapable de montrer quelque chaleur ou spontanéité. François entretient son inquiétude, en partie par jeu, en partie pour conserver l’ascendant sur sa mère.
– Le remplacement de la dent, ça coûte cher ? demande-t-il l’air de rien.
– Un pivot ! Tu penses ! s’exclame sa mère.
– En plus, s’il n’y a pas de responsable, les assurances verseront moins.