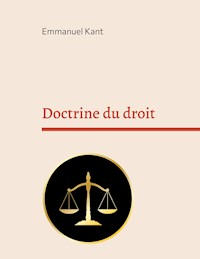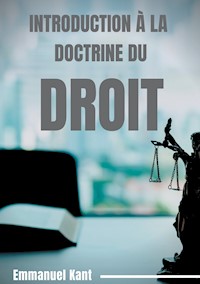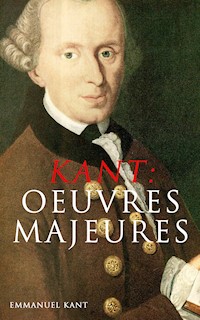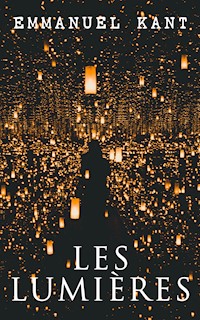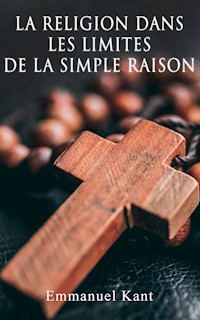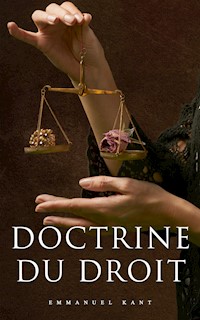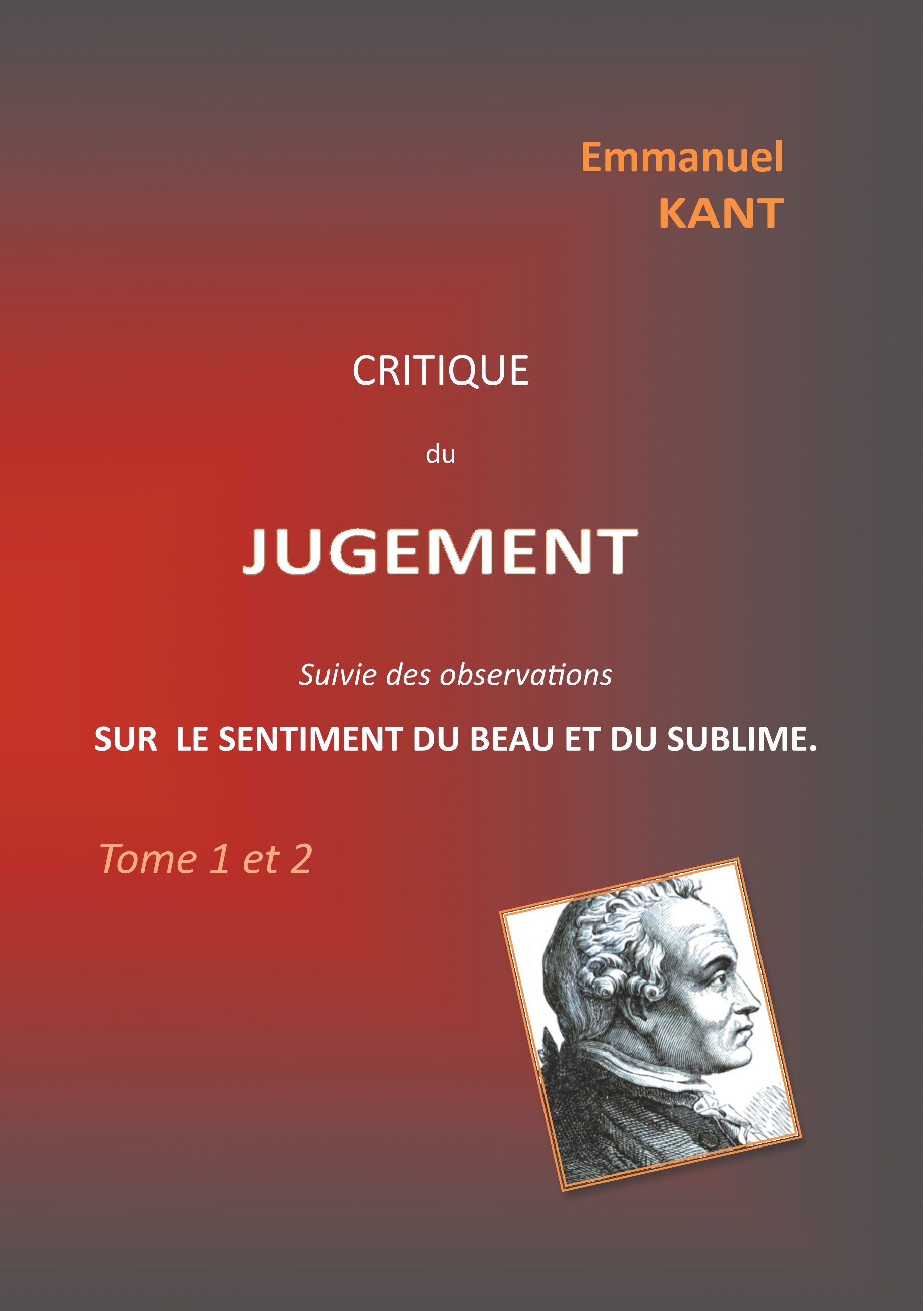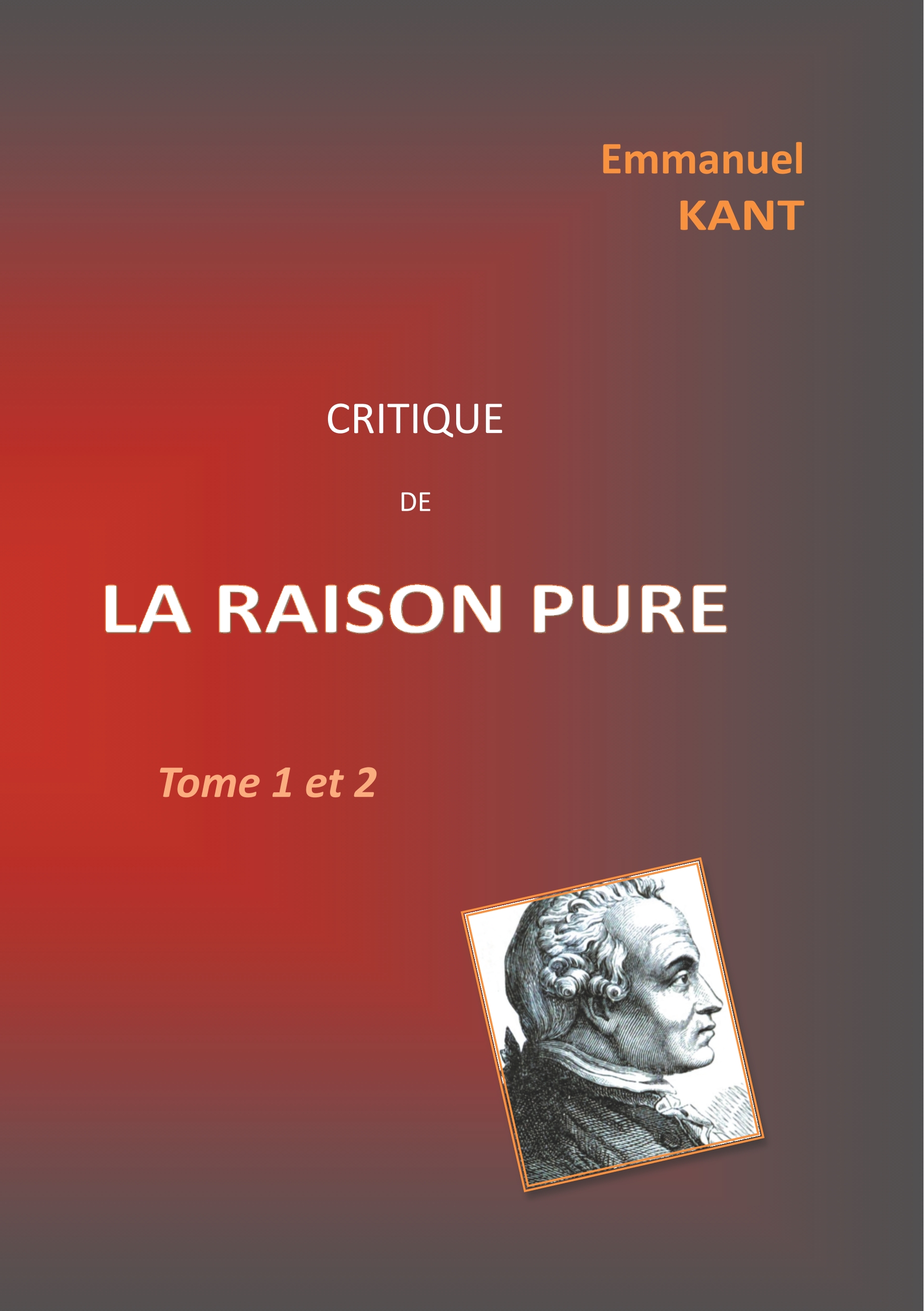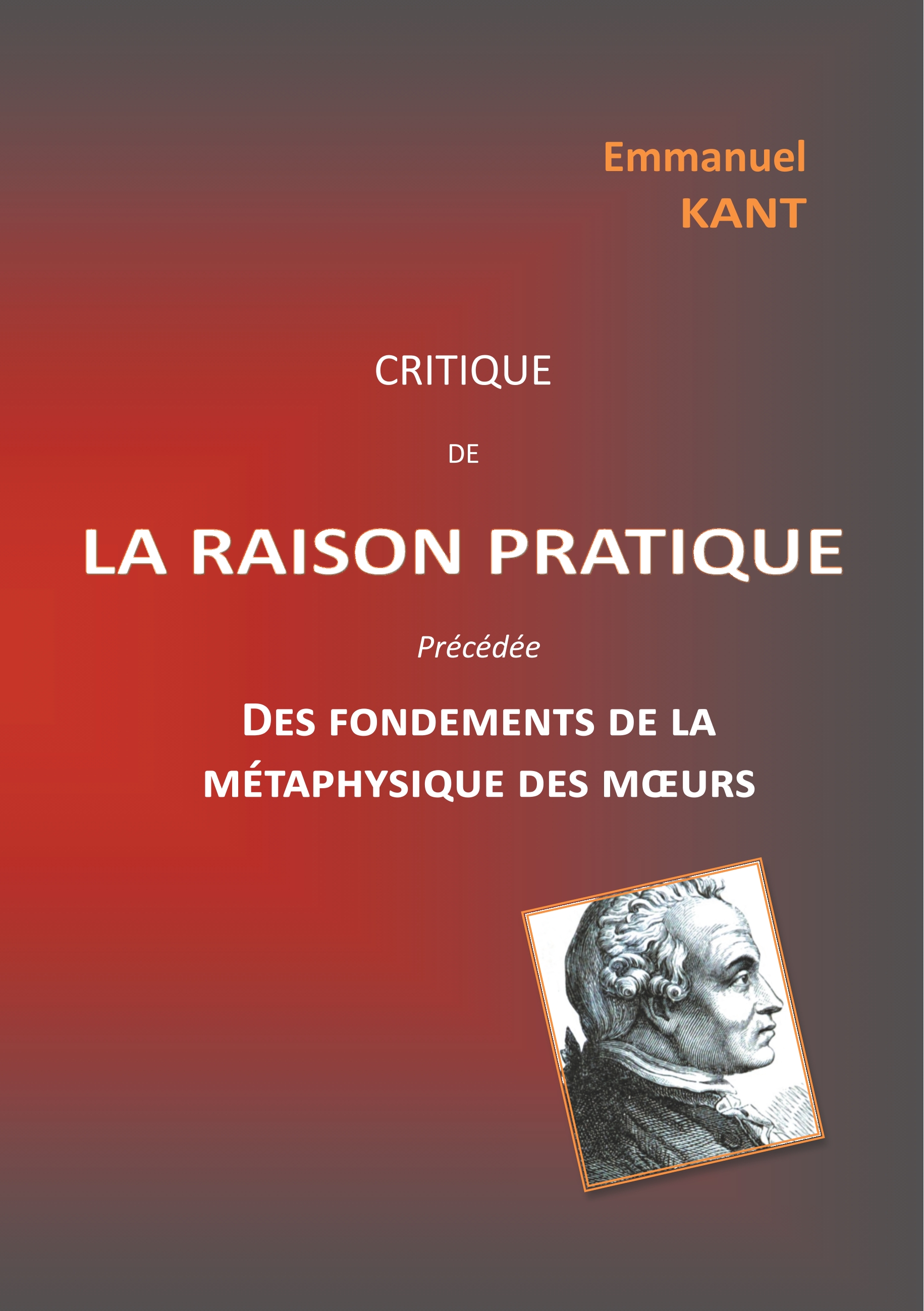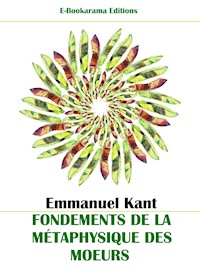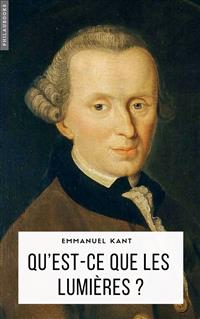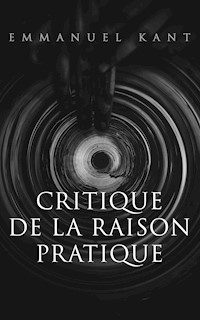
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Critique de la raison pratique abandonne l'analyse de la raison dans son usage spéculatif pour se consacrer à son usage pratique. Elle concerne donc le domaine de l'agir et non plus celui de la connaissance théorique. Elle aura une influence déterminante dans les champs de l'éthique et de la philosophie morale. L'une des innovations notables de la Critique de la raison pratique par rapport à la Fondation de la métaphysique des mœurs (1785) est l'apparition de la notion d'un faktum (fait non empirique) de la loi morale, qui s'impose à la raison alors même qu'elle ne peut être déduite analytiquement du concept positif de liberté et de dignité, puisque nous connaissons ce dernier par la loi morale, et non l'inverse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Critique de la raison pratique
Table des matières
AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR
En donnant, cent ans après la première édition de la Critique de la raison pratique, une nouvelle traduction française d’un ouvrage qui a, surtout depuis un demi-siècle, occupé les moralistes, il nous a semblé convenable de rechercher comment s’est introduite en France la philosophie, de Kant. C’est une opinion généralement accréditée que, seuls avant Cousin et son école, Villers, en 1801 et Mme de Staël en 1813, auxquels on ajoute quelquefois Degérando, avaient tenté de la faire connaître. Une lecture attentive des ouvrages philosophiques qui ont paru de 1789 à 1815, des découvertes heureuses dues au hasard, des écrits inédits gracieusement mis à notre disposition, nous ont fuit adopter une opinion diamétralement opposée.
I
Il faut se rappeler d’abord que Strasbourg avant, pendant et après la Révolution, était un centre intellectuel où l’on étudiait toutes les œuvres importantes qui, paraissaient de l’un et de l’autre côté du Rhin, où des étudiants allemands se rencontraient avec des étudiants français, où le futur conventionnel Grégoire eût pu discuter avec Goethe le Système, de la nature. Avant la Révolution, Kant y était connu et ses travaux cités fréquemment dans les thèses. Dès 1773, Walther, dans une thèse à laquelle présidait Müller, nommait, avec Bacon et son immortel ouvrage, avec Descartes qui tient le premier rang entre les restaurateurs de la philosophie, avec Locke et A. Smith, avec Berkeley et Hume, Kant et sa Dissertation sur la forment les principes du monde sensible, et du monde intelligible, qui contient déjà, comme on sait, quelques-unes des idées, fondamentales de sa philosophie définitive et qui ne date que de 1770. La même année, dans un ouvrage de ce genre, Luiz, qui faisait de Bonnet un pompeux éloge, mentionnait une autre dissertation de Kant, sur Je seul fondement possible d’une démonstration de l’existence de Dieu. En 1775, la Dissertation inaugurale de Kant est encore citée, par Juncker, à côté des ouvrages de Bonnet, de Garve, de Maupertuis, de d’Holbach, de Hume et de Warburton. Il est naturel, que les maîtres qui appelaient ainsi l’attention de leurs élèves sur des productions de Kant relativement peu importantes, aient étudié avec soin la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique, qui parurent avant la Révolution et même la Critique du jugement, qui est de 1790. On sait d’ailleurs que c’est seulement vers. 1786 ou 1787 que, grâce surtout à Reinhold, l’attention fut appelée en Allemagne sur la philosophie de Kant. De 1789 à 1794 se produisirent en France les prodigieux événements qui firent une impression si profonde, sur les penseurs de tous les pays, qui amenèrent liant lui-même à déroger à des habitudes, devenues pour lut une seconde nature, occupèrent entièrement ceux qui auraient pu s’intéresser aux doctrines nouvelles et qui auraient justement dit de l’époque tout entière ce que Sieyès disait de la Terreur. Deux mois après la chute de Robespierre, le 27 septembre 1794, Müller, le professeur dont nous avons déjà parlé, écrit a Grégoire que la philosophie de Kant, encore inconnue en France, mérite d’y être transplantée. Puis, quinze jours plus lard (12 octobre), répondant à, Grégoire, qui avait désiré que Blessig ou Muller s’essayassent sur une esquisse de la philosophie critique, ce dernier écrivait qu’il fallait à la France une philosophie spéculative établie sur des bases qui résistent à l’athéisme, au matérialisme, au scepticisme, qui soit capable de détruire le règne du Système de la nature et dé tous ceux qui tendent à avilir la nature humaine. Il insistait, après Reinhold, sur les appuis immuables que le kantisme prête aux dogmes de l’existence et des attributs de Dieu, de l’immortalité de l’âme, et aux vrais fondements de la morale, interprétant ainsi le criticisme tout autrement que Cousin et comme le comprennent à peu près aujourd’hui M. Renouvier et ses disciples. Il se préparait en même temps à entreprendre la tâche que lui avait proposée Grégoire. Muller meurt en février 1795, son ami Blessig apprend, par les papiers publics, que Sieyès veut faire connaître le système de Kant et il écrit à Grégoire, en avril 1796, qu’il craint qu’on ne trouve en Kant, si l’on ne saisit pas bien son raisonnement dans l’ensemble, un patriarche du scepticisme et même de l’athéisme, que, par conséquent il faudrait à l’ouvrage une introduction bien serrée pour les principes et bien intelligible. Il serait bon, en outre, d’y joindre un précis de l’ouvrage que Kant a donné sur la religion chrétienne. Pour en finir avec Blessig, rappelons encore une lettre de 1810, où considérant surtout les écoles de Kant, de Fichte et de Schelling, il voit dans leurs doctrines le panthéisme tout pur, se plaint que les idées qui ont pour objet d’extirper les penchants au lieu de les subordonner à la loi morale, se sont introduites chez les théologiens protestants, dans des universités et monastères catholiques, surtout chez les bénédictins, et se croit obligé de les combattre dans une lettre pastorale dont il envoie un exemplaire à Grégoire.
II
La philosophie de Kant était, par d’autres voies encore, proposée à l’examen des penseurs français. Il y aurait lieu de mettre successivement en relief les indications que pouvaient leur fournir les publications de l’Académie de Berlin, les travaux des philosophes qui, en Suisse, écrivaient en langue française, ceux des Français qui, traducteurs ou commentateurs, avaient entrepris de faire connaître à leurs compatriotes la philosophie de Kant, soit pour la combattre ; soit, pour en recommander l’adoption. Mais nous serions ainsi exposé à des redites, ce qui nous arriverait également d’ailleurs si nous voulions exclusivement suivre l’ordre chronologique. Nous préférons donc exposer, en donnant toujours des indications chronologiques très précises, d’une manière un peu plus libre, les essais tentés pour faire connaître aux philosophes français les travaux de Kant.
En 1793, Mérian, dans un Mémoire sur le phénoménisme de Hume, avait exposé et combattu la « philosophie réformatrice du grand philosophe de Kœnigsberg », en 1797, il donnait un Parallèle historique des deux philosophies nationales, celle de Wolf et celle de Kant. Tout en reconnaissant à Kant un esprit original, profond et subtil, avec les talents nécessaires pour le faire valoir, en le plaçant au-dessus de Wolf et sur la même ligna que Leibnitz, Mérian rappelait à ceux pour lesquels Kant est venu achever le grand ouvrage commencé par J. C pour lesquels le Christ nous a manifesté Dieu en chair, et Kant, Dieu en esprit, que Kant pourrait avoir un successeur comme il avait succédé à Leibnitz, sans même laisser en mourant un Wolf pour appui de sa cause, pour propagateur de sa doctrine. Et, la Décade annonçait le 10 fructidor an IX (août 1801), quinze jours après l’ouvrage de Villers ; le volume dans lequel était inséré le dernier travail de Mérian. Dès 1792, Ancillon passait en revue ; dans une dissertation latine, les jugements de Kant, sur l’existence de Dieu ; son Dialogue entre Berkeley et Hume, de 1796, était souvent une satire contre le terminologie de Kant. Les deux Mémoires d’Engel en 1801, sur la réalité des idées générales ou abstraites, sur l’origine de l’idée de force, qui exercèrent une si grande influence sur M. de Biran, étaient dirigés contre Hume et Kant. Il faut encore citer des Mémoires, de Selle, de Schwab qui, dirigés contre le Kantisme, étaient, comme les précédents, capables d’en faire connaître les grandes lignes aux philosophes français.
En 1796 (août) la Décade annonce la traduction, par Hercule Peyer Imhoff, des Observations sur le sentiment du beau et du sublime, un des plus curieux ouvrages de l’époque antérieure à l’apparition des doctrines criticistes, dans lequel Kant se montre, comme dit Barni, fin et spirituel observateur, et parle des femmes avec une délicatesse et un respect qui feraient supposer qu’il n’est pas toujours resté indifférent aux attraits qu’il peint si bien.
En 1797, Benjamin Constant combat, dans les Réactions politiques, l’opinion d’un philosophe allemand qui allait jusqu’à prétendre qu’envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime, Et Benjamin Constant déclarait à Kramer qu’il avait eu en vue Kant. Ce dernier l’apprit et publia la même année un opuscule intitulé D’un prétendu droit de mentir par humanité, dans lequel il défendait sa doctrine et ses principes. Il ne se rappelait plus, disait-il, en quel endroit il avait soutenu ce que critiquait B. Constant, mais il semble bien, d’après l’exemple cité par B. Constant, accepté par Kant et repris par Mme de Staël, qu’il s’agissait de l’article Mensonge de là Doctrine de la vertu.
La Décade signalait aussi aux lecteurs français les traductions de Werther et de Woldemar, la correspondance de Lessing avec Gleim, la publication du Spectateur du Nord, la traduction du Théâtre de Schiller, d’Hermann et Dorothée, de l’Obéron de Wieland, du W. Meister de Goethe, d’odes de Klospstock, du Laoocon, de Herder, etc. Il y aurait pour les historiens de la littérature allemande, un bien curieux et substantiel chapitre à écrire sur l’influence exercée ; de l795 à 1800, par les écrivains allemands, sur les productions littéraires de la France à cette, époque. Mais pour nous limiter à ce qui forme l’objet spécial de notre étude, nous signalerons deux curieux articles sur les Perceptions obscures que publia dans la Décade, le 7 et le 17 octobre 1797, Dorsch, employé au ministère des relations extérieures. Il montrait que la métaphysique, devenue une science en partie exacte depuis Locke et Condillac, était la base des sciences morales et politiques. « Les Allemands, disait-il, la cultivent avec ardeur, si leur marche est lente, ils ne sont pas stationnaires, s’ils n’ont point notre audace, ils creusent profondément ; Kant y fait une révolution. Depuis Aristote et Descartes, personne n’a eu plus de prépondérance métaphysique. Sa philosophie est peu connue en France, mais il serait à désirer que quelque Allemand, bien au fait de cette école et de notre langue, en traduisît la doctrine. M. Dortsch, professeur à l’Université de Mayence, pourrait rendre ce service. » Six semaines plus tard, la Décade annonçait les Essais philosophiques de feu Adam Smith, précédés d’un Précis de sa vie et de ses écrits, par D. Stewart, traduits par Prévost ; Ginguené en donnait deux extraits dans la Décade du 20 novembre et du 10 décembre. Il insistait sur la division faite par Prévost les philosophes en trois écoles : l’école écossaise, l’école française et l’école allemande, qui a eu Leibnitz pour chef et dans laquelle domine aujourd’hui Kant. Prévost, ajoutait Ginguené, reconnaît dans Kant des qualités éminentes, mais voudrait, qu’on distinguât ce qui lui appartient de ce qu’il s’est approprié ; il croit avantageux, pour le progrès de la science, de traduire en français les ouvrages de Kant, mais estime que cette entreprise est très difficile. A peu près à la même époque paraissait la traduction du Projet d’un traité de paix perpétuelle.
Le 10 floréal an VIII (30 avril 1800), François de Neufchâteau présentait à l’Institut son Conservateur ou recueil de morceaux inédils d’histoire, de politique, de littérature et de philosophie, en 2 volumes. Il avait eu, disait-il, l’idée de faire travailler à une Bibliothèque germanique et il citait, pour justifier ce projet, les noms de Bode, de Pallas, de Humboldt, de Kastner, de Lichtenberg, de Schiller, de Göthe, de Wieland, de Voss, de Stolberg ; mais, les matériaux les plus nombreux qu’il avait recueillis portaient sur la métaphysique de Kant, qui a remplacé Leibnitz et fondé une nouvelle école de philosophie. Dans le Conservateur il donna ceux qui lui semblaient les plus propres à faire connaître ce système, qui fait tant de bruit et occupe tant de penseurs, à côté de traductions, en vers métriques et hexamètres par Turgot, d’une partie de l’œuvre de Virgile, du rapport secret sur le Mesmérisme par Bailly, de lettres de Buffon à l’abbé Bexon, du Précis de l’abbé Dubos par Thouret, de lettres de J.-J. Rousseau, de remarques de Voltaire sur les Essais poétiques d’Helvétius et de notes d’Helvétius sur un exemplaire des Œuvres de Voltaire, de pièces relatives à l’enterrement de Molière et de Voltaire. Les morceaux qui portaient sur Kant formaient une partie considérable du second volume et comprenaient, sous le titre de Choix de divers morceaux propres à donner une idée de la philosophie de Kant qui fait tant de bruit en Allemagne, la Notice littéraire sur Kant et la traduction par Villers de l’opuscule sur l’histoire universelle ; puis une traduction de la Théorie de la pure religion morale, considérée dans ses rapports avec le pur christianisme, par Ph. Huldiger qui l’avait augmentée d’éclaircissements et de considérations générales sur la philosophie critique et avait mis en tête une, épigraphe empruntée à saint Mathieu : Heureuse ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Huldiger avait choisi cet ouvrage, qui n’est qu’une application des principes de la philosophie de Kant à la théorie de la religion, parce qu’il était peu volumineux, et même il s’était servi d’un Abrégé fait pour les cours publics d’une université d’Allemagne, parce qu’il voulait sonder le goût du public avant de lui faire connaître l’édifice dont il ne montrait qu’un étage. L’ouvrage lui paraît très piquant par la singularité, la force et l’enchaînement des idées, très essentiel et très consolant dans tous les temps par la matière qui en fait l’objet. La doctrine, présentée sous un point de vue neuf, lui semble prise dans la nature et nous apprend que nous avons en nous deux bases pour la religion, l’une qui tient à notre essence comme créatures intelligentes d’un être avec qui nous avons le rapport de connaître sa loi et sa volonté, l’autre tenant à notre état de faiblesse, à notre situation périlleuse qui nécessite les secours d’une main pure et puissante : belle théorie qui fait de la religion la voie du bonheur et qui prouve la sainteté de l’origine du christianisme, son identité avec la nature humaine et le caractère d’universalité qu’on ne peut reconnaître qu’en lui seul. Il signalait quatre principes fondamentaux dans cet ouvrage : 1° l’homme est méchant naturellement, sans l’être par essence ; 2° il possède dans son âme un idéal de perfection morale qu’il peut et qu’il doit réaliser ; 3° la nécessité de triompher du mal et d’établir invariablement le bien, donne naissance à l’idée d’une société civile et éthique, uniquement fondée sur les lois de la vertu, dont Dieu même serait le législateur et le chef suprême, et de cette idée découle, pour chaque individu, le devoir de travailler de toutes ses forces à l’établissement de cet empire divin ; 4° le culte que Dieu recevrait dans cette société ne pourrait être qu’un culte moral. En dernière analyse, lorsqu’on remonte ; parle secours de la raison pure et abstraite jusqu’à la première source du mal, on découvre qu’il, provient d’une détermination du libre arbitre de s’écarter de la loi morale et, qu’en bien comme en mal, le libre arbitre n’a pas d’autre motif de ses actions que sa détermination, franche, indépendante, absolue ; par conséquent le mal ne peut être expliqué que comme une adoption du libre arbitre qui s’est laissé séduire et qui a fait tomber l’homme d’un état pur et sain dans l’état misérable du péché : voilà donc l’origine du mal moral reconnue, et tel est le squelette de la vérité que tous les peuples, dans leurs traditions antiques, ont habillé diversement, que la majestueuse Écriture elle-même a cru devoir envelopper de quelques allégories. L’unique occupation de notre vie, conformément au, seul besoin réel de notre existence morale, doit être de l’anéantir en nous pour réhabiliter le bien sur ses ruines. Par conséquent les trois grands devoirs, de l’homme, de se rendre heureux lui-même, de contribuer à la félicité de ses semblables, d’amener sur la terre le règne, le triomphe et la gloire du souverain bien par essence, ne pouvant être remplis qu’en s’efforçant de réaliser l’idéal de la perfection morale, il est d’obligation stricte, pour, chaque individu de travailler à la fondation et à la propagation de la société éthique ou de l’église dans laquelle seulement cet idéal serait produit en réalité. Le scrutateur des cœurs sera seul le législateur et le chef de la société éthique, racine de l’église universelle ; le culte qu’on lui rendra sera purement moral, les cérémonies ne seront que des stimulants pour la moralité, n’acquerront du prix et de l’influence que par elle. C’est là une des plus belles idées religieuses et morales que notre siècle ait vu éclore et c’est dans l’Evangile Bien conçu, dans ce foyer de toute lumière et de toute sagesse que l’auteur l’a puisée ; non seulement elle forme la base de la morale en général et de la conduite de tout homme en particulier, mais elle est encore le modèle des sociétés politiques et de l’institution religieuse ; elle unit la religion, la morale et la poli¬ tique, embrasse le présent et l’avenir, se produit et se développe sous les caractères de l’unité et de l’universalité qui sont les marques indélébiles et positives du vrai.
Quant à l’ensemble de l’œuvre de Kant, il ne lui paraît pas douteux que les écrits de cet homme célèbre ne doivent opérer une révolution dans l’esprit humain, que Kant ne soit un homme de génie qui s’est servi de ce beau don du Créateur pour ouvrir une nouvelle carrière, qui a substitué la science certaine à la science fantastique, fixé les bornes des connaissances humaines en donnant la théorie de la sensibilité, de l’entendement et de la raison pure, prouvé victorieusement l’immatérialité, et par conséquent l’indestructibilité de l’âme, la liberté et l’existence de Dieu, affermi à jamais les bases d’une science aussi belle, aussi nécessaire, aussi universelle que la métaphysique, levé toutes nos incertitudes et comblé tous nos vœux. Ses écrits sont comme un fil pour se conduire à travers le labyrinthe où la vérité se cache à tous les regards : « Heureux, dit l’auteur, l’écrivain qui peut ainsi s’attribuer la gloire d’avoir été réellement utile à son espèce ! Nos derniers neveux donneront à sa mémoire l’éloge si rarement mérité qu’il a fait honneur à l’homme. »
On ne trouverait, croyons-nous, ni chez Villers, ni même chez Mme de Staël, une aussi claire compréhension du rôle que pouvait jouer un jour la philosophie critique, une appréciation aussi nette des services qu’elle peut rendre aux esprits qui sentent l’invincible besoin d’allier la métaphysique, la morale et la religion.
II
La façon d’apprécier Kant change avec l’apparition du livre de Villers.
Villers, né en 1765 à Boulay, dans la Meurthe, entra dans l’artillerie en 1780, tint garnison à Toul, puis à Metz, enfin à Strasbourg où il fut témoin des cures magnétiques de Mesmer et publia un roman, le Magnétiseur amoureux (1787). En même temps il étudiait le grec, l’hébreu et composait des essais dramatiques. Il accueillit la Révolution avec enthousiasme, mais se refroidit bientôt et fit connaître ses opinions dans divers opuscules, dont le dernier intitulé, De la Liberté (Metz 1791), eut trois éditions, mais l’obligea à quitter la France en 1792. Après avoir vainement essayé d’y rentrer, il se fit immatriculer comme étudiant à Göttingue et entra en relations avec les professeurs Eichhorn, Heyne, Kästner, Sartorius, Spittler et Schlözer, le célèbre historien. En 1797, il faisait paraître à Berlin les Lettres Westphaliennes du Comte de R. M, à Madame de H. sur plusieurs sujets de philosophie, de littérature et d’histoire — et contenant la description pittoresque d’une partie de la Westphalie. Dans cet ouvrage, qui est incontestablement de Villers, il était question du magnétisme animal et de la philosophie Kantienne : Jacobi trouva les lettres charmantes et Mme de Staël les lut avec un grand intérêt. Villers pensa alors à se rendre en Russie, où son plus jeune frère avait déjà trouvé une patrie ; mais en passant par Lübeck, il y rencontra la fille de. Schlözer, mariée à de Rodde, un marchand qui devint sénateur et bourgmestre ; il contracta une liaison qui dura toute sa vie avec cette femme ; que Mme de Staël, en 1803, appelait une grosse Allemande, dont elle n’avait pas encore percé les charmes.
Il s’appliqua dès lors à l’étude de la littérature allemande et surtout de la philosophie de Kant, il se donna pour tâche de faire connaître l’une et l’autre à la France. Un émigré français, Baudus, avait fondé à Altona une gazette, qui avait paru de juillet 1795 à janvier 1796, puis s’était fixé à Hambourg où il groupa comme rédacteurs du Spectateur du Nord, tous les émigrés qui avaient quelque talent. Rivarol y vivait alors et y publiait le Discours préliminaire du nouveau Dictionnaire de la langue française, qu’il ne devait jamais achever. Mme de Genlis y séjournait ; Delille y arrivait en 1799, Sénac de Meilhan y vivait quelque temps ; Chènedollé, l’abbé Louis et l’abbé de Pradt, Talleyrand pouvaient y rencontrer Jacobi et Klopstock, Villers fut le principal collaborateur de Baudus il donna une notice littéraire sur Kant et sur l’état de la métaphysique en Allemagne au moment où Kant avait commencé à y faire sensation. Il vantait l’incroyable variété des connaissances de Kant en physiologie, en histoire naturelle, en astronomie, en mathématiques, dans les belles-lettres et les différentes branches de la philosophie ; il montrait que Kant avait conjecturé l’existence d’Uranus découvert vingt six ans plus tard par Herschell, qu’il avait pris une place distinguée parmi les métaphysiciens et fixé sur lui l’attention générale par, l’écrit intitulé, Unique base possible à une démonstration de l’existence de Dieu, dont il avait depuis lors complètement désavoué la doctrine. L’importance de la dissertation inaugurale de 1770, l’influence exercée sur Kant par la lecture des Essais de Hume sur la nature humaine y sont fort bien marquées. L’apparition de la Critique de la Raison pure était signalée comme un événement qui devait produire dans le monde philosophique une révolution aussi étonnante, mais moins orageuse que celle qui se préparait dans le, mondé politique. Reinhold était présenté comme ayant réussi à faire goûter au public savant, en 1786 et 1787, la nouvelle philosophie. Tout en signalant l’appui que Kant semblait avoir donné par cet ouvrage à ceux qui disaient hautement que la métaphysique n’est au fond qu’une chimère, Villers montrait que Kant avait ouvert de nouvelles, routes au raisonnement, qu’il avait rétabli, en s’appuyant sur la moralité, de nouveaux arguments pour l’existence de Dieu, la réalité de notre libre arbitre, 1’immortalité de nos âmes ; mais il lui paraissait cependant que ce puissant athlète était plus vigoureux en terrassant ses adversaires, en renversant leurs systèmes, qu’en essayant de construire à son tour un nouvel édifice. Dans le même journal, Villers donna sous le titre de Critique de la Raison pure, une analyse abrégée de cet ouvrage qui fut reproduite en allemand sous les auspices de Kant, puis une traduction en 1798 de l’idée d’une histoire universelle dans une vue cosmopolitique, qu’il croyait propre à familiariser les lecteurs avec la tournure d’esprit particulière à ce philosophe, avec sa manière de raisonner et de présenter ses idées, parce qu’il n’y abordait point la métaphysique proprement dite, mais y développait son idée la plus chérie en politique et y exposait ses vues profondes sur la perfectibilité graduelle de l’espèce humaine. Cette traduction, réimprimée à part par Villers, le fut encore par François de Neufchâteau en l’an VIII, et un écrit imprimé trois fois, qui n’était pas sans analogie avec l’Esquisse des progrès de l’esprit humain, que Comte trouvait très remarquable, a été donné, sous forme de traduction communiquée à Comte par d’Eichthal, comme complètement inconnu en France par M. Littré dans A. Comte et la philosophie positive!
Dans le Spectateur encore, Villers fit paraître un fragment d’une traduction en prose de la Messiade, qu’il se proposait de faire connaître a Delille qui, peu versé dans la langue allemande, avait manifesté l’intention de faire, pour la Messiade, ce qu’il avait fait pour l’Énéide. A la-même époque, il est sérieusement occupé de préparer un ouvrage qui fasse connaître Kant aux lecteurs français : il hésite longtemps sur la forme à lui donner, pense à publier des Lettres à Émilie sur la philosophie, puis à faire des dialogues comme Platon et Jacobi. Enfin, il se décidera suivre, la division naturelle de sa matière, à la traiter simplement, sèchement et sérieusement, et en novembre 1799, il présente à Jacobi, dont il voudrait avoir l’avis, une esquisse de son plan ou de ses divisions, dont chacune demandera un plan à part et beaucoup dessous-divisions. En 1800, il est distrait un moment de ce travail par la traduction des Lettres à Ernestine, pour laquelle Vanderbourg, le traducteur attitré de Jacobi, lui cède ce qu’il avait déjà traduit, et qu’il songe à publier en France, lorsque Baudus refuse de la faire paraître dans le Spectateur du Nord. En 1801, Jacobi apprend par Vanderbourg, alors à Paris, qu’il est question d’un Mercure littéraire d’Europe, dont la rédaction principale serait confiée à Suard, et où la littérature allemande serait réservée à Vanderbourg : ce dernier voit Suard qu’il contredit, à qui il ne croit pas avoir plu, et qui lui paraît un peu lourd dans la conversation, un peu pédant, un peu vain et de plus fidèle à l’excès aux préjugés français contre la philosophie allemande. Jacobi souhaite ardemment que l’ouvrage de Villers paraisse bientôt, d’autant plus qu’il apprend, par Vanderbourg encore, qu’une traduction de la mort d’Adam de Klopstock a été jouée avec succès sur un des petits théâtres de Paris, tandis qu’on n’a jamais eu nulle part en Allemagne l’idée de la représenter. D’ailleurs le moment était favorable : Chênedollé, Baudus, Montlosier, Delille, presque tous les émigrés étaient rentrés en France, Rivarol se préparait lui-même à y revenir quand la mort le surprit ; Bonaparte, préoccupé d’affermir son pouvoir, se détournait du parti constitutionnel, qui comptait parmi ses membres Garat, Cabanis, D. de Traoy, Laromiguière, Daunou, Chénier, B. Constant, c’est-à-dire tous ceux qu’il appellera bientôt les idéologues ; il faisait déporter 130 démocrates, essayait de gagner le clergé à sa cause et négociait le Concordat ; Chateaubriand avait donné Atala et préparait le Génie du Christianisme, La Décade annonça le 20 thermidor, an IX (8 août l801), l’apparition de l’Exposition des principes fondamentaux de la philosophie transcendantale de Kant par Villers. L’ouvrage était dédié à l’Institut national de France, tribunal investi d’une magistrature suprême dans l’empire des sciences, juge naturel et en premier ressort de toute doctrine nouvelle offerte à la nation. Or l’auteur se plaignait que les programmes des académies et autres corps savants de France eussent été remplis, pendant les quinze-dernières années, de questions spéculatives faites avec une entière confiance, annoncées avec solennité, qui se trouveraient superflues et insignifiantes dans le point de vue de la philosophie transcendantale ; que pas un de ces corps savants, pas un de ceux qui écrivirent des mémoires sur ces questions n’eût discuté, ni mêmecité la nouvelle doctrine. Et pour bien montrer qu’il s’adressait à l’Institut, il avait soin de dire que si ce corps respectable eût été informé de ce que la philosophie critique enseignait depuis quinze ans, il n’aurait pas énoncé comme il l’avait fait, la question de l’influence des signes (p. 174). Il parle du suave Delille (LIV), qui avait maltraité la Révolution, et dédaigné l’Institut, fait l’éloge des émigrés, s’appuie sur l’autorité de Laharpe (LXVIII) et déclame comme lui contre le superficiel matérialisme, le grossier précepte de l’amour de soi qui voudraient nous ramener à l’état des brutes (LXVII) ; il ne croit pas nécessaire, dit-il en forgeant un mot nouveau, d’exposer plus au long ce sensualisme étroit qui fait tout le fond de la nouvelle métaphysique française, qui a ôté sa religion à la France, qui a placé les sens sur le trône de la métaphysique et l’intérêt sur celui de la morale, supprimant toute idée de moralité et d’honnêteté publique, paralysant la conscience, la dépouillant de la honte et de la pudeur, dégradant l’homme et amenant des maux incalculables, cette doctrine superficielle et niaise dont la dernière période est le jacobinisme, qui en était un corollaire indispensable, cet encyclopédisme, fantôme imposant au dehors, méprisable au-dedans, qui porta le nom de la vertu sur son front et alimenta de sa substance tous les vices. Aussi s’adresse-t-il surtout à cette jeune génération qui n’a reçu encore ni la doctrine sensualiste, ni les vices raisonnés des encyclopédistes, car il s’attend à une opiniâtre opposition de la part de quelques vieilles têtes de fer, qui ne peuvent rien changer à leur tendance et à leur organisation (art, VII). Et il maintient, dans sa conclusion, que la science et la moralité ne peuvent se rencontrer sur le chemin que suivent la plupart des philosophes français, que le principe du sensualisme pour la métaphysique et celui de l’amour de soi pour la morale sont incompatibles avec toute saine philosophie (401), Il ne laisse pas d’ailleurs échapper une occasion d’injurier les partisans de la philosophie du XVIIIe siècle, d’exalter leurs adversaires, de vanter l’Allemagne au détriment de la France, d’adresser aux doctrines qu’il combat des objections aussi contestables pour le fond que peu précises et injurieuses dans la forme. Il parle de la populace philosophique(132), voit dans le XVIIIe siècle une période imphilosophique et de bavadarge, estime qu’il n’a offert comme but au génie que le plaisir ou le gain, et qu’il ne faut rien voir autre chose, sous ce qu’on a appelé progrès des lumières, perfectionnement des sciences, conquêtes de l’esprit humain (146). Locke et Condillac sont restés à la superficie en ce qui concerne la véritable méthode (44) et l’origine des connaissances humaines (61) ; la soi-disant Logique de Condillac n’est qu’un mélange de psychologie empirique, de métaphysique et de théorie de la grammaire générale (47) ; il est difficile, à qui lit sans prévention les œuvres philosophiques de ce dernier, d’y trouver un plan quelconque et ; une unité de doctrine (150). Quant à Condorcet, le philosophe auquel peut-être se reconnaissaient le plus redevables les membres marquants de l’Institut, il est présenté comme ayant, dans son ouvrage posthume, refusé son assentiment à Locke, à Condillac et à tous leurs adhérents (176) et rangé avec Platon, Newton, Descartes, Leibnitz et Kant, parmi les adversaires de l’empirisme ! Et Villers prend encore la peine de distinguer Condillac de la tourbe de ses imitateurs et de tous ceux qui ont amplifié sur l’empirisme après lui et d’après lui (189). Si les ouvrages français les plus récents fourmillent de prétendues définitions de la philosophie, il n’y a rien à y apprendre, pas une idée saine à y acquérir (29). Les écrivains qui ont suivi Condillac ont disserté à perte de vue sur l’analyse, sur l’esprit humain, sur les idées claires, sur le rapport des signes, aux idées, mais l’école est restée en possession de la vraie logique (48). Les petits philosophes à la mode sourient avec compassion au seul nom de la métaphysique qu’ils ne comprennent pas (59), ils appelleraient métaphysicien le Cuisinier français, s’il s’était avisé de s’étendre un peu sur les propriétés des épices qu’il mettait en œuvre (147). Mais il faut que l’heure de l’empirisme sonne (92) ; il faut une métaphysique nouvelle et scientifique à la patrie de Lavoisier, de Lalande et de Laplace, une nouvelle théorie des arts à ceux qui possèdent aujourd’hui les plus fameux chefs-d’œuvre dont s’honoraient jadis d’autres contrées, une nouvelle morale, pure comme celle de l’Évangile et sévère comme celle du Portique, à une nation qui tend sérieusement à jouir d’une liberté raisonnable, qui ne veut plus ni libertins, ni terroristes, ni la corruption des cours, ni la férocité des clubs (206). D’ailleurs, il n’y a que des têtes systématiques qui soient capables de tirer parti de l’expérience : un faiseur d’expériences est un maçon qui peut bien aligner les pierres et remuer du mortier, mais il faut que la pensée de l’architecte ait précédé et réglé la place des matériaux (220). Parmi les adversaires de l’empirisme, Malebranche et Kéranflech ont exposé une philosophie qui repose sur une hypothèse, mais qui est religieuse et sublime (85), le kantisme, qui a donné au matérialisme le coup de grâce, sauve la morale et la religion des atteintes du raisonnement et de la spéculation enseigne à l’égard, de Dieu la doctrine de Saint-Paul (406), semble avoir été suscité par la Providence pour faire renaître universellement une religion positive (168), Ses adversaires sont des envieux et des Zoïles, des beaux esprits, des beaux diseurs, des aboyeurs ; il aura contre lui la frivolité française que caractérisent le persiflage, la légèreté et la dissipation, le bel esprit qui attire les sciences vers le superficiel, une secte niaise qui au nom du bon goût prononce sur tout en ignorant tout.
Dédier un semblable ouvrage à l’Institut, qui comptait parmi ses membres ou ses lauréats, Grégoire, Sieyès, François de Neuf château, qui avaient déjà essayé de faire connaître la philosophie de Kant, Reinhard venu en France vers 1786, Degérando et Prévost qui avaient déjà rendu une justice éclatante à Kant dans leurs ouvrages manuscrits ou imprimés, Volney, Garat, Cabanis, Lakanal, Daunou, Roederer, D. de Tracy, Laromiguière, Thurot, qui se rattachaient à Condillac pour là méthode tout au moins, qui tentaient alors, non sans succès, de donner un vigoureux élan aux recherches philosophiques et qui, loin d’être les alliés des jacobins, avaient pour la plupart été leurs adversaires ou leurs victimes, cela pouvait paraître singulier, mais était fort peu propre à faire étudier et accepter une doctrine précédée d’un préambule si injurieux pour les Français qui n’avaient pas émigré et étaient demeurés fidèles à la philosophie du XVIIIe siècle. Aussi la Décade philosophique, où écrivaient Ginguené, Roederer, Fauriel, Cabanis, J.-B. Say, etc., parlant du principe du beau dans les arts, citait un extrait du livre de Villers et raillait tout à la fois l’interprète et le philosophe : Le grand philosophe de la Germanie va nous apprendre, disait l’auteur, ce que personne avant lui n’avait imaginé que le principe de l’imitation de la nature dans les beaux-arts est, mesquin et insuffisant. Nous nous empressons de recueillir, avec respect et reconnaissance, les sublimes maximes de ce dernier, si célèbre dans les universités d’outre-Rhin, et qui doit un jour, avec plus de succès encore que Mercier, détrôner Locke et Condillac ».
Vingt jours plus tard, la Décade, par la plume de Ginguené, semble-t-il, revenait sur l’ouvrage de Villers : tout en raillant finement et sans pitié l’interprète, elle faisait l’éloge de Kant et s’engageait à discuter posément avec Villers, s’il voulait prendre la peine de motiver son analyse de l’intelligence humaine :
« Citoyens, disait l’auteur ; il vient de paraître un livre extrêmement divertissant, écrit dans le vrai style macaronique, et dont il est impossible de méconnaître le mérite, pour peu qu’on ait de tact et de bonne humeur. Cependant l’auteur montre partout, pour les lecteurs français, une tendre sollicitude qui va jusqu’à la commisération : il avertit (p. 254) que c’est par pitié pour eux qu’il n’a donné que 450 pages grand in-8° à son opuscule, car, dit-il, je devais éviter, dans un premier essai, d’être trop volumineux et ménager la grande majorité des lecteurs français qui se rebutent facilement quand on veut les contraindre à méditer et à réfléchir trop longuement. Réfléchir longtemps a de suite, est en effet une fatigue ; mais réfléchir longue-ment, c’est, je présume, réfléchir comme l’auteur, et cela ne doit pas causer une grande dépense de forces intellectuelles ; au reste, je peux me tromper, en fait de physiologie, tout dépend de l’individu.
... J’ai trouvé un moyen très efficace de seconder la bien veillance du jeune auteur pour ses pauvres lecteurs... Je les avertis que l’ouvrage commence à la page 251 et finit à là page 262... Les 250 pages qui précèdent sont ce que l’Intimé appelle le beau-dans son plaidoyer, ce qui ne fait rien a au sujet... ces douze pages renferment la décomposition de notre intelligence, telle qu’on nous prescrit de la croire et il faut la bien entendre pour aller plus loin, or je ne pense pas qu’il y ait un seul être cognitif, quelque pur qu’on le fasse, qui y comprenne rien, quelque simple qu’on le suppose qui ose croire y rien comprendre, — et dans ce cas, il n’a ni le besoin ni l’obligation d’aller plus loin, ce qui est assez doux.
Il ne faudrait pas que les lecteurs qui n’entendraient pas bien cet énorme ouvrage de douze pages, en conclussent qu’ils sont tout à fait indignes de comprendre la philosophie de Kant, car il est presque aussi difficile de la reconnaître que de retrouver le Traité des richesses de Sénèque dans l’analyse qu’en fait Hector.
Kant est un philosophe célèbre dont on peut fort bien ne pas plus aimer certaines opinions que l’harmonie préétablie de Leibnitz ou le Tout en Dieu de Malebranche, mais qu’on ne pourra jamais traiter avec légèreté... notre auteur... a trop cru, en rentrant dans ce pays-ci, qu’on n’y savait rien, parce qu’il ne savait rien de ce qui s’y faisait... S’il veut prendre la peine de motiver son analyse de l’Intelligence humaine, ou de l’être cognitif comme il l’appelle, et de la justifier contradictoirement avec celle de Condillac ou de tel autre philosophe, nous la discuterons posément avec lui ; il verra que c’est là le nœud de la question. »
Pendant le dernier trimestre de l’an IX, Degérando fit à l’Institut une seconde lecture de son Mémoire sur la Philosophie de Kant. Le secrétaire Lévesque, plus compétent comme historien que comme philosophe, signala ce Mémoire, dans la Notice des travaux de la classe, le 15 vendémiaire an X : « La philosophie de Kant, disait-il, partage le public savant de l’Allemagne, elle excite des haines nationales et des haines étrangères, et des Allemands insultent aux Français parce qu’ils n’ont pas grossi la secte du professeur de Kœnigsberg. » Sans suivre Degérando dans ce travail, parce qu’il aurait fallu employer les termes techniques de l’école et ensuite les expliquer avec l’incertitude de les avoir compris et de se faire entendre, Lévesque disait seulement que Degérando avait rendu un juste hommage au génie fécond et hardi du philosophe allemand et à la vaste étendue de ses connaissances, mais sans dissimuler que ce novateur philosophe, par la nature de ses méthodes, inspire de justes préventions contre son système et qu’elles sont encore augmentées par les prétentions qu’il affecte et par l’obscurité dont il s’enveloppe ou que peut-être il ne pouvait éviter.
Villers fit paraître une brochure intitulée Kant jugé par l’Institut, dans laquelle il malmenait tout à la fois l’Institut et la Décade, Celle-ci, qui avait déjà, en analysant le travail de Lancelin sur l’Introduction à l’analyse des sciences, fait remarquer que cet ouvrage, en présentant une analyse simple et vraie de l’entendement humain et les éléments de la saine philosophie, est par cela même la réfutation de l’ouvrage intitulé Philosophie de Kant, revint à la charge et rappela à Villers qu’elle l’avait invité à discuter avec lui son analyse de l’entendement : « L’un des précepteurs nouvellement arrivés (d’Altona) pour nous apprendre à lire, disait l’auteur de l’article sur un soi-disant disciple de Kant, après avoir annoncé qu’il allait jeter une bombe qui retentirait jusqu’aux rives de l’Elbe, et allumerait un incendie philosophique, a lancé chez un libraire de Metz cette bombe terrible... On n’a entendu qu’un pétard... Au bout de quinze jours, le pétard a été oublié du public et les philosophes de Paris ne s’en sont ni émerveillés, ni épouvantés, ni courroucés... On leur avait annoncé une grande chose, et ils n’en ont vu qu’une petite ; ils désiraient connaître un philosophe étranger, très respectable et trop peu connu et on leur dit de grosses injures, on insulte la France littéraire et on ne leur apprend rien… Ils attendent mieux et passent leur chemin... Il paraît que le soi-disant disciple de Kant a a été piqué... Il vient de lâcher un pamphlet dans lequel il a cherche à prouver par atqui et ergo, que la classe des sciences morales et politiques de l’Institut, qui a seulement entendu un Mémoire du C. Degérando sur la philosophie de Kant, a jugé et mal jugé ce philosophe célèbre. Il prend et travaille en conséquence des phrases vagues, non du Mémoire sur Kant, mais d’un compte-rendu par un secrétaire, et essaie de faire sonner de grands mots, évitant toute fois les points de la question philosophique... Il n’y a que de l’amertume dans ses vingt-quatre pages. Nous consentons qu’il en veuille à là Décade..., mais il s’en vengerait bien mieux en acceptant l’invitation qu’elle lui a faite de discuter avec lui son analyse de l’entendement, S’il veut l’exposer, c’était à cet article qui va au fait qu’il eût fallu répondre… Peut-être garde-t-il le silence sur celui-là pour en profiter à son retour d’Allemagne où il est retourné, dit-on, sans doute pour consulter Kant, sur le ton convenable aux discussions philosophiques. »
Kant n’était pas heureux à cette époque avec ses défenseurs. Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, qui se donnait comme le disciple de Rétif de la Bretonne, « l’amateur du tour de jupe de Rosalie Poinot, comme disait Ginguené, et le volumineux romancier des couturières », qui l’avait même proposé pour la section de morale, s’était fortement prononcé contre le système astronomique de Newton et pour les idées innées ; il avait combattu l’ennuyeux et illisible Locke, traité de sottise, de folie, la statue ou plutôt la poupée de Condillac, appuyé le système des idées innées sur Descartes, Malebranche ; Bonnet et la Sagesse qui, sous le nom de Kant, remplit d’admiration toute l’Allemagne. Aussi défendit-il, même avant Villers, Kant qu’il crut attaqué par Degérando, dans deux Mémoires, où il lui attribuait la gloire d’avoir fait les découvertes les plus neuves en métaphysique. Mercier ne réussit d’ailleurs pas plus que Villers à faire perdre complètement à Kant les sympathies de l’Institut. Dans les différents votes qui eurent lieu pour la présentation par la seconde classe des trois candidats parmi lesquels l’Institut choisit, comme associé étranger Niebuhr, qu’il préféra ainsi à Müller et à Bentham, Kant obtint un nombre assez considérable de suffrages. Mais si l’ouvrage de Villers pouvait faire du bruit, il était impossible qu’il eût un succès sérieux. Lancelin le trouvait plus digne du XIIIe que du XIXe siècle, composé d’un ramas de chapitres décousus, surchargé de citations et d’injures très peu philosophiques, D. de Tracy, moins mordant, se bornait, en citant l’ouvrage de Kinker, à louer l’auteur et le traducteur de ne manifester ni mépris ni dédain pour ceux qui sont moins persuadés, et à expliquer pourquoi les philosophes français avec lesquels il se trouvait en communion d’idées, ne pouvaient accepter le système de Kant, Samuel Adams appréciant, dit-il, le système avec le sens commun, accuse Kant d’être tombé dans le scepticisme, d’avoir nié l’existence de Dieu, tout en sachant bien que, pour échapper au reproche d’ériger en système l’égoïsme et le matérialisme, Kant établit l’existence d’un Dieu sur la seule conviction du cœur, parce que cela ressemble trop aux dénouements tombés du ciel de quelques drames allemands, mais estime que ce serait pour la Décade un acte de justice de faire connaître ce système aux lecteurs dont la curiosité n’a été qu’excitée par là publication de Villers. Ceux qu’on ne saurait soupçonner d’être hostiles à Kant se montrent fort sévères pour Villers. Degérando, qui d’ordinaire ménage tout le monde, dit que l’ouvrage ne lui a point paru présenter la véritable tendance de la philosophie de Kant, qu’il est de peu de ressource pour l’étude du criticisme : « S’il a voulu, dit-il, s’adresser aux hommes superficiels, son analyse, est beaucoup trop obscure, s’il a voulu s’adresser aux penseurs, elle est beaucoup trop insuffisante. J’aime à croire que si M. de Villers refaisait cet ouvrage, il affirmerait moins, prouverait mieux, conserverait plus d’égards pour les opinions des autres et donnerait plus de clarté à l’exposition des siennes. » Et il plaçait bien au-dessus de ce livre la traduction de Kinker par Le Fèvre. Boddmer qui, comme Villers, voulait amener à douter de la certitude des opinions de l’école empirique, pour engager les penseurs à examiner là philosophie de Kant, et dont Villers disait lui-même qu’il y avait du bon dans son livre, trouvait l’ouvrage absolument insuffisant pour faire connaître la philosophie transcendantale, quoique la première partie lui parut écrite avec beaucoup d’esprit et de sel, très propre à réveiller les esprits endormis et à attirer l’attention du public sur ces matières : « Si son intention, ajoutait-il, avait été de faire du bruit et d’acquérir de la célébrité, elle est remplie et il a réussi, mais il a cru devoir se faire léger pour être à la portée d’une nombreuse classe de lecteurs, et il ne nous a montré qu’un squelette très imparfait déjà doctrine de Kant. » Et Mme de Staël, à qui Villers disait modestement que son livre avait au moins un trait commun avec la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, c’est qu’il était trop fort pour le public auquel il était destiné, lui écrit à lui-même que s’il n’a pas eu tout le succès qu’il méritait, c’est qu’il n’a pas voulu avoir de l’adresse dans sa manière de présenter les idées de Kant, et de combattre celles de ses adversaires. En Allemagne, d’ailleurs, Schelling en fit un compte-rendu dans le Journal critique de la philosophie qu’il publiait en collaboration avec Hégel, et tout en se plaçant à un autre point de vue, se montra presque aussi sévère que les philosophes français. Villers eut beau lui écrire comme justification qu’il avait voulu se mettre à la portée des lecteurs de France pour lesquels les coulisseset l’art de la cuisine sont les deux points entre lesquels roule l’exercice de leur pensée (Coulissen und Kochkunsl sind die zwei Angeln aller dortigen Denkübung), Schelling n’en maintint pas moins le jugement qu’il avait porté, tout en affirmant qu’il n’avait nullement voulu attaquer personnellement l’auteur.
On pouvait supposer que Napoléon, alors en lutte avec les idéologues, accueillerait avec joie un ouvrage qui combattait leurs doctrines et proposait, pour les remplacer, une doctrine nouvelle. Villers crut un instant que celui qui avait été comme lui officier d’artillerie, patronnerait son livre. Bonaparte lui en demanda un précis, et on pensa en Allemagne qu’il avait réussi à intéresser le grand Bonaparte au kantisme. Mais Bonaparte trouvait en de Bonald, Chateaubriand et autres défenseurs du catholicisme, des adversaires bien plus décidés, encore de l’idéologie ; il n’était pas sûr de rencontrer dans les partisans d’une philosophie dont l’auteur était estimé et vanté par ceux qu’il redoutait, un appui aussi assuré que celui qu’il crut trouver vers 1810 chez Royer-Collard et ceux qui, avec lui, combattaient le condillacisme sous toutes ses formes, et le kantisme ne put compter sur sa protection.
III
L’année même où Villers avait fait paraître la philosophie de Kant, Le Fèvre traduisait du hollandais l’essai de Kinker contenant une exposition succincte de la Critique de la raison pure. Le traducteur s’étonnait que deux nations justement célèbres, l’Angleterre et la France, n’eussent pas encore daigné s’occuper d’un système qui venait de révolutionner le monde philosophique, il semblait prendre à son compte l’opinion de l’auteur des Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, que ni la vérité ni l’erreur, cachées au fond du puits, ne plaisent en France, et considérer la Philosophie du bon sens de d’Argens comme l’expression de la pensée nationale. Il affirmait que Kant a seul fourni les moyens de sortir d’un embarras inextricable, qu’il a, en s’élançant du point où s’était arrêté le plus profond des sceptiques modernes (Hume), élevé un édifice nouveau à la vérité, dont les fondements sont aussi anciens que la raison même. Quant à lui il s’est uniquement proposé d’aplanir la voie de la Critique de la raison pure à ceux que préoccupe la solution de ce problème, que pouvons-nous savoir ? en laissant de côté l’autre question non moins intéressante pour nous, que devons-nous faire ? qui appartient à la Critique de, la raison pratique.
L’année suivante, en avril et en mai (7 et 30 floréal an X), Destult de Tracy lisait à l’Institut un important et curieux mémoire où il prenait pour point de départ la traduction de Le Fèvre, sans négliger toutefois, disait-il, d’étudier Kant dans ses propres ouvrages, du moins dans la version latine, car il n’entendait pas l’allemand. Il relevait les phrases usées, sur la prétendue légèreté des Français et sur le peu de profondeur de leur, philosophie, dont s’était servi le traducteur auquel il reconnaissait toutefois un grand mérite. Puis, rapprochant le système allemand de la méthode française, il le faisait passer dans son creuset pour voir si contre son attente, il soutenait cette épreuve dans son ensemble et dans toutes ses parties et recueillir soigneusement ce qu’en résidu il y trouverait de réellement précieux, pour, le réunir à ce que la France possède déjà. Sans s’arrêter à l’obscurité qui est une forte présomption contre le système et qui suffirait pour ensevelir dans l’obscurité une philosophie française, il s’attache à l’étude de l’idéologie de Kant. D. de Tracy se montre fort sévère dans l’appréciation de la doctrine de Kant qui présente, dit-il, une décomposition incomplète et fausse de notre faculté de penser, nous donne une notion très inexacte de notre sensibilité ; qui reconnaît en nous des facultés pures, prétend nous donner des connaissance pures qui sont de purs néants, personnifiés par l’abus des mots et par un emploi vicieux des idées abstraites dont on fait des êtres réels et existants. Et il ne faudrait pas croire qu’il n’y a dans cette critique faîte par un philosophe ayant lui-même des idées toutes différentes, que des négations opposées à des affirmations : D. de Tracy a plus d’une fois fort bien aperçu les difficultés que soulève la Critique de la raison pure. Ce qu’il reproche d’ailleurs avant tout à Kant, c’est de chercher à former un vaste système qui embrasse la métaphysique, la morale, la politique, ce qu’il reproche aux philosophes allemands, c’est de professer la doctrine de Kant comme on professe la doctrine théologique de Jésus, de Mahomet ou de Brahma, comme on a été platonicien, stoïcien, académicien, scotiste, thomiste ou cartésien, au lieu de se borner, comme les Français, à n’avoir aucun chef de secte, à observer des faits, à recueillir des vérités sans se presser de bâtir les systèmes. Il fait remarquer encore, en ce qui concerne l’étude de l’esprit humain, que les-Allemands ne sont pas suffisamment instruits des nombreuses observations faites récemment en France pour développer toutes les circonstances de nos opérations intellectuelles et les effets des agents qui agissent sur elles et sur lesquels elles réagissent, de ne prendre en considération ni nos organes, ni les signes du langage ni les méthodes de calcul ; ils ne connaissent même par Condillac ; ils n’étudient guère que le Traité des sensations qui forme plutôt un recueil de conjectures qu’une description, ils ignorent la Grammaire, l’Art de penser, de raisonner, la Langue des calculs et le Traité des systèmes, chef-d’œuvre qui réfute à l’avance tout ce qui est fondé sur des idées abstraites et générales et sur des hypothèses à priori. Remarquons enfin que D. de Tracy parle de Kant lui-même avec beaucoup d’estime : c’est un homme dont il respecte les lumières, un philosophe très distingué, célèbre par un grand nombre d’ouvrages justement estimés dans beaucoup de genres, recommandable par un grand zèle pour le progrès des lùmières et pour la propagation des idées saines et libérales, qui doit avoir de grandes qualités pour avoir acquis en Allemagne une considération aussi grande et des disciples aussi habiles et aussi éclairés.
En 1802, un Suisse, W.-R. Boddmer, publiait en 160 pages un ouvrage intitulé, le Vulgaire et les métaphysiciens ou doutes et vues critiques sur l’école empirique, par lequel, en ébranlant la métaphysique régnante, il voulait engager les Français à examiner la philosophie transcendante, étonnante par la hardiesse de ses principes, la profondeur de sa marche, la fécondité de ses résultats. Sans affirmer que la vérité fût tout entière dans les ouvrages de Kant, il trouvait du moins qu’ils auront fait faire des pas immenses dans la science de l’homme. Mais les commentaires et les extraits que l’on a publiés en France sur la philosophie de Kant lui semblent absolument insuffisants pour la faire connaître, c’est la Critique de la raison pure elle-même, ce sont tous les autres ouvrages de ce beau-génie qu’il faut étudier et approfondir dans leur, langue propre, pour pouvoir bien connaître son système. Locke n’a, selon lui, mis dans son exposition des facultés et des opérations intellectuelles, ni précision, ni ordre, ni méthode, ses principes sont vagues, incohérents et confus. Condillac est vivement critiqué. Bonnet, cet immortel génie, a donné une théorie absolument insuffisante pour expliquer le jugement, le raisonnement et la formation des notions. Degérando, dont le grand et bel ouvrage sur les Signes est dans les mains de tout le monde, a traité toutes les parties de la métaphysique, soit dans ses principes, soit dans ses applications avec autant de profondeur que de génie, il a soulevé un des coins du voile qui couvrait aux empiristes purs les lois subjectives de la cognition, voile que paraît avoir arraché entièrement la philosophie transcendantale. Toutefois, contrairement aux disciples de Kant qui exigent déjà une foi implicite en leur chef, il veut qu’avant d’adopter en France les opinions de la nouvelle doctrine, on les soumette à la critique la plus rigoureuse et la plus approfondie.
Dans son grand ouvrage, publié en l’an XIII sur l’Histoire comparée des systèmes de philosophie, Degérando donnait aux doctrines de Kant et de ses disciples une part telle qu’il s’exposait, disait-il, à être accusé d’avoir détruit à leur profit l’harmonie de son œuvre ; il vantait l’Allemagne, cette nation si riche en matériaux de tous genres, Kant, une des têtes les plus fortes et les plus inventives que l’Allemagne ait produites, cherchait à justifier la France du reproche que lui adressaient les Allemands d’ignorer le kantisme, rappelait que plusieurs de nos hommes les plus distingués avaient lu les ouvrages des kantiens ou dans les originaux ou dans des traductions latines, avaient eu des conférences suivies sur la philosophie critique avec quelques-uns de ses plus éclairés sectateurs. Il rappelait qu’il avait essayé de la faire connaître dans son premier ouvrage couronné par l’Institut, qu’il avait lu ensuite un Mémoire sur ce sujet à l’Institut, que dès l’an VI, il avait formé le projet de traduire en les annotant, l’analyse donnée par Kieseweter du Critieisme, la Métaphysique des mœurs et les Prolégomènes de Kant, que ces traductions presque achevées avaient passé dans les mains de plusieurs de ses amis, mais qu’on l’avait détourné généralement de les mettre au jour. Quand il a commencé l’étude du kantisme, il a été prévenu en sa faveur par l’opinion d’hommes qui lui inspirent une profonde estime, aussi n’a-t-il rien négligé pour découvrir ce qu’il peut contenir d’utile. Il a réuni et consulté les matériaux suivants : les trois Critiques (2e édition), les Prolégomènes, les Éléments métaphysiques de la nature, la Métaphysique des mœurs, les Écrits détachés, etc., les Commentaires de Schulz, de Schmid, de Kieseweter, les notices renfermées dans les recueils de Fülleborn, deux notices manuscrites faites par des partisans très éclairés de la philosophie de Kant. L’exposition donnée par Degérando est considérable : elle occupe, en y comprenant les systèmes sortis du kantisme, de Fichte, de Schelling, de Bouterweck, de Bardili, deux chapitres comprenant ensemble 170 pages, c’est-à-dire 20 pages de plus que ne lui en accordait Villers. Degérando met en lumière successivement, grâce à de nombreuses citations, les intentions de Kant, c’est-à-dire le but qu’il a poursuivi et les problèmes qu’il s’est posés, puis ses méthodes et ses nomenclatures, enfin l’application qu’il en a faite ou les résultats qu’il a obtenus. L’importance des jugements synthétiques à priori dans le système est bien marquée ; le rôle joué par la raison pratique, venant combler les vides immenses causés par la raison spéculative, et qui est, comme l’a observé Reinhold, Une aile que Kant a prudemment ajoutée à l’édifice dont il remarquait l’insuffisance, n’a peut-être pas été aussi exactement saisi, l’accusation adressée à Kant d’être tombé dans l’empirisme, les trois erreurs trouvées dans ce système où les vérités ne sont qu’en germe, permettraient sans doute de, contester que Degérando ait bien saisi l’œuvre de liant ; mais le même reproche, en admettant qu’il soit fondé, pourrait être fait à plusieurs de ceux qui, en France et en Allemagne, se sont occupés du kantisme et il porte sur l’interprétation plutôt que sur l’exposition du système. Tous ceux qui, après avoir étudié dans les sources la philosophie allemande de 1780 à 1803, liront l’ouvrage de Degérando, conviendront qu’il la fait connaître d’une façon aussi exacte et aussi détaillée qu’on pouvait le souhaiter alors et beaucoup mieux même que plus d’un historien postérieur.