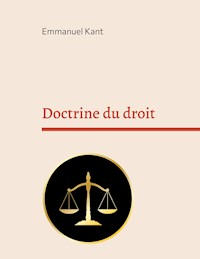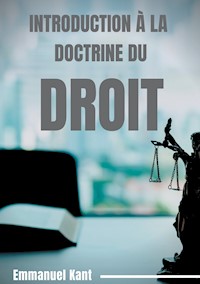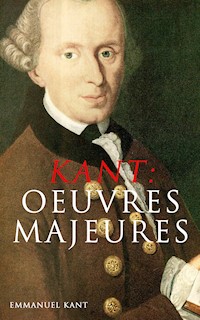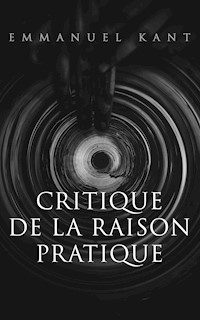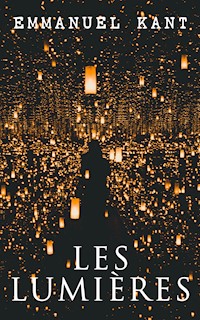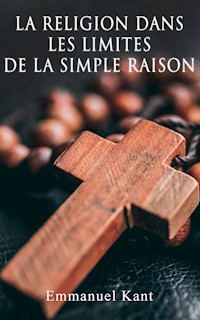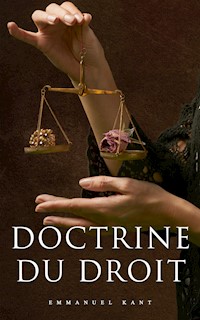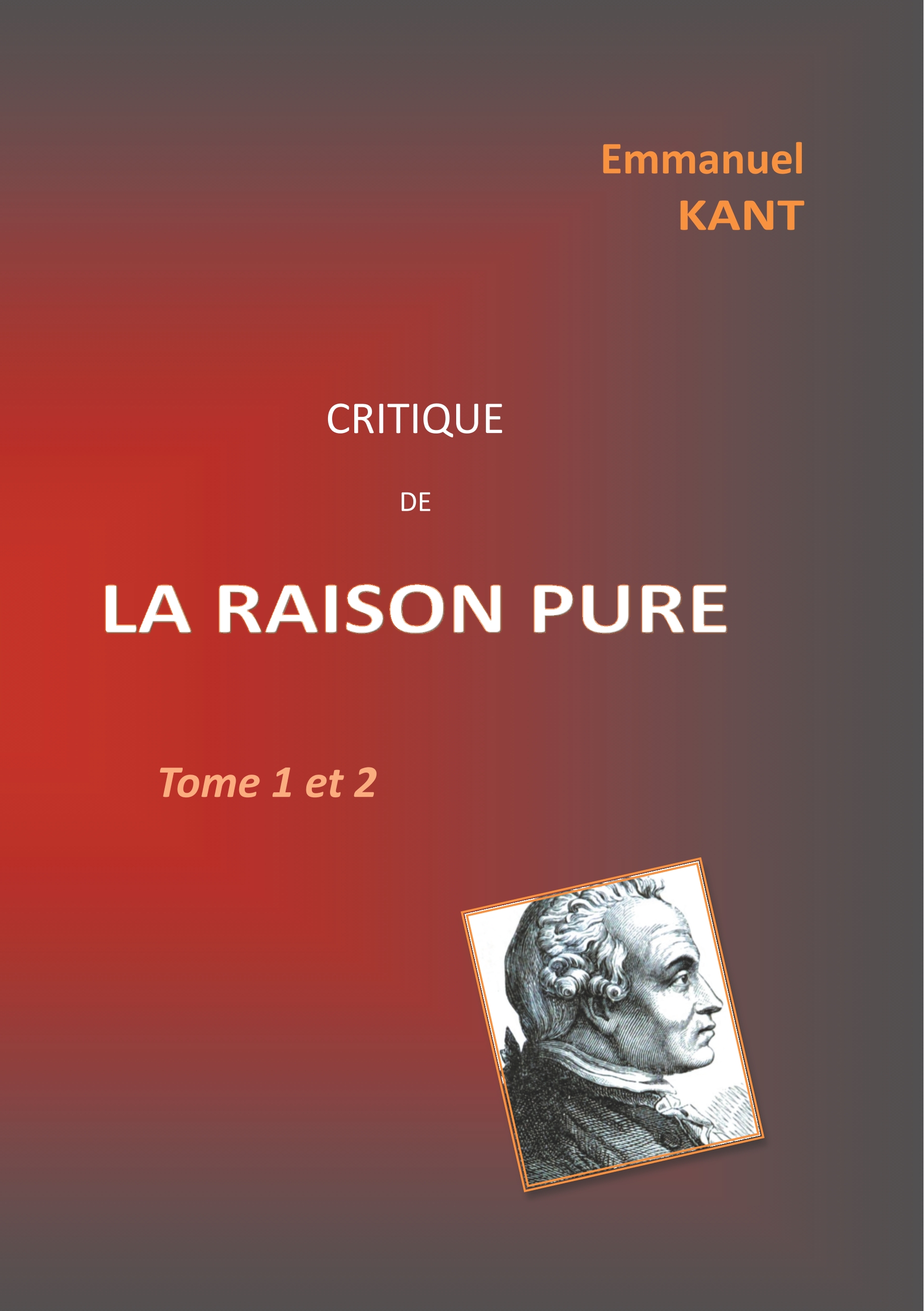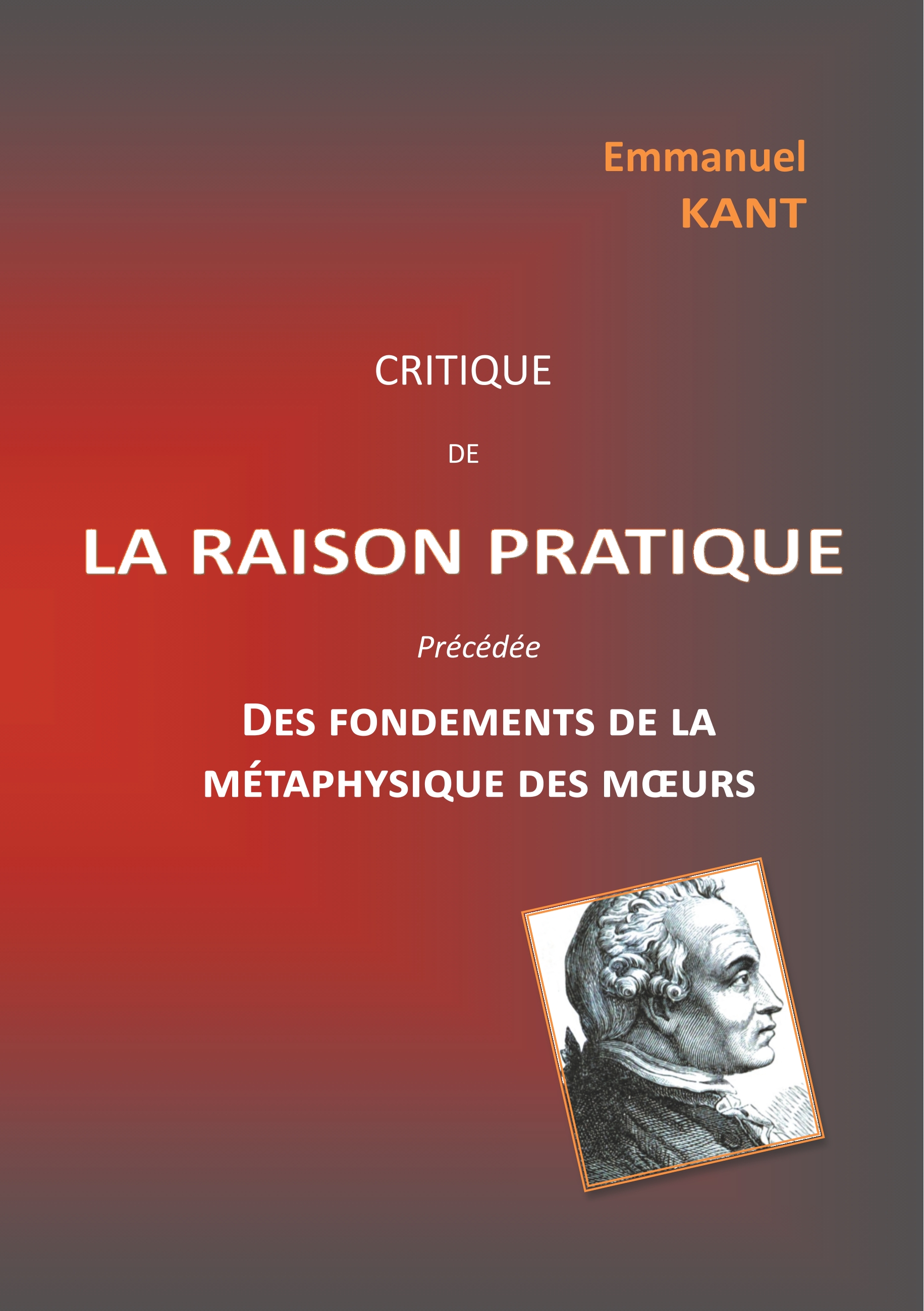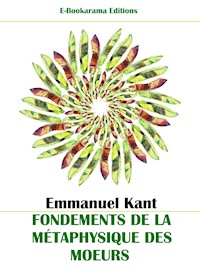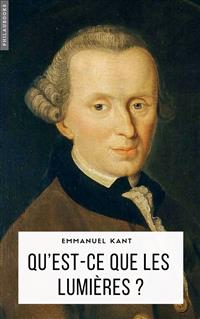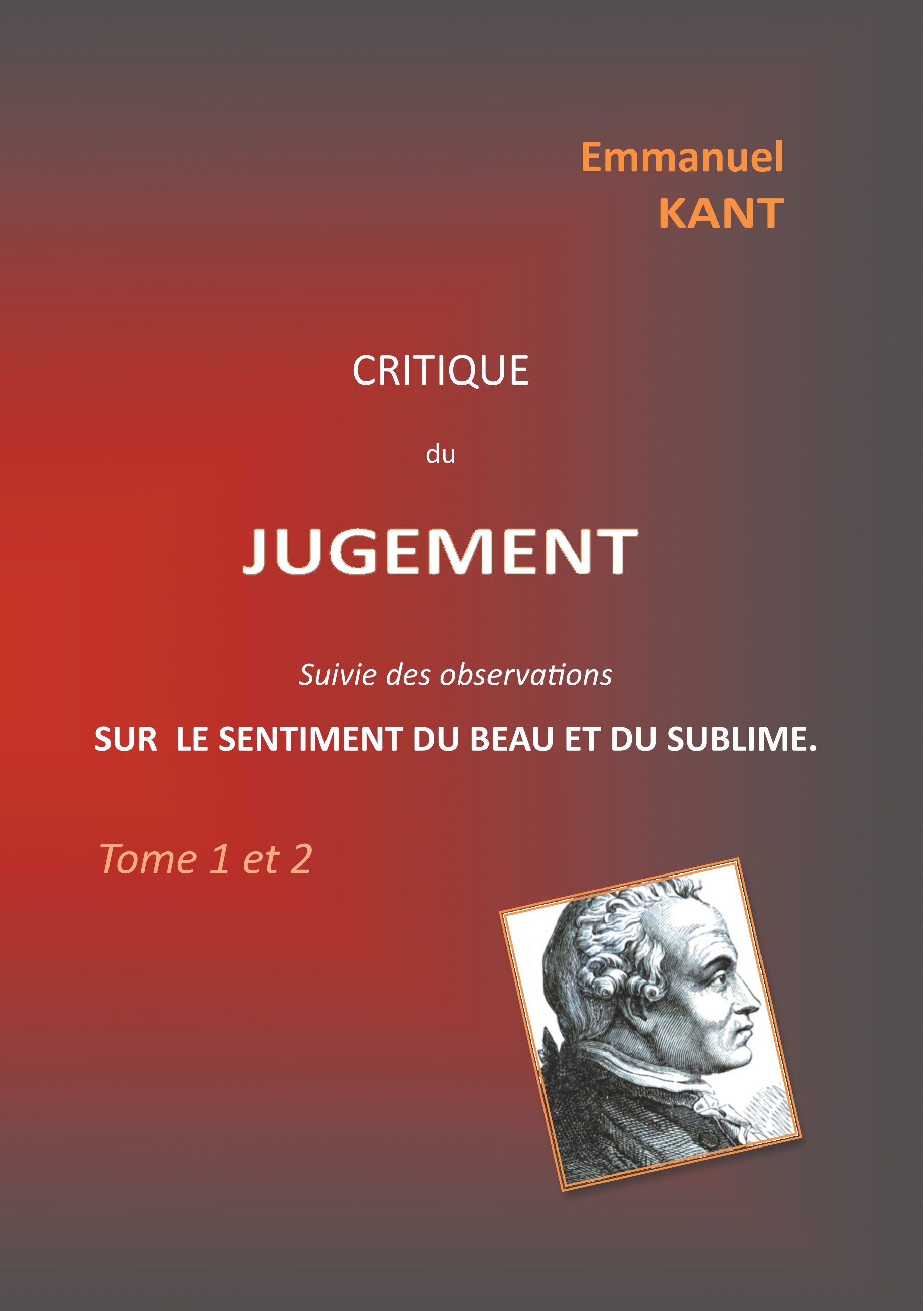
Critique du jugement suivie des observations sur le sentiment du beau et du sublime E-Book
Emmanuel Kant
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les trois grandes branches de la philosophie kantienne sont: la philosophie de la connaissance (développée surtout dans la Critique de la raison pure), la philosophie pratique (exposée dans la critique de la raison pratique et les fondements de la métaphysique des moeurs) et esthétique (dans la Critique du jugement suivie des observations sur le beau et le sublime). Dans cet ouvrage, faisant suite à la " Critique de la raison pure" et la " Critique de la raison pratique", la "Critique du Jugement", troisième grande oeuvre de Kant, est considéré comme un ouvrage fondamental de l'esthétique moderne. Dans ce livre, Kant tente de compléter son système philosophique et de créer un lien entre ses deux premières critiques. Il s'agit de jeter un pont par-dessus l'abîme creusé entre l'usage de la théorie de la raison (Critique de la raison pure) et l'usage pratique de la raison (Critique de la raison pratique). La première partie est consacrée à une esthétique (analyse du jugement esthétique), la deuxième partie à une téléologie (analyse de la place de la nature).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table des matières
CRITIQUE DU JUGEMENT Tomes 1 et 2
suivie des observations SUR LE SENTIMENT DU BEAU ET DU SUBLIME
TOME PREMIER
Avant propos du traducteur
Préface
Introduction
De la division de la philosophie.
Du domaine de la philosophie en général.
De la critique du Jugement considérée comme un lien qui réunit les deux parties de la philosophie.
Du Jugement comme faculté législative a priori.
Le principe de la finalité formelle de la nature est un principe transcendental du Jugement.
De l’union du sentiment de plaisir avec le Concept de la finalité de la nature
De la représentation esthétique de la finalité de la nature.
De la représentation logique de la finalité de la nature.
Du lien formé par le Jugement entre la législation de l’entendement et celle de la raison.
Première partie
CRITIQUE DU JUGEMENT ESTHETIQUE.
Première section
Analytique du jugement esthétique
PREMIER LIVRE
Analytique du beau.
Premier moment du jugement de goût, ou du jugement de goût considéré au point de vue de la qualité.
§ I Le jugement de goût est esthétique.
§ II La satisfaction, qui détermine le jugement de goût, est pure de tout intérêt.
§ III La satisfaction attachée à l'agréable est liée à un intérêt.
§ IV La satisfaction attachée au bon est accompagnée d'intérêt.
§ V Comparaison des trois espèces de satisfaction.
Définition du BEAU Tirée du premier moment.
Second moment du jugement de goût, ou du jugement de goût considéré au point de vue de la quantité.
§ VI Le beau est ce qui est représenté, sans concept, comme l’objet d’une satisfaction universelle.
§ VII Comparaison du beau avec l’agréable et le bon fondée sur la précédente observation.
§ VIII L’universalité de la satisfaction est représentée dans un jugement de goût comme simplement subjective.
§ IX Examen de la question de savoir si dans le jugement du goût le sentiment du plaisir précède le jugement porté sur l'objet ou si c'est le contraire.
Définition du BEAU Tirée du second moment
Troisième moment des jugements de goût, ou des jugements de goût considérés au point de vue de la relation de finalité.
§ X De la finalité en général.
§ XI Le jugement de goût n’a pour principe que la forme de la finalité d’un objet (ou de sa représentation)
§ XII Le jugement de goût repose sur des principes a priori.
§ XIII Le pur jugement de goût est indépendant de tout attrait et de toute émotion.
§ XIV Explication par des exemples.
§ XV Le jugement de goût est tout à fait indépendant du concept de la perfection.
§ XVI Le jugement de goût, par lequel un objet n’est déclaré beau qu’à la condition d’un concept déterminé, n’est pas pur.
§ XVII De l’idéal de la beauté.
Définition du BEAU tirée de ce troisième moment.
Quatrième moment du jugement de goût ou de la modalité de la satisfaction attachée à ses objets.
§ XVIII Ce que c’est que la modalité d’un jugement de goût
§ XIX La nécessité subjective que nous attribuons au jugement de goût est conditionnelle.
§ XX La condition de la nécessité que présente un jugement de goût est l’idée d’un sens commun.
§ XXI Si on peut supposer avec raison un sens commun.
§ XXII La nécessité du consentement universel, conçue dans un jugement de goût, est une nécessité subjective, qui est représentée comme objective sous la supposition d’un sens commun.
Définition du BEAU tirée du quatrième moment.
Remarque générale sur la première section de l’analytique
DEUXIÈME LIVRE
Analytique du sublime.
§ XXIII Passage de la faculté de juger du beau à celle de juger du sublime.
§ XXIV Division d’un examen du sentiment du sublime.
A.
Du sublime mathématique.
§ XXV Définition du mot sublime.
§ XXVI De l’estimation de la grandeur des choses de la nature que suppose l’idée du sublime.
§ XXVII De la qualité de la satisfaction attachée au jugement du sublime.
B.
Du sublime dynamique de la nature.
§ XXVIII De la nature considérée comme une puissance.
§ XXIX De la modalité du jugement sur le sublime de la nature.
Remarque générale sur l’exposition des jugements esthétiques réfléchissants.
§ XXX. La déduction des jugements esthétiques sur les objets de la nature ne peut pas s’appliquer à ce que nous y nommons sublime mais seulement au beau.
§ XXXI De la méthode propre à la déduction des jugements de goût.
§ XXXII Première propriété du jugement de goût.
§ XXXIII Seconde propriété du jugement de goût.
§ XXXIV Il ne peut y avoir de principe objectif du goût.
§ XXXV Le principe du goût est le principe subjectif du Jugement en général.
§ XXXVI Du problème de la déduction des jugements de goût.
§ XXXVII Ce qu’on affirme proprement a priori dans un jugement de goût sur un objet.
§ XXXVIII Déduction des jugements de goût.
Remarque.
§ XXXIX De la propriété qu’a une sensation de pouvoir être partagée.
§ XL Du goût considéré comme une espèce de sensus communis.
§ XLI De l’intérêt empirique du BEAU.
§ XLII De l’intérêt intellectuel du beau.
§ XLIII De l’art en général.
§ XLIV Des Beaux-Arts.
§ XLV Les Beaux-Arts doivent faire l’effet de la nature.
§ XLVI Les Beaux-Arts sont des arts du génie.
§ XLVII Explication et confirmation de la précédente définition du génie.
§ XLVIII Du rapport du génie avec le goût.
§ XLIX Des facultés de l’esprit qui constituent le génie.
§ L De l’union du goût avec le génie dans les productions des beaux-arts.
§ LI De la division des beaux-arts.
§ LII De l’union des beaux-arts dans une seule et môme production.
§ LIII Comparaison de la valeur esthétique des beaux-arts.
Remarque
Deuxième section
De la critique du jugement esthétique.
Dialectique du Jugement esthétique.
§. LIV.
§ LV Exposition de l’antinomie du goût.
§ LVI Solution de l’antinomie du goût.
Première remarque.
Deuxième remarque.
§ LVII De l’idéalisme de la finalité de la nature considérée comme art et comme principe unique du Jugement esthétique.
§ LVIII De la beauté comme symbole de la moralité.
§ LIX APPENDICE De la méthodologie du goût
TOME 2
Deuxième partie
CRITIQUE DU JUGEMENT TÉLÉOLOGIQUE.
§ LX De la finalité objective de la nature.
Première section
Analytique du jugement téléologique.
§ LXI De la finalité objective qui est simplement formelle, à la différence de celle qui est matérielle.
§ LXII De la finalité de la nature qui n’est que relative, à la différence de celle qui est intérieure.
§ LXIII Du caractère propre des choses en tant que fins de la nature.
§ LXIV Les choses, en tant que fins de la nature, sont des êtres organisés
§ LXV Du principe du jugement de la finalité intérieure dans les êtres organisés
§ LXVI Du principe du jugement téléologique sur la nature considérée en général comme un système de fins.
§ LXVII Du principe de la téléologie comme principe interne de la science de la nature.
Deuxième section
Dialectique du jugement téléologique
§ LXVIII Ce que c’est qu’une antinomie du Jugement ?
§ LXIX Exposition de celle antinomie.
§ LXX Préparation à la solution de la précédente antinomie.
§ LXXI Des divers systèmes sur la finalité de la nature.
§ LXXII Aucun des systèmes précédents ne donne ce qu’il promet.
§ LXXIII L’impossibilité de traiter dogmatiquement le concept d’une technique de la nature vient de l’impossibilité même d’expliquer une fin de la nature.
§ LXXIV Le concept d’une finalité objective de la nature est un principe critique de la raison pour le Jugement réfléchissant.
§ LXXV Remarque.
§ LXXVI De la propriété de l’entendement humain par laquelle le concept d’une fin de la nature est possible pour nous.
§ LXXVII De l’union du principe du mécanisme universel de la matière avec le principe téléologique dans la technique de la nature.
Appendice
Méthodologie du JUGEMENT TÉLÉOLOGIQUE
§ LXXVIII Si la téléologie doit être traitée comme une partie de la physique.
§ LXXIX De la subordination nécessaire du principe du mécanisme au principe téléologique dans l’explication d’une chose comme fin de la nature. ·
§ LXXX De l’adjonction du mécanisme au principe téléologique dans l’explication d’une fin de la nature, en tant que production de la nature.
§ LXXXI Du système téléologique dans les rapports extérieurs des êtres organisés.
§ LXXXII Du but de la nature considérée comme système téléologique.
§ XXXIII Du but final de l’existence d’un monde, c’est-à-dire de la création même.
§ LXXXIV De la théologie physique
§ LXXXV De la théologie morale
REMARQUE
§ LXXXVI De la preuve morale de l’existence de Dieu.
§ LXXXVII Limitation de la valeur de la preuve morale.
REMARQUE
§ LXXXVIII De l’utilité de l’argument moral.
§ LXXXIX De l’espèce d’adhésion que réclame une preuve morale de l’existence de Dieu.
§ XC De l’espèce d’adhésion produite par une foi pratique.
REMARQUE GÉNÉRALE SUR LA TÉLÉOLOGIE.
OBSERVATIONS SUR LE SENTIMENT DU BEAU ET DU SUBLIME.
Première section
Des différents objets du sentiment du sublime et du beau
Deuxième section
Des qualités du sublime et du beau dans l'homme en général.
Troisième section
De la différence du sublime et du beau dans le rapport des sexes.
Quatrième section
Des caractères nationaux, dans leurs rapports avec les divers sentiments du sublime et du beau.
TOME PREMIER
A Monsieur
VICTOR COUSIN
Hommage d'un élève reconnaissant,
Avant propos du traducteur
Depuis le commencement de ce siècle, c’est-à-dire depuis l’époque où quelques écrivains, M. Villers, M. de Tracy, M. de Gérando, madame de Staël1, appelèrent sur Kant l’attention de la France, sa doctrine n’a cessé d’exciter l’intérêt des penseurs, mais il s’en faut qu’elle soit à cette heure même bien connue parmi nous et qu’on lui ait rendu tous les honneurs qu’elle mérite. M. Cousin qui a élevé en France l’étude de l’histoire de la philosophie à la hauteur d’une méthode, et lui-même a tant fait pour l’avancement de cette étude, ne pouvait passer indifférent à côté d’une philosophie qui avait eu un si grand retentissement en Allemagne, et qui, au moment où elle commençait à piquer la curiosité des Français, avait déjà produit au delà du Rhin une si puissante et si féconde agitation. Dans un temps où l’on ne connaissait en France la philosophie de Kant que par quelques faibles esquisses, il entreprit de l’exposer et de la juger dans son enseignement public2 ; même, le traducteur de Platon eut un instant la pensée de se faire celui de Kant. Mais d’autres travaux le détournèrent de cette tâche, et elle reste encore aujourd’hui presque entière. Des trois critiques de Kant, c’est-à-dire de ses trois plus importants ouvrages, une seule a été traduite3 ; les autres sont à peine connues parmi nous4. Or ces ouvrages méritent assurément qu’on les traduise dans notre langue, et, si difficile, si ingrat même à certains égards que soit ce genre de travail, je me suis hasardé à l’entreprendre. Voici d’abord la traduction de la Critique du Jugement, et j’espère publier bientôt celle de la Critique de la raison pratique, travail déjà fort avancé.
Quand il s’agit d’un homme comme Kant et de monuments comme la Critique de la raison pure, celle de la raison pratique ou celle du Jugement, de simples analyses, quelque exactes et quelque détaillées qu’elles soient, ne peuvent suffire. Malgré tous ses défauts, si antipathiques au génie de notre langue, il faut traduire Kant et le traduire littéralement, car rien ne doit dispenser en philosophie de l’étude des monuments. Mais aussi Kant n’est pas de ceux qu’on peut se contenter de traduire ; l’étude de ses ouvrages est difficile, et même, disons-le, rebutante, surtout pour des lecteurs français, et c’est pourquoi il importe de les préparer à cette étude en les initiant aux idées du philosophe allemand par une exposition plus simple et plus claire, à son langage par une explication de ses termes et de ses formules. Je ne pouvais donc me borner au rôle de traducteur, et j’ai du songer à joindre à ma traduction un travail destiné à faciliter l’étude de l’ouvrage ; mais comme l’importance et les difficultés de ce travail m’arrêtent encore, et que je ne veux pas trop retarder la publication de la traduction imprimée déjà depuis quelque temps, je me décide à la faire paraître d’abord, m’engageant à en publier bientôt l’introduction.
Je ne dirai rien ici de la Critique du Jugement, puisque j’en parlerai tout à mon aise dans l’introduction que je prépare ; je veux seulement ajouter quelques mots sur le système de traduction que j’ai cru devoir suivre. M. Cousin, dans ses leçons sur Kant5, a caractérisé avec tant de justesse et de netteté les défauts de Kant comme écrivain, que je ne puis mieux faire ici que de reproduire son jugement. « Cet ouvrage, dit-il, en parlant de la Critique de la raison pure, avait le malheur d’être mal écrit ; ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait souvent infiniment d’esprit dans les détails, et même de temps en temps des morceaux admirables ; mais, comme l’auteur le reconnaît lui-même avec candeur dans la préface de l’édition de 1781, s’il y a partout une grande clarté logique, il y a très peu de cette autre clarté qu’il appelle esthétique, et qui naît de l’art de faire passer le lecteur du connu à l’inconnu, du plus facile au plus difficile, art si rare, surtout en Allemagne, et qui a entièrement manqué au philosophe de Kœnigsberg. Prenez la table des matières de la Critique de la raison pure, comme là il ne peut être question que de l’ordre logique, de l’enchaînement de toutes les parties de l’ouvrage, rien de mieux lié, de plus précis, de plus lumineux. Mais prenez chaque chapitre en lui-même, ici tout change : cet ordre en petit, que doit renfermer un chapitre, n’y est point ; chaque idée est toujours exprimée avec la dernière précision, mais elle n’est pas toujours à la place où elle devrait être pour entrer aisément dans l’esprit du lecteur. Ajoutez à ce défaut celui de la langue allemande de cette époque, poussé à son comble, je veux dire ce caractère démesurément synthétique de la phrase allemande, qui forme un contraste si frappant avec le caractère analytique de la phrase française. Ce n’est pas tout : indépendamment de cette langue, rude encore et mal exercée à la décomposition de la pensée, Kant a une autre langue qui lui est propre, une terminologie qui, une fois bien comprise, est d’une netteté parfaite et même d’un usage commode, mais qui, brusquement présentée et sans les préliminaires nécessaires, offusque tout, donne à tout une apparence obscure et bizarre. » Les défauts que M. Cousin reproche à la Critique de la raison pure, et qui, comme il le remarque, retardèrent dans le pays même de Kant le succès de cet immortel ouvrage, sont aussi ceux de la Critique du Jugement et de la Critique de la raison pratique. Seulement Kant est en général dans ces deux derniers ouvrages plus sobre et moins diffus que dans le premier, et le caractère même des sujets qu’il y traite, ici les principes de la morale et les sentiments, les idées qui s’y rattachent, là le beau et le sublime, les beaux-arts, les causes finales, etc., ce caractère donne parfois à son style une couleur moins sévère et moins dure. Cependant les mêmes défauts reparaissent et dominent. On comprend d’après cela combien doit être difficile une traduction littérale de ces ouvrages. Or toute autre traduction, une traduction qui retranche ou ajoute, résume ou paraphrase, ne rend pas l’auteur tel qu’il est, et ne peut tenir lieu du texte. D’un autre côté, une traduction littérale court grand risque d’être barbare, et de faire à chaque instant violence aux habitudes de notre langue et de notre esprit. Selon moi, le problème à résoudre serait de traduire Kant d’une manière qui, tout en reproduisant fidèlement le texte, en atténuerait un peu les défauts, c’est-à-dire y introduirait, sans le modifier, les qualités propres à notre langue. Une traduction qui remplirait ces deux conditions, ayant un double mérite, rendrait un double service à l’auteur. Voilà le problème que je me suis proposé, et j’en connais trop bien les difficultés pour me flatter de l’avoir résolu. J’espère du moins que mes efforts ne seront pas entièrement perdus. Si la langue française a la vertu de clarifier tout ce qu’elle rend ou traduit, cela doit surtout s’ appliquer à Kant, car, comme l’obscurité qu’on lui reproche vient en partie, suivant la juste remarque de M. Cousin, du caractère démesurément synthétique de sa phrase, et que la phrase française est au contraire essentiellement analytique, traduire Kant en français, c’est déjà l’éclaircir en corrigeant ou en atténuant un défaut qui répugne à notre langue.
Mais c’est assez insister sur les défauts de la manière de Kant ; il est temps de le faire paraître sous un autre jour. On ne sait pas assez en France que cet écrivain que nous traitons de barbare a su parfois approcher de nos meilleurs écrivains. C’est ce qu’on voit dans la plupart de ses petits écrits, et particulièrement dans celui qui a pour titre : Observations sur le sentiment du beau et du sublime, et qui parut en 1764, c’est-à-dire vingt-six ans avant la Critique du Jugement6. Malgré quelques essais de traduction, ces petits écrits sont en général peu connus en France, et, bien traduits, ils montreraient Kant sous une face toute nouvelle7. C’est là que Kant paraît tout au long ce qu’on le retrouve parfois dans certains passages de ses grands ouvrages, surtout dans les remarques et dans les notes, un homme d’infiniment d’esprit, dans le sens moderne et français de ce mot, un fin et délicat observateur de la nature humaine, un ingénieux écrivain. Car ce profond penseur, ce génie abstrait, cet écrivain barbare était aussi tout cela. Son chef-d’œuvre sous ce rapport est sans contredit le petit ouvrage que je viens de citer. Aussi a-t-il été déjà traduit trois fois en français8 ; mais il était bon de le retraduire, et j’ai voulu en joindre une nouvelle traduction à celle de la Critique du Jugement, parce que ces deux ouvrages, quoique bien différents par la forme et le fond, ont un sujet commun, le beau et le sublime, et qu’il est curieux de rapprocher ces deux manières si différentes dont Kant a traité le même sujet à vingt-six ans de distance.
Il ne faut pas chercher d’ailleurs dans les Observations sur le sentiment du beau et du sublime le germe de la théorie exposée dans la Critique du Jugement, et bien moins encore une théorie philosophique sur la question du beau et du sublime. Kant n’a point ici une si haute prétention ; il veut seulement, comme il en avertit dès le début, présenter quelques observations sur les sentiments du beau et du sublime. Il considère ces sentiments relativement à leurs objets, aux caractères des individus, aux sexes et aux rapports des sexes entre eux, et enfin aux caractères des peuples. Ce petit ouvrage n’est donc qu’un recueil d’observations. On n’y pressent pas le profond et abstrait auteur de la Critique de la raison pure ; Kant n’est encore que le beau professeur de Kœnigsberg, comme on l’appelait dans sa ville natale9. Or il excelle autant dans le genre auquel appartient ce petit écrit que dans la métaphysique. Il se montre ici aussi fin et spirituel observateur qu’ailleurs subtil et profond analyste. On admirera la justesse et souvent la délicatesse de ses observations, un heureux et rare mélange de finesse et de bonhomie10, enfin le tour ingénieux et vif qu’il donne à ses idées et où paraît clairement l’influence de la littérature française. Si parmi ces remarques quelques unes ont cessé d’être vraies11, si d’autres nous paraissent étroites et mesquines12, on retrouve dans la plupart une pénétrante observation et une haute intelligence de la nature humaine. Mais la plus remarquable partie de ce petit écrit est sans contredit celle où Kant traite du beau et du sublime dans leurs rapports avec les sexes. Il y a là sur les qualités essentiellement propres aux femmes, sur le genre particulier d’éducation qui leur convient, sur le charme et les avantages de leur société, des observations pleines de sens et de finesse, des pages dignes de Labruyère ou de Rousseau13. Kant reprend après celui-ci cette thèse, si admirablement développée dans la dernière partie de l’Emile, que la femme, ayant une destination particulière, a aussi des qualités qui lui sont propres, et qu’une intelligente éducation doit cultiver et développer conformément au vœu de la nature. Nul au dix-huitième siècle n’a parlé des femmes avec plus de délicatesse et de respect14. On serait tenté de croire avec le nouvel éditeur de Kant, Rosenkranz, que le cœur du philosophe n’est pas toujours resté indifférent aux attraits dont il parle si bien. Mais je ne veux pas gâter par mes commentaires le charme de ce petit ouvrage. Il est inutile aussi de le rapprocher de la Critique du Jugement, car il n’y aurait que des différences à remarquer, et si, à l’exemple de Rosenkranz, j’ai réuni ces deux ouvrages dans la traduction, c’est que le contraste m’a paru piquant.
Kant avait fait interfolier pour son usage un exemplaire de ce petit écrit, et, après avoir chargé d’additions chacune des pages ajoutées, et, en beaucoup d’endroits, les marges mêmes du texte, il l’avait donné en 1800 au libraire Nicolovius, sans doute en vue d’une nouvelle édition. D’après Rosenkranz, qui a eu, en composant son édition, cet exemplaire entre les mains, ces additions sont des observations variées et quelquefois piquantes, qui se rattachent au même sujet, le sentiment du beau et du sublime, mais se répandent dans toutes les directions et prennent diverses formes. Ici Kant développe entièrement sa pensée, là il se borne à l’indiquer, et quelquefois un seul mot lui suffit. Rosenkranz n’a pas cru devoir se servir en général de ce brouillon, parce que l’on retrouve tout ce qu’il contient d’important dans d’autres ouvrages de Kant. J’ai suivi le texte de son édition.
Quant à la Critique du Jugement, je me suis servi à la fois de la troisième édition (1799)15 et de celle de Rosenkranz.
Ce 15 décembre 1845.
J. BARNI.
1 La Philosophie de Kant, par M. Charles Villers, est de 1801. La même année parut, traduit du hollandais, l’Essai d’une exposition succincte de la critique de la raison pure par Kinker, et ce petit ouvrage, remarquable par sa clarté, mais un peu superficiel, fournit par M. de Tracy le sujet d’un mémoire lu à l’Institut le 7 floréal an 10 (Mémoires de l'Institut national, sciences morales et politiques, tome IV). Il est curieux de voir comment Kant fut accueilli en France par un illustre disciple de l’école à laquelle il avait fait une si rude guerre en Allemagne, et qui, puissante encore chez nous au début de ce siècle, allait bientôt perdre sa domination et son crédit. — Dans son Histoire comparée des systèmes de philosophie, relativement aux principes des connaissances humaines, qui parut en 1804, M. de Gérando entreprit d’esquisser et de juger la philosophie critique (Tome II, ch. XVI et XVII), et si son esquisse et son appréciation sont encore bien superficielles et bien incomplètes, elles ne manquent pas d’intérêt, surtout quand on se reporte à l’époque où fut écrite cette histoire. Il est juste aussi de rappeler ce que nous apprend M. de Gérando lui-même dans une note de son ouvrage (tome II) que, cinq ans avant la publication de cet ouvrage, il avait présenté à l’Institut une notice sur la philosophie critique, à laquelle le prix avait été décerné, mais qu’il avait retranchée à l’impression, la jugeant trop insuffisante, et que, deux ans plus tard, il lui communiqua une notice plus détaillée. — Le livre de l’Allemagne, qui contient sur Kant quelques pages brillantes (troisième partie, ch. VI), imprimé et supprimé, comme on sait, par la police impériale en 1810, parut à Paris en 1814. — Puisque nous parlons des premiers travaux auxquels donna lieu en France la philosophie de Kant, il faut citer un choix de morceaux publiés par le Conservateur en 1800 (le Conservateur ou recueil de morceaux inédits d’histoire, de politique, de littérature et de philosophie, tirés des portefeuilles de N. François (de Neufchâteau), Paris, Crapelet, an VIII, tome II) ; ce sont : 1 ° une Notice littéraire sur M. Emmanuel Kant et sur l’état de la Métaphysique en Allemagne au moment où ce philosophe a commencé à y faire sensation, tirée du Spectateur du Nord ; 2° une traduction d’un petit écrit de Kant intitulé : Idée de ce que pourrait être une histoire universelle dans les vues d’un citoyen du monde ; 3° une traduction de l’abrégé de la Religion dans les limites de la raison. Cet abrégé, dont MM. Lortet et Bouillier ont publié récemment une nouvelle traduction (Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison} traduit par le docteur Lortet et précédé d’une introduction, par M. F. Bouillier (Paris et Lyon, 1842), est ici attribué à Kant et désigné sous ce titre : Théorie de la pure religion morale, considérée dans ses rapports avec le pur christianisme. Le traducteur, Phil. Huldiger, y a joint des éclaircissements et des considérations générales sur la philosophie de Kant. — A cette époque avaient déjà paru la traduction d’un petit ouvrage ayant pour titre : Projet de paix perpétuelle (Paris, 1796), et celle du petit écrit dont je publie une nouvelle traduction à la suite de la Critique du Jugement (Observations sur le sentiment du beau et du sublime, traduit par Payer Imhoff, Paris, 1796). — On voit donc quelle curiosité excitait le nom de Kant dès la fin du dernier siècle et le commencement de celui-ci. Mais on ne pouvait songer alors à traduire ses grands ouvrages, et l’on se borna à traduire quelques-uns de ses petits écrits. — Rappelons aussi que M. Maine de Biran et M. Royer-Collard, ces deux fermes esprits qui commencèrent la réforme philosophique dont s’honore notre siècle, ne manquèrent pas, le premier dans ses écrits et le second dans ses cours, d’examiner et de discuter quelques unes au moins des opinions du philosophe allemand, mais sans lui attribuer encore toute l’importance que révélèrent bientôt des études plus approfondies. M. Laromiguière parle aussi quelque part de Kant (Leçons de philosophie, deuxième partie, sixième leçon), mais de manière à prouver qu’il le connaissait fort peu. — Il faut citer enfin l’article de M. Stapfer dans la Biographie universelle.
2Voyez le Cours d’histoire de la philosophie moderne et pendant les années 1816 et 1817, dont M. Cousin va publier une nouvelle édition (chez Ladrange, Paris, 1846), et surtout le Cours d’histoire de la philosophie morale au dix-huitième siècle pendant l’année 1820, troisième partie. — Philosophie de Kant (Ladrange, 1842).
3La Critique de la raison pure, traduite par M. Tissot (Paris, Ladrange, 1836). M. Tissot vient de publier une nouvelle édition de sa traduction (Paris, Ladrange, 1845), où il a eu l’heureuse idée de suivre l’exemple donné par Rosenkranz dans son excellente édition des œuvres de Kant, c’est-a-dire de reproduire la première édition (1781) en indiquant dans des notes ou en ajoutant dans un appendice les changements faits par Kant dans la seconde (1787). Il est en effet curieux et important de noter ces changements et de suivre Kant de la première à la seconde édition.
4 Les analyses de ces deux ouvrages qui ont été faites jusqu’ici en français ou traduites de l’allemand ne sont pas propres, il faut l’avouer, à diminuer les difficultés de l’étude du texte, qu’elles se bornent à reproduire en le démembrant et en le défigurant. — L’Académie des sciences morales et politiques, en mettant au concours l’Examen critique de la philosophie allemande, a provoqué d’importants travaux sur Kant, mais qui ne sont point encore connus. Voyez le Rapport intéressant que vient de publier M. de Rémusat (Paris, Ladrange, 1845), à qui nous devions déjà un excellent morceau sur la Critique de la raison pure (Essais de philosophie, tome 1er).
5 Deuxième leçon.
6 La première édition de la Critique du Jugement est de 1790.
7 J’ai indiqué plus haut les petits écrits de Kant qui ont été traduits en français. On pourrait, en retraduisant ceux qui ont été traduits et en y ajoutant quelques-uns qui ne l’ont pas encore été, en former un curieux et piquant recueil. M. Cousin a songé aussi à ce travail, et il eut été digne de la plume du traducteur de Platon de faire passer dans notre langue ce que Kant a produit de plus littéraire. Héritier de cette tâche, je m’efforcerai de justifier la bienveillance qui me l’a confiée.
8 La première traduction est celle que j’ai indiquée plus haut. Elle est de 1796. — La seconde est de M. Kératry ; elle est précédée d’un long commentaire (Examen philosophique des considérations sur le sentiment du sublime et du beau de Kant, Paris, 1823). — Une autre traduction fut publiée la même année par M. Weyland sous ce titre : Essai sur le sentiment du beau et du sublime.
9 Voyez la préface de Rosenkranz au volume de son édition qui contient la Critique du Jugement et les Observations sur le sentiment du beau et du sublime (Vorrede, s. VIII).
10 Ce mélange de finesse et de bonhomie est une des qualités les plus saillantes du caractère de Kant. C’est encore un trait qu’il a de commun avec Socrate auquel on l’a justement comparé.
11 Tel est, par exemple, comme le remarque Rosenkranz, (préface déjà citée), le jugement qu’il porte sur les Français, ce jugement auquel la révolution française est venue donner depuis un si éclatant démenti.
12 Par exemple son jugement sur l’architecture du moyen-âge.
13 Aussi l’auteur des Observations sur le sentiment du beau et du sublime fût-il appelé le Labruyère de l’Allemagne.
14 Il reproche à Rousseau, en qui il se plaît d’ailleurs à reconnaître un grand apologiste du beau sexe, d’avoir osé dire qu’une femme n’est jamais autre chose qu’un grand enfant, et il ne voudrait pas, dit-il, pour tout l’or du monde avoir écrit cette phrase (Traduction française, tome II).
15 J’ai déjà indiqué la date de la première édition, 1790, c’est à dire 9 ans après la Critique de la raison pure et 2 ans après la Critique de la raison pratique. La seconde édition est de 1793.
Préface
On peut appeler raison pure la faculté de connaître par des principes a priori, et critique de la raison pure, l’examen de la possibilité et des limites de cette faculté en général, en n’entendant par raison pure que la raison considérée dans son usage théorique, comme je l’ai fait, sous ce titre, dans mon premier ouvrage, et sans prétendre soumettre aussi à l’examen la faculté pratique que déterminent en elle ses propres principes. La critique de la raison pure ne comprend donc que notre faculté de connaître les choses a priori : elle ne s’occupe que de la faculté de connaître, abstraction faite du sentiment du plaisir ou de la peine et de la faculté de désirer ; et dans la faculté de connaître, elle ne considère que l’entendement dont elle recherche les principes a priori, abstraction faite du Jugement16 et de la raison (en tant que facultés appartenant également à la connaissance théorique), parce qu’il se trouve dans la suite qu’aucune autre faculté de connaître, que l’entendement, ne peut fournir à la connaissance des principes constitutifs a priori. Ainsi la critique qui examine toutes ces facultés, pour déterminer la part que chacune pourrait avoir par elle-même à la vraie possession de la connaissance, ne conserve rien que ce que l’entendement prescrit a priori comme une loi pour la nature ou pour l’ensemble des phénomènes, (dont la forme est aussi donnée a priori); elle renvoie tous les autres concepts purs aux idées qui sont transcendantes pour notre faculté de connaître théorique, et qui, loin d’être pour cela inutiles ou superflues, servent de principes régulateurs : en agissant ainsi, d’une part, elle écarte les dangereuses prétentions de l’entendement, qui (parce qu’il peut fournir a priori les conditions de la possibilité de toutes les choses qu’il peut connaître) voudrait renfermer dans ses propres limites la possibilité de toute chose en général, et d’autre part, elle dirige l’entendement lui-même dans la considération de la nature à l’aide d’un principe de perfection qu’il ne peut jamais atteindre, mais qui lui est posé comme le but final de toute connaissance.
C’est donc véritablement à l’entendement, qui a son domaine propre dans la faculté de connaître, en tant qu’elle contient a priori des principes constitutifs de la connaissance, que la critique désignée en général sous le nom de critique de la raison pure, devait assurer une possession sûre, mais bornée, contre tous les autres compétiteurs. De même la critique de la raison pratique a déterminé la possession de la raison, qui ne contient des principes constitutifs que relativement à la faculté de désirer. Maintenant le Jugement, qui forme dans l’ordre de nos facultés de connaître un moyen terme entre l’entendement et la raison, a-t-il aussi par lui-même des principes a priori ; ces principes sont-ils constitutifs ou simplement régulateurs (ne supposant point par conséquent un domaine particulier) ; et donne-t-il a priori une règle au sentiment du plaisir ou de la peine, comme au moyen terme entre la faculté de connaître et la faculté de désirer (de même que l’entendement prescrit a priori des lois à la première et la raison à la seconde) ? Voilà ce dont s’occupe la présente critique du Jugement.
Une critique de la raison pure, c’est-à-dire de notre faculté de juger suivant des principes a priori, serait incomplète, si celle du Jugement qui, en tant que faculté de connaître, prétend aussi par lui-même à de tels principes, n’était traitée comme une partie spéciale de la critique ; et pourtant les principes du Jugement ne constituent pas, dans un système de la philosophie pure, une partie propre entre la partie théorique et la partie pratique ; ils peuvent être rapportés, suivant l’occasion, à chacune de ces deux parties. Mais si, sous le nom général de métaphysique, ce système (qu’il est possible d’achever et qui est d’une haute importance pour l’usage de la raison sous tous les rapports) doit être un jour accompli, il faut d’abord que la critique ait sondé le sol de cet édifice, assez profondément pour découvrir les premiers fondements de la faculté qui nous fournit des principes indépendants de l’expérience, afin qu’aucune des parties ne vienne à chanceler, ce qui entraînerait inévitablement la ruine du tout.
Or on peut aisément conclure de la nature du Jugement (dont il est si nécessaire et si généralement utile de faire un bon usage que sous le nom de sens commun on ne désigne pas d’autre faculté que celle-là) qu’on doit rencontrer de grandes difficultés dans la recherche du principe propre de cette faculté (elle doit en effet en contenir un a priori, sinon la critique même la plus vulgaire ne la considérerait pas comme une faculté particulière de connaître). Ce principe ne peut être dérivé de concepts a priori : ceux-ci appartiennent à l’entendement et le Jugement ne concerne que leur application. Le Jugement doit donc fournir lui-même un concept, qui ne fasse proprement rien connaître, et qui seulement lui serve de règle à lui-même, mais non pas de règle objective à laquelle il puisse s’accommoder, car alors il faudrait une autre faculté de juger, pour décider si c’est le cas ou non d’appliquer la règle.
Cette difficulté que présente le principe (subjectif ou objectif) de la faculté de juger se rencontre surtout dans ces jugements, appelés esthétiques, qui concernent le beau et le sublime de la nature ou de l’art. Et pourtant la recherche critique du principe des jugements est la partie la plus importante de la critique de cette faculté. En effet, quoique par eux-mêmes ils n’apportent rien à la connaissance des choses, ils n’en appartiennent pas moins uniquement à la faculté de connaître et révèlent un rapport immédiat de cette faculté avec le sentiment de plaisir ou de peine fondé sur quelque principe a priori, qui ne se confond pas avec les motifs de la faculté de désirer ; car celles-ci trouve ses principes a priori dans des concepts de la raison. Il n’en est pas de même des jugements téléologiques sur la nature : ici, l’expérience nous montrant dans les choses une conformité à des lois qui ne peut plus être comprise ou expliquée à l’aide du concept général que l’entendement nous donne du sensible, la faculté de juger tire d’elle-même un principe du rapport de la nature avec l’inaccessible monde du supra-sensible, dont elle ne doit se servir qu’en vue d’elle-même dans la connaissance de la nature ; mais ce principe, qui doit et peut être appliqué a priori à la connaissance des choses du monde et nous ouvre en même temps des vues avantageuses pour la raison pratique, n’a point de rapport immédiat au sentiment du plaisir ou de la peine. Or c’est précisément ce rapport qui fait l’obscurité du principe du Jugement, et qui rend nécessaire pour cette faculté une division particulière de la critique ; car le jugement logique, qui se fonde sur des concepts (dont on ne peut jamais tirer de conséquence immédiate au sentiment du plaisir ou de la peine), aurait pu à la rigueur être rattaché à la partie théorique de la philosophie, avec l’examen critique des limites de ces concepts.
Comme je n’entreprends pas l’étude du goût, ou du Jugement esthétique, dans le but de le former et de le cultiver (car cette culture peut bien continuer de se passer de ces sortes de spéculation), mais seulement à un point de vue transcendental, on sera, je l’espère, indulgent pour les lacunes de cette étude. Mais, à son point de vue, il faut qu’elle s’attende à l’examen le plus sévère ; seulement la grande difficulté que présente la solution d’un problème, naturellement si embrouillé, peut servir, je l’espère aussi, à excuser quelque reste d’une obscurité qu’on ne peut éviter entièrement. Pourvu qu’il soit assez clairement établi que le principe a été exactement exposé, on peut me pardonner, s’il est nécessaire, de n’en avoir pas dérivé le phénomène du Jugement avec toute la clarté qu’on peut justement exiger ailleurs, c’est-à-dire d’une connaissance fondée sur des concepts, et que je crois avoir rencontrée dans la seconde partie de cet ouvrage.
Je termine ici toute mon œuvre critique. J’aborderai sans retard la doctrine, afin de mettre à profit, s’il est possible, le temps favorable encore de ma vieillesse croissante. On comprend aisément que le Jugement n’a point de partie spéciale dans la doctrine, puisque la critique lui tient lieu de théorie ; mais que, d’après la division de la philosophie en théorique et pratique et de la philosophie pure en autant de parties, la métaphysique de la nature et celle des mœurs doivent constituer cette nouvelle œuvre.
16 Notre mot Jugement signifie à fois la faculté de juger et l’acte par lequel nous jugeons, tandis que la langue allemande a les deux mots Urtheilskraft et Urtheil. Pour remédier à cette confusion, j’écrirai Jugement ou jugement suivant que j’emploierai ce mot dans le premier ou dans le second de ces deux sens. J. B.
Introduction
I De la division de la philosophie.
Quand on considère la philosophie comme fournissant par des concepts les principes de la connaissance rationnelle des choses (et non pas seulement, comme la logique, les principes de la forme de la pensée en général, abstraction faite des objets), on a tout à fait raison de la diviser, comme on le fait ordinairement en théorique et pratique. Mais il faut alors que les concepts qui fournissent aux principes de cette connaissance rationnelle leur objet, soient spécifiquement différents ; sinon ils n’autoriseraient point une division, qui suppose toujours une opposition des principes de la connaissance rationnelle propre aux diverses parties d’une science.
Or il n’y a que deux espèces de concepts, lesquelles impliquent autant de principes différents de la possibilité de leurs objets : ce sont les concepts de la nature et le concept de la liberté. Et comme les premiers rendent possible, à l’aide de principes a priori, une connaissance théorique, et que le second ne contient relativement à cette connaissance qu’un principe négatif (une simple opposition), tandis qu’au contraire il établit pour la détermination de la volonté des principes extensifs, qui, pour cette raison, s’appellent pratiques, on a le droit de diviser la philosophie en deux parties, tout à fait différentes quant aux principes, en théorique en tant que philosophie de la nature et en pratique en tant que philosophie morale (car on appelle ainsi la législation pratique de la raison fondée sur le concept de la liberté). Mais jusqu’ici une grave confusion dans l’emploi de ces expressions a présidé à la division des divers principes et par suite de la philosophie : on identifiait ce qui est pratique au point de vue des concepts de la nature avec ce qui est pratique au point de vue du concept de la liberté, et sous ces mêmes expressions de philosophie théorique et pratique, on établissait une division qui, dans le fait, n’en était pas une (puisque les deux parties pouvaient avoir les mêmes principes).
La volonté, en tant que faculté de désirer, est une des diverses causes naturelles qui sont dans le monde, c’est celle qui agit d’après des concepts; et tout ce qui est représenté comme possible (ou comme nécessaire) par la volonté, on l’appelle pratiquement possible (ou nécessaire), pour le distinguer de la possibilité ou de la nécessité physique d’un effet dont la cause n’est pas déterminée par des concepts (mais, comme dans la matière inanimée, par mécanisme, ou, comme chez les animaux, par instinct. ― Or ici on parle de pratique d’une manière générale, sans déterminer si le concept qui fournit à la causalité de la volonté sa règle est un concept de la nature ou un concept de la liberté.
Mais cette dernière distinction est essentielle : si le concept qui détermine la causalité est un concept de la nature, les principes sont alors techniquement pratiques ; si c’est un concept de la liberté, ils sont moralement pratiques ; et, comme dans la division d’une science rationnelle il s’agit uniquement d’une distinction des objets dont la connaissance demande des principes différents, les premiers se rapportent à la philosophie théorique (ou à la science de la nature), tandis que les autres constituent seuls la seconde partie, à savoir la philosophie pratique (ou la morale).
Toutes les règles techniquement pratiques (c’est-à-dire celles de l’art ou de l’industrie en général, et même celles de la prudence, ou de cette habileté qui donne de l’influence sur les hommes et sur leur volonté), en tant que leurs principes reposent sur des concepts, doivent être rapportées comme corollaires a la philosophie théorique. En effet elles ne concernent qu’une possibilité des choses fondée sur des concepts de la nature, et je ne parle pas seulement des moyens à trouver dans la nature, mais même de la volonté (comme faculté de désirer, et par conséquent comme faculté naturelle), en tant qu’elle peut être déterminée conformément à ces règles par des mobiles naturels. Cependant ces règles pratiques ne s’appellent pas des lois (comme les lois physiques), mais seulement des préceptes ; car, comme la volonté ne tombe pas seulement sous le concept de la nature, mais aussi sous celui de la liberté, on réserve le nom de lois aux principes de la volonté relatifs à ce dernier concept, et ces principes constituent seuls, avec leurs conséquences, la seconde partie de la philosophie, à savoir la partie pratique.
De même que la solution des problèmes de la géométrie pure ne forme pas une partie spéciale de cette science, ou que l’arpentage ne mérite pas d’être appelé géométrie pratique, par opposition à la géométrie pure qui serait la seconde partie de la géométrie en général, de même et à plus forte raison ne faut-il pas regarder comme une partie pratique de la physique, l’art mécanique ou chimique des expériences ou des observations, et rattacher à la philosophie pratique l’économie domestique, l’agriculture, la politique, l’art de vivre en société, la diététique, même la théorie générale du bonheur et l’art de dompter ses passions et de réprimer ses affections en vue du bonheur, comme si tous ces arts constituaient la seconde partie de la philosophie en général. En effet, ils ne contiennent tous que des règles qui s’adressent, à l’industrie de l’homme, qui, par conséquent ne sont que techniquement pratiques, ou destinées à produire un effet possible d’après les concepts naturels des causes et des effets, et qui, rentrant dans la philosophie théorique (ou dans la science de la nature), dont elles sont de simples corollaires, ne peuvent réclamer une place dans cette philosophie particulière qu’on appelle la philosophie pratique. Au contraire, les préceptes moralement pratiques, qui sont entièrement fondés sur le concept de la liberté et excluent toute participation de la nature dans la détermination de la volonté, constituent une espèce toute particulière de préceptes : comme ces règles auxquelles obéit la nature, ils s’appellent véritablement des lois, mais ils ne reposent pas, comme celles-ci, sur des conditions sensibles ; ils ont un principe supra-sensible, et ils forment à eux seuls, à côté de la partie théorique de la philosophie, une autre partie sous le nom de philosophie pratique.
On voit par là qu’un ensemble de préceptes pratiques, donnés par la philosophie, ne constitue pas une partie spéciale et opposée à la partie théorique de cette science, par cela seul qu’ils sont pratiques ; car ils pourraient l’être encore, quand même leurs principes (en tant que règles techniquement pratiques) seraient tirés de la connaissance théorique de la nature : il faut encore que le principe sur lequel ils se fondent ne soit pas dérivé lui-même du concept de la nature, toujours subordonné à des conditions sensibles, et repose par conséquent sur le supra-sensible, que le concept seul de la liberté nous fait connaître par des lois formelles, et qu’ainsi les préceptes soient moralement pratiques, c’est-à-dire que ce ne soient pas seulement des préceptes ou des règles relatives à tel ou tel dessein, mais des lois qui ne supposent aucun but ou aucun dessein préalable.
II Du domaine de la philosophie en général.
L’usage de notre faculté de connaître par des principes et la philosophie par conséquent n’ont pas d’autres bornes que celles de l’application des concepts a priori.
Mais l’ensemble de tous les objets auxquels se rapportent ces concepts, pour en constituer, s’il est possible, une connaissance, peut être divisé selon que nos facultés suffisent ou ne suffisent pas à ce but, et selon qu’elles y suffisent de telle ou telle manière.
Si vous considérez les concepts comme se rapportant à des objets, et que vous fassiez abstraction de la question de savoir si une connaissance de ces objets est ou n’est pas possible, vous avez le champ de ces concepts : il est déterminé seulement d’après le rapport de leur objet à notre faculté de connaître en général. La partie de ce champ, où une connaissance est possible pour nous, est le territoire (territorium) de ces concepts et de la faculté de connaître que suppose cette connaissance. La partie du territoire, où ces concepts sont législatifs, est leur domaine (ditio) et celui des facultés de connaître qui les fournissent. Ainsi les concepts empiriques ont bien leur territoire dans la nature, considérée comme l’ensemble de tous les objets des sens, mais ils n’y ont pas de domaine ; ils n’y ont qu’un domicile (domicilium), parce que ces concepts, quoique régulièrement formés, ne sont pas législatifs et que les règles qui s’y fondent sont empiriques, par conséquent contingentes.
Toute notre faculté de connaître a deux domaines, celui des concepts de la nature et celui du concept de la liberté ; car, par ces deux sortes de concepts, elle est législative a priori. Or la philosophie se partage aussi, comme cette faculté, en théorique et pratique. Mais le territoire, sur lequel s’étend son domaine et s’exerce sa législation, n’est toujours que l'ensemble des objets de toute expérience possible, en tant qu’ils sont considérés comme de simples phénomènes ; car autrement on ne pourrait concevoir une législation de l’entendement relative à ces objets.
La législation contenue dans les concepts de la nature est fournie par l’entendement ; elle est théorique. Celle que contient le concept de la liberté vient de la raison ; elle est purement pratique. Or c’est seulement dans le monde pratique que la raison peut être législative ; relativement à la connaissance théorique (de la nature), elle ne peut que déduire de lois données (dont elle est instruite par l'entendement) des conséquences qui ne sortent pas des bornes de la nature. Mais, d’un autre côté, la raison n’est pas législative partout où il y a des règles pratiques, car ces règles peuvent être techniquement pratiques.
La raison et l'entendement ont donc deux législations différentes sur un seul et même territoire, celui de l’expérience, sans que, l'une puisse empiéter sur l'autre ; car le concept de la nature a tout aussi peu d’influence sur la législation fournie par le concept de la liberté, que celui-ci sur la législation de la nature. — La possibilité de concevoir au moins sans contradiction la coexistence des deux législations et des facultés qui s’y rapportent a été démontrée par la critique de la raison pure, qui, en nous révélant ici une illusion dialectique, a écarté les objections.
Mais il est impossible que ces deux domaines différents, qui se limitent perpétuellement, non pas, il est vrai, dans leurs législations, mais dans leurs effets au sein du monde sensible, n’en fassent qu'un. En effet le concept de la nature peut bien représenter ses objets dans l’intuition, mais comme de simples phénomènes et non comme des choses, en soi ; au contraire, le concept de le liberté peut bien représenter par son objet une chose en soi, mais non dans l’intuition ; aucun de ces deux concepts, par conséquent, ne peut donner une connaissance théorique de son objet (et même du sujet pensant) comme chose en soi, c’est-à-dire du supra-sensible. C’est une idée qu’il faut appliquer à la possibilité de tous les objets de l’expérience, mais, qu’on ne peut jamais élever et étendre jusqu’à en faire une connaissance.
Il y a donc un· champ illimité, mais inaccessible aussi pour toute notre faculté de connaître, le champ supra-sensible, où ne nous trouvons point de territoire pour nous, et où, par conséquent, nous ne pouvons chercher, ni pour les concepts de l’entendement, ni pour ceux de la raison, un domaine appartenant à la connaissance théorique. Ce champ, l’usage théorique aussi bien que pratique de la raison veut qu’on le remplisse d’idées, mais nous ne pouvons donner à ces idées, dans leur rapport avec les lois qui dérivent du concept de la liberté, qu’une réalité pratique, ce qui n’élève pas le moins du monde notre connaissance théorique jusqu’au supra-sensible.
Mais, quoiqu’il y ait un immense abîme entre le domaine du concept de la nature, ou le sensible, et le domaine du concept de la liberté, ou le suprasensible, de telle sorte qu’il est impossible de passer du premier au second (au moyen de la raison théorique), et qu’on dirait deux mondes différents dont l’un ne peut avoir aucune action sur l’autre, celui-ci doit avoir cependant une influence sur celui-là. En effet le concept de la liberté doit réaliser dans le monde sensible le but posé par ses lois, et il faut, par conséquent, qu’on puisse concevoir la nature de telle sorte que, dans sa conformité aux lois qui constituent sa forme, elle n’exclue pas du moins la possibilité des fins qui doivent y être atteintes d’après les lois de la liberté. — Il doit donc y avoir un principe qui rende possible l’accord du suprasensible, servant de fondement à la nature, avec ce que le concept de la liberté contient pratiquement, un principe dont le concept insuffisant, il est vrai, au point de vue théorique et au point de vue pratique, à en donner une connaissance, et n’ayant point par conséquent de domaine qui lui soit propre, permette cependant à l’esprit de passer d’un monde à l’autre.
III De la critique du Jugement considérée comme un lien qui réunit les deux parties de la philosophie.
La critique des facultés de connaître, considérées dans ce qu’elles peuvent fournir a priori, n’a pas proprement de domaine relativement aux objets, parce qu’elle n’est pas une doctrine, mais qu’elle a seulement à rechercher si et quand, suivant la condition de nos facultés, une doctrine peut être fournie par ces facultés. Son champ s’étend aussi loin que toutes leurs prétentions, afin de les renfermer dans les limites de leur légitimité. Mais ce qui n’entre pas dans la division de la philosophie peut cependant tomber, comme partie principale, sous la critique de la faculté pure de connaître en général, si cette faculté contient des principes qui n’ont de valeur, ni pour son usage théorique, ni pour son usage pratique.
Les concepts de la nature, qui contenaient le principe de toute connaissance théorique a priori, reposaient sur la législation de l’entendement. — Le concept de la liberté qui contenait le principe de tous les préceptes pratiques a priori et indépendants des conditions sensibles, reposait sur la législation de la raison. Ainsi, outre que ces deux facultés peuvent être appliquées logiquement à des principes, de quelque origine qu’ils soient, chacune d’elles a encore, quant à son contenu, sa législation propre, au-dessus de laquelle il n’y en a point d’autre (a priori), et c’est ce qui justifie la division de la philosophie en théorique et pratique.
Mais dans la famille des facultés de connaître supérieures, il y a encore un moyen terme entre l’entendement et la raison : c’est le Jugement. On peut présumer, par analogie, qu’il contient aussi, sinon une législation particulière, du moins un principe qui lui est propre et qu’on doit chercher suivant des lois ; un principe qui est certainement un principe a priori purement subjectif, et qui, sans avoir pour domaine aucun champ des objets, peut cependant avoir un territoire pour lequel seulement il ait de la valeur.
Il y a d’ailleurs (à au juger par analogie) une raison de lier le Jugement avec un autre ordre de nos facultés représentatives, qui paraît plus importante encore que celle de sa parenté avec la famille des facultés de connaître. En effet, toutes les facultés ou capacités de l’âme peuvent être ramenées à ces trois qui ne peuvent plus être dérivées d’un principe commun : la faculté de connaître, le sentiment du plaisir et de la peine et la faculté de désirer17. Dans le ressort de la faculté de connaître, l’entendement seul est législatif, puisque cette faculté (comme cela doit être quand on la considère en elle-même, indépendamment de la faculté de désirer), se rapporte comme faculté de connaissance théorique à la nature, et que c’est seulement relativement à la nature (considérée comme phénomène) qu’il nous est possible de trouver des lois dans les concepts a priori de la nature, c’est-à-dire dans les concepts purs de l’entendement. – La faculté de désirer, considérée comme faculté supérieure déterminée par le concept de la liberté, n’admet pas d’autre législation a priori que celle de la raison (dans laquelle seule réside ce concept).– Or le sentiment du plaisir se place entre la faculté de connaître et la faculté de désirer, de même qu’entre l’entendement et la raison se place le Jugement. On peut donc supposer, du moins provisoirement, que le Jugement contient aussi par lui-même un principe a priori, et que, comme le sentiment du plaisir ou de la peine est nécessairement lié avec la faculté de désirer (soit que, comme dans la faculté de désirer inférieure, il soit antérieur au principe de cette faculté, soit que, comme dans la faculté de désirer supérieure, il dérive seulement de la détermination produite dans cette faculté par la loi morale), il opère aussi un passage entre la pure faculté de connaître, c’est-à-dire le domaine des concepts de la nature et le domaine de la liberté, de même qu’au point de vue logique, il rend possible le passage de l’entendement à la raison.
Ainsi, quoique la philosophie ne puisse être partagée qu’en deux parties principales, la théorique et la pratique ; quoique tout ce que nous pourrions avoir à dire des principes propres du Jugement doive se rapporter à la partie théorique c’est-à-dire à la connaissance rationnelle fondée sur des concepts de la nature, la critique de la raison pure, qui doit établir tout cela avant d’entreprendre l’exécution de son système, se compose de trois parties : la critique de l’entendement pur, celle du Jugement pur et celle de la raison pure, facultés qui sont appelées pures parce qu’elles sont législatives a priori.
IV Du Jugement comme faculté législative a priori.
Le Jugement en général est la faculté de concevoir18 le particulier comme contenu dans le général.
Si le général (la règle, le principe, la loi) est donné, le Jugement qui y subsume le particulier (même si, comme Jugement transcendental, il fournit a priori les conditions qui seules rendent cette subsomption possible) est déterminant. Mais si le particulier seul est donné et que le Jugement y doive trouver la général, il est simplement réfléchissant.
Le Jugement déterminant, soumis aux lois générales et transcendentales de l’entendement, n’est que subsumant ; la loi lui est prescrite a priori, et ainsi il n’a pas besoin de penser par lui-même à une loi pour pouvoir subordonner au général le particulier qu’il trouve dans la nature. — Mais autant il y a de formes diverses de la nature, autant il y a de modifications des concepts généraux et transcendantaux de la nature, que laissent indéterminés les lois fournies a priori par l’entendement pur ; car ces lois ne concernent que la possibilité d’une nature (comme objet des sens) en général. Il doit donc y avoir aussi pour ces concepts des lois qui peuvent bien, en tant qu’empiriques, être contingentes au regard de notre entendement, mais qui, puisqu’elles s’appellent lois (comme l’exige le concept d’une nature), doivent être regardées comme nécessaires en vertu d’un principe, quoique inconnu pour nous, de l’unité du divers. — Le Jugement réfléchissant, qui est obligé de remonter du particulier qu’il trouve dans la nature au général, a donc besoin d’un principe qui ne peut être dérivé de l’expérience, puisqu’il doit servir de fondement à l’unité de tous les principes empiriques, se rangeant sous des principes également empiriques mais supérieurs, et par là à la possibilité de la coordination systématique de ces principes. Ce principe transcendental, il faut que le Jugement réfléchissant le trouve en lui-même, pour en faire sa loi ; il ne peut le tirer d’ailleurs (parce qu’il serait alors Jugement déterminant), ni le prescrire à la nature, parce que, si la réflexion sur les lois de la nature s’accommode à la nature, celle-ci ne se règle pas sur les conditions d’après lesquelles nous cherchons à nous en former un concept tout à fait contingent ou relatif à cette réflexion.