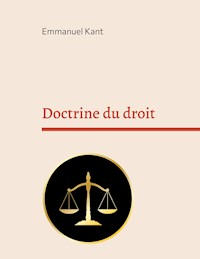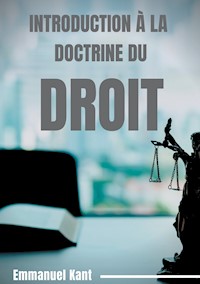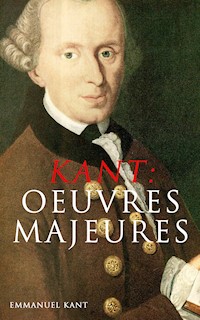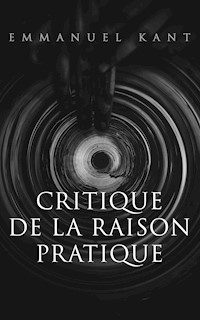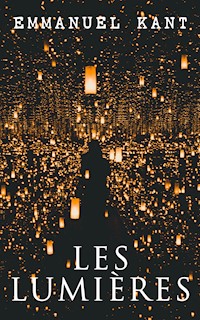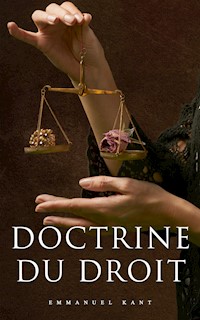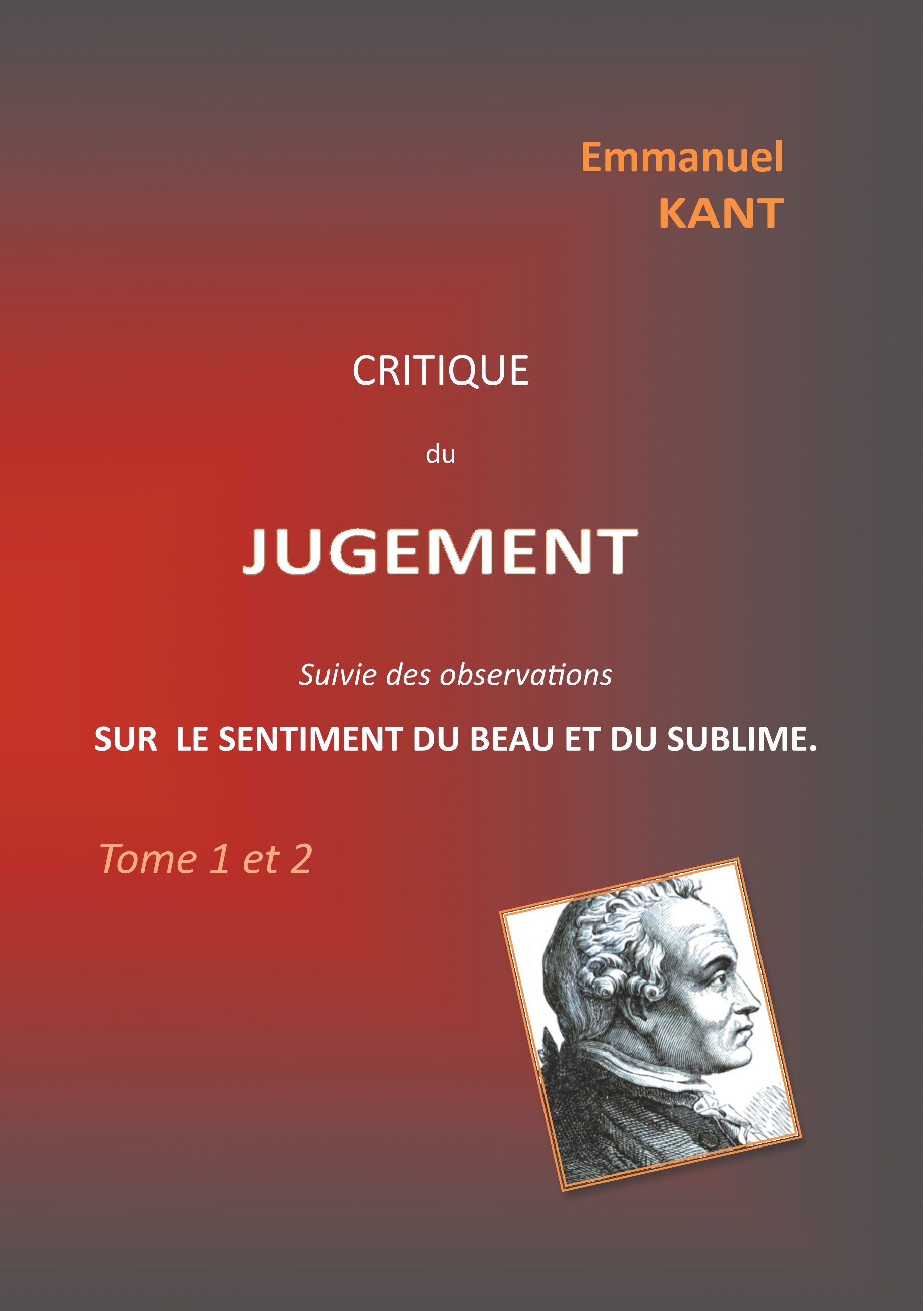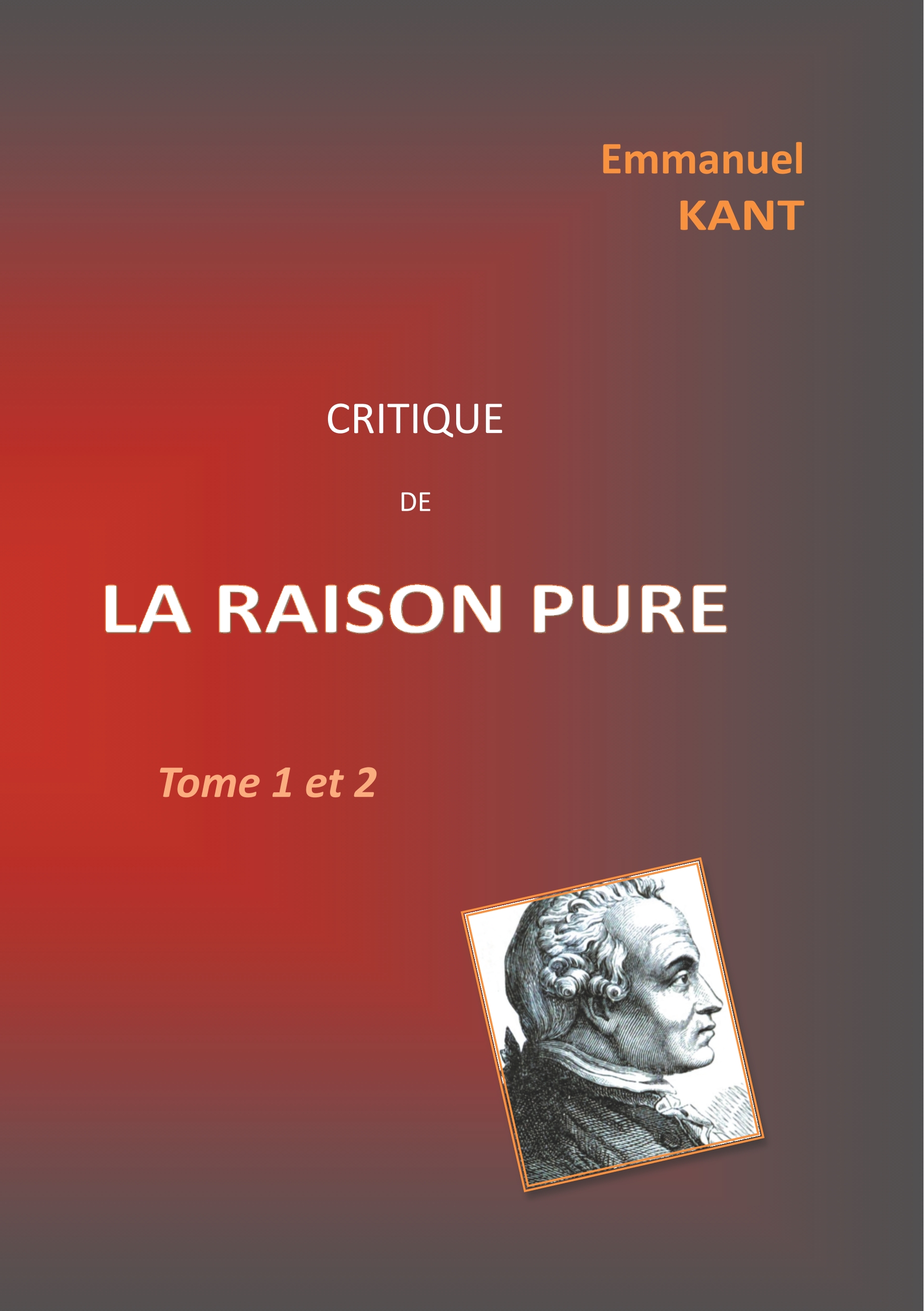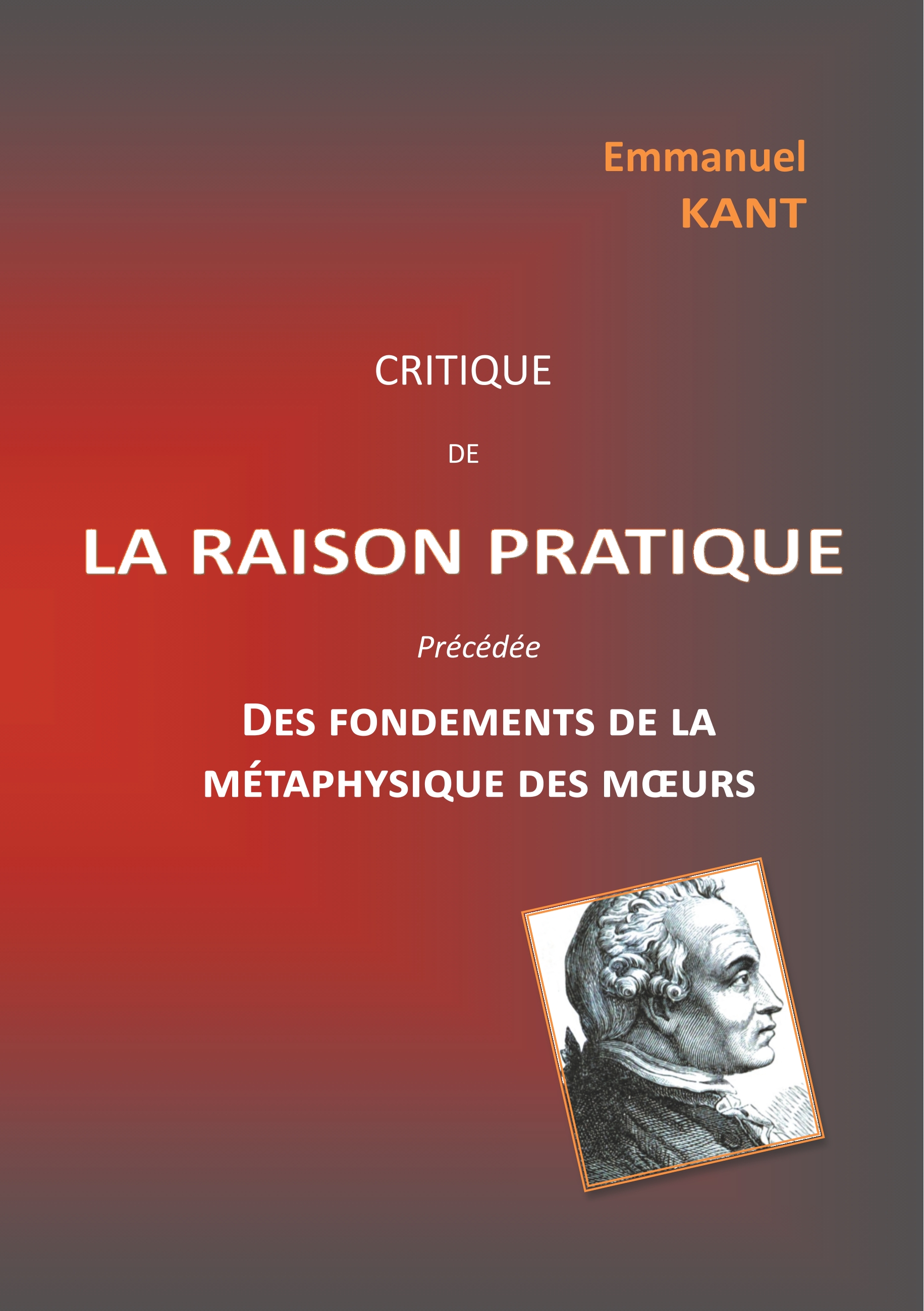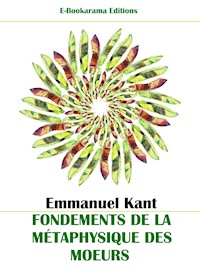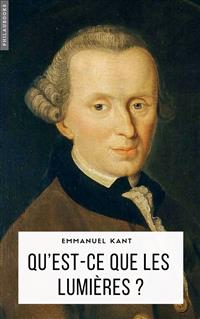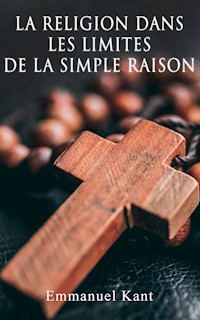
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
La Religion dans les limites de la simple raison est écrit en 1793 par Emmanuel Kant. Bien que le but et l'intention de l'auteur prêtent à discussion encore aujourd'hui, l'influence immense et durable du livre, sur la théologie et la philosophie de la religion, est incontestable. Le livre est composé de quatre parties ou "pièces" écrites dans des revues et qui furent réunies par la suite. L'ouvrage tend à distinguer les éléments d'une foi purement rationnelle, qui pour Kant constitue l'essentiel de la religion, des éléments institutionnels. Il propose une intense réflexion sur le mal moral.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La religion dans les limites de la simple raison
Table des matières
AVANT-PROPOS.
L’objet de cet écrit est la solution de l’un des trois grands problèmes qui s’agitent sourdement au sein des sociétés : je veux parler du problème religieux.
L’auteur de cette solution est l’illustre philosophe de Kœnigsberg, dont le puissant génie devança de beaucoup les événements. Son grand nom trouve aujourd’hui de l’écho dans tout le monde éclairé ; mais l’homme remarquable qui le porta n’a pas encore été, en France, le sujet d’une de ces études patientes, curieuses des moindres détails, avides de toutes les circonstances caractéristiques, et, par conséquent, est à peu près inconnu de nous. La philosophie féconde qui est comme l’auréole de ce nom, est commentée aujourd’hui avec une persévérante ardeur ; et bientôt sans doute l’on nous développera, avec l’étendue que mérite ce point considérable de l’histoire, le rapport, déjà signalé, de l’œuvre révolutionnaire de Kant avec les événements politiques au milieu desquels il l’accomplit. Dans cette double étude, celle de la vie vraiment antique de l’auteur de la Religion dans les limites de la raison, et celle du rapport de la haute spéculation avec l’état social à la fin du dernier siècle, on puisera les garanties d’austérité sublime, de vertu stoïque, ainsi que les preuves de la profondeur de génie, de l’étendue de coup d’œil, qui ne peuvent jamais être plus nécessaires et jamais être exigées avec plus de droit qu’alors qu’il s’agit de l’immense question religieuse, de sa solution selon les exigences du présent et celles de l’avenir.
Cet important travail, qui confirmerait un des principes les plus féconds posé par M. Cousin, a été commencé déjà par plusieurs écrivains, mais est encore loin d’être achevé. Sa place serait évidemment en tête de cette publication, s’il ne devait former un gros livre à lui seul : nous n’entamons donc point ici ce trop vaste sujet. Nous voulons seule ment exposer l’idée-mère de la Religion de Kant, et fixer un moment l’attention sur le plan remarquable de cet ouvrage qui, ardu, hérissé, rebutant pour la forme, est tout à fait en rapport, pour le fond, avec les opinions instinctives des masses elles-mêmes au dix-neuvième siècle.
Toutefois, qu’on nous permette de raconter auparavant l’émotion qui, tantôt, à propos de l’ouvrage de Kant, s’empara de nous, et que nous tairions avec un soin scrupuleux, si de notre récit ne pouvait, ne devait résulter un enseignement utile.
Je m’occupais de réduire, dans ma pensée, le travail qu’on va peut-être prendre la peine d’étudier ; je coordonnais avec soin les réponses, ou ingénieuses ou profondes, que Kant fait aux diverses questions religieuses soulevées depuis dix-huit siècles, et même depuis le commencement de la réflexion dans l’humanité ; je reconnaissais avec bonheur l’accord de ses opinions philosophiquement mûries et des intuitions spontanées des sociétés dépouillées de préjugés religieux ; j’étais ravi d’admiration devant ce grand génie posant, il y a déjà soixante années, des principes qui ont germé dans les esprits, et qui porteront bientôt les fruits ardemment désirés ; j’étais plongé dans cette calme, douce et sainte méditation, lorsque je sentis tout à coup mon cœur, comme en proie à une vive crainte, battre violemment, un frisson de fièvre me parcourir tous les membres, et mes yeux se remplir d’amères larmes. Je venais de m’apercevoir que dans ce livre, pourtant vaste et profond, de Kant ; dans ce livre qui traite de la religion, le mot d’amour le mot de charité ne se trouvent point prononcés. A cette découverte tardive, je sentais mon âme comme se fondre d’admiration pour la doctrine catholique, qui m’apparaissait alors semblable à une de ces vierges grandes, belles et graves qui, par le chaste amour qu’elles nous inspirent, nous purifient. Dans ce moment, où je croyais m’être affranchi, trop tard ! d’une illusion, je ne pus retenir cette exclamation de colère : « Eh bien ! livre maudit ! tu paraîtras tout de même ! tu seras l’évangile des hommes sans cœur ! » Et je restai tout le jour bourrelé par le doute et les perplexités. Je me demandais incessamment, avec un sentiment d’indignation profonde : Comment la raison peut-elle s’ingérer de répondre au cœur ? Ces deux facultés, qui ont chacune leur langage, peuvent-elles jamais se comprendre ? La raison, surtout, au milieu de sa sphère d’abstractions, de déductions logiques, concevra-t-elle jamais rien aux élans sublimes du sentiment ?
Qu’on me pardonne la révélation publique de cette crise intellectuelle à cause de la réflexion qu’elle suggère et du secours qu’elle peut apporter à quelques jeunes et ardents chercheurs de la vérité.
La religion, ce fond de toute philosophie, cette fin de toute vie humaine, se compose essentiellement de deux parties : l’une, qui ressortit de la raison ; l’autre, qui ressortit du sentiment. Les sectes qui fondent la religion sur la raison exclusivement, de même que celles qui l’étayent sur le sentiment seul, tout comme celles qui la font reposer sur la raison et sur le sentiment, en donnant toutefois à ces deux facultés une autorité égale, se trouvent toutes à côté du vrai, et sont bientôt jetées, par la logique et la force de leur principe même, dans les plus graves erreurs. C’est que le sentiment et la raison ne peuvent pas être placés au même rang. Dans la spéculation, dans l’investigation de la vérité, cela est hors de doute : les révélations du sentiment, bien qu’elles puissent être vraies, que leurs objets puissent être vrais, ne sont pas d’une certitude apodictique, démontrée ni démontrable. Dans la pratique, sous le rapport pragmatique, comme parle Kant, il n’y a pas non plus à hésiter : le sentiment doit être subordonné à la raison : seul, abandonné à lui-même, le sentiment, comme moyen de connaissance, jette dans les extravagances du mysticisme ; comme règle de conduite, il expose à la superstition, au fanatisme et aux déceptions les plus amères : qui ne le sait de reste ? Il est donc bon, il est donc utile, il est donc ; nécessaire que le sentiment, comme cela s’observe d’ailleurs dans la vie journalière, soit soumis à la raison qui le dirige. Mais, au nom même de la raison, il faut prendre garde qu’elle n’anéantisse le sentiment ; car il ne resterait, chose bien évidente, que des natures mutilées.
Cette nécessité, en matière de religion, de la coexistence de la raison et du sentiment, et cette nécessité de la subordination de l’un à l’autre, sont un double principe dont il ne faut point se départir, si l’on ne veut être entraîné dans les opinions les plus gravement erronées en étudiant et les rationalistes purs et les mystiques à tous les degrés. « Tant importe, lorsqu’on allie deux choses, l’ordre dans lequel on les unit ! »
Quand je dis que la raison et le sentiment ainsi subordonnés constituent la religion vraie, je dis la vie de tous les jours et de tous les instants. Car la vie est un devoir continuel, et la religion véritable est l’accomplissement des devoirs considérés comme autant de commandements divins. Telle est l’admirable définition que Kant donne de la religion. Son livre, qu’il destinait au peuple et qui ne suppose qu’indirectement la connaissance de ses écrits antérieurs, a deux tendances : l’une, à transformer le présent ; l’autre, à fonder l’avenir. La première, comme on voit, est le moyen de la seconde, qui est la fin : il montre, dans la conception de ce plan, qu’à toutes ses connaissances théoriques et spéculatives il joignait une certaine aptitude aux affaires ou du moins à la direction sage, progressive des esprits. Il interprète une à une toutes les parties du dogme chrétien ; il discute tous les articles de foi du protestantisme et du catholicisme sous le point de vue rationnel, et donne sur chacun des points essentiels, des explications parfaitement positives, parfaitement raisonnables et admissibles. Il n’est guère qu’une question qu’il tranche avec l’autorité d’un homme d’un grand caractère, sûr de lui, de sa moralité, de la pureté de ses sentiments et de la force de sa volonté dans l’exécution : je veux parler de la question de la confession auriculaire dans l’Église catholique. Il représente Jésus non point comme une idée, mais comme la manifestation de l’idéal le plus parfait de l’humanité, et, dans cette manière de le concevoir, dans cette représentation de l’exemplaire, du type et du modèle tout ensemble de l’homme, l’homme-Dieu ne reste-t-il pas tout entier ? La loi morale nous représente une fin à atteindre, et, par cela même qu’elle nous la propose, nous devons graviter incessamment vers cette fin, et nous le pouvons, sauf à en rester toujours à une grande distance. Nous ne devons nous reposer de notre développement moral, de cette ascension continuelle vers le bien absolu, que sur nous seuls, et n’admettre d’autres mobiles d’actions que les injonctions inconditionnées de la morale suffisante par elle-même. Mais c’est n’accomplir qu’une portion de ses devoirs que de travailler à son amélioration individuelle ; il faut encore établir un État divin, une cité de Dieu, une république morale, dans laquelle doit entrer le genre humain tout entier. C’est ainsi, c’est par la religion rationnelle seule que peut être réalisée la véritable Église universelle. Le sacerdoce ne peut être une mission divinement confiée à quelques-uns : il appartient à tous les hommes, car tous doivent travailler, dans la mesure de leur pouvoir, à l’extension du bien sur la terre : tout homme est prêtre, ministre et serviteur de Dieu, parce qu’il a charge de la moralité de ses semblables. Tous les moyens que n’improuve pas la raison peuvent être employés pour l’accomplissement du grand œuvre de perfectionnement moral, pourvu qu’ils ne tendent point à égarer les esprits et les cœurs, à faire naître dans les âmes la superstition et le fanatisme, ou à nous inspirer la coupable défiance de nos propres forces.
Cette morale, cette théorie du devoir appliquée à la religion, est essentiellement une théorie de la liberté ; et, si nous abordions la question du rapport d’une religion ainsi conçue, de la véritable religion avec la politique, pour suivre en cela l’exemple de plusieurs membres influents du clergé, on peut prévoir quelles seraient nos légitimes et grandes conséquences. Le dogme chrétien se rattache logiquement et réellement à l’absolutisme, ce gouvernement de l’arbitraire sur la lâcheté, qu’avec une habileté antique on prétendit longtemps établi de Dieu. La religion véritable, la religion de la bonne conduite, la religion du devoir, ne relevant de Dieu que médiatement, par l’intermédiaire de la conscience, organe toujours actif de la volonté divine, se rattache au gouvernement de la liberté, fondé sur la raison et sur la justice que fonde la raison, ou qui plutôt est la raison pratique elle-même. Telle est la doctrine religieuse, professée dans l’ouvrage que nous venons de traduire. Kant, dans la division de son sujet et l’arrangement des parties, a suivi une méthode qui est plutôt celle d’un artiste et d’un poëte que celle d’un savant et d’un philosophe. En considérant le titre de chacune des quatre parties, on dirait d’un poëme dramatique que l’auteur a entrepris de composer. En effet, nous constatons d’abord, avec le philosophe de Kœnigsberg, l’existence de deux puissants adversaires au sein de la nature humaine : ils sont rigoureusement et exactement caractérisés ; puis nous assistons à la lutte continuelle, acharnée, du bien et du mal sur le théâtre de la conscience. La tactique savante du bon principe est décrite, c’est-à-dire que les conditions auxquelles il peut triompher sont énumérées, La victoire est à la fin remportée par la vertu, et on procède à l’organisation de la conquête. Ces quatre moments distincts et successifs dans le combat forment au traité de la Religion de Kant une base brillante et vraiment digne de Platon. Toutefois, on pourrait encore intituler la première partie : le Péché originel ; la seconde, le Verbe ; la troisième, le Règne de Dieu ; la quatrième enfin, l’Église.
Quant au style de l’ouvrage, je n’en dis rien ici ; je conviens seulement qu’il peut être comparé à un massif de végétation vigoureuse dans lequel l’air ne circule qu’à grand peine. Mais, pour être étranger à nos habitudes intellectuelles, il n’en est pas moins accessible au sincère désir de la vérité.
Ce livre est comme un puits obscur, au fond duquel est le vrai dans l’ordre religieux.
Puissent mes amis que préoccupe l’avenir des sociétés, et que troublent les froides ténèbres du doute, examiner avec attention ce monument de l’histoire, y pénétrer avec un courage patient, et en sortir pleins de cette sécurité d’âme, de cette tranquillité de cœur et d’esprit, de cette force morale qui sont les conditions du bonheur ! Puissent-ils en rapporter un amour plus vif encore du bon, du juste, de l’honnête ! Puissent-ils aussi, en étudiant les plus belles productions ou littéraires ou philosophiques de l’étranger, ne point laisser émousser en eux le sentiment de la nationalité !
JACQUES TRULLARD.
Paris, 25 juillet 1841.
PREMIÈRE PARTIE. DE LA COEXISTENCE DU MAUVAIS ET DU BON PRINCIPE DANS L’HOMME.
OU
DU MAL INHÉRENT A LA NATURE HUMAINE.
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
Le monde est en proie au mal ! — Cette plainte est aussi ancienne que l’histoire, que la poésie antérieure encore à l’histoire, même que la plus ancienne entre toutes les poésies, que la poésie religieuse. L’histoire et la poésie, pourtant, font commencer le monde par le règne du bien, par l’âge d’or, la vie dans le Paradis, ou une vie plus heureuse encore à cause du commerce avec les êtres célestes. Mais ce bonheur, les mêmes traditions poétiques et historiques le font bientôt évanouir comme un songe, et montrent la chute des hommes dans le mal (le mal moral avec lequel marche toujours de pair le mal physique) de plus en plus rapide et profonde 2 ; en sorte que maintenant (et ce maintenant est aussi ancien que l’histoire) nous vivons dans les temps suprêmes ; le dernier jour, la fin du monde sont à notre porte 3. Dans quelques contrées de l’Indostan, l’arbitre et le destructeur du monde, Routtren (appelé encore Siba ou Siven), est déjà honoré comme le Dieu aujourd’hui le plus puissant ; le conservateur du monde, Wischnou, las de l’emploi qu’il avait reçu du Créateur du monde, ayant abdiqué déjà depuis des siècles.
Une opinion plus nouvelle, mais moins répandue, est l’héroïque opinion opposée qui a trouvé créance parmi les philosophes, et surtout, dans ces temps modernes, chez les pédagogistes. Elle consiste à dire que le monde marche dans une direction précisément inverse de la précédente, qu’il va du mal au mieux continuellement, quoique le progrès soit à peine sensible ; que, du moins, la disposition à l’amendement moral se
(N. du T.)
trouve dans la nature humaine. Mais cette opinion, ses partisans ne l’ont certainement pas puisée dans l’expérience, s’il s’agit du bien et du mal moral (et non de la civilisation) ; car l’histoire de tous les temps élève, pour la démentir, une voix trop puissante ; il est probable qu’elle n’est qu’une généreuse hypothèse de la part des moralistes depuis Sénèque jusqu’à Rousseau, pour encourager à cultiver infatigablement (si l’on peut compter sur une pareille disposition naturelle dans l’homme) le germe du bien qui se trouve peut-être en nous. Du reste, tout comme on doit admettre que l’homme, de sa nature, c’est-à-dire ordinairement, est sain de corps, de même il n’y a aucun motif pour ne point le supposer, quant à l’âme, naturellement sain et bon. Que la nature, pour développer en nous cette disposition morale au bien ; nous vienne donc en aide ! Sanabilibus oegrotamus malis nosque in rectum genitos natura, si sanari velimus, adjuvat : dit Sénèque.
Comme, pourtant, il pourrait être arrivé que l’on se fût trompé dans ces deux assertions soi-disant basées sur des faits, cette question se présente : un terme moyen, au moins, ne serait-il pas possible ? c’est-à-dire l’homme, dans son espèce, ne serait-il pas ni bon ni méchant ? ou, en tous cas, autant l’un que l’autre, moitié bon, moitié méchant ? — Un homme est appelé méchant non point par la raison que ses actions sont méchantes ou contraires à la loi, mais parce qu’elles ont un caractère tel qu’elles donnent droit de supposer dans l’agent des maximes mauvaises. Or, on peut bien constater par l’expérience que les actions sont contraires à la loi morale ; on peut même reconnaître, du moins d’après les actions mêmes, qu’elles ont été accomplies contrairement à cette loi avec la conscience de la transgression que l’on commettait. Mais les maximes, on ne peut point les observer expérimentalement même dans sa propre conscience, par conséquent on ne peut point fonder sur l’expérience l’affirmation de la méchanceté d’un agent avec une pleine et entière certitude. Il faudrait pouvoir conclure à priori de quelques actions mauvaises, même de chacune des actions mauvaises accomplies avec la conscience qu’elles sont telles, à une maxime mauvaise radicale, puis de cette maxime à un principe fondamental et universel de chaque acte spécial moralement méchant, principe qui deviendrait à son tour une maxime, pour pouvoir soutenir avec connaissance de cause qu’un homme est méchant.
Afin que le lecteur ne se méprenne point sur le sens du mot nature, qui, s’il devait signifier, comme à l’ordinaire, le contre-pied du principe des actes libres, serait en contradiction flagrante avec les attributs de moralement bon et de moralement méchant, je dois faire remarquer que, par nature humaine, j’entends uniquement le principe subjectif de l’usage de la liberté en général(sous des lois morales objectives), principe qui est antérieure tout fait tombant sous les sens, auquel on peut d’ailleurs attribuer telle origine que l’on voudra. Mais il doit toujours être un acte de liberté, sans quoi l’usage ou l’abus de notre arbitre 4, en ce qui concerne la loi morale, ne pourrait pas nous être imputé, et il n’y aurait pas lieu à dire bien ou mal moral. Par conséquent, ce ne peut être ni dans un objet déterminant la volonté par l’inclination, ni dans une impulsion instinctive que se trouve la source du mal ; mais uniquement dans une règle que la volonté se crée à elle-même pour l’usage de sa liberté, c’est-à-dire dans une maxime. Maintenant il ne faut pas poursuivre et demander quel est le principe subjectif d’après lequel l’homme accepte
(N. du T.)
telle maxime plutôt que la maxime opposée. Car, si ; en dernière analyse, ce principe lui-même était non plus une maxime, mais un pur instinct, l’usage de la liberté ne serait plus autre chose que la détermination par des causes physiques : ce qui implique. Quand donc nous disons : l’homme est bon de sa nature, ou il est méchant de sa nature, cela signifie simplement et exclusivement qu’il renferme en lui un principe primitif, à nous impénétrable 5, en vertu duquel il adopte de bonnes ou de mauvaises maximes ; et l’homme est ici considéré en général et exprime en conséquence, par ces maximes, le caractère de toute son espèce.
Nous pouvons donc dire de tel caractère moral de l’homme (et l’on va remarquer la différence qui existe entre l’homme et les autres êtres raisonnables possibles) qu’il lui est inné, sauf à toujours faire cette restriction, que la nature n’en porte pas la faute, s’il est mauvais, n’en recueille point le mérite, s’il est bon ; mais qu’il est toujours, quoiqu’il arrive, l’œuvre libre de l’homme. Or, comme le principe primitif en vertu duquel nous adoptons nos maximes, et qui, par cette raison, doit toujours être aussi du domaine du libre arbitre, ne peut être un fait empirique, le bien, de même que le mal, dans l’homme (en tant que principe subjectif d’après lequel sont admises telles ou telles maximes par rapport à la loi morale), est dit simplement inné dans le sens, c’est-à-dire que le bien ou le mal est déjà un principe avant tout usage sensible de la liberté (pendant l’époque de la vie qui s’écoule depuis l’adolescence en remontant jusqu’au berceau), et peut, à ce titre, être représenté comme existant dans l’homme dès sa naissance, sans que pour cela la naissance en soit la cause.
Pour ce qui est de la divergence des deux opinions hypothétiques précédemment rapportées, elle a pour fondement cette proposition disjonctive : L’homme est (de sa nature) ou moralement bon ou moralement méchant. Or, il vient naturellement à l’esprit de demander si, après tout, on doit s’accommoder de cette disjonction, et si l’on ne pourrait pas soutenir que l’homme, de sa nature ; n’est ni bon ni méchant. Une quatrième opinion pourrait être : que l’homme est tout ensemble bon et méchant, bon dans certaines occurrences, méchant dans d’autres : l’expérience semble, en effet, confirmer ce moyen terme entre ces extrêmes.
Mais il est, en général, du plus haut intérêt pour la morale de ne concéder, autant que possible, de milieux moraux d’aucune sorte, ni en fait d’actions, ni en fait de caractères ou de qualités, parce que, dans ces positions intermédiaires entre deux positions extrêmes, toutes les maximes courent risque de perdre leur sens précis et fixe. On nomme communément les partisans de cette sévère manière de penser d’un nom qui peut emporter un blâme, mais qui, dans le fait, est un éloge : on les appelle rigoristes ; les partisans de l’opinion contraire peuvent, par conséquent, s’appeler latitudinaires. Les lalitudinaires admettent donc ou que l’homme n’est ni bon ni méchant et peuvent se nommer indifférentistes, ou que l’homme est bon et méchant tout ensemble et peuvent s’appeler syncrétistes6.
La réponse que les rigoristes, dans leur manière de voir 7, font à la précédente question se fonde sur une observation importante en morale : le libre arbitre a pour caractère particulier de ne pouvoir être déterminé à une action par aucun mobile, sans que l’agent l’ait reçu parmi ses maximes (sans qu’il ne s’en soit fait une règle générale de conduite) ; il peut toutefois y avoir accord entre un mobile quelconque et la spontanéité absolue du libre arbitre. Mais la loi morale est, en soi, selon le jugement de la raison, un mobile, et qui l’adopte pour sa maxime est moralement bon. Celui, par conséquent, dont le libre arbitre n’a point été déterminé par la loi morale dans une action ressortissant de cette loi, doit avoir subi l’influence d’un mobile tout opposé ; et comme, par l’hypothèse, cela ne peut avoir lieu sans que l’agent ait admis parmi ses maximes ce mobile, et par conséquent aussi la déviation de la loi morale (auquel cas il est méchant), alors son sentiment par rapport à la loi morale n’est jamais indifférent, n’est jamais ni bon ni mauvais.
L’homme ne peut pas non plus être moralement-bon dans quelques circonstances et moralement méchant dans d’autres. Car s’il est bon dans un cas, il a adopté la loi morale parmi ses maximes ; s’il doit, lui-même, être méchant dans un autre cas, comme la loi morale de l’accomplissement du devoir en général est unique et universelle, la maxime ressortissant de cette loi serait tout ensemble générale et particulière : ce qui est contradictoire 8.
Avoir une disposition au bien ou une disposition au mal comme manière d’être primitive et innée, ne signifie pas non plus que l’homme qui les revêtue peut point les acquérir, qu’il n’en est point l’artisan ; cela signifie seulement qu’il ne peut pas les acquérir dans le temps, qu’il a toujours été tel ou tel, ou bon ou méchant, depuis sa jeunesse. La disposition, c’est-à-dire le principe subjectif primitif en vertu duquel nous adoptons nos maximes, doit être une et rien qu’une, sauf à être étendue à tout l’ensemble de l’usage de la liberté. Et elle doit elle-même être également admise par le libre arbitre, sans quoi elle ne pourrait point nous être imputée. Mais pour le principe subjectif, pour la cause de cette admission, nous ne pouvons, malgré la pente irrésistible de l’esprit à s’en enquérir, en rien connaître, par la raison qu’il faudrait de nouveau alléguer une maxime dans laquelle serait admise la disposition, et que cette maxime présupposerait à son tour un principe. Ainsi, ne pouvant point déduire cette disposition d’un premier acte volontaire accompli dans le temps, nous la nommons une manière d’être que le libre arbitre tient de la nature (quoique, dans le fait scelle ait son principe dans la liberté) 9. Quant au droit d’appliquer cette dissertation sur le bien et le mal primitif non à un individu, parce qu’alors l’un pourrait être considéré comme bon, l’autre comme méchant, mais à toute l’espèce, nous ne pouvons le démontrer qu’ultérieurement, à moins qu’il ne devienne évident, au moyen de recherches anthropologiques, que les motifs qui nous autorisent à attribuer à un homme le caractère de bonté ou celui de méchanceté comme lui étant inné, sont de telle nature qu’il n’y a aucune raison de faire exception d’un seul individu, et qu’il faut en frapper, de l’un ou de l’autre, l’espèce humaine tout entière.
CHAPITRE PREMIER. — De la Disposition originelle au bien dans l’homme.
Nous pouvons considérer cette disposition, par rapport à sa fin, sous trois points de vue, c’est-à-dire sous autant d’aspects qu’il y a de principes de détermination dans la nature humaine, et distinguer :
1°. La disposition de l’homme à l’animalité, en tant qu’être vivant ;
2°. Sa disposition à l’humanité, en tant qu’être vivant et tout ensemble raisonnable ;
3°. Sa disposition à la personnalité, en tant qu’être raisonnable et tout ensemble susceptible d’imputabilité10.
1°. La disposition à l’animalité dans l’homme peut être comprise sous le titre général d’amour de soi physique et purement mécanique, c’est-à-dire tel qu’il ne suppose point la raison. Cette disposition est de trois sortes : il y a, premièrement, la disposition à la conservation de soi-même ; deuxièmement, la disposition à la reproduction de l’espèce, en vertu de l’appétit du sexe, et à la conservation de ce qui a été procréé ; troisièmement, la disposition à l’association avec les autres hommes, c’est-à-dire le penchant à la société. — A la disposition à l’animalité peuvent être rattachés les vices de toute espèce (qui, pourtant, ne découlent pas de cette disposition comme de leur source, mais naissent d’eux mêmes). Ils peuvent être appelés des vices de la grossièreté de la nature, et, dans leur déviation extrême de la fin naturelle ; on peut les appeler des vices brutaux ; tels : l’intempérance, la volupté et le refus sauvage de reconnaître aucune loi (par rapport aux autres hommes).
2°. Les dispositions à l’humanité peuvent être comprises sous le titre d’amour de soi, physique, à la vérité, mais tendant néanmoins à comparer ; opération qui requiert l’intervention de la raison ; c’est seulement, en effet, par voie de comparaison que l’homme se juge heureux ou malheureux. De cet amour de soi provient notre penchant à nous acquérir une valeur dans l’opinion d’autrui, sans ambitionner toutefois primitivement au delà de l’égalité, et à ne concéder sur nous de supériorité à personne. Ce penchant entraîne nécessairement après soi la constante appréhension que les autres n’aspirent à nous être supérieurs, et conséquemment l’injuste désir d’acquérir la supériorité pour soi-même. — A ces tendances de la nature humaine, c’est-à-dire à la jalousie et à la rivalité, peuvent être rapportés les plus grands vices, les inimitiés secrètes et publiques contre tous ceux qui ne partagent point nos sympathies. Toutefois, ces vices n’ont point, à proprement parler, leur racine dans la nature de l’homme ; ils naissent d’eux-mêmes. L’aspiration inquiète d’autrui à posséder sur nous une supériorité que nous haïssons, engendre les penchants à la rechercher sur les autres pour notre propre sûreté et comme un préservatif, quand la nature, pourtant, ne voulut faire de l’idée d’une pareille émulation (laquelle n’exclut point la réciprocité d’affection) qu’un stimulant à la culture de nos facultés physiques et morales. Aussi, les vices qui se rattachent à ce penchant peuvent être appelés des vices de culture ou de développement ; et lorsqu’ils sont à leur plus haut degré de perversité, qu’ils offrent l’idée de l’apogée d’une méchanceté hors nature, telles que l’envie, l’ingratitude, la jouissance du malheur d’autrui, etc., ils peuvent être nommés des vices sataniques.
3°. Quant à la disposition à la personnalité, c’est la susceptibilité de respecter la loi morale, et d’ériger ce respect en un mobile qui suffise par lui-même au libre arbitre. La susceptibilité de respecter purement et simplement la loi morale en nous, serait le sentiment moral ; mais ce sentiment ne peut par lui-même être une fin d’une disposition de la nature sans être un mobile du libre arbitre. Or, ceci étant absolument impossible si le libre arbitre n’a accepté le sentiment moral parmi ses maximes, il s’ensuit que le caractère du libre arbitre qui l’accepte est un caractère de bonté. Comme toute manière d’être du libre arbitre, ce caractère ne nous est point donné, nous l’acquérons, à la condition, pourtant, de tenir de la nature une disposition à laquelle on ne puisse absolument rien rapporter de mauvais. Sans doute, l’idée de la loi morale, ainsi que celle du respect qui est dû à cette loi et en est inséparable, ne peut, rigoureusement parlant, être appelée une disposition à la personnalité, car elle est la personnalité même (l’idée de l’humanité considérée d’une manière purement intellectuelle). Mais le principe subjectif en vertu duquel nous acceptons le respect de la loi pour, mobile parmi nos maximes, paraît être un acheminement à la personnalité ; et, par cette raison, il mérite le nom de disposition auxiliaire de la personnalité. Si nous recherchons quelles sont les conditions de la possibilité de ces trois dispositions, nous trouvons que la première suppose l’absence de la raison, que la seconde requiert sans doute la raison pratique, mais uniquement dans l’intérêt des autres mobiles, et que la troisième seule se fonde sur la raison pratique prise en elle-même, c’est-à-dire donnant des lois absolues. Toutes ces dispositions dans l’homme ne sont pas seulement d’une bonté négative, en ce sens qu’elles ne sont point rebelles à la loi morale ; elles sont encore des dispositions au bien, en ce sens qu’elles favorisent l’accomplissement de la loi. Elles sont primitives, car d’elles dépend la possibilité de la nature humaine. L’homme peut bien, dans l’usage des deux premières de ces dispositions, méconnaître leur fin, mais il ne peut détruire ni l’une ni l’autre. Par dispositions d’un être, nous entendons aussi bien les éléments essentiels qui lui sont nécessaires que les formes de la connexion de ces éléments qui font qu’il est ce qu’il est. Ces formes sont primitives, si elles sont le fondement nécessaire de la possibilité d’un être ; elles sont contingentes, si, sans elles, l’être est possible en soi. De reste, on doit remarquer qu’ici nous ne parlons d’aucune autre faculté que de celles qui ont un rapport immédiat à l’appétit ou au désir, et à l’exercice de l’arbitre.
CHAPITRE II. — Du Penchant au mal dans la nature humaine.
Par penchant (propensio), j’entends le principe subjectif de la possibilité d’une inclination (d’un désir habituel, concupiscentia), en tant que cette inclination est contingente dans l’humanité11. Le penchant, diffère de la disposition en ce que, bien qu’il puisse être inné, il ne peut pourtant point être représenté comme tel ; au contraire, selon qu’il est bon ou qu’il est mauvais, il peut être regardé comme acquis ou comme contracté par l’homme. — Mais il n’est ici question que du penchant au mal proprement dit, c’est-à-dire au mal moral, qui, n’étant possible que comme détermination volontaire, et la détermination volontaire ne pouvant être jugée bonne ou mauvaise que d’après les maximes du libre arbitre, doit consister dans le principe subjectif de la possibilité que les maximes soient détournées de la loi morale. Si ce penchant peut en général être regardé comme inhérent à la nature humaine et, par conséquent, comme un caractère de l’humanité, il peut être appelé un penchant naturel de l’homme au mal. — Ajoutons encore que la capacité ou l’incapacité de l’arbitre à admettre la loi morale parmi ses maximes, s’il écouté un penchant naturel, constitue ce qu’on appelle bon ou mauvais cœur.
On peut distinguer dans le penchant au mal trois degrés : Il y a, premièrement, la faiblesse de l’homme dans l’accomplissement des maximes adoptées, ou la fragilité morale de la nature humaine ; il y a, secondement, le penchant à mêler (fût-ce dans de bonnes intentions et en vertu de maximes de bien) les mobiles immoraux avec les mobiles moraux, ou l’impureté de la nature humaine ; il y a, troisièmement, enfin, le penchant à l’adoption de mauvaises maximes, c’est-à-dire la méchanceté de la nature humaine ou du cœur humain.
Premièrement, la fragilité morale de la nature humaine (fragilitas) est même exprimée dans la plainte d’un apôtre : J’ai bien la volonté, dit-il, mais l’exécution me fait défaut ; ce qui se traduit ainsi : J’adopte la loi morale parmi les maximes de mon arbitre, mais cette loi morale qui, objectivement et en idée (in thesi), est un mobile invincible, est, subjectivement (in hypothesi) et lorsqu’il s’agit d’accomplir la maxime, plus faible que l’inclination.
Deuxièmement, l’impureté du cœur humain (impuritas, improbitas) consiste en ce que la maxime, quoique bonne dans son objet qui est l’accomplissement de la loi morale, quoique assez puissante peut-être même pour l’exécution, n’est point moralement pure. En d’autres termes, l’impureté résulte de ce que la loi morale n’a pas été prise, comme elle devait l’être, pour mobile unique et suffisant, mais que, le plus souvent et peut-être toujours, d’autres mobiles étrangers à la loi morale ont été nécessaires pour déterminer la volonté à accomplir les injonctions du devoir. En d’autres termes encore, le cœur est impur quand des actions conformes au devoir n’ont point été faites purement par devoir.
Troisièmement, la méchanceté (vitiositas, pravitas) ou, si l’on veut, la dépravation (corruptio) du cœur humain est le penchant à rejeter comme maximes les mobiles pris de la loi morale et à en adopter d’autres qui ne sont point moraux. On peut encore appeler ce penchant la perversité du cœur humain (perversitas), parce qu’il trouble et pervertit l’ordre moral relativement aux mobiles du libre arbitre ; et, bien qu’il puisse en résulter des actions conformes à la loi morale et bonnes aux yeux de la loi positive, toujours est-il que la manière de penser est corrompue dans sa source, du moins en ce qui touche le sentiment moral, et que l’agent, pour ce motif, est marqué comme méchant.
Observons que le penchant au mal est ici supposé à tout homme, même à celui que ses actions font réputer un homme de bien. Cela doit être, à la condition, toutefois, de prouver que le penchant au mal est universel dans le genre humain, et que l’homme, ce qui revient au même, est corrompu dans sa nature.
Il n’y a entre un homme de bonne conduite (benè moratus), et un homme moralement bon (moraliter bonus) aucune différence en ce qui concerne l’accord des actes avec la loi morale, du moins il ne devrait y en avoir aucune. Tout ce qui les distingue, c’est que le premier prend toujours la loi morale pour unique et suprême mobile, et le second, rarement et peut-être jamais. On peut dire de l’un qu’il suit la lettre de la loi, qu’il accomplit les actions commandées par cette loi ; on peut dire de l’autre qu’il en observe l’esprit, qui consiste à regarder la loi morale comme un mobile unique et suffisant. Tout ce qui n’est point fait dans celte conviction est faute (comme manière de penser). Car, si pour déterminer l’arbitre à des actions conformes à la loi, il est besoin d’autres mobiles que de la loi même, s’il faut que l’ambition, l’amour de soi en général, ou même un instinct bienveillant, une impulsion sympathique interviennent, alors la concordance des actions avec la loi n’est plus que fortuite et contingente ; car ces mobiles eussent pu tout aussi bien pousser l’agent à la transgression de la loi. La maxime dont la bonté sert de mesure pour apprécier la valeur morale d’une personne, est donc alors moralement illégitime, et l’agent, malgré des actions extérieurement bonnes, est pourtant méchant.
L’explication suivante est encore nécessaire pour préciser l’idée du penchant au mal. Un penchant est physique s’il ressortit de l’arbitre de l’homme considéré comme être physique ; moral, s’il ressortit de l’arbitre de l’homme considéré comme être moral. — Entendu dans le premier sens, il n’existe point de penchant au mal moral, car ce mal doit dériver de la liberté, et un penchant physique (ou provenant d’une impulsion sensible) à faire un usage quelconque de la liberté, soit en bien, soit en mal, est une contradiction. Un penchant au mal ne peut donc compéter qu’aux facultés morales de l’arbitre. Mais il n’y a de mal moral, c’est-à-dire imputable, que celui qui est notre action propre. Or, on entend par penchant le principe subjectif de détermination volontaire, lequel précède l’action, et par conséquent n’est pas même encore une action ; il y aurait donc là, dans l’idée d’un penchant au mal, une contradiction, si le mot action ne pouvait être pris dans deux acceptions tout ensemble différentes et susceptibles d’être conciliées avec l’idée de liberté. En effet, par action, en général, on entend tout aussi bien l’exercice de la liberté pour adopter dans l’arbitre des maximes fondamentales, conformément ou contrairement à la loi morale, que l’exercice de la liberté pour accomplir matériellement les actions elles-mêmes, et réaliser les objets de l’arbitre selon les maximes adoptées. Le penchant au mal est donc une action, à prendre le mot dans le premier sens (peccatum originarium) ; et c’est, en même temps, le principe formel de toute action (à entendre le mot dans le second sens) opposée à la loi morale, en contradiction matérielle avec cette loi, et nommée vice (peccatum derivativum). De ces deux manquements, l’un est consommé sans retour, quoique l’autre, provenant de mobiles qui ne consistent point dans la loi même, puisse être évité de plusieurs manières. L’action par laquelle nous choisissons nos maximes est intelligible, connaissable seulement par la raison sans condition de temps ; celle par laquelle nous accomplissons les actions elles mêmes est sensible, empirique, donnée dans le temps (factum phoenomenon). La première s’appelle donc, par comparaison avec la seconde, un simple penchant ; et ce penchant est dit inné, parce qu’il ne peut être extirpé (attendu que pour cela la maxime suprême devrait être bonne, et qu’en vertu du penchant au mal elle a été choisie mauvaise) ; puis, surtout, parce que nous ne pouvons pas plus dire pourquoi le mal, qui pourtant est notre fait, a précisément corrompu notre maxime suprême, que nous ne pouvons expliquer la raison d’existence d’une qualité inhérente à notre, nature. — On voit, d’après ce que nous venons de dire, par quel motif nous avons cherché, dès le début, les trois sources du mal moral dans le principe fondamental et libre en vertu duquel nous acceptons et observons nos maximes, et non point dans la sensibilité (en tant que receptivité).