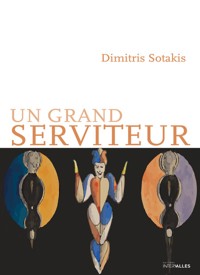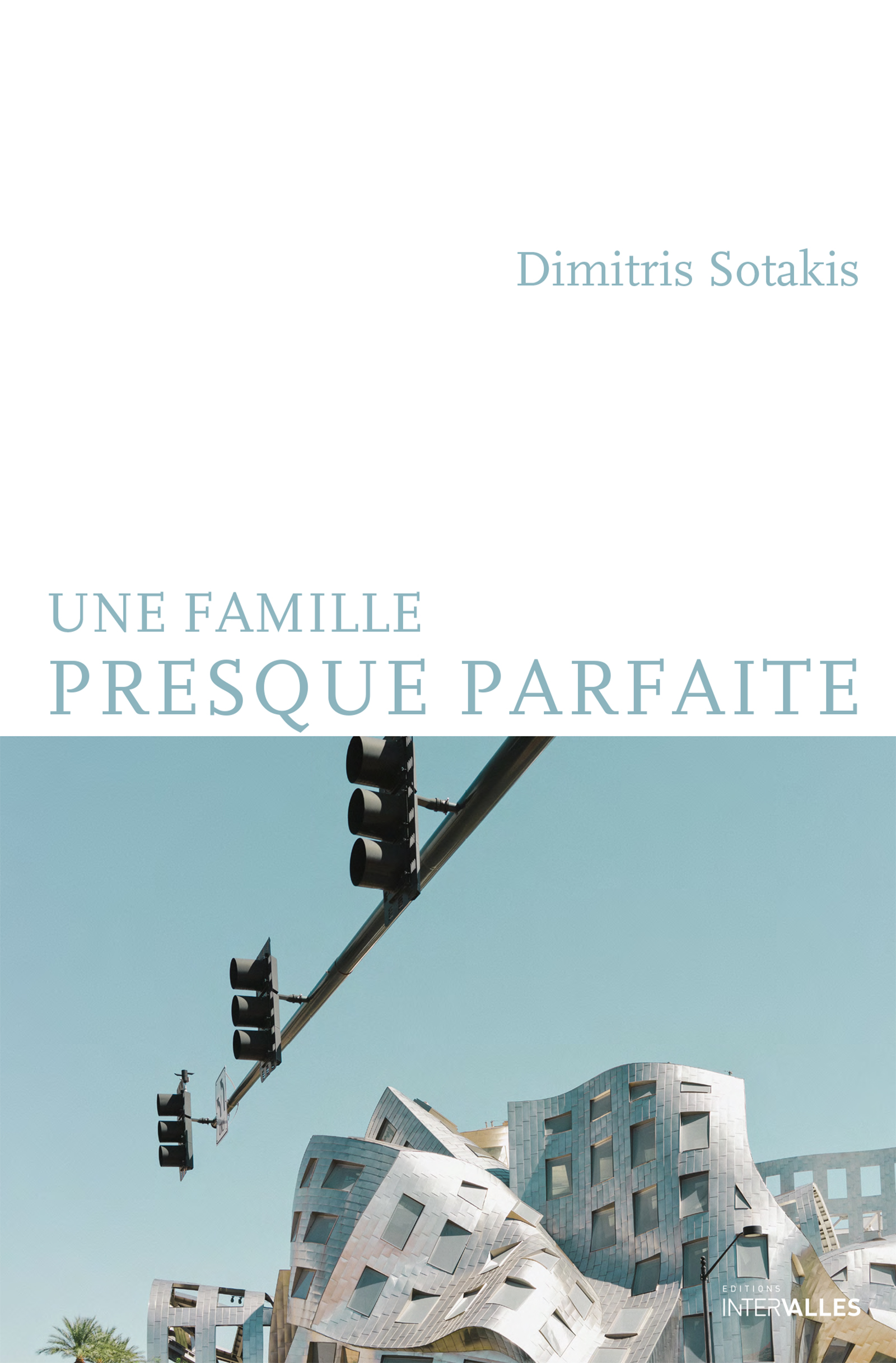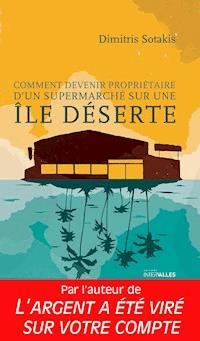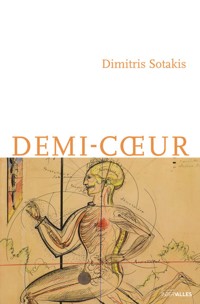
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Un homme découvre sur une photo un véritable sosie. Il comprend peu à peu que cet autre lui-même ressemble furieusement à celui qu’il serait devenu s’il avait continué de peindre et était resté dans les bras de son premier amour, au lieu de mener la vie confortable et banale qui semble être la sienne. Le besoin de rencontrer ce double devient dès lors irrépressible. À quel point cette rencontre peut-elle bouleverser cette existence bien rangée ? Si chaque être humain est la version concrète de ses choix, alors que derrière lui disparaissent des milliers de possibles qui n’ont pas été réalisés, Dimitris Sotakis fait à appel à un drôle de double pour éclairer, dans une comédie psychanalytique haletante, cette inquiétante étrangeté avec laquelle nous nous débattons tous lorsque nous songeons à ce qu’il aurait pu advenir de nous. Après Un grand serviteur en 2022, "Demi-cœur" est le cinquième livre de Dimitris Sotakis traduit en français. Ses œuvres sont aussi traduites en turc, serbe, néerlandais, italien, danois, arabe et chinois.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dimitris Sotakis est né à Athènes en 1973. Il a étudié la musicologie à Londres et a publié son premier livre en 1997. Son œuvre a reçu de nombreux prix et ses livres connaissent un succès croissant en Grèce et plus largement en Europe. Après L’argent a été viré sur votre compte (prix Athènes de Littérature, 2010), puis Comment devenir propriétaire d’un supermarché sur une île déserte, Une famille presque parfaite est le troisième roman de Dimitris Sotakis publié aux éditions Intervalles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Chapitre 1Géométrie
Notre salle de bains présentait depuis quelque temps de sérieux problèmes de plomberie. Tout d’abord, certains tuyaux s’étaient mis à fuir. Nous avions essayé de couper l’arrivée d’eau pour limiter les dégâts, mais lorsque le plombier arriva, il nous informa qu’il ne suffirait pas de changer un seul tuyau. Ces travaux nous coûtèrent une fortune. Plus tard, il nous parut évident aussi que la pression de l’eau était insuffisante dans tout l’appartement. Maria avait l’impression que cela venait surtout du réseau de distribution dans le secteur, mais le plombier soutint au contraire que la faible pression était due à l’accumulation de dépôts et qu’il fallait purger les robinets sans perdre de temps.
Lorsque surviennent des tracas de ce genre, une espèce de nervosité s’empare automatiquement de la famille. Mon moral, notamment, s’en ressent, je n’arrive pas à me concentrer sur ce genre de problèmes qui m’ennuient profondément et perturbent mon quotidien. Dans de telles circonstances, je reste des heures assis sur le canapé en poussant des soupirs, les yeux dans le vide. Maria ne dramatise pas autant tous ces problèmes, elle s’est habituée à moi maintenant, depuis quinze ans que nous sommes mariés et vivons dans ce petit logement. Notre appartement est à la fois beau et affligeant. Il est rempli à craquer de tout ce qu’on accumule pour s’assurer une vie satisfaisante, faite d’une dose de bonheur et d’un sentiment de plénitude. Des appareils ménagers, des meubles bon marché, de grandes armoires remplies de vêtements et de couvertures chaudes pour l’hiver.
Même si je n’ajoutais rien, ces détails infimes que je viens de vous donner vous suffiraient à tout comprendre de moi. Je suis un homme comme tant d’autres, je parcours les rues de cette ville en regardant mon corps vieillir et en vivant de la manière la plus conventionnelle que puisse imaginer l’esprit le plus retors. Maria est mon épouse. Elle est institutrice dans une école publique. La décrire n’est pas évident. Elle appartient à une catégorie neutre de l’espèce humaine, ce qui ne me permet pas de mettre l’accent sur ce qui la caractérise. Elle est plutôt mûre, plutôt sérieuse, plutôt drôle, plutôt tendre, elle ne pique pas de crises, elle ne fait pas de dépression, elle ne hurle pas quand elle est enthousiaste, elle peut discuter de n’importe quoi avec du bon sens et de la logique, elle est en quelque sorte ce qu’on pourrait appeler une « personne normale ». De mon côté, je ne suis pas dépourvu des qualités mentionnées ci-dessus, à cette différence près que je tombe souvent dans des nids de poule psychologiques ou que je tente de faire des bonds dans le vide avec une joie grotesque et, bien sûr, Maria est toujours là pour me sauver en me ramenant à une réalité plus stable.
Je travaille pour un institut de sondages. Je suis chargé du classement des données statistiques et du résultat de diverses études qui, bien évidemment, ne m’intéressent pas du tout. Je suis dans cette société depuis une dizaine d’années et n’en suis pas mécontent. Je ne peux pas dire que je subisse la moindre pression, mon travail a acquis une certaine fluidité, cette partie de ma vie est néanmoins marquée par une routine quotidienne inévitable, à l’intérieur de laquelle j’ai conscience d’être enfermé. Ces derniers temps, j’ai développé une capacité d’observation originale, quand je m’installe dans le salon l’après-midi pour boire mon café. J’examine les murs et j’y découvre des éléments infimes mais intéressants que je n’avais jamais remarqués auparavant. Ainsi nos murs et tout ce qui y est accroché, depuis un simple objet décoratif ou un cadre, jusqu’aux interrupteurs, sont d’une terrible précision géométrique, l’harmonie qui se dégage de ce que j’ai sous mes yeux est admirable, les combinaisons de couleurs, la nature des matériaux et la disposition générale des objets créent une géométrie inédite et unique en son genre. Maria n’est pas de mon avis et elle réfute toutes ces théories en recourant sans cesse au même argument, à savoir que mes élucubrations sont le résultat d’un refoulement plus général de mon passé. Il m’arrive de trouver un allié pour défendre ces théories, en la personne de notre fils Dionysis. Lorsqu’il est témoin de ces arguties naïves, il prend discrètement mon parti – ce qu’il a fait en l’occurrence, quand il a rappelé à sa mère que la façon d’occuper un espace se fait de manière intuitive. Si donc je persiste à voir tout ce que je vois sur les murs, cela représente ma propre version de la symétrie, par conséquent j’ai raison de croire ce que je crois. Après ce genre d’intervention, Maria a l’habitude de sourire en hochant la tête, d’un air soi-disant désespéré, laissant entendre qu’elle a affaire à des fous.
Dionysis est tout sauf fou. Du haut de ses treize ans, il fait preuve de maturité et d’une rare logique. Il est doté d’une grande capacité à extérioriser ses crises ou ses tensions émotionnelles au moment opportun ; il a savamment dessiné la carte de son propre principe géométrique, en définissant ses points de repère personnels, sa manière à lui de percevoir intellectuellement les choses. C’est un garçon très discret, calme, qu’on n’entend presque pas, il a développé un sens aigu d’un humour très particulier. Il reste généralement dans sa chambre où il s’est construit son propre univers, composé de cartes, de jeux de société, de bandes dessinées, d’ouvrages consacrés aux mathématiques et à la vie des insectes, mais aussi et surtout à partir de tout ce qui lui permet de se sentir en sécurité et heureux. C’est avec une légère ironie que Dionysis fait face aux différends qui surgissent entre sa mère et moi. Ces désaccords n’ont rien à voir avec des disputes liées aux problèmes de la vie quotidienne, ils concernent la fixation que fait Maria sur mon passé, un passé dont elle a l’illusion qu’il me travaille encore, pourtant elle se trompe complètement, cela entretient visiblement chez elle un sentiment d’insécurité absurde qui, peu à peu, a fini par prendre des proportions démesurées, alors qu’en réalité il s’agit d’une chose insignifiante.
Et ce passé maudit, c’est la peinture. Je ne sais pas ce qu’on peut imaginer en lisant ces lignes, mais c’est la source de toutes nos tensions. Il y a des années, avant de rencontrer Maria, avant de me poser dans cette vie plus évidente que je mène aujourd’hui, j’ai consacré mon existence à la peinture. J’ai fait mes études à l’École des beaux-arts, puis dans une école privée de la capitale, et quelque temps à Paris. Et ces années – celles de mes études et les suivantes, durant lesquelles je louais au centre-ville un atelier qui me servait d’appartement –, ces années furent les plus belles de ma vie. Mais comme on peut le constater, Maria ne supporte pas cette idée. L’idée qu’un jour, je vivais parfaitement heureux, que mon horizon géométrique était constitué de points, de droites et de plans différents, qu’il n’obéissait pas aux règles de la logique euclidienne, étant déterminé par des courbes et des vecteurs, aujourd’hui invisibles, qui avaient néanmoins joué un rôle primordial dans l’image globale que je m’étais faite de moi.
À vrai dire, tout était différent alors. Cette époque me paraît tellement lointaine maintenant, comme si je ne l’avais jamais vécue. J’étais plongé dans mes couleurs et mes toiles, avec un cœur qui ne battait que pour ce qui me faisait palpiter – mon travail, les tableaux empilés dans un coin de la pièce, mais aussi une autre grande passion : Myrtô. Et j’ai l’impression que cette combinaison explosive est aujourd’hui la raison pour laquelle Maria déteste tout ce qui a un rapport avec les arts et qu’elle montre une telle aversion pour cette période de ma vie. Myrtô était ma Muse – c’est le mot qui me vient spontanément l’esprit –, elle était l’amour auquel je devais toute mon existence, ou du moins était-ce ainsi que je me la représentais à cette époque. Elle faisait elle aussi des études d’Arts plastiques, mais elle les avait très vite abandonnées pour travailler dans l’entreprise de transports maritimes de son père. Elle voyait davantage la peinture comme une expérience, un amour bref et soudain, contrairement à notre histoire d’amour qui dura trois ans, trois années débordantes de passion et de bonheur, une époque noyée dans une ivresse indescriptible. Je serais incapable de trouver les mots pour décrire ce sentiment orgasmique – les jours se succédaient comme si s’était répandu dans mon corps un hallucinogène qui y instillait le bonheur.
Je me souviens de tout et de rien, dans les moindres détails, et en même temps, comme s’il s’agissait d’un rêve. Avec Myrtô, nous avons fait le tour du monde, en buvant, en chantant, en nous faisant de nouveaux amis, et nos corps s’unissaient dans une sorte de transcendance, nous vivions au sein d’un monde voluptueux que nous avions construit à notre mesure. Jusqu’à ce qu’un jour, tout vole en éclats. Je me souviens avoir eu la sensation qu’une bombe à retardement avait explosé entre mes mains, j’étais certain que ma chair et mes os avaient été projetés sur le bord de la route et qu’on ne voyait de moi qu’un squelette, les restes d’un homme soudain attaqué par un ennemi invisible. Si l’on me pose la question, quels que soient mes efforts, je ne parviens pas à me rappeler pourquoi nos routes se sont séparées, sincèrement je ne sais pas, c’est comme si cela avait été prédéterminé par le destin qui nous ballottait çà et là comme deux marionnettes – je savais que je n’avais plus le choix. Et en même temps que Myrtô, j’abandonnai définitivement la peinture, je ne voulus plus jamais voir un pinceau ni aucun autre accessoire, je quittai l’atelier et rompis toute relation avec des camarades, d’autres peintres, et même avec des amis qui s’adonnaient à des activités voisines – bref, je fermai la porte à tout ce qui, de près ou de loin, avait un lien avec la création artistique.
Je pleurai ces pertes – Myrtô et la peinture – enfermé dans ce qui fut alors un refuge pour moi, là où jadis le soleil perçait à travers les fenêtres, où je me sentais fort et capable de décrocher tout le bonheur qui m’était dû sur cette terre. Je restais là jour et nuit, n’étant que l’ombre de moi-même, sans oser sortir à la lumière. Mais notre corps a son autonomie, sa propre vie et ne nous rend pas de comptes sur ses intentions. C’est ainsi qu’un jour, sans comprendre ce qui se passait, je sortis de ce trou sombre et commençai à me rappeler ce que signifiait « vivre » parmi des êtres humains. Je résiliai le bail de l’atelier, je vendis tout ce qui s’y trouvait et je revins aux choses de ce monde.
Peu de temps s’écoula avant ma rencontre avec Maria. Ce fut une rencontre tout à fait classique, à l’occasion d’une soirée organisée pour l’anniversaire d’un ami commun. Maria me plut beaucoup. Mon cœur ne battit pas aussi fort qu’il l’avait fait autrefois pour Myrtô, mais je ressentis aussitôt une grande familiarité entre nous, une chaleur dont j’avais besoin à cette époque. Je trouvai alors un emploi dans l’entreprise du père d’un ami et, beaucoup plus tard, grâce à un proche, je décrochai le poste que j’occupe encore aujourd’hui. Maria voulut officialiser notre relation sans attendre. Elle n’avait pas de temps à perdre, disait-elle. Je n’y étais pas opposé. Simplement j’aurais dû savoir me taire. Mais comme un imbécile qui cherche une épaule réconfortante, j’avouai à Maria avec force détails mes péripéties avec la peinture, ma séparation d’avec Myrtô – ce que je fis, bien sûr, avec une fougue rare. Et comme on peut s’en douter, il lui en resta une blessure permanente, blessure que je me garde bien d’alimenter. Néanmoins, chaque fois que l’occasion se présente, dans chaque moment difficile, elle me jette à la figure ses commentaires sur mon passé, le fait que j’aurais dû devenir un grand peintre et vivre des amours fatales, que c’était le bois dont j’étais fait, tout cela déballé bien entendu sur un ton ironique et exaspéré qui trouble souvent la paix de notre famille.
Nous avons loué un appartement près du centre. Il me faut quarante-cinq minutes environ pour me rendre à mon bureau ; l’école de Maria est beaucoup plus proche – elle y va même à pied quand elle en a envie. Lorsque je marche dans les rues de la ville, je sens monter en moi une angoisse liée à l’éventualité d’un contact avec d’autres passants. Cette relation possible avec ces inconnus est souvent la source d’un processus douloureux et il ne fait pas de doute que l’origine de cette phobie singulière vient essentiellement de ce que j’ignore les formes que prennent ces individus. Le premier objectif qu’on se fixe, dans l’apprentissage de la géométrie – celle qu’on enseigne aux enfants –, c’est de comprendre la façon dont les formes géométriques présentent des différences et des ressemblances. C’est à ce niveau-là que je me trouve. Les promeneurs apparaissent cruellement informes devant moi, au point que je suis incapable de les reproduire et de les transformer visuellement en formes humaines précises ; et c’est là que gît le problème, car l’utilisation de moyens appropriés pour la restitution d’un concept mathématique est très importante – bref, mon sens de la géométrie en est à un stade embryonnaire.
Cette inaptitude qui est la mienne à percevoir les formes géométriques comme des entités qui constituent un tout a limité mes mouvements. J’ai peu de relations, en dehors de mes collègues de bureau, de ma famille évidemment, et de Gerasimos – sur lequel je reviendrai bientôt. Le puzzle de mes fréquentations n’est pas du tout compliqué et, comme je l’ai déjà mentionné, tout découle de mon incapacité à avoir une perception plus vaste de l’espace. Maria s’obstine à dire que toutes ces théories sont des divagations qui enflent au fil du temps, et que je devrais faire un effort pour y mettre un terme, puisque mon seul but – croit-elle – est de la persuader que mon cerveau fonctionne différemment du sien, et peut-être aussi de tous les autres. Je trouve son argument péremptoire et incongru, presque risible, mais je ne m’énerve pas et ses remarques caustiques me laissent impassible.
Maria a longtemps refusé de voir Gerasimos. Ce n’est pas tout à fait exact, j’exagère peut-être, néanmoins elle était opposée à ce qu’il vienne souvent chez nous et que je passe beaucoup de temps avec lui. La raison de ce refus n’est pas claire. Gerasimos était le seul lien avec ma vie antérieure, mon ami depuis les années que j’avais consacrées à la peinture, lui-même aurait pu devenir peintre mais il avait tout laissé tomber assez tôt, presque à la même époque que Myrtô, et il s’était reconverti comme cadre dans une agence immobilière où il travaille encore actuellement. Maria ne le considère plus comme une menace pour ma santé psychique et mentale, elle s’est convaincue qu’il a parcouru lui aussi un chemin différent et elle le traite de manière amicale. Gerasimos est mon seul ami et, de fait, notre vie sociale se réduit aux rencontres avec lui. Car, pour être tout à fait franc, s’il n’y avait pas Gerasimos, nous ne verrions personne chez nous. Ses visites en compagnie de ses maîtresses du moment sont notre principale source de distraction. Il vient invariablement chez nous deux samedis par mois, et nous passons la soirée autour d’un repas, dans la bonne humeur et les éclats de rires – preuve que du sang chaud coule encore dans nos veines.
Gerasimos est un homme très agréable, il profite de la vie – en tout cas, il en a la volonté –, je ne dirais pas qu’il est tout le contraire de moi, mais il a au moins ses astuces pour échapper aux tempêtes inutiles qui s’emparent de mon cerveau et qui entraînent mon dérèglement complet ainsi que ma totale incapacité à nommer des formes simples, bidimensionnelles et tridimensionnelles… Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais que c’est un homme lumineux, plein de gaité, sans la moindre zone d’ombre. On peut passer des heures amusantes avec lui, en se sentant à l’aise, sans se forcer le moins du monde, et c’est probablement l’aspect le plus séduisant de sa personnalité. Les soirées du samedi que nous passons ensemble sont tellement agréables que, lorsqu’il nous arrive de devoir reporter l’une de nos rencontres, Maria et moi nous asseyons de part et d’autre de notre table rectangulaire, et nous nous contentons de nous regarder sans aucun entrain.
La semaine dernière, Maria et moi étions au salon, en face de Dionysis qui feuilletait un livre. Je buvais mon café en silence pendant que Maria corrigeait des devoirs. D’après la manière dont nous étions assis pendant cette heure agréable, pleine de nonchalance et de torpeur, nous formions un triangle. Si l’on prend en compte le fait que les coins étaient formés par nous trois, et que la bissectrice de Maria et la ligne médiane de la section entre Dionysis et moi coïncidaient… alors nous formions un triangle isocèle. Si au même moment j’avais essayé de nous observer sous un autre angle optique, de nous imaginer comme une sphère compacte, alors sa désagrégation en un nombre fini de diverses sous-parties nous aurait complètement séparés les uns des autres, même si, plus tard, les morceaux pourraient à nouveau se rassembler pour nous redonner notre forme initiale. Ce paradoxe géométrique est tout simplement notre propre régularité. Notre famille témoigne de l’imprécision géométrique des formes. Il va de soi que je n’ose pas me lancer dans une discussion avec Maria sur ce point, car le résultat en est tout à fait prévisible. Néanmoins, elle a très bien compris certaines choses au moment où je m’efforçais de mettre de l’ordre dans ces raisonnements qui m’encombrent l’esprit et elle a hoché la tête en signe de désapprobation.
Nous attendions le samedi suivant avec impatience. Gerasimos avait insisté pour qu’on ne fasse pas la cuisine cette fois, il voulait commander un repas dans un nouveau restaurant qui avait ouvert derrière la gare ferroviaire et qui, à l’entendre, n’avait pas son pareil, il y était allé récemment avec des collègues et en était ressorti emballé. Le jeudi soir s’était produit une véritable tempête qui avait paralysé la vie citadine pendant plusieurs heures. Toutes les rues autour de chez nous étaient inondées, nous n’avions jamais vu tomber une telle quantité d’eau. Nous observions ce chaos, le visage collé contre la vitre recouverte de buée, et Dionysis était allé chercher son appareil photo pour immortaliser ces trombes d’eau sans précédent – il semblait enthousiasmé par le spectacle. Ce déluge dura jusqu’à l’aube, laissant à perte de vue le lendemain des traces perceptibles de son passage. Les branches d’arbre qui étaient entassées sur les trottoirs ressemblaient à des monstres miniatures, elles se dressaient de part et d’autre des troncs dans le plus grand désordre, lourdes et brisées, comme si elles avaient été assaillies par des escouades d’insectes meurtriers. Les feuilles gorgées d’eau semblaient supporter tout le poids du monde, à croire qu’elles allaient bientôt s’écrouler sous cette charge inique. L’eau avait creusé d’immenses rigoles dans les caniveaux, elle semblait avoir été prise au piège et ne pas pouvoir trouver d’issue dans les égouts voisins, tandis que là où elle avait réussi à se faufiler, elle laissait derrière elle une masse de feuilles et de détritus qui avaient pris, le long du boulevard, la forme d’un corps épais. Nous étions à la mi-mars, les violentes averses étaient un phénomène habituel, mais jamais nous n’avions vu un tel déluge.
En sortant du travail, j’enfilai un imperméable parce qu’il continuait à pleuvoir – même si c’était moins intense – et je me rendis à pied jusqu’au grand supermarché qui se trouve à deux kilomètres environ de chez nous. Curieusement, une atmosphère de fête régnait dehors, les haut-parleurs du magasin diffusaient une musique joyeuse, toutes les allées étaient pleines de monde, avec des gosses juchés dans les caddies et des couples qui s’esclaffaient, en proie à un enthousiasme inexplicable. Le supermarché est un espace immense, divisé de manière extrêmement précise en deux sections. Elles sont équidistantes et forment deux surfaces parallèles, facilitant ainsi la circulation des clients. Et si l’on veut étudier cet espace plus attentivement, ce vaste bâtiment est divisé en deux parties égales, deux demi-plans qui débouchent sur des angles dièdres convexes, de sorte que, par exemple, quelqu’un qui vient de faire des achats au rayon charcuterie peut passer directement à celui des primeurs et des aliments conditionnés. Cet agencement astucieux du supermarché rappelle ou plutôt reflète aussi ma propre vie, car celle-ci est définie par des figures superposées qui, tout en paraissant se métamorphoser continuellement, restent en réalité constantes et immuables.
Sur le chemin du retour, j’avançais d’un pas lourd avec tous mes sacs de provisions et mon imperméable qui dégoulinait ; en approchant de la maison, j’essayai de l’enlever et de le tenir à la main, mais cela rendit ma démarche encore plus laborieuse, car mes mains ne pouvaient faire face en même temps au poids de l’imperméable et des provisions. Je m’arrêtai au coin d’une rue et posai les sacs sur un bord de trottoir déjà sec, pour remettre mon imperméable. Quand j’entrai dans l’appartement, Dionysis éclata de rire en me voyant avec les bras chargés et mon imperméable qui m’enveloppait de la tête aux pieds.
— Tu as acheté du chocolat ? demanda-t-il d’un ton visiblement inquiet.
Je farfouillai dans l’un des sacs d’où je sortis une grande tablette de chocolat au lait et aux noisettes dont il était friand. Je la tins un moment en l’air comme si je le visais avant de la lui lancer. Il l’attrapa tout content.
Bravo, papa, tu es génial ! cria-t-il avant de filer dans sa chambre.
Maria n’était pas encore rentrée de l’école. Je sortis sur le balcon pour voir dans quel état se trouvait la rue. Même si on la voyait encore partout, l’eau se retirait peu à peu, les premiers rayons de soleil remettaient un peu d’ordre dans le décor. Je rentrai à l’intérieur et me mis à ranger mes achats sur les étagères et dans le frigo. Cette tâche me procure toujours du plaisir, j’essaie même de la faire durer le plus longtemps possible. Quand, par exemple, j’ai dans les mains une botte de légumes, je réfléchis un bon moment avant de décider quel serait l’endroit le plus approprié pour la ranger, entre l’intérieur du frigo ou le plan de travail de la cuisine. Souvent je dépose mes emplettes à une place précise et je m’éloigne un peu pour vérifier l’impression qu’elles donnent de plus loin. Notre frigo est toujours plein, non parce que nous avons besoin de tout ce que nous y entassons, mais c’est pour nous un signe manifeste de notre prospérité familiale, une preuve que nous avons réussi et que nous sommes nous aussi des membres de cette communauté humaine qui parvient à vivre dans un semblant d’harmonie.
Maria est satisfaite de notre mode de vie, je perçois du moins, quand je la regarde dans les yeux, que ce jeu lui convient très bien, les règles sont faites à sa mesure. D’un autre côté, je me demande souvent si je ne suis pas injuste à son égard, avec tous les reproches que je lui adresse sur son besoin de normalité, et je me demande parfois s’ils ne résonneraient pas de manière désobligeante aux oreilles d’une tierce personne ; de plus, Maria est une femme normale, elle s’accommode de ce qui est prévisible, alors que moi, je suis un esprit rétif qui tolère tout au plus ce qui est conventionnel. Peut-être les choses ne sont-elles pas exactement telles que je les décris, et ma tendance à la ranger dans une catégorie avec des caractéristiques précises ne prouve rien, si ce n’est mon propre conservatisme. De son côté, Maria ne semble pas perturbée par toutes ces théories, elle mène sa vie avec sa propre discipline inébranlable, ce qui, sans aucune réserve, mérite l’admiration.
Le vendredi en fin d’après-midi, la pluie s’était enfin arrêtée, mais il faisait un froid terrible pour la saison. Gerasimos me passa un coup de fil pour s’assurer que nous nous retrouverions bien le lendemain, vers vingt heures. Même si j’appréciais beaucoup la compagnie de mon cher ami, j’étais très déçu, au fond, de constater que ma seule distraction dépendait de ces soirées du samedi. Il est vrai que les retrouvailles entre amis autour d’un verre de vin et d’un bon repas représentent une expérience agréable pour beaucoup de gens, néanmoins je n’avais aucune alternative aux soirées du samedi avec Gerasimos, je dépendais complètement d’elles. Et si je me livrais à une introspection plus approfondie de mon état psychique durant cette période, je pourrais dire que mon principal problème était que je n’éprouvais ni bonheur ni souffrance, j’avais juste emprunté une voie et je la suivais, mes sens réagissaient de manière relativement satisfaisante, le goût, les plaisirs de la chair, mon instinct, tout était tantôt en éveil, tantôt assoupi.
Il m’arrivait parfois d’avoir conscience du fait que Maria ne connaissait que cette version actuelle de moi : depuis notre rencontre, j’étais une seule et même entité qui avançait dans une direction précise, sans zigzag ni slalom. Je me demandais si elle me trouvait séduisant, si j’étais attirant avec cette posture psychique que j’avais développée, mais je suppose que je ne me débrouillais pas trop mal, notre vie érotique ne bénéficiait peut-être plus de l’étincelle des premiers temps, elle n’en restait pas moins active, il n’y avait aucune raison de se plaindre de cet aspect de notre vie commune. Toutes ces années que nous avions passées dans cette maison me semblaient parfois n’avoir duré qu’un instant ; d’autres fois, j’avais l’impression que le temps s’était arrêté et que je me retrouvais sans arrêt au même endroit. Et on peut comprendre que j’essaie d’imaginer la façon dont j’aurais pu passer ma vie si je n’avais pas abandonné la peinture, si je n’avais pas épousé Maria, si je n’avais pas emprunté le chemin que j’avais pris et si j’avais continué sur la même voie que par le passé, cette voie dont j’étais certain autrefois qu’elle me mènerait au bonheur absolu. Peut-être me serais-je retrouvé dans un cul de sac monstrueux, peut-être me serais-je enlisé dans les conditions de vie floues et chaotiques qui sont souvent générées par l’Art ou, qui sait, peut-être me serais-je plongé dans une euphorie sans précédent, entouré par tout ce que j’aimais. Parfois j’imagine ce que j’ai vécu comme un chemin circulaire qui se reproduit et se répète, ce cercle est constamment interrompu par les côtés des angles émanant de son centre, qui s’efforcent de le briser, d’abolir sa course répétitive vers l’infini, mais je m’accroche de toutes mes forces, en me tenant en équilibre sur ses arcs comme un acrobate paranoïaque qui n’ose pas s’écarter de la ligne droite.
Nous avons passé des jours et des nuits dans ce quartier, nous sommes devenus une famille, notre enfant dort dans la chambre voisine, nous savons désormais ce que nous réserve le destin, nous nous chamaillons pour des choses sans importance, mais au fond, nous restons satisfaits et à l’abri sous la voûte du ciel qui nous recouvre, comme dans une pièce de théâtre spécialement créée pour nous. Maria dort près de moi, j’entends sa respiration dans le noir. Il est tard, deux ou trois heures du matin, je sais exactement ce qui se passera demain, quelles blagues nous allons nous raconter, comment nous allons nous taquiner, la façon ostentatoire dont je vais déboucher la bouteille de vin, tout cela je le sais, ma ligne droite n’est plus coupée par un quelconque axe et, pourtant, au lieu de me jeter du haut du balcon, désespéré, je continue à vivre comme si j’appréciais cette étrange équation.
Chapitre 2Bruits de billes sur le plancher
Le vendredi soir, lorsque je m’affalai sur le lit, j’entendis de nouveau dans l’appartement au-dessus quelqu’un jouer avec des billes, en les faisant rouler sur le plancher. Ce phénomène inexplicable rompait souvent le calme de la nuit. Le bruit d’os que font les billes en tombant sur le sol – un bruit sec, avec une sorte d’écho – est tout à fait caractéristique et il est d’autant plus mystérieux que personne n’habite au-dessus de nous. Pourtant, les billes roulent très régulièrement en provoquant cet étrange phénomène acoustique. Maria est convaincue que personne ne joue aux billes, mais elle ne trouve pas ma théorie ridicule, puisqu’elle aussi les entend rouler. Je me suis penché sur la question et suis arrivé à la conclusion que le béton de l’immeuble créé cette illusion en se dilatant et en se contractant. J’entends donc quelque chose qui n’existe pas, les pulsations et les vibrations des murs envoient un message erroné en direction de l’arc neural de mon cerveau. Je ne sais pas jusqu’à quel point je suis prêt à accepter ce genre de théorie.
Le samedi matin, nous nous étions levés en pleine forme et nous décidâmes d’aller faire les courses indispensables pour la soirée toute proche. C’était notre deuxième visite au supermarché en quelques heures. Nous n’avions pas grand-chose à acheter puisque ce jour-là, comme je vous l’ai dit, nous n’aurions pas de cuisine à faire. Nos achats se limitèrent à des boissons, des gâteaux et diverses bricoles pour être sûrs qu’il ne manquerait rien sur la table, le soir venu. Je me sentais bien. Le temps était très agréable, le soleil avait repris sa place dans le ciel, une fraîcheur douce et bienvenue rendait maintenant notre agitation plus légère. Maria était très belle ce jour-là. À un moment où nous étions chacun de notre côté, dans le supermarché, je tombai par hasard sur elle pendant que je cherchais quelque chose dans une allée et elle me parut terriblement attirante. Si je ne l’avais pas connue et si je l’avais rencontrée là pour la première fois, je lui aurais certainement trouvé un charme tout particulier. Elle le sentit et apprécia le message que lui envoyaient mes yeux. Tout cela nous avait mis de fort bonne humeur, si bien qu’après avoir réglé nos achats à la caisse, nous allâmes prendre un café avant de rentrer à la maison, chose rare ces derniers temps.