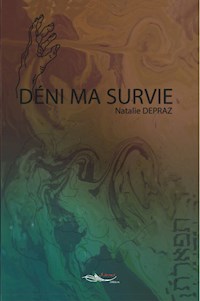
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« J’ai reconnu le jardinier. A sa voix. La première fois que je l’ai vu, j’ai seulement entendu sa voix. Elle est suave, douce et rocailleuse, un peu tordue par un rhume persistant, granuleuse comme la vie. J’ai aimé cette voix. »
C’est un huis-clos à trois. Il y a Ephimia, Deniz, et Marie. Un roman à trois parties, comme les trois volets d’un triptyque. Chaque personnage aura sa partie, racontera son histoire, dans une périchorèse infinie. Même si Deniz très vite s’effacera dans le rêve d’Ephimia et y resplendit d’ailleurs, même si Marie, très longtemps, peinera à parler de lui, et hante d’autant les rêves d’Ephimia, fauve d’amour.
Mais il y a un quatrième personnage. Sans nom. Immonde. Qui crée la dépendance, et le déni. L’ombre de C.
Ephimia se débattra dans ses vies. Et traumas, suicide, folie, transgenre la côtoieront furieusement.
« Il fait chaud.
Un jardin, soudain. Je m’avance. Il y a un homme, qui me sourit. Je suis faible, il le sait. Je suis nue. Il le sait. Le visage grimaçant d’une femme, hilare. Je le sens, par derrière. Je la sens, par devant.
Ils rient ensemble, au-delà de moi.
Ça viole en moi, inconcevable. Je cède, ça m’envahit de tous les côtés. Je veux je ne veux pas. Je résiste doucement, ça vomit en moi. Ça relâche, et ça hurle de rire. Dans les tréfonds du désert. »
À PROPOS DE L'AUTEURE
Natalie Depraz enseigne la philosophie à l’Université de Rouen. Dans ses cours, elle lit les textes au prisme de l’expérience de l’auteur et guide ses élèves vers leur propre expérience. Attention et vigilance (2014) et La surprise du sujet (2018) décrivent des décrochages infimes où la normalité se retire, où émerge un traumatisme. Depuis longtemps, elle accompagne la réflexion de psychiatres sur la dépression et les maladies chroniques. Déni ma survie est son second roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natalie Depraz
Déni ma survie
De la même autrice
– L’endroit, roman
5 Sens Editions, 2019
« dit à Caïn : Pourquoi ça t’a échauffé, et pourquoi tu as été abattu. Ne ferais-tu pas bien de supporter… ? Si tu n’en fais pas un bien, c’est une faute de laisser cette brèche dormante, (la-pètah, hata’at rabaç) car c’est vers toi qu’elle aspire. Mais toi, tu vas la maîtriser ! » (Genèse 4, 6-7)
Pour toi.
Quand il n’y aura plus ni femme, ni homme.
Préface
Un dimanche après-midi de la Toussaint 1951
Jouissac
Il est installé sur une chaise au milieu de la pièce, les yeux bandés. À peine s’il ose respirer. On lui a attaché les mains derrière le dossier. Il entend des bruits d’objets qu’on pose par terre, des chaises qu’on tire, des rires étouffés. Il n’ose bouger. Il a peur. Les tripes en feu. Il y entend résonner la peur congénitale d’être là, d’être seul, l’angoisse d’être né, dans cette grande maison qui est la sienne et qui le plus souvent est vide.
Soudain, quelqu’un pose sa main sur son épaule. Il sursaute de terreur. Se recroqueville en lui-même (escargot ? huître ? autruche ?), et sent de très fines gouttes de sueur perler sur son front. Puis, un rire cristallin, ce ton légèrement moqueur, des chuchotements à quelques pas derrière. Que se passe-t-il ? Depuis combien de temps est-il là ? Il ne sait plus. Il a cinq ans, et il est perdu. Dans les replis de son cerveau limbique de petit Bambi…
C’est alors qu’une musique se met à résonner, assez lointaine, ou bien faible, et qui s’amplifie soudain. Il connaît cette mélodie. Il l’a déjà entendue, souvent. Elle lui rappelle les fêtes de famille, le monde, les gens joyeux, parfois ivres, ou bien hilares. Il n’avait pas trop aimé. Des danses, aussi, un orchestre, des grandes tables, de la nourriture en abondance, et lui, attablé, à manger manger manger (combler le vide ?), seul et entouré de plein de gens. Non, il n’avait pas vraiment aimé… La musique se rapproche, il entend des voix claires qui rient. (Ses cousines ? Pourquoi ne viennent-elles pas le délivrer ?) La main est toujours sur son épaule. Une autre main lui prend alors la sienne. Son corps ne résiste pas. Il sait qu’il n’y a rien à faire, juste attendre que ça passe. Il n’a pas le choix.
De nombreux corps autour de lui, tout proches. De l’air déplacé, des tissus qui le frôlent, des effluves de parfums et d’odeurs de corps mêlés et, à nouveau, l’angoisse qui monte. Commencement de la panique. Car ce qu’il redoutait le plus est en train de se produire : il sent dans son estomac que ça se crispe, que ça gigote que ça gargouille, et il sait que ça va arriver. Une sensation de douleur, non, de spasme aigu dans son intestin. Il y a de l’air dans les tuyaux, ça va arriver, non, pitié, il ne faut pas, je ne dois pas, il sent son visage en eau, ses yeux trempés sous son bandeau, s’il vous plaît supplie-t-il dans sa tête, faites que ça s’arrête ! ! Il plisse les lèvres de toutes ses forces, se contracte dans son corps, dans son intestin, jusque dans son anus, pour barrer la voie à l’ennemi, sa hantise, sa terreur, qui toujours l’attaque quand il est seul, faible, sans défense et livré au regard des autres. Mais il sait qu’il a déjà perdu, que l’autre s’est installé en lui, le farfouille de l’intérieur, le prend et est en train de le faire imploser. Alors, il cesse de lutter. Il s’abandonne, et il sent que ça y est, ça sort, sort, sort… Ça sent, il sent, ça y est, il a chaud très chaud, son visage brûle, la honte est là, et sa peau, cramoisie.
Où sont-ils tous donc ? Pourquoi personne ne vient-il le délivrer ? Car c’est le silence soudain autour de lui. Que se passe-t-il ? Ont-ils senti ? Ont-ils quitté la pièce écœurée de cet air brutalement irrespirable ?
Des rires, à nouveau… Non, des ricanements. On lui arrache son bandeau. Lui, les yeux collés, la bouche pâteuse. Des visages, tout proches. Il sent leur haleine, goûte la sienne dans sa langue, fétide. Il plisse les yeux.
C’est alors qu’il voit : il a devant lui une fille qui porte une robe blanche, et qui lui sourit. Elle a des traits si familiers, on dirait qu’il la connaît. Mais, qui est-elle ? Elle lui sourit, et découvre ses dents blanches, trop blanches, un peu trop grandes, des dents de cheval. Il a les yeux fixés dans ses orbites, et il ne peut regarder ailleurs : il voit ses canines, et éprouve un mélange d’attirance, qui l’aspire, et une forte envie de vomir, aussi. C’est alors qu’il sent. Il y a une odeur nauséabonde qui lui donne le tournis. Ses yeux se révulsent. Elle a mis son haleine d’œuf pourri en lui. Est-ce elle, d’ailleurs ? Il essaie de bloquer ses narines, mais ça ne marche pas… Puis, plus rien. Du blanc. Il n’est plus là.
Des rires, soudain, autour de lui. Et des cris, aigus : « un bisou, un bisou, un bisou ! ! » On le lève, les filles crient autour de lui, hurlantes, il aperçoit des visages grimaçants, il sent une couronne douloureuse brusquement enfoncée sur sa tête, il voudrait hurler, on le lève, on le fait avancer vers un simulacre d’autel céleste fabriqué avec des chaises empilées, et on lui fourre du pain dans la bouche, et il sent du vin un peu aigre couler de ses lèvres descendre dans sa gorge, et puis, encore cette bouche, cette langue qui cette fois entre dans sa bouche, qui trifouille et farfouille et gigote, ces canines qui grincent sur les siennes. La sueur l’envahit, il perd connaissance.
Un homme ouvre les yeux. Il regarde l’heure sur son iPhone : 5 h 55. Son réveil va sonner dans quelques minutes. Une date s’affiche, lundi 1er, mois, janvier, année, 2017. Il est allongé dans sa petite chambre de célibataire de la rue Putois. Il tâte sa main droite, son annulaire. Pas de bague. Encore ce cauchemar. Ce simulacre. Trauma.
Marié contre son gré…
Première partie
Ephimia
(2002-2010)
« Lorsqu’Olivier Todd demande à Sartre comment il s’en sort avec ses femmes, l’auteur des Mots répond : “je leur mens ; c’est plus facile, et plus décent.” Même au Castor ? Particulièrement au Castor. »
Chapitre I
Sables mouvants
2002, une semaine de mars.
I
Lundi
« Merci d’être venu, j’avais besoin de te parler. »
En ce milieu d’après-midi, peu de monde au café. Les habitués ont fini de déjeuner et sont repartis travailler. Il y a quelques jeunes couples qui prennent leur temps. Une ou deux personnes âgées musardent aussi, à la retraite sans doute.
« J’avais besoin de te parler. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. J’ai l’impression d’avoir tout essayé depuis cet automne. Rien ne change. Les HDT, c’est vrai que ça le purge, mais, après ça, aussitôt sorti, il replonge. C’est désespérant ! »
C’est le printemps, bien timide il est vrai. L’air est frais et le soleil souvent derrière les nuages. Ils sont installés en retrait, dans un petit espace du café qui donne sur le trottoir, où les vitres font serre sous le soleil. Il fait bon. Marie m’écoute attentivement depuis plus d’une heure lui raconter le drame de ma vie, comment ça m’éprouve à mort, mon impuissance aussi. Il paraît saisir à deux cents pour cent.
« Que me conseilles-tu ? Tout cela m’use… Quand je vois défiler ma vie durant ces derniers mois, durant les quelques années qui viennent de s’écouler, je n’aperçois plus une once de bonheur entre nous. Tout est moche. Il est parti ailleurs dans son monde LSD. Il devient agressif, hors contrôle. Les moments détendus, sans même parler des moments joyeux, je n’en vois plus. Ou bien ils ont lieu ailleurs, avec des amis, dans la solitude d’une promenade, d’une lecture. Ça me fait peur… »
Le soleil, qui commence à baisser, joue avec les reflets de nos verres dans la lumière. Nous sommes là depuis un temps inconcevable. Je n’en finis pas de parler. Les serveurs, habituellement si diserts, se sont retirés sans même nous demander de payer l’addition, comme s’ils pressentaient un temps d’une autre couleur. Marie reste silencieux, mais je sens que son cerveau bouillonne à deux cents à l’heure. Au bord de la collision.
« Tu veux que je te dise, lâche-t-il enfin, lentement. Tu devrais partir un peu, prendre des vacances. Tu as l’air épuisée. Tu verras la situation plus sereinement à ton retour. Ce que tu vis est très douloureux. Tu dois te protéger. Et tu sais, le concernant, tu ne peux vraiment plus rien faire de plus. De toute façon, il doit passer par ce processus de plongée dans la drogue, de purge, de replongée, repurge, replongée, jusqu’à ce qu’il se décide lui-même à arrêter, qu’il se prenne en main, qu’il commence un travail. Cela lui appartient, et tout ce que tu pourras lui dire sur ce plan sera contre-productif, rejeté, voire un obstacle au processus de retour sur lui-même. Fais-moi confiance, tu as tout fait, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. Lâche prise à présent, prends soin de toi, c’est tout ce qui compte. »
Un serveur s’approche, timide, brisant le cercle de notre intimité. « Puis-je vous encaisser ? J’ai fini mon service… » Je mets la main à mon sac pour payer, mais Marie pose la sienne sur la mienne, m’interrompant : « laisse, c’est pour moi ! » Je n’insiste pas. Je ne suis pas en mesure aujourd’hui de défendre mon droit à l’autonomie (financière) de la femme ! Et, comme le serveur se retire, je me lance à nouveau : « je sais bien, tu as raison, je ne peux le sauver de lui-même. Pourtant, je me sens si coupable. Je voudrais tant l’aider, même à son insu. Je me trouve tellement responsable de sa plongée dans la drogue. » Marie relève la tête. « Que veux-tu dire ? Tu m’as dit toi-même que tu avais été très présente lors de ses débuts dans sa boîte, lorsqu’il s’est retrouvé dans ce milieu de requins, confronté à des attaques insidieuses et sans soutien de ses collègues de travail ou de sa hiérarchie. Tu ne pouvais pas faire mieux. Il a vécu des années très dures, et toi aussi, tu n’y peux rien ! »
Avec la pénombre qui gagne progressivement sur le jour, nos voix se font murmures. Un serveur apporte une bougie, qui projette des ombres vacillantes. Il nous propose un menu. « Tu veux manger quelque chose ? » me demande Marie. Je regarde ma montre. Les enfants sont chez leurs grands-parents pour le dîner. « D’accord, mais je ne resterai pas très longtemps, je dois passer les prendre à 21 h 30. »
Nous voilà installés dans un coin plus tranquille encore, à l’intérieur cette fois. L’air s’allège. On entre dans le temps de la parole fluide. « Je n’ai pas été honnête envers lui. Durant cette période où il a vécu l’enfer dans sa boîte, c’est vrai que je l’ai soutenu autant que j’ai pu, mais j’ai craqué aussi. Le quotidien était tellement morose. J’avais beau me réfugier dans le travail, m’occuper à fond des enfants, j’étouffais. Et puis, je sentais le désir me déserter peu à peu, c’était affreux. Je suis tombée amoureuse. De jour en jour, je sentais un nouveau désir s’emparer de moi. Au début je l’ai repoussé tout au fond de mon esprit : je ne voulais pas, je ne pouvais pas le voir. Mais il ne cessait de grandir, de prendre toute la place. J’ai été jusqu’à en parler à celui-là même qui intensifiait ce désir. Il m’a avoué le sien aussi, et on a décidé ensemble de ne pas aller plus loin. Et puis, après des mois de lutte intérieure, de lutte partagée, le désir a eu raison de nous. Tout cela a eu lieu si brutalement pendant sa plongée progressive à lui dans la drogue, à laquelle j’assistais, impuissante. Qui sait même si l’histoire que je vivais en parallèle n’a pas accentué, peut-être même fait surgir son addiction ? »
J’ai parlé longtemps. Marie me regarde. Le plat que j’ai commandé mais à peine touché, un steak au poivre, a refroidi. La nuit maintenant est tout autour de nous.
« Ce que je viens de te raconter, personne ne le sait. Lui non plus, bien sûr. Je ne l’ai jamais dit à personne : tu es le seul à connaître ce secret. Je te fais confiance pour ne jamais le dévoiler, surtout pas à mes enfants. » Je regarde Marie, je vois ses yeux vert noisette irisés grands ouverts, tournés haut contre le ciel. Il a le visage vermeil de la lune. Je poursuis : « je te suis vraiment reconnaissante de m’avoir écoutée. Jamais personne ne m’a prêté attention comme cela. Jamais personne ne doit savoir. » Je me rends compte qu’il y a à présent entre nous quelque chose d’inconditionnel. Une alliance scellée à jamais ? Marie me scrute, et je sens son regard me transpercer jusqu’à la brûlure : « merci de ta confiance », dit-il, un sourire ténu léger dans la voix. « Sois tranquille, je suis excellent pour garder les secrets… »
Il fait nuit noire. Les serveurs s’affairent sur le devant du café. On les sent pressés de rentrer chez eux. Je jette un coup d’œil par-dessus l’épaule de Marie. Il y a encore quelqu’un au bar, qui doit être en train de prendre un digestif. Sinon, l’espace est désert. Je me sens vide. Plus rien à dire. Dénudée, presque violée. Car plus rien ne m’appartient : plus de jardin secret. Tout a été livré. Un étrange sentiment de ne plus vraiment être moi-même m’envahit, comme si un autre avait élu domicile en moi sans y avoir vraiment été invité.
Soudain le regard de Marie sur moi, et cette dernière pensée s’évanouit. « Veux-tu qu’on aille prendre un verre chez moi ? » m’entends-je lui dire tout en jetant un coup d’œil à mon téléphone où s’est affiché un message SMS. C’est mon père qui, constatant mon retard, me propose de garder mes petits-enfants pour la nuit. L’horloge affiche 22 heures. Que faire ? Mon cerveau carbure à deux cents à l’heure.
« Allons plutôt au bar des Belges dans la rue à côté ! » me suggère Marie. Je me sens alors prendre une grande lampée d’air, qui m’apaise, et je m’entends lui répondre « oui », tout en inscrivant un « d’accord, merci, à demain » à mon père sur mon iPhone, en guise de réponse. Nous sommes les derniers dans le café, et je nous vois nous lever, sortir et nous acheminer lentement vers le bar. Une sensation confuse de l’incongru de notre situation me saisit, mais je ne sais quoi en faire.
Nous nous sommes installés dans un coin du bar, à l’écart. Une musique qui pourrait être du Stromae fend le silence, et rend la conversation par moments inutile. D’ailleurs, mes paroles, saisissantes, ont eu un tel accent de vérité tout à l’heure qu’elles se sont imprimées sur un écran psychique situé au milieu de nous et restent figées là : j’ai leur sensation en moi, un mélange d’euphorie et de dégoût. Marie semble avoir compris quelque chose. Il ne dit rien. Il n’a rien dit depuis qu’on est sorti du café. C’est vrai qu’on a marché en somnambules jusqu’au bar. Moi, du moins. Je me vois soudain me laisser bercer par cette musique hybride envoûtante où hip-hop et rythmes africains collusionnent, et mes yeux, alourdis par des heures infinies d’insomnie, entrent en quelques fractions de seconde dans l’univers du dedans. « Tu ne veux pas venir chez moi ? On serait plus tranquille pour discuter ? »
La voix est familière, presque suave.
C’est tentant. C’est vrai qu’il y a trop de bruit ici. J’hésite cependant. Je dois aller chercher mes petits-enfants. Aller chercher mes enfants ! Mes enfants… Cette phrase résonne dans ma tête, obsédante. « Est-ce que tu crois qu’on a le temps ? » m’entends-je demander. « C’est toi qui vois… » dit la voix. Je me laisse guider, je connais cette voix, je l’aime bien, elle est celle d’un ami, j’ai une confiance éperdue en lui, même si je n’arrive pas à mettre un visage dessus.
On s’avance ensemble, c’est calme, je n’ai plus de colère, plus de douleur. Soudain, une chambre. Une clé qui tourne dans la serrure. Je me vois assise sur un lit, nue. Quelqu’un s’approche, il n’y a plus que cette voix, toujours aussi douce : « on fait un bébé ? »
J’essaie de crier, mais aucun son ne sort.
Une pression légère sur mon épaule. J’ouvre les yeux. Marie est devant moi, qui me parle. « J’étais passé aux toilettes quelques minutes et, en revenant, je t’ai trouvée assoupie, le visage crispé. On aurait dit que tu avais très mal quelque part. Ça va ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu as mal ? Ça va ? »
Lentement je m’extrais de ce qui a dû être sans doute je m’en rends compte à présent je ne sais plus très bien une sorte de vision de rêve-cauchemar. « Non, ça va, j’ai dû m’assoupir… Tu sais, la musique tout à l’heure, la fatigue, l’alcool aussi. Ce n’est rien. »
Mais Marie n’est qu’à moitié rassuré. « Tu veux que je reste encore ? Il est tard, tu as l’air vraiment épuisée. »
Je ne suis plus en mesure de refuser. Trop lasse, trop incertaine de ce que je sens, de ce qui s’est passé peut-être je ne sais, de ce que je vis. Et puis cette voix, je connais cette voix… « D’accord, merci, c’est gentil ! C’est vrai que je me sens vraiment à bout. »
Je me rappelle à présent que, dans le bar, tout à l’heure, la musique avait changé (je crois) : ça ressemblait davantage à du Death Metal presque inaudible, assez proche de mon état intérieur. Je m’étais fait la réflexion. Pas mécontente alors, pour autant, d’avoir quitté cet endroit, qui à vrai dire ne me plaisait pas trop.
On s’était levé et je m’étais rendu compte que Marie avait déjà réglé la note. « Tu n’aurais pas dû payer encore, tu m’as déjà offert le dîner tout à l’heure… » m’entendis-je lui dire. Mais lui, déjà à la porte, prêt à sortir. M’avait-il entendue ? Pas sûr. Je m’étais dit alors que, décidément, il était vraiment très gentil. Qu’a-t-on fait alors ? Où est-on allé ? Je ne sais plus.
Ça fait un moment qu’on marche dans la rue côte à côte. D’abord j’ai pris le chemin de chez moi. On y sera en deux minutes. Puis, sans trop savoir pourquoi, j’ai tourné dans la rue à droite au lieu d’aller jusqu’à mon numéro. Sensation confuse de ne pas souhaiter retourner chez moi ? Envie de prolonger ce temps déjà trop long avec Marie ? Angoisse de ne pas réussir à nous empêcher de passer (encore ?) le seuil de la porte quand je mettrai la clé dans la serrure ? Tout cela trotte dans ma tête, indémêlable. Le quartier est désert. Même les marchands arabes ont tiré leur rideau. Il doit vraiment être très tard.
Soudain, Marie prend mon bras, légèrement violemment. « On est déjà passé dans cette rue, tu sais. Ça va ? Tu ne retrouves plus ton immeuble ? C’est quoi, la rue, déjà ? Le numéro ? C’était à deux pas du bar, je me souviens… » Manifestement, Marie est déjà venu chez moi, il veut m’aider, c’est vraiment gentil de sa part. Mais en ai-je vraiment envie à présent ? Je n’en suis plus très sûre.
Je le regarde. Son expression est à la fois douce et inquiète. (Inquiétante ?) Je voudrais le rassurer, mais le silence m’a envahie. À vrai dire, je ne sais pourquoi, je me sens envahie. In extremis, je m’entends cependant laisser échapper : « ah ! Mais oui, c’est vrai, c’est là, tu as raison. Où avais-je la tête ? » Et je m’abandonne. Brutalement, sans un mot de plus. Je fais le code, j’ouvre la porte, un petit signe de la tête, un « merci » très vite jeté, la porte de l’immeuble aussi vite refermée, les escaliers montés, ma clé, j’ouvre la porte, l’interrupteur, la lumière, referme à clé, jette ma veste et mon sac sur la chaise à l’entrée et fonce dans la chambre, mon lit, m’affale. Lui sur moi aussitôt, une fraction de seconde (vraiment ?). Ça aura eu lieu. Personne n’a rien vu (alors). Moi non plus. (Surtout pas moi. Rêvé-je ?) La porte s’est refermée sitôt ouverte. Je plonge dans un lourd sommeil sans rêve.
Aujourd’hui, c’est jour de lune.
II
Mardi
Bruit d’eau dans les canalisations. Un rayon de lumière chaude à travers les rideaux mauve de la chambre. J’ouvre un œil. Le referme aussitôt. Trop de soleil. Tâte le lit. Personne. Difficile de reprendre le fil de mes pensées d’hier. Là où je me suis arrêtée. J’essaie. Tout est embué. Mieux vaut renoncer. Pour l’instant. Je replonge dans un sommeil plutôt trouble, avec des images bizarres de légers froissements, de draps tièdes, d’ombres que j’arrive mal à identifier, un sentiment de ne pas être seule, sans trop savoir qui est là avec moi. J’entends soudain un couinement au loin, qui se répète. Je regarde autour de moi… C’est curieux, il n’y a pas de cochon aux alentours. Le couinement se poursuit, plus proche on dirait… Mais, oui, c’est mon réveil, suis-je bête ! Tout revient, subitement. Pas la soirée d’hier, non, trop lointaine, trop enfouie… Soudain, le réel d’aujourd’hui. Brutal : j’ai rendez-vous ce matin avec la médecin psychiatre de mon mari. Je n’ai pas une minute à perdre. Coup d’œil à mon portable. Nouveau message de mon père, qui me dit que les petits-enfants ont bien dormi, pris leur petit déjeuner, et jouent tranquillement dans le salon. Je lui répondrai plus tard.
Une douche chaude très chaude, qui assaille tous mes sens. J’attrape le drap de bain couleur sable acheté l’été 2000 lors de notre voyage en amoureux sur l’île de Samothrace. Images fugaces de la plage aux galets diaphanes qui faisait même protester le soleil. Un pincement aigu d’estomac-désir me rappelle à la réalité d’aujourd’hui. Samothrace disparaît. Loin. Sors en trombe nue de la salle de bains et fonce jusqu’à mon dressing choisir des vêtements décontractés. Comme à mon habitude, jean, petit haut et gilet. Attrape mon sac, y jette iPhone, clés et Pass Navigo. Je prendrai un café au bar en attendant le bus, pas le temps de déjeuner !
En sirotant mon crème, je repense à la soirée d’hier soir. Je n’en garde qu’un souvenir embrumé, un mélange de douceur et de malaise que je m’explique mal. Que s’est-il passé ? – Rien. Vraiment ? C’est peut-être ça justement qui me chiffonne. À vrai dire, j’espérais que Marie allait me donner des conseils qui m’aideraient, non pas à comprendre, mais à agir autrement. Il ne s’est rien passé. À ce moment-là, une sensation aiguë me traverse le bas-ventre. Je mets la main là où ça fait mal, tout en continuant le fil de mes pensées. J’ai beaucoup parlé, rien pourtant que je n’aie je crois exprimé déjà à mon thérapeute. Marie, lui, s’est contenté de m’écouter… Réflexion faite, il est resté bien silencieux. Ça me trouble. N’ai-je pas été assez claire dans ma demande ?
Un bus passe subitement devant mes yeux. Je suis loin, perdue dans la soirée d’hier. Rien ne bouge. Cela dure un temps indéfini : le bus, comme au ralenti. Moi, ailleurs. Un tapotement sur l’épaule, qui me fait sursauter. C’est Christophe le serveur (on se connaît si bien, depuis le temps…) : « tu ne dois pas prendre ton bus ? » Il a sans doute remarqué que j’avais l’œil vers l’arrêt, comme souvent, puis que mon regard s’était mis à partir loin, très loin, vers le dedans. Je lui fais mon plus beau sourire, juste histoire de lui dire : merci de me sortir de ma torpeur, j’ai à faire, tu as raison et, en fait, ce qui sort, c’est : « ben, je prendrai le suivant… » J’ai appris à gérer mon retard chronique aux rendez-vous en ralentissant au moment où le stress devrait au contraire me mettre en panique, et me faire accélérer. Rien que de très naturel ! Du coup, je suis en général encore plus en retard, mais aussi bien moins stressée… « C’était qui, ce type avec qui tu dînais hier soir ? » me demande-t-il de but en blanc. « Il connaît mon mari, il sait ce que je traverse, et il s’inquiète. » « Il n’avait pas l’air très net ! » Nouveau sourire, moins fendu cette fois, plus une esquisse, qui se fige à mesure que ses paroles entrent dans mon esprit. Ah, oui, Marie… C’est un ami. Pourquoi dis-tu cela ? Il est gentil… Et, ce qui sort, c’est : « ah, oui, tu trouves ? Qu’est-ce qui te fait dire cela ? » « Je sais pas, juste une impression… Il avait l’air trop proche de toi, c’était bizarre… »
Soudain le bruit d’un moteur, l’ombre d’un véhicule : c’est mon bus ! Coup d’œil rapide à Christophe (on reparlera de cela plus tard…). Il n’insiste pas. La discrétion, c’est son métier : il en voit tellement… En deux pas je suis à la porte du café, sur le trottoir, devant le bus, sur un siège strapontin. Les rues défilent, et j’entre lentement dans ma chambre intérieure.
J’ai reconnu le jardinier. À sa voix.
La première fois que je l’ai vu, j’ai seulement entendu sa voix. Elle est suave, douce et rocailleuse, un peu tordue par un rhume persistant, granuleuse comme la vie. J’ai aimé cette voix. Cette voix chante, chante même très bien. Elle monte très haut dans les cieux. Cette voix fascine, elle a le charme frais de ne pas être parfaite ; toujours sur le bord du fausset, toujours se rattrapant au dernier moment ; hésitante, pourtant, allant de l’avant, frêle et fragile de ne pas s’engager ; avançant sans le savoir dans les vibrations, les sons inconnus, les mélodies angéliques ; souvent distraite, parfois grondée, toujours souple, jamais ne rompant le ton.
J’aime. Cette voix. Le tout de son être.
Ça tapote sur mon épaule. Une sensation de sécheresse accentuée dans la bouche. Une voix, assez loin, dit des mots dont je ne saisis pas le sens. Me suis-je assoupie ? Je regarde autour de moi. Le bus est vide. Le conducteur, soudain, devant moi : « il va falloir descendre, ma p’tite dame… » Je me rends compte que j’ai raté l’arrêt, qu’il me faudra revenir sur mes pas. Des sensations visuelles sonores imprimées dans mon cerveau embrouillé. Cependant : je n’arrive pas à les retracer… On verra plus tard. Pour l’instant, l’urgence, c’est d’essayer d’arriver pas trop en retard à l’hôpital Marmottan.
La médecin psychiatre m’a reçue. C’est une femme. Elle a l’air d’avoir la situation bien en main. Je lui parle de mon mari, de l’inquiétude qui me cheville l’estomac, de sa fragilité, de mon angoisse d’être responsable de son addiction. « Ne vous sentez pas coupable ! Votre mari est avant tout très mal de ne pouvoir parler à son propre père : il se sent jugé par lui, condamné à ses yeux, et c’est cela qui le mine ! »
Me voilà rassurée. Si l’on peut dire… Reste maintenant le véritable problème en face de moi, mon problème. Le dilemme absolu qui m’a déjà confrontée à moi-même, et qui je le sens vaguement se fait à nouveau un chemin pour venir me torturer, se poser sans vergogne devant ma conscience, s’imposer comme mon péché majeur devant Dieu. Sans parler de moi-même… J’écoute distraitement la médecin psychiatre. Elle raconte les séquences de la prise en charge, comment aider mon mari à entrer dans un parcours de soins, comment la guérison pour lui, ce sera bien davantage d’apprendre à vivre avec son mal que de l’arracher une bonne fois pour toutes. Cela court en moi par petits filets d’eau, cela forme des nappes d’eau souterraines. Elle me parle de moi, comment on n’éradique pas le désir par la volonté, comment sinon on le récupère par-derrière : un coup de massue sur la nuque. Comment il faut être doux avec soi-même en acceptant de vivre avec… Cela fait si longtemps que je suis là, assise devant elle, à l’écouter.
Pas envie de partir. De me lever. Elle parle de moi. Elle doit le sentir, car elle continue à me parler, elle répète : le soin, la guérison, l’accompagnement, la relation… Les mots dansent devant moi comme fétus de paille, quasi dépourvus de sens. Mon regard se perd loin derrière, là où il n’y a ni maux ni tristesse, juste un jardin de verdure : des lys blancs. C’était il y a longtemps, lorsque l’amour était encore possible. Ou bien : lorsque je fus assez naïve pour y croire.
J’ouvre un œil, soudain. Je suis seule. La médecin est partie. Elle a dû être appelée en urgence, ou bien, me voyant assoupie, elle n’a pas voulu me réveiller.
Malgré moi mes yeux se referment, et une scène s’impose : un homme est là, qui me regarde, que je ne reconnais pas.
Il y a aussi quelqu’un d’autre, dont je distingue mal les traits. On dirait une femme, cheveux bruns mi longs, bottes hautes en cuir, imper sombre, maquillage outrancier. J’aperçois son oreille droite coupée, comme une boucle d’oreille arrachée. Elle se met à parler : elle zozote, elle a la voix criarde d’un perroquet éraillé. On dirait qu’elle me parle : je n’entends que le beuglement d’une vache. Je tourne la tête vers elle : elle a le visage d’un cochon grimaçant, hilare.
Tout cela n’aura duré qu’une fraction de seconde et, soudain, la médecin, à nouveau devant moi, inquiète. « Ça va ? Vous vous êtes endormie, vous avez grogné dans votre sommeil. Ça fait dix minutes que je suis revenue, j’étais juste allée chercher des papiers à vous faire signer. Je vous ai observée. Vous semblez souffrir le martyre. »
« Je ne sais pas. J’ai dû m’assoupir un peu, c’est vrai. Vous savez : la fatigue, l’addiction de mon mari… Ce n’est rien. » En lui parlant, j’éprouve un vague sentiment de déjà-dit, quelque chose qui trotte dans ma tête, mais je ne sais pas ce que c’est. La médecin me regarde dans les yeux, et je sens qu’elle me transperce jusque dans les replis anciens de mes zones végétatives. Qu’y voit-elle ? Je ne sais. Quoi que ce soit, je me sens traversée par des sensations confuses de malaise et de mal-être. D’ailleurs, tout se mêle et s’emmêle.
« Je dois y aller. » Cette phrase est sortie de moi malgré moi, et je me vois me lever, prendre mon sac et tendre la main pour serrer celle de la médecin. Je me vois ensuite prendre mon carnet de chèques pour payer, mais elle me fait un signe de la main pour me faire comprendre que je ne lui dois rien. Je perçois une compassion infinie sur son visage, et je me dis : « inspiré-je à ce point la pitié ? Y a-t-il quelque chose que je vis dont je ne percevrais pas la gravité ? » Et puis, aussi : « qu’ont tous ces gens à ne pas me permettre d’honorer ma dette, du moins, de rétribuer ce qui doit l’être, de payer ma part comme il se doit, et qui me permettrait (enfin) de me sentir adulte, autonome, libre et responsable ? » J’ai un sentiment diffus de ne pas pouvoir être celle que je souhaiterais être, de manquer de tenue, d’être manipulée, même victimisée, ou bien peut-être simplement infantilisée… À moins que ce soit moi qui m’infantilise toute seule par mon attitude ! Et pourquoi je me fais mal comme ça ? Qui me fait mal ? C’est jour de guerre aujourd’hui, ou quoi ?
Toute à ces pensées sans fin, je me suis dirigée vers l’arrêt de bus Place des Ternes. En attendant le bus, je m’assois, vide, sans raison. Cela dure un certain temps. Mon regard flotte, accroche des fragments de réalité. Les bouquets de tulipes sur la place en ce printemps naissant, un pigeon à quelques mètres de moi qui picore sans crainte, à deux pas d’un cycliste à l’arrêt, un couple en grande discussion devant la brasserie de l’autre côté de la rue. Soudain, le sang se fige en moi. Marie. Ma respiration, coupée. Que se passe-t-il ? Je l’ai tout de suite reconnu à sa démarche rapide. Non : je l’ai entendu avant même de le voir. Cette façon caractéristique qu’il a de frotter le sol avec ses pieds, avec une régularité obsédante. J’entends presque son souffle, alors qu’il est encore si loin, bien trop loin. Je détourne le regard, mais les images frappent dans ma tête : celle de son corps, notamment, son torse, tout contre moi, puis son souffle dans ma nuque, son bas-ventre sur mes fesses, son torse encore, un mètre en avant de ses jambes, et sa tête, aussi, tournée face à terre. C’est une vision presque grotesque, et je sens malgré moi un sourire s’esquisser sur mes lèvres. Mais que fait Marie ici ? Il ne m’a pas vue. Si absorbé, dirait-on… Il dépasse l’arrêt de bus. J’ai failli lui faire signe. Quelque chose en moi s’est arrêté. Je le suis du regard. Il vient de faire signe à une femme. Je me dis : j’ai bien fait de ne pas me manifester. Brune, assez grande, bottes et imper clair. Sentiment de déjà-vu. Un malaise me prend. Je sens soudain le vide en moi. Envie de vomir. Je me relève, et le bus soudain est là. Je me sens monter, m’asseoir, et tourner à nouveau les yeux vers le trottoir. À l’endroit où la scène a eu lieu, il n’y a rien. Ai-je rêvé ? Je jette un coup d’œil aux alentours. Rien. Je me dis : la fatigue te jouerait-elle des tours ? Et puis : je dois revoir Marie demain. Je lui poserai la question. Pour en avoir le cœur net. Pour savoir.
III
Mercredi
C’est lui qui a appelé. Il voulait savoir comment l’entretien d’hier avec la médecin de Marmottan s’était passé. Il est vraiment attentionné. Je me dis : je ne saurai jamais assez comment le remercier… Au téléphone j’ai été un peu rapide : je n’aime pas parler de ça au téléphone. On a convenu d’un rendez-vous demain pour le déjeuner.
J’aime ces moments avec Marie : il est doux, et prévenant. Moi qui suis tellement éprouvée en ce moment, ça me fait du bien.
Le téléphone sonne. À nouveau. Cette fois, c’est Deniz… Il est sorti de l’hôpital hier, et il voudrait qu’on se voie. Comment lui refuser ? « Oui, bien sûr… À quelle heure ? Ce soir ? Disons plutôt 16 heures. Je devrai te laisser à 18 heures pour aller chercher les p’tits à la sortie de l’étude. Tu veux venir les chercher avec moi ? Ben, on verra… On en parlera tout à l’heure. Bisou. »
Je raccroche et je me laisse tomber dans le canapé. Je regarde ma montre. Je regarde ma vie. J’ai deux heures devant moi avant d’aller à la fac. Que faire ? Je suis vide. J’ai tant de choses à penser, à faire. Mais : où est mon désir ?
Comme à mon habitude, j’ai finalement préparé avec soin cette séquence de cours adressée aux premières années de Licence, et qui traite de la curiosité. C’est quasiment la fin du semestre, et les étudiants sont accros. Après un temps où je les ai sentis perplexes, ils se sont laissé gagner. Je les entends encore en début de semestre dans les couloirs après le cours, lorsque je passais furtivement : « c’est quoi, ce cours ? La “curiosité”, mais, c’est pas une question de philo ? Et pourquoi pas “la main”, ou bien “les vampires” ? C’est n’importe quoi ! Moi, je voudrais un cours sur le temps, ou bien la vérité… » À présent, ils sont enthousiastes : de Saint Augustin à Heidegger en passant par la curiositas/studiositas aquinate, Hume et Husserl, ils ont adoré. Ils ont (enfin) compris la logique du cours qui fait voir la force du désir de nouveauté (Neugier) par-delà la morale du « curieux » voyeur…
Je suis encore dans la salle de cours, alors que le bus me ramène chez moi, fait défiler ma vie aussi, me ramène au cœur de mon problème après m’avoir fait heureusement dériver quelque temps ailleurs : Deniz. C’est mon problème de cœur. Que vais-je pouvoir lui dire ? Que je veux l’aider ? Que c’est fini entre nous ? Je suis perdue. Et lasse.
Il y a peu, j’ai senti l’endroit, à l’intérieur, là où ça se défait, comme un nœud de chaussure bien serré, et qui, à force de pressions diverses, s’est insensiblement distendu puis carrément dénoué. On se dit souvent : « je n’avais pas dû bien le “faire” (le nœud). » J’en suis à la distension. Après la dernière séance chez le thérapeute, j’ai senti quelque chose.
Je me dirige lentement vers le café de notre rendez-vous. Le même café que l’autre jour avec Marie : la Chope. C’est mon quartier général. J’y travaille le matin : c’est mon lieu de retraite, le moment où je me ressource, où j’écris, tout simplement. J’y reçois les étudiants l’après-midi, ou bien des collègues de travail. J’y dîne ou j’y prends un verre le soir avec des amis proches. C’est aussi notre lieu de toujours à Deniz et à moi. Avant-hier, j’y ai fait entrer Marie.
Deniz y est déjà. Il a changé. Son visage est un peu gonflé. Il ne s’est pas rasé depuis longtemps. J’aperçois ses chaussures ouvertes, sous l’effet de ses pieds, tellement enflés. Et puis, cette odeur qui flotte dans l’air : depuis quand ne s’est-il pas lavé ? Je m’approche, je l’embrasse sur la joue. « Comment ça va, toi ? » (Cette question, insupportable entre toutes, surtout quand on sait pertinemment que ça ne va pas, non, que ça ne va pas du tout…) Il me regarde, moi, coup d’œil oblique furtif. Une tristesse infinie pénètre tout mon être.
« C’est pas trop lourd, ton traitement ? » Il fait non de la tête. Un silence s’installe, que je n’interromps pas. J’aperçois du coin de l’œil Christophe le serveur, qui m’observe, interrogateur. Bienveillant, aussi. « Est-ce que je peux venir avec toi chercher les enfants ? » me demande-t-il. À nouveau. Je le regarde. Mon désir est là, à fleur de voix. Rien ne sort de ma bouche. Je sens une immense douleur dans sa voix. Mes pensées s’affolent : je voudrais tant lui faire plaisir, j’ai peur pour les enfants, qu’ils soient gênés, qu’ils le rejettent, je me sens mal à l’aise, je reçois sa souffrance. Et, ce qui sort de ma bouche, c’est : « je ne sais pas… Peut-être la prochaine fois… Demain ? Je vais leur dire que tu es sorti de l’hôpital et que tu as envie de les voir. » Deniz n’insiste pas. Il n’a plus de désir on dirait. Ou bien : le désir l’a dévasté. Les yeux dans le vague. Il me fait un peu peur. Pitié aussi. Il y a là quelque chose d’horrible. Son regard s’anime seulement légèrement quand il se pose sur moi. Je le sens, et j’ai honte. J’ai l’impression de l’avoir abandonné, même si ce n’est pas vrai au fond, car c’est lui qui s’est abandonné tout seul… À cet instant, je n’ai plus le courage de lui donner les papiers de divorce que j’ai apportés, plus le courage de lui parler de se séparer, de la vie qui impose clarification entre nous, de ce nœud qui s’est défait en moi et qui dit tout, du désir qui m’a désertée. Il y a un désastre qui s’étale devant moi, et qui prend toute la place. Qui réclame mon attention entière. Je n’ai pas le droit, non, pas le cœur de lui parler de tout cela. Il y aurait là quelque chose d’obscène.
Doucement, on a repris là où on s’était arrêté il y a longtemps : ça a duré longtemps, c’est presque tendre. J’ai failli y croire un instant à nouveau, puis j’ai entendu loin au fond le désir d’ailleurs appeler. À nouveau. Je suis prise ailleurs. On ne peut se laisser prendre si on sent la prise qui appelle ailleurs. La justesse crie « non ! » On ne peut être « pris » à deux endroits en même temps. Sinon, il y a folie, ou mort. Peut-être est-ce la même chose d’ailleurs… Lentement, je me détache. Non : ça se détache.
On a beaucoup parlé. Comme jamais. J’ai dit à Deniz mon désir naissant ailleurs, la vie en moi, qui pousse. Je crois. Il a dit : « si c’est le cas, j’adopterai l’enfant. » Je me suis tue. (Je ne lui ai pas dit de qui est l’enfant.) Mon désir est ailleurs. J’ai la certitude (alors) de savoir où il est. Je me suis tue. L’aveuglement aura été si puissant, je le sais à présent, après toutes ces années d’illusion, maintenant que je l’écris, si intime qu’il s’était fait vérité inconditionnelle. Mais, alors, je suis si certaine d’être dans le vrai. Deniz me regarde : il pressent ma détermination, et la puissance de mon illusion. Je sens qu’il pressent qu’il n’est pas à la hauteur de la puissance actuelle de mon désir. Nous nous regardons. Il sait qu’il est vaincu. On ne combat pas à armes égales avec le désir ailleurs. Même illusoire. Je vois sa douleur. Son renoncement absolu. Non, je ne vois que mon désir et je dénie sa douleur. Je ne pourrai vivre si je la voyais. Je sens qu’il s’efface doucement, par amour.
La soirée a été calme. Je suis seule. Les enfants, à nouveau, dînent chez mes parents. Ils aiment être chez eux, et eux les adorent. Ça me fait du bien de les savoir bien. C’est toujours mieux que de les avoir avec moi, et de me sentir absente pour eux. Après le repas, j’ai été les chercher, on a bavardé un petit moment avec Elie mon aîné, après le coucher de Reine et d’Eden, les jumelles. Puis j’ai regardé une série, ça me parle, l’urgence, la folie, Doctor House, puis, dans un autre genre, Breaking bad (je crois…), histoire d’oublier.
Coucher tardif. J’enfile les épisodes. Ma drogue. Ma façon de survivre. Il y aura demain.
La voix est familière, presque suave.
C’est tentant. C’est vrai qu’il y a trop de bruit ici. J’hésite cependant. Je dois aller chercher mes petits-enfants. Aller les chercher… Mes enfants… Cette phrase résonne dans ma tête, obsédante. « Est-ce que tu crois qu’on a le temps ? » m’entends-je demander. « C’est toi qui vois… » dit la voix. Je me laisse guider, je connais cette voix, je l’aime bien, elle est celle d’un ami, j’ai une confiance éperdue en lui, même si je n’arrive pas à mettre un visage dessus.
On s’avance ensemble, c’est calme, je n’ai plus de colère, plus de douleur. Soudain, une chambre. Une clé qui tourne dans la serrure. Je me vois assise sur un lit, nue. Quelqu’un s’approche, il n’y a plus que cette voix, toujours aussi douce : « on fait un bébé ? »
J’essaie de crier, mais aucun son ne sort.
J’ai plongé loin, là où les limites s’estompent, là où je ne sais plus… Je ne me suis pas réveillée au cœur de la nuit. J’ai été envahie sans le savoir, et cela me traverse, sans le savoir. Où suis-je ? Qui suis-je ? Ce moi a disparu de moi, et je ne me trouve plus. D’ailleurs je ne me cherche même plus.
Dans la nuit sale, un picotement. De la ouate devant mes yeux. Ça replonge en moi.
Il fait chaud.
Atmosphère de désert. Depuis longtemps je marche. Rien qui ressemble à un être humain. Des images dans la tête. Dans la tête ? Un jardin, soudain. Je m’avance. Il y a un homme, qui me sourit. Je suis faible, il le sait. Je suis nue. Il le sait. Le visage grimaçant d’une femme, hilare. Je le sens, par-derrière. Je la sens, par-devant.
Ils rient ensemble, au-delà de moi.
Ça viole en moi, inconcevable. Je cède, ça m’envahit de tous les côtés. Je veux je ne veux pas. Je résiste doucement, ça vomit en moi.
Ça relâche, et ça hurle de rire. Dans les tréfonds du désert.
Au petit matin, neige beige du jour. Jour de neige. De printemps. Ça colle dans mes yeux. Couleur ambre ça brûle sous la paupière. J’y retourne contre mon gré.
J’ai reconnu le jardinier. À sa voix.
La première fois que je l’ai vu, j’ai seulement entendu sa voix. Elle est suave, douce et rocailleuse, un peu tordue par les rhumes, granuleuse comme la vie. J’ai aimé cette voix.
Cette voix chante, monte très haut dans les cieux. Cette voix fascine, elle a le charme de ne pas être parfaite, toujours sur le bord du fausset, se rattrapant au dernier moment, hésitante et, pourtant, allant de l’avant, frêle et fragile de ne pas s’engager, avançant sans le savoir dans les vibrations, les sons inconnus, souvent distraite, parfois grondée, toujours souple, jamais (ou presque) ne rompant le ton.
J’ai aimé. Cette voix. Le tout de son être.
IV
Jeudi
J’ouvre un œil. Un jour opaque filtre à travers les rideaux mauves. Sensation de nuit en moi. Du déjà senti. Léger appel d’air dehors. La signature de Jupiter…
Je me traîne jusqu’à la salle de bains. C’est lourd en moi. Douche brûlante électrique qui assaille tous mes sens. Retour du même. Cela seul me fait tenir, avec le petit crème au bar, qui forme le segment de rite de mes matins. Hier. Flash d’un désir clair dans la mélasse. Ça frémit dans les entrailles de mes entrailles, je le sens. Trois jours déjà, la nidation fait son chemin, un corps me parle en ondes sonores, les antennes ont poussé et, oui, je sais que c’est là… Le fascinant fit son œuvre, et je n’ai pas résisté. Pas pu. Trop de douleurs. L’échappatoire du désir, un exutoire plutôt que la prière. Je suis jeune, je suis naïve, je crois à l’amour d’un homme. Qui parle, parle, fascine, prend, et vend de l’espoir. Un illusionniste qui s’illusionne lui-même. Ça, je ne le sais pas. Maintenant, en l’écrivant, je le sais. Trop tard. En parlant, en fascinant, il creuse le vide en lui-même sous sa face façade de pacotille. Il m’a envahie et m’a vidée de ma substance. À mon insu. M’a remplie d’une pacotille qui se fait passer pour de l’or, pour la prière même.
La douche est longue sur la peau. L’eau, de la bienfaisance à l’état pur. Je sors, enfin, m’habille. Puis, je prépare le petit déjeuner pour mon aîné, les biberons pour les filles. Un rite. Ça me tient. Ça aussi. L’automate en moi tient la barre, et c’est tant mieux. J’ouvre le frigo, prends du lait, du Nesquik, prépare le chocolat froid dans le verre, attrape les biberons, eau, poudre de lait, tartine beurre, confiture et Nutella. Voilà, tout y est. Attention légère à ce qu’il y a à faire. Rien de compliqué. Si difficile pourtant. Une seule pensée de travers ou par-derrière, et tu verses du lait à côté, tu te trompes de tiroir, tu fais tomber un verre. Les gestes simples, juste dans l’instant. Y être. Du bouddhisme à l’état pur. De l’or. Être ailleurs ne serait-ce qu’un quart de seconde, voilà que s’insinue à ton insu la torsion infime qui ouvrira la minuscule brèche dormante. Puis, ce sera une crevasse, et on ne l’aura pas vue déchirer ton psychisme. Je sais cela maintenant, je me dis tout cela alors déjà, je me sais forte (je me crois forte), et juste, jusque dans les actes posés. Je ne vois pas l’illusion gigantesque qui est derrière moi, et qui me tient. Si proche. Imperceptible. Je l’alimente sans le savoir. Il y a de la présence au kilo, et c’est bien. Mais il n’y a pas la prière, et ça déserte l’amour pur. Comment aurais-je pu savoir ?
Elie est là devant moi, soudain, mon enfant frêle sourire aux lèvres. Il paraît reposé. « Viens, mon chéri, viens t’asseoir pour déjeuner. As-tu bien dormi ? » D’un geste intérieur, j’ai enroulé le fil de mes pensées perdues-instables, et je l’ai déposé ailleurs, très loin. Me voilà tout à lui. Il sirote son chocolat en silence. Ces moments de contact pur, je les bénis. Sans mots. « Papi viendra avec moi vous chercher à l’école tout à l’heure. Il est sorti de l’hôpital. Il va mieux. »
Elie me regarde. Longuement. Il a les yeux fichés en moi. « Est-ce qu’il va revenir à la maison avec nous, ou bien tu ne veux plus de lui ? » Sa parole, claire comme de l’eau de montagne. Je ne sais que répondre. L’enfant parle en vérité, adulte rime avec adultère. Je me sens sale, tout à coup. Car mon désir est ailleurs, il a déjà frappé, et la séparation est consommée. « Écoute, mon chéri, papi est fatigué, il a encore besoin de se reposer. Tu vas le voir ce soir. On verra ensuite. » Je diffère, j’apprends le détournement, le mensonge par omission. À son contact à lui. Avant lui, déjà. Ça s’imbibe en moi, ça prend forme et ça gagne mon être. Insidieusement. Je ne le sais pas. Je ne le sens même pas. Piqûre indolore dans tout mon être.
Elie ne m’a pas lâché du regard durant tout ce temps. On dirait qu’il sait. Déshabillement de tout mon être. Je lui prends la main et l’attire à moi, le laisse se blottir contre moi. Sa chair. La chair de ma chair. Celle de Ghésar… Qu’ai-je fait ? Que suis-je en train de faire ? Que me fait-il faire ? La folie du désir, qui te tient et détruit tout. Je m’engloutis en lui, pour oublier, un instant. Mais il doit sentir la faute dormante, car, assez vite, c’est l’enfance en lui, il cherche à relâcher mon étreinte. Aussitôt, je m’écarte. Que suis-je en train de faire ? Que me fait-il faire, encore ?
J’ai levé les jumelles et conduit tout le petit monde à l’école Pouchet et à la halte-garderie rue Kellner. Mon rituel du matin. Ma survie. À peine rentrée, je me mets à la préparation de mes cours du lendemain. Autre genre, autre survie. Continuer.
Ce midi. La Chope. Toujours et encore. Est-ce là aussi un rite ? Christophe à nouveau, du coin de l’œil. Avec Marie, on s’est installé au même endroit. Quel rite est-ce là ? Nous sommes à l’inauguration. Marie veut savoir. À cet instant, le professionnel en lui sauveur de vies a pris toute la place. Il semble rassurant. Presque étayant. Moi, aveugle me croyant lucide. La suprême illusion. Je lui raconterai le rendez-vous avec la médecin psychiatre.
Elle a été encourageante : l’accompagnement, pas la guérison, apprendre à être avec, pas s’en débarrasser. Comment, en l’écoutant, j’ai compris que, soigner, ce n’est pas guérir, mais apprendre à « vivre avec ». Comment soigner, c’est avoir conscience qu’on ne peut guérir. Bien sûr, me dit-elle, quand on est malade, on cherche à ne plus l’être, à « guérir » en effet. En l’écoutant, je ne peux contester ce point. Toute la question, me dit-elle est celle de la relation que l’on entretient avec sa maladie, la capacité qu’on a à travailler avec l’être-malade en soi, et le soin, ici, c’est l’aide que l’on peut apporter à chacun et qu’on peut s’apporter à soi-même pour vivre avec les parties malades en soi. Être son propre éducateur thérapeutique… Quelle belle idée ! Quand on prend conscience de la précarité de notre corps et de notre esprit, on mesure combien il y a toujours du malade en nous, et aussi l’illusion de penser qu’une maladie peut s’arrêter.
Je regarde Marie. Il est absorbé. Je vois son regard pétiller en moi. Je suis prise, je me sens emportée par la vague de fond d’un désir de lui dire ce qu’il sait déjà, de lui faire plaisir en le lui faisant réentendre : je lui parle de lui, et je sais que ça lui plaît.
La médecin psychiatre répète, encore et encore (on n’en a jamais fini avec la parole soignante…) Dans ce contexte d’une maladie chronicisable, au long cours, soigner n’est plus guérir. Ah, l’acte technique curatif qui consiste à supprimer les symptômes, à faire disparaître la maladie ! Non, on aide à « vivre avec ». On apprend et on réapprend à chaque fois à nouveau à vivre en dépit de, plutôt, grâce à la maladie. Évidemment, on pense immédiatement aux maladies incurables, aux cancers, aux centres de soins palliatifs, où l’on accompagne les patients tout en sachant qu’on ne peut les guérir, où se trouvent dissociés, évidemment, « curer », cure et « prendre soin », care. (J’entends encore sa prononciation américaine, elle semble tellement bien s’y connaître…) Mais, sans aller jusqu’à ces cas extrêmes, c’est aussi vrai des psychoses comme la schizophrénie, où la personne peut seulement être accompagnée dans sa vie avec cette pathologie, sans espérer jamais (ou presque) ne plus être schizophrène. Dans d’autres pathologies, troubles bipolaires, dépression, on parlera de « rémission », pour indiquer un mieux-être, comme dans le cas du trouble de stress post-traumatique ; les thérapies EMDR, l’hypnose permettent (ses yeux brillent quand elle en parle, on dirait qu’elle est concernée de près…) de gagner un état de résilience (qu’est-ce que je n’aime pas ce terme que Cyrulnik a porté au-devant de la scène… ! !), où la personne semble s’adapter voire surmonte son stress. Mais, dans tous les cas et, bien sûr, avec l’addiction à l’alcool, à la drogue, au jeu, la fragilité, le vécu de la maladie est toujours là, la maladie se tapit, et personne jamais n’en demeurera indemne : on apprend à cohabiter comme on peut avec cette personne, avec ce moi qui a vécu tout cela, et qui ne s’en remet pas. Comme on apprend à cohabiter avec quelqu’un sans avoir l’orgueil insensé de vouloir le transformer… Elle lâche cette dernière phrase, soudain. On la sent touchée. Ai-je relevé ? Non, mais ça me revient, et je le dis à Marie, moi aussi, en passant, sans m’y attarder. Et, aujourd’hui, je l’écris, ça s’est sculpté en moi, à mon insu. Et, aujourd’hui, je le comprends si bien. Elle poursuit, elle est intarissable. L’existence d’un soin en l’absence de la possibilité de guérir vaut de l’or. Ça vaut pour toutes les pathologies, la guérison vient par surcroît. On ne peut pas compter avec elle. Jamais.
« Tu sais, j’ai bu ses paroles. Elles sont gravées dans mon esprit. Ça me parlait tellement… » À cet instant, je ne vois plus Marie. Comment il est en train de me regarder. Je ne vois pas à cet instant le mélange d’admiration et de jalousie qui le dilate et le contracte en même temps, jusqu’au désir de l’insupportable. Il ne me voit plus, lui non plus. Il voit seulement en moi ce « lui » qu’il est et qu’il n’est pas. Et il plonge en moi pour me prendre. (Pour prendre ce que j’ai qu’il n’a pas, peut-être. Comme les enfants : on veut toujours avoir ce que l’autre a…)
Nous sommes là depuis des heures. Car la première minute s’est installée entre nous comme de la colle forte, et cela dure. L’instant est là, il y a de l’épaisseur dans l’air, un fruit confit qui flotte entre nous, surtout ne pas le prendre, ne pas le manger. Le contempler avec envie, c’est déjà trop. Trop tard. La pensée est là, insidieuse. Je suis fragile, et il le sait. On a déjà franchi la limite, et on le sait. Tout au fond de nos viscères, ça se sait. La date est gravée dans les corps en fusion, la sensation est chaude du corps qui s’approche, qui prend par-derrière, furtivement. Impossible de regarder en face, de s’engager, de s’assumer déjà. La sensation est humide du corps qui se laisse prendre par-derrière, qui est pris dans l’inconscience d’un moment d’abandon, là où la vie est si violente que seul un viol presque consenti pourrait embaumer la violence.
Lundi 25 mars 2002. Les mots, les chiffres dansent devant mes yeux, fétus de paille… Notre viol mutuel : fut-il consenti ? Je regarde Marie à travers le voile de mes yeux. On s’est volé le corps de l’autre. On dirait. Je ne le vois pas. J’entends juste sa voix, suave et rocailleuse, et ça me plaît.
Il est tard. Le four du jour nous entoure. Cinq heures, déjà, que nous sommes là. C’est inconcevable. Que les mots font l’amour, comme dit le poète. C’est léger, dans le poids tout autour. Qui suis-je ? Non, que suis-je ? Un poisson de rivière, qui tente à toute force de remonter le courant. Qui veut vivre avec passion… Déjà ferré sans le savoir.
Le silence s’installe. Beaucoup de choses ont été dites. Marie me regarde. Je le vois du coin de l’œil. Je sais que je suis embarquée, et je me pense si forte. Trop forte. Vaincre toutes les puissances du mal. L’orgueil. Suprême illusion. Je peux l’écrire maintenant, installée à la table noire de la salle à manger.
Je regarde ma montre. 17 h 30. « Il faut que j’y aille. Je vais être en retard à la sortie de l’école. » Marie jette un œil à la sienne. « Moi aussi, je dois y aller. Tu me tiens au courant ? » Il fait signe au serveur. D’un bond, il est au comptoir. A payé avant que j’aie pu dire quoi que ce soit. Je me dis (non, la voix frêle en moi me dit) : « il est vraiment gentil… Tout ce temps passé ensemble, lui qui a tant de travail, d’urgences, d’engagements auprès des autres, de responsabilités : le combat ultime contre le feu ! Et, en plus, il paie, il m’invite ! J’ai vraiment de la chance d’avoir un ami sur qui je peux compter dans ces moments si douloureux. » À l’arrière, Christophe vaque à ses clients. Je l’entends, qui échange un mot avec l’un, un rire avec l’autre. Du coin de l’œil, à cet instant, j’aperçois Marie qui s’approche à nouveau et, soudain, Christophe, le regard fixe en sa direction, en arrêt, ce regard clair des jours de discernement que je lui connais bien. Que se passe-t-il ?
Devant l’école, j’attends. Deniz n’est pas là encore. En fin de compte, je suis en avance. C’est rare. Je regarde à l’intérieur de moi : que se passe-t-il ?
« Mamie ! ! » D’un bond ils sont là et c’est à qui me donnera le premier son cahier d’activités. « Non, moi d’abord ! ! » Reine et Eden trépignent devant moi et agitent leur chef-d’œuvre sous mes yeux attendris. Je souris et, d’un geste rapide, j’attrape en même temps les deux cahiers des deux mains. « Alors, c’est les vacances ? » Elles se blottissent toutes les deux sur mes genoux, à me faire tomber, et je sens leur petit corps plein de vie contre moi. Elie aussi est sorti de l’école à côté. En discussion animée avec sa copine Julie. Au milieu du babillement des jumelles, j’en perçois des bribes. « … sorti de l’hôpital… maison… Chance… » Je souris. Un coup d’œil à ma montre. Deniz est en retard. C’est rare… Elie s’approche. « Il arrive quand, papi ? » Reine se redresse brutalement : « quoi, y a papi qui vient ? » Elie fait oui de la tête, le regard interrogateur. Je confirme : « oui, il va mieux, il est sorti de l’hôpital… » Eden se met à hurler de joie : « je-vais-voir-mon-papi, je-vais-voir-mon-papi ! ! » Je souris, et je les serre tous les trois dans mes bras.
En attendant, on est allé chercher à goûter à la boulangerie à côté. En payant, je guette l’école, au cas où Deniz arriverait. Il est très en retard. C’est vraiment rare.
V
Vendredi
Il n’est pas venu. On a attendu un moment, puis on est rentré. J’ai fait à dîner. J’ai couché mes petits-enfants. Puis j’ai regardé une série. Breaking bad, toujours… Oublier.
*
Deniz est mort hier dans l’après-midi.
Sa disparition, douloureuse comme jamais.
L’ami de toujours me comprend :
je vis sa perte comme ma perte.
Sa mort m’en donne la mesure :
un lien infrangible de nature.
Un diamant du matin.
Sa mort me remonte à la bouche : je vomis Deniz mort.
C’est un monde qui s’écroule.
Je me revois avec lui au café après la décision d’une séparation tacitement consentie, qui n’eut finalement jamais lieu en vertu de sa mort : sentiment de parcourir un champ de ruines – ma vie.
*
J’écris à la table noire de la salle à manger, ou bien dans le grand fauteuil rouge à l’angle. J’écris. Les mots sortent tout seuls. La mort de Deniz, je ne l’ai pas écrite alors. L’inconcevable. Juste subie. Aujourd’hui, j’ai cette petite voix dans ma tête qui me rappelle cent fois par jour qu’il peut se produire quelque chose. Toujours. Je ne le savais pas, alors. Ça ne supprimera pas le choc. Jamais. Ça fera juste que j’aurai eu l’expérience, déjà, de cet inconcevable. Je vis dans l’ouverture.
Il est 14 heures. Je viens de coucher les jumelles pour la sieste. Je m’apprête à donner une touche finale à mon cours de tout à l’heure. Ça sonne. Je décroche. C’est son père : Deniz s’est suicidé. Tout s’arrête. (Il se serait jeté dans la mer du monastère de la Grande Lavra au Mont Athos. On n’a pas retrouvé son corps… Mais… N’était-il pas avec moi avant-hier encore ? Que se sera-t-il passé ?)
Il n’y aura plus de pensées. Il n’y aura pas le cours d’aujourd’hui. On ne joue pas avec la mort. La mort n’est pas pensée. Tant qu’on y pense, elle n’est pas là.
D’un bond, Marie est là. Il est toujours là. Quand il y a urgence. Sans un mot, sans discuter. Il (me) prend en charge. Il se donne à fond. La vie commande de vivre, mon corps le sait, quoique mon esprit ait déjà abandonné la partie. Marie est là. Il adhère à mon être, il épouse ma souffrance, il entre en fusion avec moi. Seule issue pour lui, seule issue pour nous. Combler l’écart, non, combler le vide, empêcher la souffrance intolérable de s’immiscer. La souffrance qui détruit, la souffrance qui te fait toucher le fond, la souffrance qui rédime. La souffrance sera en oblique. Il y aura un deuil latéral. Surfer sur la perte, surfer sur la souffrance. La souffrance nue un court instant, juste entrevue. Trop dur. Il est parti sans rien dire, insupportable. Il nous a laissés, Tiphaine et moi, sans dire au revoir. Souffrance très vite trop vite contournée.
Il n’y a pas eu quarante jours. On a effacé le deuil. Oublié la nécessité de souffrir. Il y a de l’impossible avec cette souffrance. Il y a eu Marie, d’emblée.
Et ça s’est instillé en moi sans le savoir. Comme on coule du béton armé. Ça n’a pas autorisé la souffrance inconcevable du deuil.





























