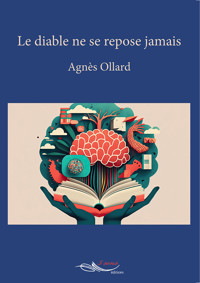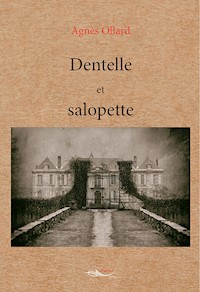
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au moment de refermer les volets de la vieille bâtisse, la narratrice se souvient… Elle a 5 ans. Années 6O. Au manoir, le dimanche, elle s’appelle Lucienne, fille d’Emile Marsignac, riche industriel de l’Angoumois, un homme austère et distant qui la terrorise et jamais aucun mot n’est prononcé sur les absences prolongées de sa mère. En semaine, chez Mamé sa nourrice, on l’appelle Lulu et elle grandit libre au sein d’une famille bigarrée et exubérante. Il y a Paulo et Monique, les petits de l’assistance publique, Rodolphe le petit prince noir, Tatiche la douce et Solange qui règne sur la tribu. Il y a aussi Riri, Tintin, Youpette et tous les autres. « Ainsi, j’avais deux maisons, deux vestiaires, deux familles, deux dictionnaires et il me fallait sauter entre deux mondes… l’un tout chaud comme un marron, l’autre en eau comme un glaçon. Ça embrouille tout ça. Alors, je trouve que je ne méritais pas de me faire enguirlander quand il m’arrivait de me mélanger les pinceaux. C’était mon avis et aussi celui de Paulo qui disait : T’as qu’à le renvoyer chier ton père… »
C’est le récit coloré d’une enfance qui se perd entre deux univers. C’est le roman de l’abandon, de l’absence, du chagrin traversé de fulgurants éclats de joie et de bonheur. C’est aussi la peinture d’une société corsetée de morale en train de changer. Comme Lulu, on passe du rire aux larmes et de la gravité à la légèreté. Comme Lucienne, on regarde l’enfant que l’on fut et l’adulte qui est devenu. Comme dans la vie en sorte.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Agnès Ollard est née à Angoulême où elle réside toujours. Après une vie professionnelle consacrée à la psychiatrie, elle continue à travers ses romans de témoigner de la complexité et la fragilité de l’être, irrigué par le monde qui l’entoure. « Dentelle et salopette » est son deuxième roman, après « La chaise rose de Virgile » paru aux éditions Spinelle en 2020.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agnès Ollard
Dentelle et salopette
En ce petit matin clair de février 1954, la France grelottait. La Charente charriait ses glaçons. Les oiseaux avaient envahi la ville pour se réchauffer mais surgelés en plein vol tombaient ventre en l’air sur les trottoirs. Les plus miséreux les glissaient dans leurs besaces pour en sucer les os à la soupe du soir. Un mètre de neige ! Moins 26 degrés ! Un blizzard à vous couper en morceaux ! La peau restait collée sur le manche des pelles, les larmes gelaient dans les yeux, les lèvres éclataient comme des figues et le lait congelait dans les pis des vaches. De mémoire de chrétien, personne n’avait encore vu ça. On disait que les loups avaient déjà envahi l’est du pays et descendaient en meutes droit vers nous, égorgeant au passage bêtes, femmes et enfants. Les croyants se signaient, les mécréants blasphémaient et tous souffraient. Et le jour et la nuit, les menuisiers sciaient, clouaient les planches des cercueils pour enterrer les morts.
C’est ce jour-là que l’abbé Pierre lança son appel désespéré à la radio, exactement le 1er février 1954. Mais dans le manoir des Marsignac, on avait autre chose à faire qu’écouter Radio Luxembourg. À cette heure-ci Jeanne Marsignac mettait au monde une petite fille. Cette petite fille c’était moi. À vrai dire personne ne fit grand cas de cet événement qui n’en était un pour personne sauf pour l’intéressée. Chacun se contenta de faire ce qu’il avait à faire : au mieux et au plus vite. On sortit les serviettes des armoires et on courut dans les couloirs avec les bassines fumantes. Jeanne poussa aussi fort qu’elle le put et moi, vu les circonstances, je sortis vite fait de mon trou sans faire d’embarras. Après quoi, on rabattit promptement les édredons sur le ventre de ma mère et on m’emballa sous des monceaux de plumes pour que je ne fusse raidie de froid avant d’avoir vécu. Bien que les cheminées eussent été chargées jusqu’à la gueule, il régnait dans ces immenses pièces un froid sidéral. Quoiqu’on fasse, même au cœur des canicules, il y fait toujours froid. Les hauts plafonds à caissons, les pierres de calcaire pompant l’humidité de la rivière toute proche, les fenêtres à meneaux par où siffle le vent, tout concourt à donner à l’endroit, la majesté glaciale d’une cathédrale et à vous filer les frissons d’un tombeau.
En tout état de cause, par la suite je ne suis jamais parvenue à me réchauffer. Il m’est resté de cette anomalie météorologique, une frilosité dont je ne pus jamais me départir. Et je traverse vie, désert et Sibérie emmitouflée de duvet de canard.
Mais revenons aux couches de Jeanne Marsignac, la quatrième si on parle des vraies ou la sixième si on compte les fausses. Et pourtant je n’ai qu’une sœur : Irène Marsignac, dix ans à l’heure de mon premier vagissement. N’y voyez pas une entourloupe mathématique. La vérité est plus simple, plus cruelle aussi et la différence d’âge s’explique aisément. D’une part, je suis une sorte d’erreur à retardement comme la bombe du même nom et d’autre part, entre nous deux, il y eut deux morts.
Le premier s’appelait Luc. Il avait tout. Il était beau, il était blond, il était un garçon et serait successeur de papa à l’usine : Établissements Marsignac et fils. Papeteries de l’Angoumois depuis 1853. Il gazouillait ses premiers mots quand une pneumonie l’emporta en quelques semaines. Comment se remettre de ce cauchemar ? Bien entendu, Jeanne ni personne ne le put et pourtant deux années plus tard, courageusement elle mit au monde un autre petit garçon pour remplacer le premier. On l’appela Lucas. Il était blond, il était beau et il serait le successeur de son père. Il survécut quatre jours.
Et après ce fut moi. J’étais brune. J’étais une fille et pour tout dire je tombais comme une mouche dans un bol de lait. Ce n’est pas pour en faire un fromage mais seulement pour expliquer pourquoi ma naissance fut escamotée de la sorte. La faute des Russes qui nous envoyaient leurs stalactites, la faute de l’abbé Pierre qui choisit ce jour-là pour chatouiller la conscience de ses concitoyens, la faute de tous les morts en général et des nôtres en particulier. Mon père ne vint pas me dire bonjour de la journée ni me souhaiter bienvenue. Il avait, parait-il, plus important à régler. Pour l’heure, il mettait en œuvre un plan d’aide aux miséreux et préparait un discours avec le préfet en habit d’apparat. Je pouvais bien attendre ! C’est Mamé qui m’a expliqué tout ça quelques années plus tard, trouvant toutes les excuses à notre grand homme et grand patron. Mais père pas si grand selon moi. Mamé veut trouver toutes les explications qu’elle peut et prier tous les saints qu’elle veut, des saints fruscin aux saints glinglin. Mais en un mot comme en mille, il n’était pas là pour me souhaiter la bienvenue. Un point c’est tout. Elle n’aime pas ça Mamé que je parle ainsi de lui. Mais elle est comme ça ! Elle aime bien mon père et n’aime pas dire du mal des autres. Mamé c’est ma nourrice et j’aurais l’occasion de vous en reparler encore et encore, quitte à vous en rebattre les oreilles. De toute façon, même si Mamé n’avait rien expliqué, j’aurais senti l’absence du père. Je la connais trop bien.
Quant à Jeanne, ma mère, une fois que j’eus glissé hors d’elle comme un têtard, elle se tourna sur le côté, cala son nez dans les oreillers et reprit ses sanglots là où elle les avait laissés.
On dérangea le secrétaire général de la préfecture de la Charente qui dérangea le directeur de cabinet qui dérangea l’huissier qui vint apporter sur une soucoupe d’argent à monsieur Marsignac, une fiche dactylographiée qui listait mes caractéristiques : 6 livres et des poussières, 52 centimètres de long et sexe tout ce qu’il y a de plus féminin. Fille prénommée, Lucienne, Marie, Jeanne. Oui, vous avez bien entendu ! Lucienne ! C’est comme le froid. On ne s’en remet pas. Ce prénom, je l’ai porté comme un furoncle sur le nez. Et même si dans la vraie vie, on m’appelle Lulu, n’empêche que sur ma carte d’identité, sur ma carte d’électeur, pour la sécu, les impôts et le facteur, je suis Lucienne. Dans les cours de récréation, les cours d’histoire, de maths et de gym, de longues années je fus Lucienne au grand bonheur de mes congénères qui firent de moi « la pauvre Lucienne ». Ce n’est pas un prénom c’est une punition. Luc, Lucas, Lucienne et pourquoi pas Lucifer ? Je ne veux pas faire la pleurnicheuse mais avouons que comme début, on a vu mieux.
Cependant je suis née avec une cuillère d’argent dans le bec sauf que le manche est resté coincé. Pourtant, grande famille, grosse fortune, je suis bien née. Je n’ai pas connu mes arrière-grands-parents sauf par les grands portraits en pied qui ornent les murs du salon bleu. Ils posent austères, la moustache avantageuse et la main sur le pommeau d’argent. Ils sont raides et pour tout dire assez laids. Je suis issue de cette longue lignée d’industriels du 19e siècle qui ont fait d’Angoulême la capitale du papier. Un bisaïeul besogneux, un aïeul visionnaire, une descendance entreprenante et le tour était joué. S’ensuivirent les grandes écoles, les beaux mariages, une culture de caste et pour finir un millier d’employés qui devaient tout à la famille Marsignac. Leurs logements ouvriers, serrés les uns contre les autres comme des poussins sous les ailes de la poule, les crèches pour leurs bambins, les écoles pour leurs enfants et les dispensaires pour leurs bronchites. Chaque maison possédait à l’arrière son propre jardin dessiné au cordeau pour faire pousser les épinards et le beurre qu’on met dedans. Afin de vitaminer les motivations et fortifier les loyautés, le grand patron organisait chaque année, le 21 juin à 12 heures 30 précises, un grand banquet sur les quais. On mangeait de la cochonnaille, on buvait sec et on faisait tourner les cotillons au son de l’accordéon. Une sorte de fête de la musique paternaliste avant l’heure. Une salle de cinéma fut même construite et tous les papetiers, du larbin au petit chef ont larmoyé de concert au destin du docteur Jivago.
Je suis mademoiselle Lucienne Marsignac, descendante de ces grands notables et promise dès ma naissance à de hautes fonctions. Il m’appartient de faire honneur au pêle-mêle épinglé au mur où on trouve un député et un sénateur. Ils sont tous là en habits et en médailles à veiller sur le poulet du dimanche au manoir. Ça fout les jetons, tout ça !
Le manoir, justement, parlons-en ! Un tantinet prétentieux et m’as-tu-vu, comme je suis arrogant. Vingt-trois pièces, quatre salons, un magnifique balcon de fer forgé dessiné par Eiffel, ami de la famille, des fausses statues antiques dans le parc, des clochetons tarabiscotés et la Charente qui glisse sous nos fenêtres. Et un froid de canard !
Aujourd’hui, il ne reste pas grand-chose de cette splendeur d’antan. Subsiste encore intacte la façade en pierre sculptée des ateliers, les hautes cheminées en briques et les herbes folles. Au milieu de sa friche se dresse le manoir qui porte beau encore, pourvu qu’on le regarde de loin et coule et roucoule à ses pieds d’argile la Charente qui s’en fiche de l’Histoire et de nos histoires. Et nous les Marsignac mangeons toujours notre poulet le dimanche avec trois pulls sur le dos.
Aujourd’hui, comme avant et comme toujours, papa est en bout de table, cravaté, le cheveu rare et gominé Lustra. À sa droite Irène, ma sœur ainée qui malgré deux liftings marque quand même son âge. À ses côtés Bertrand, son énarque de mari essaie d’expliquer à mon père le monde qu’il a perdu, ce monde dont je n’ai pas encore compris dans quel sens il tournait.
Aujourd’hui, le 28 septembre 1994. C’est l’anniversaire de papa. 80 ans. Irène déballe le cadeau qu’elle a apporté. Une paire de charentaises qui lui tiendra enfin aux pieds et lui évitera de se casser les os. Elle vit utile Irène. À sa décharge, il a gardé les stigmates de son dernier tourneboulé dans l’escalier. Des bleus arc-en-ciel sur une moitié de figure. Elle me regarde et me dit en mimiques :
« Tu vois bien qu’il ne peut pas rester là. »
Je ne réponds pas. Courageusement, elle mime la gaité en déballant le paquet.
« Tu n’as rien apporté à papa ? » demande-t-elle.
« Pour qu’il joue avec les bolducs ? »
Du coup elle lui ôte prestement la ficelle dorée qu’il est en train de mâchonner avec application et la fourre dans son sac Hermès. Je suis triste de sa tristesse alors je dis :
« Tu as sans doute raison. Il ne va pas pouvoir rester ici. »
Je regrette déjà ma capitulation. Elle s’épanouit de soulagement. Elle esquisse même le mouvement pour venir me claquer une bise de merci. Irène a développé depuis des mois tous les arguments, sur toutes les variations. De la supplication au chantage, elle a tout tenté pour me convaincre. Dans le fond, je sais qu’elle a raison. Mais la seule raison de ma résistance et qui vaut à mes yeux toutes les siennes, est que mon père aurait voulu rester ici. Dans ses souvenirs. Mourir là en regardant la Charente et ses arbres. De plus Emile Marsignac n’a jamais laissé à quiconque le loisir de décider à sa place. Et maintenant qu’il est cette petite chose bavochant, j’ai la sensation de lui porter le dernier coup de Jarnac.
Irène veut son bien, rien que son bien. Ce qu’elle veut, c’est qu’il soit soigné, lavé, torché, nourri. Qu’il ait chaud et qu’il ne dégringole plus tous les deux jours, se perde dans les couloirs et macule d’excréments sa robe de chambre en soie. En un mot qu’il vive encore et pour longtemps son cauchemar.
Moi ce que je veux, c’est qu’il meure au plus vite. Comme il lui plaira ! De faim, de froid, qu’il mélange ses médicaments, s’engoue avec son jambon mixé menu ou tombe la tête la première sur le marbre. Ensuite on l’enterrera au cimetière de Bardines avec le drapeau bleu, blanc, rouge sur le ventre de son cercueil et on lui lira les beaux discours qui vous redressent les poils.
Mais je ne peux pas dire les choses ainsi à Irène. Surtout que c’est elle qui gère l’essentiel et l’accessoire, elle qui vient deux fois par jour, qui dort dans son petit lit de jeune fille quand il s’étouffe dans ses crachats, qui renonce à ses vacances, qui m’appelle à l’aide et tombe immanquablement sur mon répondeur. Je sais tout ça. Mais comment dire à Irène que malgré les rapports alambiqués que j’entretiens avec mon père, je souffre pour lui de cet honneur perdu. Même s’il devait me regarder de ce regard condescendant dont il était coutumier et qui disait : « Ma pauvre Lucienne ! »
Surprise de ma reddition, ma sœur pousse son avantage.
« De toute façon, il ne se rendra même pas compte qu’il est en maison de retraite. Et madame Dupuis dit qu’elle ne pourra bientôt plus s’en occuper. Elle prend de l’âge aussi et tu sais bien qu’il est de plus en plus difficile de trouver des gardes de nuit fiables. La semaine dernière, celle qui devait venir a fait faux bond au dernier moment, sans même téléphoner et il m’a fallu planter mes invités au milieu du diner. N’est-ce pas Bertrand ? » argumente Irène.
Sursautant au milieu d’un assoupissement d’après Côtes-Du-Rhône millésime 82, le dénommé Bertrand hoche la tête sans trop savoir à quoi il donne son assentiment.
« Non vraiment, ça ne pouvait plus durer. Tu verras on trouvera une bonne maison de retraite avec un parc où papa pourra se promener. On choisira ensemble. On s’y met dès la semaine prochaine ! Maintenant que la décision est prise, ce n’est plus la peine de lanterner. Hein Papa ? »
Papa est en train de s’étouffer avec la génoise et ses yeux bleus lui sortent de la tête.
« Tu vois Lucienne, ce n’était plus possible ! »
Irène essuie la bouche de son père avec les mêmes gestes tendres et efficaces qu’elle avait avec ses enfants quand ils étaient enfants.
Ce geste me bouleverse. Je voudrais lui dire que je l’aime. Une seule fois. Une fois pour toutes. Ensuite on n’en parlerait plus. Mais on pourrait s’engueuler pour de vrai, se dire ce que l’on a sur le cœur sans avoir peur de se perdre, on ne serait plus obligées de s’éviter par regrets ou par remords. On serait ensemble. Mais comment le dire à Irène penchée sur l’évier à dégraisser le plat de gratin du chou-fleur de midi.
J’écrase mon mégot dans la soucoupe de mon café, siffle mon dernier verre de vin et claque la porte sans embrasser personne en criant Ciao ! ! !
Irène dira : « Non vraiment, elle exagère ! »
Bertrand dira : « Comme si tu ne la connaissais pas ! »
Mon père dirait : « Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas ma fille ! »
Ma mère absente n’aurait rien dit !
Mais moi, je suis déjà loin et j’efface sans le lire le message laissé par Irène pour me passer un savon.
Irène, je ne sais pas vraiment comment l’aimer. Comme une sœur, une grande sœur ou comme une mère, une petite mère. On passe sans cesse d’un registre à l’autre et on s’y perd. Je suis la petite dernière avec la presque quarantaine pas encore et des ridules qui froissent le regard. Du coup, le propos devient anachronique. Elle m’abreuve de conseils, veut veiller sur moi comme si j’étais une enfant ou une incapable ou les deux et pour sa défense, ma vie conforte son jugement. Elle s’irrite de mon inconséquence. Je m’agace de son omniprésence. Et fatiguées l’une de l’autre, il nous arrive de nous lancer des méchancetés que nous regrettons surtout parce qu’elles sont vraies.
Irène a débarqué trop tard dans ma vie et à l’âge de mes premiers souvenirs, cinq ou six ans peut-être, elle était presque une femme avec du sang dans sa culotte, des copines fiancées et des rêves de grande. Elle est née le 1er septembre 44. Mon père, non plus n’était pas présent ce jour-là. Mais Irène, contrairement à moi ne lui en veut pas. Elle en tire même un certain orgueil et aime raconter ce jour de gloire comme si elle y était pour quelque chose. Il faut reconnaitre que tout le monde ne peut pas se vanter d’être né le jour de la libération de sa ville natale et qui plus est, libération conduite par le colonel Renaud-Emile Marsignac en personne.
Ce matin l’aube est sale. Les maquisards ont pendu leurs frusques sur les bosquets et trempent leurs figures dans les baquets d’eau froide. Ils rigolent insouciants, pressés d’en découdre avec les Boches qui se sont retranchés dans la caserne 107. Ils ont vingt ans, dix-huit ans et le petit Marcel n’a pas encore attrapé ses seize ans. Enfin Marsignac donne le signal. On entend pétarader sur les hauteurs de Grapillet du côté de Soyaux. La colonne de maquisards avance de maison en maison. Il leur faut remonter à découvert la longue rue de Lavalette. Ils progressent en rasant les murs et durant ces trois cents mètres sont des lapins au milieu d’une clairière sous la mitraille ennemie. Le premier, le petit Marcel tombe pour la France en écarquillant les yeux d’étonnement. Victor le tatoué appelle sa mère et kiki la boulange s’écrase en disant « putain de bordel de Dieu ». Beaucoup tombent comme des allumettes et jonchent les caniveaux. Personne n’a le temps de pleurer ni de prier. On verra plus tard. En tête, Marsignac donne l’ordre de se déployer dans les greniers les plus hauts pour surplomber les casernes. Ça prend un temps fou mais maintenant les mouches ont changé d’âne et les gars sont en position du chasseur. À minuit des camions avec des croix de Lorraine peintes sur les portières débarquent en faisant crisser les pneus. Ils arrivent de partout, de Limoges, de la Creuse et de plus loin encore. Et puis d’autres sortent, on ne sait pas d’où avec des uniformes flambant neufs sur des torses bombés car les plus malins, sentant le vent tourner avaient attrapé les girouettes à temps. Mais pour l’instant, c’est la pagaille, ça tire en tous sens. Et puis… c’est le silence ! Soudain, quelque part, une poitrine chante la Marseillaise et une autre lui répond et encore une autre. Ça vous remue les tripes et les plus fiers à bras essuient d’un revers de manche les larmes qui coulent sur les mentons barbus.
Angoulême n’est plus que chansons, étreintes et embrassades. Angoulême est libre. « Angoulême martyrisée, Angoulême… mais Angoulême libérée » aurait dit le général s’il avait été là. À défaut de général, on fit sauter le colonel Renaud-Emile Marsignac, de bras en bras pour saluer son courage.
C’est le moment que choisit Irène pour apparaitre. Évidemment son père, le héros Emile qui sautait de bras en bras avait, on le comprend toutes les excuses pour n’être point au chevet de Jeanne, sa femme. Évènements historiques obligent, il lui fut impossible de prendre dans ses bras son premier enfant, une fille qu’il aurait préférée garçon. « Tant pis, ce sera pour la prochaine fois » se dit-il fataliste en rentrant au manoir trois jours plus tard. Sur ce, Emile s’était endormi comme un soudard sur la chemise de sa femme.
Ce sont ces circonstances picaresques qu’aime raconter Irène.
Irène fut un début prometteur qui ne s’est pas concrétisé. En fait, Irène fut une éternelle promesse. Promesse de beauté, promesse de hautes études, promesse d’un grand destin. Irène préféra l’amour. Elle aima aimer. Son mari, un peu, sa mère beaucoup, son père passionnément, ses enfants à la folie et elle en dernier. C’est un boulot à plein temps d’aimer. Sans condition ! Ça use tout cet amour pas toujours rendu. Alors on peut lui pardonner. Tout lui pardonner ! La manière qu’elle a de vous retourner la tête et de vous malmener pour votre bien, ses tailleurs couture, son parler aigu et son petit doigt qui tient tout seul en l’air par habitude ou lassitude. Irène a hérité du front haut des Marsignac, de leurs joues creuses et de la pâleur de leur teint. Elle a pris la délicatesse maternelle et ce maintien qui fait que personne ne lui pique sa place dans la queue du supermarché. Bien malin, celui qui peut se vanter d’avoir surpris chez elle, le moindre laisser-aller. Tirée à quatre épingles dès potron-jaquet, elle ne laisse aucune chance aux circonstances de la prendre au débotté. Incapable d’une telle discipline, j’admire. Mais mon Dieu que cette maitrise doit être épuisante et de fait Irène est épuisée et s’exprime de plus en plus par soupirs.
Et Jeanne notre mère dont je n’ai pas encore parlé. Je tourne la cuillère autour du pot depuis un bon moment mais il va bien falloir que je présente Jeanne.
Que fait-elle ? Que dit-elle ?
Si je ne le dis pas, c’est que je n’en sais rien. Elle est comme celui qui prend les photos, toujours présent mais jamais sur pellicule. Et de fait sur les clichés elle est souvent absente et lorsqu’elle apparait, elle est déjà en mouvement prête à sortir du cadre ou se cache à l’abri d’un plus grand ou d’un chapeau ou derrière sa main comme le ferait quelqu’un pour se protéger d’une lumière aveuglante. Jeanne est une tache blanche ou un tableau flou. À son insu, j’ai voulu la dévoiler et j’ai acheté une loupe, la plus puissante que j’ai trouvée. Grossissante X fois mille quelque chose. Mais Jeanne s’est échappée pour de bon en mille petits points sans contours. J’ai agrandi les photos et cette fois elle s’est changée en zébrures. Les témoignages ne valent guère mieux. Mamé dit qu’elle était brune avec des cheveux frisés. Irène dit qu’elle était châtain tirant sur le roux avec des yeux verts ou bleus. Elle ne s’en souvient pas. Je presse Mamé de questions. Elle s’irrite et dit que c’est trop loin tout ça et qu’il faut laisser les morts avec les morts.
Une fois, une seule, j’avais demandé à mon père. J’avais frappé doucement à la porte de son bureau pour ne pas le déranger. À contrecœur, Il m’avait fait signe d’entrer en tapotant avec impatience son stylo sur le dos de sa main. J’avais pris mon élan et comme pour un plongeon, je m’étais lancée :
« Elle était comment Maman ? »
Inspiration.
« Est-ce que je lui ressemble ? »
Expiration.
Il m’avait regardée par-dessus ses binocles, avait fait non de la tête et du revers des doigts m’avait fait signe de déguerpir et de fermer la porte. C’était tout. Ensuite je n’avais plus rien demandé à personne. Je l’inventais et c’était mieux pour elle et pour moi. Et pour tout le monde.
« C’est quand même bizarre que tu n’aies aucun souvenir » dit Irène. « Tu avais quand même onze ans quand elle est morte. À onze ans on se souvient d’habitude ! »
Eh bien pas moi, je n’ai aucun souvenir. Aucune image, pas même une silhouette. En revanche, j’entends encore sa voix. À moins que ce ne soit pas la sienne non plus. Pour le passé plus passé, j’interrogeais Mamé mais il ne fallait pas trop se fier à sa mémoire car non seulement elle brodait la réalité mais en plus elle déraillait souvent. Alors entre les versions colorisées, originales et sous-titrées, je ne sais pas trop à quel saint me vouer et de toute façon Mamé avait raison : C’est si loin tout ça !
Cependant, selon elle, Emile et Jeanne se sont beaucoup aimés. Comme des fous disait-elle. Un véritable coup de foudre. Emile était encore un jeunot. Marsignac père cherchait à étendre son royaume et mangeait de bon appétit et à tour de bras tout ce qui était plus petit que lui. Ses usines s’étiraient déjà le long de la rive est mais assoiffé d’or, il était parti à la conquête de l’Ouest. Il proposait des associations avantageuses à des concurrents en mauvaise passe, accolait son nom aux leurs, sur le fronton de leurs entreprises mais en moins d’un an, les avait avalés et digérés comme un boa. Peu après, ne restait d’eux ni patronyme ni louis d’or, ni souvenir.
Jeanne était la fille d’un de ces malheureux gros Jean comme devant. Inutile de préciser que la négociation fut rapidement menée et l’accord promptement signé. Le père Ribaut sauvait d’un coup son usine, ses économies et son honneur et offrait à sa fille un des plus beaux partis de la ville. Et contre toute attente ces marchandages tournèrent à la romance. Jeanne ne fut pas insensible à ce grand escogriffe rougissant qui baragouinait ses premiers mots d’amour.
« Monsieur Emile Marsignac, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Ribaut Jeanne ? Et vous Mademoiselle Ribaut Jeanne… Patin, couffin » demanda l’évêque en habits dorés et chapeau pointu.
Tout le monde étant d’accord, on chanta l’alléluia sous les orgues de la cathédrale Saint Pierre d’Angoulême et les deux cent quatorze invités lancèrent des grains de riz sur les jeunes époux en guise de prospérité et de fécondité.
J’ai grand mal à m’imaginer Emile faisant tournoyer Jeanne au milieu des champs de tournesol ou dormir jusqu’à midi après une nuit de galipettes. Eh bien si ! Pas seulement parce qu’il s’agit de mon père et de ma mère car comme toute progéniture, je préfère la version Saint-Esprit au concret de la chose, mais je ne parviens pas à me représenter mon père sans sa raideur, son quant-à-soi et son costume trois-pièces. Qu’il ait pu un moment jeter tout ce fatras cul par-dessus tête et changer par amour me laisse perplexe. Ça colle mal avec le bonhomme. Mais comme tout le monde l’a dit d’une seule voix, je suis bien obligée de le croire. Alors oui, je le crois, avec réticence certes mais je le crois. Du coup, ce coup de projecteur sur un Emile-Edouard-Louis Marsignac romantique au sang chaud brouille un peu mes cartes et écorne le roi de pique. Ça m’empêche de lui en vouloir tout net. Ça écharpe un peu les coins et du coup le ressentiment est moins propre.
Voilà j’ai présenté tout le monde. En fait, ça ne fait pas grand monde comme survivants en ligne directe. Il ne reste qu’Irène et moi et notre moitié de père, l’autre moitié prend l’eau et rame entre les vivants et les morts. Et puis il y a nos descendants. Pas les miens parce que je n’en ai pas. Non que je n’ai pas voulu mais la situation ne s’est pas présentée et comme je n’ai pas le caractère à forcer le destin ou que je n’ai pas de caractère diront certains, je n’ai donc pas d’enfants. À presque quarante balais maintenant, je n’ai ni risque ni chance. La messe est presque dite et c’est à la fois désespérant et reposant.
En revanche Irène et Bertrand ont deux enfants. Béatrice et Emmanuel. Comme la majorité des enfants, ils ont détesté les prénoms que leurs parents avaient amoureusement choisis dans le livre des prénoms ou le calendrier des postes et on les appelle Béa et Manu. Je les aime bien surtout Béa à qui je donnerais la chemise que je n’ai plus car elle m’a déjà bien dénudé, la scélérate. Elle m’aime par accrocs. Je la vois jusqu’à l’overdose ou pas du tout pendant des semaines. Puis elle réapparait sans prévenir, elle graisse mon canapé avec ses chips et son coca, pleure sur mes oreillers, finit mes bouteilles d’apéro et regarde Plus belle la vie en boucle. Et puis un jour, elle disparait. Elle m’écrit du Congo où elle est partie faire l’école aux pauvres ou me téléphone du lit qu’elle partage avec l’homme de sa vie du moment. Quand elle est en panne d’espoir, elle préfère le chez moi-chez Mamé que les récriminations de sa mère à qui elle fiche la migraine. De désespoir et de fatigue, ma sœur pousse des soupirs à se vidanger les poumons. Heureusement, elle a son garçon cardiologue. Que du bonheur et elle est déjà grand-mère deux fois.
« Ma pauvre Lucienne, tu ne peux pas t’imaginer tous les tracas » dit-elle.
Non je ne peux pas m’imaginer et pour lui faire plaisir je demande des nouvelles du dernier streptocoque et pendant qu’elle m’explique les picotements et les chatouillements, je peux regarder le ciel sans l’écouter. Je relis dans ma tête la lettre de notre père trouvée par hasard par Irène sous un monticule de paperasses. Elle était bouleversée et moi aussi, même si j’ai fait semblant du contraire. La lettre était pliée en confettis et bouchonnée dans un ancien livre de comptes. Depuis qu’il est malade, mon père a pris l’habitude de plier en infiniment petit tout ce qui lui tombe sous la main.
« Tu te rends compte, pour un peu, elle serait passée à la poubelle ! » soupire Irène.
« Oui, je me rends compte. »
Cette lettre écrite, il y a plus d’un an, aurait pu ne jamais exister.
LETTRE D’EMILE MARSIGNAC
À SES FILLES. 1993
Mes enfants,
Je reviens d’une consultation chez le neurologue à l’hôpital de Girac. Le diagnostic est sans appel. Le médecin ne savait comment me l’annoncer et a tergiversé pendant de longues minutes avant de lâcher le gros mot. Alzheimer. C’est tout aussi terrifiant mais plus élégant que démence sénile. Mis à part cet habillage sémantique, le résultat est identique et mon cerveau s’effiloche. Avant d’en arriver à cette conclusion, il m’a fallu passer toute une batterie de tests tous plus humiliants les uns que les autres. Compter deux par deux en avant ou à reculons. Le plus terrible, c’est que malgré mes efforts je me suis trompé à plusieurs reprises. L’infirmière chargée du supplice me criait dans les oreilles pour m’expliquer les consignes. « Alors Monsieur Marsignac, on a compris ce qu’il faut faire ? Allez, on se concentre et on est parti ! » Mais pourquoi diable, prend-on les vieillards pour des imbéciles sourds. À chaque erreur, elle mimait ses déceptions et j’ai fait un bond en arrière de plusieurs décennies pour me retrouver en culottes courtes devant mon maitre d’école ou mon père qui me donnaient conscience de mon idiotie à coups de tournioles qui me brulaient l’arrière-train pour plusieurs jours.
Dans quelques mois, tout aura foutu le camp. Et la tête. Et la tête et les ailes. Alouette, vilaine alouette, je te plumerai.
Je ne pourrai plus vous parler.
Il sera trop tard.
Du reste, peut-être est-il déjà trop tard puisque je ne l’ai jamais fait auparavant ?
J’ai pensé au suicide bien sûr. Il suffirait d’avaler une poignée de ces pilules multicolores que me prescrit ce bon vieux docteur Pascal qui ferait mieux d’arrêter l’exercice de son art avant d’envoyer au purgatoire ou en enfer une bonne partie de sa patientèle. Je pourrais plus virilement me tirer une balle dans cette tête qui aura dans quelques mois autant de raison qu’une courgette. Mais je ne le ferais pas. Un Marsignac fait face, un catholique laisse Dieu décider et un père n’inflige pas ce tourment à ses enfants. Mais la vraie raison, n’est-elle cette panique qui me réveille au milieu de chaque nuit ? Alors quand la solitude et l’angoisse m’étreignent, j’espère que je partirais sous peu comme mon père ou mon grand-père dans mon sommeil. Il n’y a pas de belles morts mais de moins cruelles que d’autres. J’en appelle à la miséricorde de Dieu.
Irène, je t’entends dire : « pourquoi n’as-tu rien dit ? On t’aurait soutenu. On t’aurait emmené à Paris ou New York consulter les meilleurs spécialistes. Là-bas, tu aurais bénéficié des derniers traitements. On t’aurait accompagné. On aurait… » Pour toutes ces raisons je n’ai rien dit. Pour que tu ne fasses rien. Pour que tu ne dises rien. Que tu ne soupires pas du matin au soir. Pour que tu ne pleures pas tous les dimanches en découpant le rôti. Tu as toujours donné, trop donné. Je ne voulais pas prendre davantage. Et puis entre nous Irène, ce que tu peux être agaçante quand tu te mets à vouloir le bien de quelqu’un et on connait les sales quarts d’heures que passe le malheureux. Alors chacun se protège à sa manière et où il peut. Moi c’était dans la tanière de mon bureau, comme le vieil ours que je suis.
À toi, Lucienne, je n’ai rien dit pour les raisons exactement inverses. J’ai eu peur de ce haussement d’épaules dont tu es coutumière et de ton silence qui semble me crier « démerde-toi vieux con ! C’est bien fait ! »
J’ai préféré nos habitudes à tout ce tohu-bohu qui somme toute n’aurait rien changé au cours des choses. Agissons seulement sur ce que l’on peut changer, le reste n’est que gesticulation.
Je vous écris aujourd’hui pour vous demander une faveur.
Je me suis résolu à écrire quelques pages concernant la résistance en Charente pendant la guerre et un éditeur de Poitiers me fait l’amitié de vouloir publier ce récit. Je n’ai accepté qu’à deux conditions expresses : de ne le faire qu’après ma mort et de recueillir votre autorisation. Toutefois, sans vouloir forcer votre jugement, j’aimerais que vous acceptiez. À la lecture vous comprendrez qu’il ne s’agit pas de glorifier mes faits d’armes ni d’abreuver quiconque de mes ressassements. J’ai seulement pour dessein de préciser ou corriger quelques faits et par là même restaurer quelques vérités moins plaisantes à la vue. Soyez assurées qu’en aucun cas, il s’agira d’un récit autobiographique. J’ai trop de pudeur pour cela et trop de défiance à l’égard de celui qui s’y compromet. Cet exercice m’est toujours apparu ridicule et il va sans dire que je voulais me garder de tomber dans ces radotages égotistes. J’ai tenté de ne pas ménager mon image. Toute guerre porte ses atrocités et génère ses propres monstres. Il lui faut des bras pour mener ses batailles et parmi d’autres, je fus l’un d’eux. Pour faire œuvre de vérité, il m’a fallu à mon corps défendant, que le privé éclaire le soldat. Je vous demande pardon de cette intrusion. Je l’ai voulue la plus légère possible mais elle me semblait nécessaire à la cohérence du tout.
De tous ces souvenirs, il ne resterait rien et j’ai éprouvé soudain un curieux sentiment d’urgence à les sauver du néant. Comme quelqu’un qui gratte les cendres de sa maison ravagée par un incendie avec l’espoir d’y retrouver les débris de sa vie passée. La mort, la vieillesse, la maladie sont passées et se sont éteintes les voix de mes compagnons. Il ne restera bientôt que quelques fumerolles de mémoire et quelques photos passées aux visages anonymes sur des silhouettes vidées de leur histoire qui finiront quelque part dans une benne à ordure après moi. Je n’ai pu me résoudre à les abandonner au vent avant d’avoir pu les saluer une dernière fois. J’ai assemblé comme je pouvais les petits morceaux que j’ai pu et même si le tricot final a plus de mailles à l’envers que de mailles à l’endroit, c’est tout de même un linceul.
Lorsqu’on est jeune, on a ni le temps ni le gout d’interroger sa préhistoire. Au mieux, on se dit qu’on le fera plus tard. Et le plus tard devient trop tard. Maintenant que mon cerveau se troue, je ne pourrai bientôt plus rassembler les fragments rabougris qui s’envolent au vent d’hiver. Je n’ai pas cherché à traquer la vérité coute que coute de la pointe d’un bistouri. J’ai fait confiance à la sagesse de la mémoire capable de ne restituer que ce qui est audible et utile à autrui. À défaut de garantir la vérité lavée à grande eau, je peux au moins certifier d’un propos authentique. Il m’est arrivé de me trouver face à des blancs lorsque la mémoire ne répondait plus à la manière d’un membre paralysé et il m’a fallu parfois colmater les trous. On pourra me faire le procès de l’approximation, mais non celui de l’insincérité.
Pour mener à bien le projet, je vous ai fait rentrer sur scène. Le moins possible toutefois. Comme ce premier septembre 44 qui fut une hécatombe. Dans les livres d’histoire, on voit des photos de la libération de Paris. Les jolies jeunes filles en amazone sur les ailes des camions embrassent leurs sauveurs. On pourrait presque entendre les chants de joie et de libération tellement la liesse exulte. Les rues sont noires de ce peuple qui pour une bonne partie a pourtant fait allégeance à l’ennemi, profitant de l’aubaine pour gonfler leur chaussette ou régler quelques ardoises avec un voisin ou cousin. Jamais la France n’aura autant écrit et envoyé de courriers immondes et anonymes à la Kommandantur. Cependant tout le monde chantait plus ou moins juste mais d’une seule voix la paix retrouvée.
Pendant que mes compagnons me faisaient sauter comme un sac, de bras en bras pour chanter la victoire, je ne pouvais chasser le regard implorant du petit Marcel chaviré de douleur et qui venait de comprendre qu’il venait de crever sur un bout de trottoir avant d’avoir aimé. C’est moi qui une semaine plus tôt l’avais asticoté pour qu’il vienne nous rejoindre au maquis. Il ne demandait rien Marcel. Ce qu’il voulait, c’était embrasser la petite fleuriste de la rue de Saintes et s’envoyer son canon de blanc après sa journée de mécano. Il se voyait vieillir peinard et sans doute l’aurait-il fait si la traction familiale n’avait pas coulé une bielle et si comme un croisé présomptueux, je n’avais pas voulu convertir le monde, et si… et si… Marcel me disait tout ça avec sa figure en bouillie et son œil de cyclope qui me fixait. Et le vieux Maurice qui tenait à peine sur ses jambes et que les Allemands avaient éclaté comme une pastèque et Antoine, battu à mort et laissé pour exemple rue Fontchaudière, les bras en croix, son regard de supplicié qui ne regardait plus rien. Je ne suis pas responsable de tous les morts bien entendu, mais de certains assurément. J’aurais pu dire non aux FFI, des gars que je connaissais à peine et qui étaient venus du Confolentais nous prêter main-forte. Il y avait un nommé Gaston. C’est lui qui menait les autres avec un air chafouin qui m’a rebuté dès le premier instant. Mais nous n’avions pas dormi depuis des jours. Nous étions ivres de sang, d’exaltation, de larmes. On se prenait pour des héros et quand ce petit groupe m’a embarqué pour rendre gorge aux salauds de collabos, je n’ai pas refusé. Je suis monté à l’arrière du camion. Il faisait chaud. J’étais serré contre mes compagnons. J’étais bien. On a roulé longtemps, enfin je crois car je me suis endormi sur une épaule. C’est le coup de frein qui m’a réveillé. On était sur une place de village. Il y avait des dentelles tendues sur une corde entre des châtaigniers et des tables avec des fleurs. Les villageois avaient entendu le camion arriver et les gens s’étaient rassemblés en groupe comme pour une photo. Et comme pour une photo, la mariée était au centre avec son voile blanc et son bouquet de roses entre ses gants blancs. Les gars ont sauté du camion en beuglant. Un d’entre eux, a attrapé la mariée à bras-le-corps et l’a embrassée sur la bouche. Un autre a gueulé : « faut pas te gêner mec » « tu nous en laisses un peu » a répliqué un autre. Ils l’ont poussée comme un chiffon de bras en bras en riant. Le marié, enfin je suppose que c’était le mari parce qu’il était le seul avec un œillet à la boutonnière, s’est interposé. Éberlué, il s’est affaissé sous une balle. Ensuite les choses sont allées très vite. Un d’entre eux a décroché une corde où pendaient les lampions pour le bal du soir. La mariée a poussé un hurlement sans fin que j’entends encore puis sa robe de tulle s’est balancée sur le bout de la branche comme une poupée de chiffon dans un théâtre de mort. Famille et invités, personne n’a fait un geste. Personne n’a dit un mot. Moi non plus. Le chafouin a pris un harmonica sur la table et durant le retour personne n’a parlé tandis qu’il a joué : « le petit vin blanc » « la Madelon » et autres chansons à boire. Il faisait nuit quand ils m’ont déposé Place Mulac. J’ai marché comme un pantin, les quatre cents mètres qui me séparaient du manoir. Je me suis accoudé au parapet pour vomir encore et encore et pleurer aussi. Sur Marcel, sur Pierre, sur la petite mariée et tous les autres et surtout j’ai pleuré de dégoût de moi-même.
Quand je suis rentré, tu étais née Irène. Ma petite fille. Je sentais le sang, la sueur et la mort et je n’ai pu ni voulu te prendre dans mes bras. Tu agitais tes petits poings et tu hurlais, violette de colère. Irène déjà si décidée ! Je me suis étendu près de Jeanne, douce Jeanne. J’ai blotti mon visage contre son cou où la peau est si douce. Elle sentait la vanille. Et je suis resté longtemps sans parler. Je n’avais pas de mots pour l’horreur, le bonheur et toutes les émotions mélangées jusqu’à la nausée. Mais tu ne peux pas savoir combien j’étais heureux de ta naissance.
Cette sale guerre a tout miné. Ma rencontre avec ma fille. Ma relation avec Jeanne. Mon attachement à mon père. Je suis parti jeune et candide pour cette bataille héroïque et c’est un vieillard sans illusion qui en est revenu.
Nous avions dû quitter le manoir réquisitionné par les Allemands pour y installer leur état-major si bien que nous dûmes nous installer chez mes parents au châtelet. Nous étions juste mariés avec Jeanne et tout de suite les relations avec ma mère et ma sœur Paulette ont été compliquées et la promiscuité difficile à supporter pour votre mère soumise aux regards permanents et aux reproches de sa belle-famille. Je pensais qu’il s’agissait d’histoires de femmes sans importance dont il valait mieux se tenir à l’écart. Par lâcheté, j’ai préféré passer au large pour avoir la paix. Jeanne ne s’est pas plainte mais je crois qu’elle a souffert autant de mes silences que des méchancetés subies.
Heureusement, quelques mois plus tard, les Allemands ont fait leurs cartons pour emménager à L’Houmeau, de l’autre côté du fleuve. Nous nous sommes tant réjouis de ce retour chez nous et de retrouver notre intimité au manoir. Jeanne était si heureuse. Elle raccrochait aux murs ses tableaux et ses tentures aux fenêtres, faisait briller les commodes et elle avait installé dans les combles son petit atelier de dessin et de peinture. Elle avait tant de talent. D’ailleurs elle avait tous les talents. Malgré la guerre, ces semaines furent des semaines de bonheur. Elle refusait de se faire aider par le père Arnoult, homme à tout faire du manoir. Vous vous souvenez de lui peut-être ? Elle disait qu’il puait tellement que les chevaux se bouchaient le nez quand il passait près d’eux. C’était le frère de Mamé ! Ou son cousin ! Mes souvenirs s’emmêlent ! Quoi qu’il en soit, Jeanne s’amusait de tout et rayonnait. Elle te faisait danser et toi Irène encore bébé, tu riais aux éclats en te trémoussant. J’étais heureux aussi. Elle m’enjoignait de venir valser mais trop empoté, je me contentais de vous regarder, assis sur la bergère. Pour ma défense, je n’avais pas été élevé de la sorte. Je ne savais pas tournoyer pour dire mon bonheur. Je savais seulement rester piqué sur une bergère, raide et sourire rentré. Parce que je ne savais pas sourire non plus. Encore moins rire. « Mais viens, Emile, viens donc danser. » Jeanne riait. Mais comme pris en faute, je me sauvais vers des tâches plus convenables.
L’usine tournait à pleines turbines. Mon père fit l’acquisition de deux nouvelles machines qui arrivèrent de Pologne. Elles débitaient le papier tellement vite qu’elles remplacèrent une vingtaine d’ouvrières.
« Si on ne va pas de l’avant, on recule. Souviens-toi de ça, fils » disait-il.
À vingt-deux ans, j’avais déjà la responsabilité de la comptabilité. Mon père, lui, s’occupait de la production et des relations commerciales. Je ne me mêlais jamais de son périmètre mais lui supervisait toutes mes décisions. C’est un jour qu’il s’était absenté pour la signature d’un contrat juteux qu’un gradé allemand s’est présenté. Il souhaitait parler à mon père et avait été contrarié de son absence.
« C’est très urgent et de la première importance » ajouta-t-il. « Il nous faudrait au plus vite dix mille exemplaires supplémentaires de ce texte en affiche A6. Avec exactement les mêmes gravures en arrière-fond. Votre père avait réalisé un très bon travail, monsieur Marsignac et le commandant était très satisfait du résultat mais nous avions vu trop petit. Il nous faut la livraison impérativement en fin de semaine. Bien le respect à monsieur votre père. »
Sur ce, il claqua les talons, remit sa casquette, fit le salut hitlérien et à grandes enjambées rejoignit sa voiture dont son aide de camp avait déjà fait chauffer le moteur.
Je reconnus immédiatement ces affichettes placardées dans toute la ville appelant tout bon chrétien à dénoncer tout mauvais juif. En fond de page, on distinguait un vautour piquant sur un joli lapin blanc qui essayait de se sauver. Bien que je me tienne à l’écart de tous les événements, j’avais été choqué par cette campagne de propagande plus virulente encore que la précédente, mais en même temps, baigné depuis toujours dans la gloire de Pétain, je ne me posais que peu de questions. Des juifs, bien entendu, on en connaissait. Monsieur Cohen, par exemple et on ne pouvait pas dire que le pauvre homme roulait sur l’or avec sa ribambelle de mômes. Il s’échinait du matin au soir, sans faire d’histoires, ni rien demander à personne. Les youpins dont il était question n’avaient rien à voir avec monsieur Cohen, l’épicier de la rue de Saintes ni avec le garagiste du port L’Houmeau, ni avec le banquier à petite moustache que je saluais chaque jour. Quant à ces histoires de camps que personne n’avait jamais vus et dont personne n’était revenu, elles n’étaient selon mon père qu’inventions de communistes et de francs-maçons.
Cette commande portant le cachet officiel du troisième Reich allemand que je tenais entre les mains, soudain me fit horreur. Ainsi, c’était notre usine qui éditait ces abominations ! Notre usine à la botte de la propagande nazie ! Je réalisais du même coup que mon père dont je n’avais jamais remis en cause ni l’autorité, ni la parole était un… Je ne pouvais pas prononcer le mot, même dans le silence de ma tête. Par réflexe, je froissais le modèle ignoble qui me brulait. Comment avais-je pu croire ? Comment n’avais-je pas vu ?
Comment ne pas comprendre tous ces va-et-vient d’uniformes médaillés et de voitures rutilantes. ? Que dire aussi de nos garde-manger regorgeant de denrées devenues introuvables. Pourquoi cette méfiance de la part de mes amis ? Pourquoi ces conversations interrompues soudainement lorsque j’entrais dans une pièce ? Tout s’éclairait. Pierre, mon ami, mon frère qui faisait désormais un détour pour éviter de me serrer la main ou me casser la gueule. Pierre avec qui j’avais tout partagé : les jeux d’enfant, la première hostie, les premières confidences et toutes les premières fois de notre jeune vie. Pierre qui maintenant détournait la tête à mon passage. Pierre, le mari de Mamé que je n’ai pu sauver.
Le soir, la scène qui m’opposa à mon père fut d’une rare violence. Loin de nier son commerce avec l’occupant il le revendiqua et je compris qu’au-delà d’une accointance d’affaires, il s’agissait plus encore d’une concorde d’idées. Tout y passa : Pétain sauveur de la patrie, la décadence de la France, le besoin d’ordre et la fin justifiant les moyens. « De plus, jusqu’à preuve du contraire, tu ne rechignes pas de mettre de l’essence dans ta voiture ou une entrecôte dans ton assiette. Alors ne prends pas des grands airs s’il te plait ! Et sache, mon petit vieux, qu’on ne doit pas cracher dans la soupe que l’on mange, ni mordre la main qui vous nourrit ! » me jeta-t-il à la figure d’un air de mépris.
Nous parlions tous les deux en même temps, nos voix et nos cris se superposaient sans s’entendre. Il fixait la cheminée et me tournait le dos et c’est peut-être pour ça que pour la première fois j’osais défier mon père. Je n’avais pas été moulé pour la révolte mais pour assurer un continuum de convictions passées de génération en génération comme les aubes de baptême. J’aimais mon père et je le respectais parce que c’était lui et que c’était ainsi mais à cet instant, je sentais que ce monde sans questions s’écroulait, que je ne pouvais plus l’aimer sans conditions. Pour la première fois, je le trouvais laid. Trop grand, trop maigre, trop chauve. Et pour la première fois, je n’eus plus peur de lui et de son regard condescendant me renvoyant à mes inconséquences. Je me mis à grandir d’un coup ce soir-là dans le salon bleu tandis qu’Edouard Marsignac rapetissait et relevait le menton dans une dernière tentative pour impressionner son fils.
Ma mère, attirée par nos vociférations, entra en trombe. Elle nous regardait tour à tour sans comprendre et sans savoir vers qui porter ses soutiens ou ses accusations. Quelques instants, l’incertitude dansa dans ses prunelles. Son mari ou son fils, son fils ou son mari. Edouard remporta l’alliance.
« Tu devrais avoir honte de parler de la sorte à ton père. Regarde dans quel état, tu l’as mis ? Tu ne parles pas ainsi à celui auquel tu dois tout ! Fais-lui tes excuses immédiatement ! C’est un ordre ! »
Mon père s’épongea les rides dans un grand mouchoir à carreaux dans lequel il finit de souffler si fort que de cramoisi, il vira au violet puis il s’écroula dans le fauteuil crapaud. Ma mère se précipita sur lui pour le ventiler et j’en profitai pour prendre la porte.
Malgré les apparences ma mère m’aimait comme elle aimait ma sœur Paulette. Personne ne peut en douter mais j’étais l’héritier, celui qu’il fallait forger et plier. Elle m’aimait avec dureté, sans effervescence jugée vulgaire et juste bonne à amollir le caractère. Elle soignait ma force, mon ambition et ma vanité sans démonstrations de sensibleries. Ma mère voulait faire de moi un homme et m’éduquait en homme. Elle défendait d’ailleurs haut et fort la suprématie masculine et revendiquait pour ses congénères ce statut d’incapable au sens juridique et moral dans lequel elles étaient encore confinées. Elle criait sur tous les toits que la France était perdue corps et âme si les femmes qui n’entendaient rien à la politique se mettaient à voter pour tout et n’importe qui. Marie de Marsignac mère d’Emile, associée d’Edouard, fille de jésus, gouvernante du manoir, tous ces titres ne lui laissaient ni le loisir ni l’envie d’être une femme. Elle n’appartenait à aucun sexe et n’avait en conséquence aucun combat de femme à mener. J’ai toujours vu mon père occuper la chambre côté jardin et ma mère côté fleuve. S’ils ne furent pas toujours d’accord sur les détails, au moins le furent-ils sur l’essentiel. Elle régnait sur son royaume, commandait ses servantes terrorisées, marchandait comme un maquignon le prix du jambon avec ses fournisseurs, se faisait faire trois robes par an, à Noël, à Pâques et à L’Assomption, regrettait la monarchie et allait à l’office deux fois par semaine. Elle donnait un diner chaque jeudi soir ce qui lui mettait les nerfs à vif dès le lundi matin. Ces soirs de réception, à vingt heures précises, elle nous faisait entrer, Paulette et moi pour saluer le procureur, le notaire, le médecin et quelques industriels et financiers. Les dames nous félicitaient de notre bonne mine, en nous tapotant le haut du crâne ou en nous pinçant les joues. Après ce tour de cirque, ma mère, d’un geste discret nous faisait signe de décamper ce que je faisais sans demander mon reste. Ma sœur aimait ces réceptions que j’avais en horreur. Puis j’enlevais mon costume de lumière et filais au lit sans autre forme de procès. Le lendemain, j’avais droit aux choux à la crème quand il en restait et à la migraine de ma mère qui ne me voulait pas dans ses jambes et il me fallait raser les murs. J’ai compris bien plus tard combien ces mondanités coutaient à ma mère. D’origine modeste, elle avait dû apprendre sans modèle les codes qu’elle ignorait et ses maladresses du début lui avaient causé quelques humiliations dont elle ne s’était jamais remise. Si bien qu’elle voulait ses repas du jeudi d’une perfection absolue et nous faisions partie du décorum aussi surement que les bouquets tous raides qui pavoisaient la table du souper. En écrivant ces lignes, je me rends compte combien je sais peu de choses de ce qu’ils furent l’un pour l’autre. Je n’ai jamais su si ma mère avait souffert du départ de sa fille ainée morte à dix ans d’un banal accident de charrette. Elle n’en parlait jamais. Mon père pas davantage. Comme si elle n’avait jamais vécu. N’eussent été les dates sur le tombeau familial du cimetière de Bardines qui attestait de sa réalité, on aurait pu douter de cette existence avalée par le silence et je répétais pour moi-même son nom tracé en lettres gothiques : Odette Marsignac 1912-1922. Si mes parents l’ont pleurée et sans doute l’ont-ils fait, leur chagrin fut vécu dans le secret de leur intimité. Ce fut par l’indiscrétion d’une servante que j’appris du même coup sa vie et sa mort. Ma mère que j’interrogeais, se contenta de me répondre sans lever les yeux de son ouvrage. « Dieu a rappelé à lui Odette. Béni soit-il. » Sur ce elle m’avait renvoyé à mes amusements. À cette époque je fus pris de cauchemars terrifiants. Je réveillais toute la maison par mes hurlements chaque nuit et je me mis à remouiller mon lit. Mon père jugeant ces enfantillages indignes s’évertua de me remettre dans le droit chemin à coups de ceinture chaque fois que je souillais mes draps, ce que je fis jusqu’à ma dixième année au moins deux fois par semaine. Ma mère parfois tenta de prendre ma défense mais devant la colère de son époux qui ne voulait pas de poules mouillées sous son toit, elle capitulait en me demandant d’y mettre du mien et de cesser de faire enrager mon père. Personne évidemment ne fit le lien entre les deux évènements. Petit garçon, j’avais été terrifié à l’idée de disparaitre sans traces, dans l’indifférence la plus totale. Devant l’explication pseudopsymachin d’un ami, je m’étais contenté de hausser les épaules à ses baragouinages. Balivernes que ce charlatanisme ! Aujourd’hui, je regarde d’un œil plus distancé l’éducation qui me fut donnée. Elle fut certes un peu rude mais sans doute mon père aura voulu casser un caractère trop enclin à la rêverie. Quant à votre grand-mère si elle ne s’en laissait pas conter, c’était une femme honnête et pieuse. Je regrette que Jeanne et elle ne se soient pas mieux accordées. Oui, c’est un vrai regret.
Ainsi ce différend avec mon père était-il le premier. Personne et moi, pas plus que quiconque ne s’avisait à s’opposer à ses décisions. Alors pourquoi ce jour-là ? Par idéologie ? Par conscience ? Un peu de tout ça. Mais surtout, parce que soudain, je me voyais à travers le regard de Pierre mon ami. Je me voyais là, assis sur mes fesses dans mes pantalons taillés sur mesure, déjà un peu gras de toutes ces cochonnailles. Je me voyais silencieux alors que les gens disparaissaient soudainement. Des jeunes, des enfants, des vieux. Je me voyais tel que j’étais : sourd et lâche. Et soudain j’eus honte. Je voulais retrouver Pierre. Je voulais qu’il me tape dans le dos comme avant. Et peut-être aussi voulais-je dire merde à mon père. Au moins une fois.
Alors je suis allé voir Pierre dans sa petite maison sur les coteaux de Fléac. Il m’a écouté goguenard, d’abord suspicieux puis peu à peu, j’ai senti sa confiance revenir. Et j’aurais affronté tous les dangers, eu tous les courages pour ce moment de grâce où comme avant il m’a tapé dans le dos. C’est ainsi que j’ai rejoint le maquis dont il était un membre actif. Je m’appelais désormais Renaud et deviendrais bientôt le colonel Renaud.
Je sais que mon modeste témoignage concernant ces années noires écornera l’image du nom de Marsignac et en flétrira d’autres. C’est pourquoi, je m’en remets à vous pour décider quelle suite vous voulez y donner. Je sais Irène combien tu es fière de ce paronyme et toi Lucienne, même si tu le détestes, néanmoins tu le portes.
Je n’ai pas su le dire, encore moins le montrer mais sachez mes chères petites filles combien je vous ai aimées et combien je vous aime. Bientôt, la maladie aura tout enseveli et au milieu de ces décombres, je laisse chez le notaire, deux modestes ouvrages : Celui qui concerne la guerre et un autre manuscrit que par vanité, je n’ai pu me résoudre à détruire. Il s’agit d’un roman et son écriture m’a rempli de joie et m’a guéri de bien des peines. J’aurais tant aimé consacrer ma vie à l’écriture mais le destin m’avait programmé pour un autre labeur. C’est ainsi !
Mes chères filles, je m’en remets à vous pour donner à cette prose la suite qu’elle mérite.
Je vous aime.
Papa
SAINT-CYBARD. 1994
Quand Irène prend une décision, elle la met à exécution immédiatement. C’est son côté militaire. Elle en a aussi le vocabulaire. Elle s’exprime en stratégies, en situation de repli, en plan B et autres expressions qu’elle a héritées du vieux. Elle lance volontiers la cavalerie et les fantassins au moindre problème, mène sa vie au pas de charge et aurait tendance à mener celle des autres et la mienne à la même cadence.
Pour lui résister, il faut faire le mort. C’est ce que je fais. J’ai coupé la sonnerie de mon téléphone et débranché la sonnette de ma maison. Il faut se méfier toutefois et savoir doser ses absences car l’an dernier, inquiète de mon silence prolongé, elle avait appelé police et pompiers qui avaient massacré la porte au bélier pour rentrer chez moi alors que j’étais tranquillement sur l’île de Ré.
Elle s’était excusée mollement, certaine au fond d’elle-même qu’elle avait pris la meilleure décision qui fût.
« C’est qu’avec toi on ne sait jamais ! Alors, je m’inquiète, c’est normal ! »
Elle n’a pas tout à fait tort et il me faut admettre qu’elle est arrivée parfois alors que j’étais en mauvaise position.
Elle a déjà saturé mon répondeur de messages qui évoluent de la supplique à la menace. En gros elle répète sur tous les tons que nous devons trouver une maison de retraite pour Papa. Et elle me prie instamment de lui répondre sinon, sinon… ça, elle ne le dit pas. Alors je finis par rappeler.
« Enfin !… Mais qu’est-ce que tu fais ? ? » Et de répéter l’objet de son harcèlement. Ce qu’elle me fatigue ! Je ne suis jamais dans le même tempo. Si je prends une décision, je la laisse murir. Pourrir, dirait-elle et souvent ce qui était urgent devient accessoire puis inutile. Il suffit d’attendre. Je ne prétends pas que c’est mieux, je dis que c’est ainsi. « C’est de l’inconséquence ma pauvre Lucienne. » Ah oui je ne vous ai pas dit quand tout va bien je suis Lulu, et quand je déconne, je suis Lucienne.
« Alors tu es libre demain pour les visites des maisons de retraite ? »
Va pour demain.
On s’est tapé cinq visites en une journée. Irène, méthodique comme d’habitude, avait organisé un circuit en cercles concentriques et établi une liste de critères préremplis avec des cases à cocher. Propreté. Accueil. Soins. Restauration. Etc. etc. Malgré tout, elle fut débordée. À la fin de la journée, avec cinq kilos de documentations sur papiers glacés, étalés sur nos genoux, on ne savait plus qui était où et quand. Tout se mélangeait. Les lys, les iris, les pivoines, les bleuets, le rayon de lune ou le soleil d’automne. Elles avaient toutes la même odeur, les mêmes couleurs et les mêmes vieux qui dodassaient bouches pendantes sur leurs fauteuils à roulettes.
Brushing avachi, Irène s’écroula sur une chaise.
« On ne peut tout de même pas le mettre dans un de ces mouroirs ! Après tout ce qu’il a fait pour nous, on a le devoir de lui donner une fin de vie digne ! »
« Et qu’a-t-il fait pour nous ? »
« Tu ne vas pas recommencer avec ces vieilles histoires. Il a fait ce qu’il a pu, c’est tout ! »
Je ne veux pas me disputer avec Irène et me lancer dans ces sempiternelles discussions qui à la manière des toupies, tournent sur elles-mêmes.
« Qu’est qu’on fait alors ? »
Pour une fois, elle ne sait pas.
Je suggère mollement : « On va continuer à chercher ! J’ai entendu dire qu’un établissement venait de s’ouvrir du côté de Cognac. Un ancien château restauré avec un grand parc. Un machin de luxe parait-il. »
« On y va dès demain ! Je passe te chercher à neuf heures et on file » dit Irène qui avait regonflé son énergie.
« Pour le prix en revanche, je crois savoir que c’est, très, très cher » risquais-je pour tempérer son enthousiasme.
« On se débrouillera ! »
« On se débrouillera comment ? Tu sais bien que je n’ai pas un rond et que je ne peux pas payer une grosse somme tous les mois. À moins qu’on vende le manoir ! »
« Tu es complètement folle. Vendre le manoir ! Il est dans la famille depuis plus de deux cents ans. Tu déraisonnes ma parole ! Qu’est-ce qu’il dirait papa ? Tu y as pensé à ça ? »