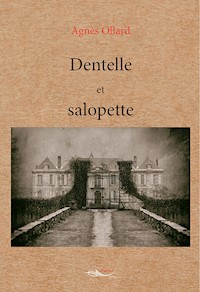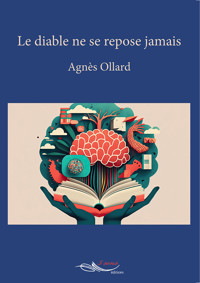
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À Rochebrune, au sein de la belle demeure ancestrale, la famille Forestier vit ses amours et ses conflits sous l’œil souverain de Malinette, la grand-mère et de son fils bien aimé, le grand Max. Une photo de famille idéale. Mais Alex, l’ainée des filles va recevoir une série de lettres anonymes dans lesquelles plusieurs femmes témoignent de leur douleur quand leurs vies sont soudainement percutées par les bouleversements du siècle et la fureur des guerres. Qui sont ces femmes ? Que veulent-elles ? Qu’ont-elles à voir avec les Forestier ? Il va falloir un drame pour que des morceaux de vérités surgissent des mémoires.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Agnès Ollard est née en 1954 à Angoulême en Charente où elle réside toujours. Elle écrit son premier roman
La chaise rose de Virgile (Editions Spinelle) en 2020. Puis publie un second livre
Dentelle et salopette (Editions 5 sens) en 2021. Elle signe avec
Le diable ne se repose jamais son troisième roman. Des romans sur la fatalité et l’âpreté du monde venant bousculer des vies ordinaires, des mises en récits pour capter la complexité des âmes et des mises en mots pour exprimer l’indicible. L’écriture acérée d’
Agnès Ollard, marquée de ruptures entre violence, poésie et humour vient renforcer, s’il en est encore besoin, les paradoxes des êtres. Ce dernier récit qui met en scène des personnages profonds et fragiles, entraîne le lecteur et bouscule son émotion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agnès Ollard
Le diable ne se repose jamais
Pour Cloclo
Jeudi 21 juin 2001.
Ma Paula, mon amie,
Je vais écrire cette histoire.
Quel titre portera-t-elle ? La douleur des guerres ? La défaite des femmes ?
Elle pourrait aussi s’appeler la chaise ou la chaise d’en face ou encore la chaise d’à côté. Car c’est souvent assis sur une chaise qu’on regarde les astres, qu’on veille ses morts, qu’on apprend à lire et qu’on attend le facteur ou le destin.
C’est assise à mon bureau que je vais commencer cette histoire aujourd’hui.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Max. On ne le fête pas. On ne le fête plus. Depuis cette histoire.
Pour mieux la raconter, je me suis installée à Sauvaitre, dans ce petit village, près de Rochebrune. La maison que j’ai louée est nichée à flanc de coteaux et au-delà la fenêtre, je peux voir les étangs en contrebas et même apercevoir un héron en tapinois derrière les joncs. Oui, je vais écrire cette histoire.
Un an plus tôt
Mercredi 1er mars 2000.
Ma Paula,
Pardonne ce long silence, mais il me fallait absolument terminer ce roman afin de l’envoyer à quelques éditeurs. Pourquoi ce besoin impérieux et cette urgence vaine ? Pourquoi vouloir lancer tous ces mots à la mer sans personne pour les pêcher, pourquoi vouloir faire vivre quelques pauvres héros morts avant que d’être aimés, morts de n’être pas aimés ? Et toutes ces natures mortes peintes pour le néant et tous ces récits momifiés avant la première phrase, tous ces levers de soleil sur un désert aride et ces beaux sentiments à ranger au grenier. Je conviens de l’absurde et la vanité de cette tentative et parfois, il me prend l’irrésistible désir de me coucher sur le bord d’un fossé tant je suis fatiguée de ces longues marches verbeuses au bout desquelles personne ne m’attend pour une respiration. Autour de moi aussi, c’est silence. Paula, est-on toujours si seul au milieu de ses rêves ?
Le plus souvent, Pascal rentre de son cabinet, d’une humeur maussade et remplit nos silences par les misères de ses malades avant de s’assoupir, bouche ouverte, en milieu de canapé. Je le trouve laid. Je le regarde, étranger à lui-même, étranger à ce qu’il fut. Pascal, mon amour qui traversait la vie à grandes enjambées, qui riait fort et qui d’un mouvement vif, redressait la boucle noire qui lui barrait les yeux. Pascal l’insouciant et l’enchanteur Pascal. Ce soir, il parait vieux, alourdi d’une cinquantaine trop bien nourrie, trop mal bouffie. Et la mienne, qu’est-elle devenue ? Serait-elle aussi moche en plus d’être méchante ? Je m’en veux.
Tout à l’heure, nous nous sommes cherché chicanes sans raison, sauf à être nous, misérablement nous. De fil en aiguille, nous nous sommes jeté un tas de guenilles à la figure comme des oripeaux de fin d’amour. Puis il a boudé pendant que je marmonnais dans mes casseroles et enfin, parce qu’il fallait bien manger, nous avons mâchonné des excuses du bout des lèvres, retenant par un fil, les mots accrochés à nos pensées. Ils se sont tenus tranquilles, sagement en retrait comme des amis qui assistent à une scène de ménage et la bouclent par peur de jeter de l’huile sur le feu.
Je déteste ce que nous sommes. Maintenant Pascal somnole bouche ouverte sur le canapé et je le trouve laid. Nous étions beaux de vie et d’amour et sans que nous y prissions garde, la vie comme une souris nous a grignotés et recrachés laids et vieux. Maintenant nous voici deux vieux cons dans un couple de vieux cons.
Je dois avouer en toute sincérité que je suis à fleur de peau par la faute de ces fichus romans et plus encore de ce dernier roman ; et ces milliers de mots, qui me prennent mes jours et ma peau et mon sang sans un signe en retour. Un impossible amour. Et sais-tu, que je le vois dès le dernier mot posé, tel qu’il est, bancal et méprisable. Un maquereau suffisant et bavard. Voilà tout. Médiocre comme moi, comme tout ce que je fais et, en creux, tout ce que je suis. Pour éviter la vérité, je ne peux m’empêcher de rendre Pascal, responsable de mes naufrages. Parce qu’il est lui, parce qu’il est là. En toute injustice, je me noie et c’est lui qui prend l’eau. Lassé, il ne fait plus semblant de me soutenir, se contentant de me renvoyer distraitement à mes amusements comme on renvoie un enfant à ses pâtés de sable. Cette fois, il n’a demandé ni le titre, ni le thème de ce bouquin. C’est te dire ! Devant mes doutes ressassés, il s’est contenté d’un laconique : « L’important, c’est de te faire plaisir. » Comme si je pratiquais la masturbation ou le tricotin. Ils disent tous la même chose, même les moins cons et il me prend l’envie de les étrangler tous. D’ailleurs, j’y pense, le premier qui redit pareille ânerie, je l’étrangle et tous les autres suivront aussi. Il y aura alentour un grand champ d’étranglés. L’écrivain est belliqueux à défaut d’être talentueux. Heureusement que tu es là, sinon…
Comme il est impudique d’avouer que l’on écrit. Sans être publié, comme tu ne peux te prétendre écrivain, tu passes pour un raté ou un hurluberlu ou les deux à la fois. Les gens changent de conversation et se détournent gênés, comme si prise de folie, tu voulais te mettre à poil au milieu du salon. Tous ont cet imperceptible recul, même les plus intimes. Ensuite ils ne t’en reparlent plus, ne te demandent pas si tu progresses, si tu en baves des ronds de chapeaux et personne ne propose de lire ta prose. Le pire sont les rares à qui tu as tendu ton manuscrit, gênée et éperdue. « Tu me diras sincèrement ce que tu en penses ? » Ils tentent de fourrer ce machin encombrant dans leur sac et se disent « Mince alors, il fallait que ça tombe sur moi ! » Ils sourient faussement et soudainement pressés, ils filent leur chemin. Tu te retrouves bras ballants parce que tu n’as pas pu, ni su vendre tes mots. Ensuite viennent l’attente et le silence car tu n’oses pas relancer. C’est perdu, t’est foutu ! Fichtrement seule au milieu de ta prose. Et pourtant, le plus douloureux reste à venir. Recommencer. Et savoir que sans doute, toute cette douleur sera, pour rien, ni pour personne. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas vivre sans scribouiller comme je ne peux pas vivre sans respirer. Je ne peux pas.
Ai-je eu raison de quitter mes élèves pour me mettre sous le diktat de ce maître implacable ? Faut-il toucher le fond de cette solitude pour mener ce travail de forçat ? Mais pour une fulgurance de bonheur à nul autre pareil, je consens et me plie. Il n’y a que toi, ma Paula pour m’encourager et me retenir in extrémis quand il me prend l’envie de lancer ma plume par la fenêtre et m’accrocher à ses ailes pour m’envoler aussi.
Je n’en parle plus et Pascal non plus. Une non-question dans un consensus mou. Mon fils, Paul me pose parfois une question comme une politesse dont on n’attend pas la réponse. Une sorte de « comment va automatique » qui se suffit à elle-même. Puis père et fils, médecin et médecin, se calent sur les fauteuils pour parler boutique. Paul, en ce moment, a entrepris une étude de grande envergure sur les ilots de Langerhans. Ne va pas penser comme moi, pauvre ignare, qu’il s’agit d’une contrée inconnue. Ils sourient, indulgents à mon ignorance. Non, c’est une petite glande qui emplit nos soirées de l’entrée au café que je sers à mes deux mandarins. Ils sont heureux l’un de l’autre et moi par ricochet, je suis heureuse aussi.
Voilà, où j’en étais de mes ruminations hier, quand la femme de ménage de ma grand-mère a appelé pour nous prévenir qu’elle l’avait trouvée dans une mare de sang, en bas de l’escalier. Les portables, tu t’en doutes, ont sonné leurs fanfares et toute la troupe a foncé à la clinique où elle venait d’être admise en urgence. Nous avons couru dans les couloirs, attendu devant des portes interdites au public, guetté des blouses blanches masquées pour leur expliquer que nous ne faisions pas partie du public mais voilà, désolées, elles ne pouvaient rien dire pour l’instant et elles continuaient à rouler leurs chariots. Enfin après un long dédale de couloirs, la porte de la chambre 122 s’est ouverte. Notre Malinette était là. Elle reposait épanouie comme une sultane, le crâne enrubanné de bandes Velpo, retenues par un drôle de filet blanc et bleu attaché au sommet.
« 18 points de suture ! » fanfaronna la vieille dame comme si elle venait de gagner un concours. On a rigolé ! Les On, c’est moi, Pascal et Véro. Max était déjà dans la chambre et a commencé à nous engueuler avant même la porte refermée. Il nous a rendus responsables de tout et en particulier de cette chute et de toutes celles à venir. Nous sommes restés sans voix. « Il faut dire qu’à ton âge Malinette, ce n’est pas prudent de rester toute seule à Rochebrune » ont dit les lèche-culs réunis. Les lèche-culs sont toujours Pascal, Véro et moi. Devant notre reddition, Max a cessé se tourner autour du lit comme un jaguar. « Je n’ai pas encore 80 ans, tout de même » a soutenu Malinette.
Personne ne la contredit. À plus de 82 ans, elle persiste à vouloir vivre dans cette grande baraque glaciale, isolée sur son piton où le vent d’hiver siffle jusque sous les édredons. Son fils, le grand Max, mon père qui terrifie tout le monde, que personne ne contrarie, qui jette des ordres comme d’autres balancent des claques, même lui n’y peut rien. Notre Malinette veut rester vivre là-bas et contempler le monde du haut de son rocher. La seule concession, consentie de mauvaise grâce, fut la présence d’une femme de ménage, deux heures chaque matin et à part envoyer l’armée pour la déloger, rien, ni personne, ni même Max n’y peuvent rien changer. Ses aïeux sont nés là-bas, sont morts là-bas, elle est y née et veut y mourir aussi. Point final. Fin de discussion. Elle détourne son joli visage.
Évidemment, nous sommes consternés. Mon père et sa femme Véro se tiennent raides au pied du lit. En geste d’apaisement, elle pose la main sur son bras mais impatient, il lève le coude pour se dégager. Pascal se fait petit dans un coin de mur, ce qui ne le grandit pas à mes yeux. Mais pour comprendre cette capitulation, il faut intercepter le mépris du grand chirurgien à l’encontre de son gendre, vulgaire généraliste, juste bon à soigner une angine. Et encore. Il l’écrase de sa haute stature et soupire avec condescendance. C’est pourquoi Pascal se fait minuscule dans son coin, et je voudrais qu’il se redresse et qu’il…
Heureusement, Paul, mon petit Paul, mon grand fils est arrivé. Et soudain, tout s’est dégrippé. Il est entré et tout s’est décoincé. Tout le monde s’est remis à bouger, à parler, à respirer. Max a souri, s’est avancé d’un pas et a ouvert les bras pour l’embrasser. Comme ils se ressemblent. Mêmes traits abrupts, même menton carré, même regard bleu marine avec l’arcade droite qui se relève avec nervosité. Des jumeaux dont l’un des deux aurait soudainement vieilli durant la nuit. En effet, Max s’est légèrement tassé ces derniers mois, ce qu’il compense par un surcroît de raideur mais devant le lit de Malinette, soumis, il baisse la garde. Malinette radieuse, s’entête. Il insiste pour la forme. « Maman, tu vois bien que tu ne peux plus rester seule à Rochebrune. » En réponse, Malinette offre un sourire si ingénu, qu’il s’incline vaincu. C’est Véro qui essuiera ses humeurs. « Ma pauvre Véro… » dira-t-il avec une vacherie en bout de phrase. Je le déteste parfois mais j’en veux également à Véro de ses renoncements et de ses soumissions. Entre l’humiliant et l’humilié, je ne sais plus qui combattre, qui défendre et après tout je ne vais pas dénier à Véro la force de se révolter. Dans cette histoire cent fois rejouée, les bourreaux, les victimes, je les confonds parfois. Qu’ils se débrouillent. D’ailleurs ils se débrouillent. Mieux que moi.
L’attente fut longue et silencieuse pour ne pas fatiguer Malinette. Les murs de cette chambre d’hôpital nous étouffaient. Collés peaux contre peaux, nous sentions nos souffles, nos odeurs, nos crispations, gênés de cette intimité irrespirable. Lorsque d’ordinaire, nous nous retrouvons à Rochebrune, les pièces immenses, nous laissent libres de ne pas nous toucher, de ne pas nous croiser et même de nous ignorer. Là-bas, sous les peupliers, dorment les étangs aux couleurs changeantes au gré de nos humeurs, où l’on peut se cacher, se taire ou bien pleurer. Nous pouvons être ensemble et ailleurs à la fois et nous-mêmes parfois. Ici, dans cette chambre surchauffée, il était impossible d’échapper au regard de l’autre qui toujours se posait, s’enfuyait mais toujours revenait, capturait. Pascal a essayé vainement d’entrouvrir la fenêtre. Il secouait la poignée, s’énervait et Max a haussé les épaules. On transpirait.
Quelqu’un a demandé : « Est-ce qu’on a pensé à prévenir les autres ? »
Tu devineras que les autres sont ma sœur Léa et mon petit frère Julien.
La « pauvre » Véro s’est excusée de ne pas…
Et Malinette s’est endormie ou plutôt a feint de s’endormir pour éviter une scène. Tendre Malinette qui câline et apaise pour nous avoir heureux blottis autour elle. Si bien, que silencieux pour protéger son repos, on s’est aplatis contre les murs.
Puis, Julien est arrivé mal à propos selon son habitude.
« Salut ! » a-t-il lancé.
Personne n’a répondu. Il a fixé Max. Que la situation fût légère ou bien grave, il faut qu’il nargue son père, arborant à ses lèvres, une sorte de rictus, qui se fout de la gueule du monde. C’est quoi, Paula ? Une provocation, une déclaration de guerre, une posture de prestance ou bien tout à la fois ? C’est tellement absurde pour qui connait la douceur de Julien. En la circonstance, il arborait, un débardeur kaki-kaka qui dénudait des tatouages multicolores en forme de boléro comme en portent les toréros. Max qui se veut impassible, a tout de même cillé et j’ai croisé le désarroi étonné de son regard. Malinette a émis un couinement en se bouchant les yeux de ses aigues-marines. Paula, ce que j’écris lentement n’a duré qu’une fraction de seconde tout au plus, le temps de se reprendre, de reprendre son rôle.
« Alors, fiston, on a sorti ses gribouillages ? »
Julien rougit violemment piquant un sourire arrogant au milieu d’une bouche qui se contracta violemment. Mais son arrogance est si abattue si vaincue. Il a baissé les yeux et la tête et les ailes et tout le corps s’est rapetissé pour demander pardon. Ceci fait, tout redevint ordinaire. Les conversations qui n’engagent à rien ont repris. On a chanté le temps, le printemps, le beau temps et le temps qui passe.
Malinette redressée sur ses coussins, règne plus régalienne que jamais. Elle tapote son drap pour inviter tel ou tel à prendre place à ses côtés. Elle adoube, elle distribue, elle rassemble, elle congédie. Que serons-nous quand elle ne sera plus ? Minuscule dame au pouvoir majuscule, notre plus belle fleur de serre, la plus parfaite, la plus mortelle aussi. D’ailleurs, il y a toujours quelqu’un pour dire : « Ce sera peut-être le dernier noël de Malinette ? » On soupire à cette idée. On le dit aussi pour Pâques, les anniversaires, les fêtes des mères et toutes les fêtes. Et comme ce sera peut-être la dernière fois, personne ne peut prendre le risque de ne pas être là, alors, on fait cercle autour d’elle, autour de la dinde ou du gigot. On peut vivre une passion torride, voyager au bout du monde, avoir une fièvre de cheval, comme ce sera la dernière fois, nous sommes là. Elle le sait. Rayonnante, sous sa poudre de riz rose, elle sent la violette et pavane au milieu de ses petits serrés dans son giron. Nous sommes là, même Julien qui tire la gueule, même Léa qui jure que c’est la dernière fois qu’elle se fait baiser et que la prochaine fois…, elle fait un bras d’honneur à la place des mots manquants mais elle sait qu’elle sera là. Tu connais ma sœur et son exubérance. Mais tu vois que l’on soit grande gueule ou révolté musette ne change rien à rien. Car comme peut-être ce sera la der des ders, on sera là. En fait, Malinette est immortelle comme ces fleurs qui sèchent mais gardent leurs couleurs. On parle de sa disparition comme on parlerait de l’apparition de Bernadette Soubirou. Sans y croire. Ma grand-mère parle de sa mort depuis si longtemps qu’elle semble l’avoir mise dans sa poche, comme nous tous. Mais là, il faut avouer que les choses se compliquent car c’est la première fois que notre sémillante Malinette tourneboule dans les escaliers et c’est un miracle qu’elle ne se soit pas rompu les os sur le marbre. Je vois que Max se trouve embarrassé de la question, comme fils d’abord mais aussi comme médecin. La chose fait des nœuds dans sa tête, ce qui le rend plus hargneux, s’il se peut. Véro propose de s’occuper de Malinette chez eux, dans leur grande et somptueuse demeure cachée derrière les murs des remparts d’Angoulême. « Vous voulez me tuer, ma parole. Il n’en est pas question » réplique cette dernière plus vivement qu’elle ne l’aurait voulu, avant de reprendre plus doucereuse.
« C’est gentil, Véronique mais tu connais les habitudes d’une vieille dame accrochée à ses petites manies. »
Ces deux-là se détestent, c’est du moins ce que je crois car tout observateur ne verrait qu’une politesse guindée dans ces sourires contraints. Quand balles il y a, elles sont en caoutchouc et les batailles se mènent en chuchotis. Voilà maintenant longtemps que Véronique a prêté allégeance à sa belle-mère qui avant tout, est la mère de Max. C’était perdu d’avance.
Mais voilà, avec cette chute dans l’escalier, personne ne sait plus quoi faire de cette Malinette qui prend des airs de sainte pour affirmer que bientôt, elle ne gênera plus personne. « Oui, mais en attendant, tu es toujours là ! » dit Julien. Tous les regards le fusillent et le cobra d’encre bleue qui enserre son cou maigre, se violace et redresse la tête prête à mordre. Pourtant Julien a reculé vers le mur alors que Max avance d’un pas vers lui.
Mais Malinette d’un mot, se jette entre eux.
« Pour l’instant, je reste là ! Max, mon chéri, toi qui es le patron de cette belle clinique, tu voudras bien me garder le temps de me rétablir, n’est-ce pas ? On me recoud, on me découd et hop, en trois mouvements, je serai sur pied et je reviendrai à Rochebrune. N’allez pas croire mes chéris que vous allez vous débarrasser si facilement de moi. Ici je suis dorlotée comme une papesse, alors inutile d’en faire toute une pendule. »
Elle s’est redressée comme une rose et glousse de ce petit rire cristallin qui enchante Rochebrune et on a tous envie en cet instant de serrer cette fleur si fragile contre nous.
« On verra, on verra » bougonne Max dont on sent la tendresse infinie sous la rocaille.
Les yeux pervenche de notre aïeule balaient l’assistance, pour lever la dernière résistance et comme il n’y en a plus, souriante elle s’endort pour de vrai cette fois. Chacun inspire, respire. Un ange passe et repasse content.
C’est à ce moment-là que Léa est entrée dans la chambre comme elle entrerait sur scène. Trop fardée, trop rousse, trop court vêtue, trop volubile, trop tout et surtout trop tout pour son âge : 46 ans. Elle a ouvert la porte à la volée, fait valser la poussière et maintenant occupe tout l’espace. Elle en fait trop. C’est ce que l’on peut entendre dans le silence embarrassé. C’est vrai qu’elle en fait trop. Léa a basculé d’un coup, de ménagère translucide en pute flamboyante. En un mois, ce fut fait. Un lundi, elle envoya valdinguer mari, maison, confort et Rotary. Ce ne fut pas un lundi particulier mais un lundi ordinaire, un lundi comme un autre. Elle a loué un studio tout moche, trouvé un job miséreux et s’est fait teindre les cheveux en rouge. Elle n’a gardé de son ancienne vie que ses jumeaux adolescents qui rigolent jaune et préféraient une mère grisonnante. « Grave ! » fut leur plus long commentaire.
Elle dit qu’elle est heureuse et tous les autres la disent folle. Surtout Max qui déteste l’incongru quelle qu’en fut la forme. Donc ma sœur entre toutes voiles dehors et étale ses jupons multicolores sur l’édredon de Malinette et la couvre de baisers. « Fais attention, redresse-toi. Tu vas faire mal à ta grand-mère » tonne Max. La voix est coupante et Léa obéit car elle vient de retrouver ses dix ans et l’avant, ses vingt ans et après. Max commande et les autres obéissent. C’est inscrit. Personne ne bronche. La main de Malinette suspend la caresse ébauchée. Pascal contemple la pancarte de traitement accrochée au bout du lit. Véro gratte dans son sac. Julien triture ses bagues têtes de mort. Moi, je ne fais rien ! Un instant vacant ! Une panne de famille !
« Dans moins d’un mois, c’est Pâques. Qu’est-ce qu’on fait, on annule ou on se retrouve à Rochebrune comme d’habitude ? » C’est naturellement que Paul pose la question. Du coup, le moteur se remet en route dans un embrouillamini de mots enchevêtrés.
« Ah, oui ? »
« Ah, bon ? »
« Pourquoi non ? »
« Sans elle ? »
« Et alors ! »
Max tranche.
« Bien entendu que nous fêterons Pâques à Rochebrune, comme tous les ans. N’est-ce pas maman ? Nous trouverons une solution et d’ailleurs, Malinette sera rétablie dans un mois. »
Des nuages passent sur les visages, certains doux et cotonneux, d’autres plus gris, porteurs d’averses. Nous sourions.
« Ce sera chouette ! »
« On est contents ! »
Malinette s’épanouit comme une Ronsard. Tu vois, ma Paula rien n’a changé ici. Les mêmes phrases convenues, les mêmes hypocrisies. On joue à la famille, comme jadis, nous jouions à la poupée. Pourtant, je les aime. Je les hais. Mais comme je les aime plus que je les hais, va pour le gigot de Pâques à Rochebrune. Malinette se tiendra en bout de table. Comme l’âge l’a tassée, on la grimpe maintenant sur un gros coussin à franges et comme l’âge l’a aussi éblouie, on lui met de grosses lunettes de soleil comme Liz Taylor et elle sourit de son dentier tout neuf. Comme elle est jolie et douce, notre Malinette. Comme elle sent bon. À sa droite, se tiendra son fils, son amour, son grand Max et à sa gauche, son petit-fils préféré, mon petit Paul, le passeur de flambeau, l’héritier désigné de Rochebrune et de ses traditions. À sa naissance, penché sur son berceau, Max l’a choisi comme dauphin et lui a dessiné un destin.
Autour de la table, comme toujours, les autres seront rangés par ordre décroissant d’importance. Véro, en bout de table, déclassée depuis longtemps et devenue inhabitée comme ces mannequins de papier glacé. Elle se tient raide comme si elle assistait à un office et sourit à qui veut bien lui prêter une seconde d’attention. On a envie de la remonter comme ces délicats automates pour qu’elle s’anime de nouveau et redevienne la pétillante jeune femme épousée jadis. Elle est demeurée belle mais sa beauté s’est ternie comme ces perles de culture qui meurent dans un tiroir. Souviens-toi, comme elle irradiait de jeunesse quand elle est arrivée à Rochebrune. Elle regardait Max son amour et rayonnait. Te souviens-tu comme elle se montrait affectueuse avec Julien encore si petit. Puis elle s’est éteinte sous nos yeux comme une nuit qui tombe sans que nous y prenions garde. Nous la regardions si peu.
Bien sûr qu’à Pâques, nous serons tous là. Tels qu’en nous-mêmes. Julien, renfrogné dans son coin, Léa tout en excès, flanquée de ses jumeaux enfermés dans leur monde d’écran. Max tapotera tendrement le dos de Paul et je lui pardonnerai tout. Malinette resplendira. Au retour, Pascal me fera grief de n’avoir pas réagi au dédain de mon père. Mince de mince. Et si cette année, je n’allais pas à Rochebrune où on se gèle le cuir autant que le cœur. Ou alors si tu faisais le voyage pour l’occasion. Tu serais là comme avant et on se ficherait d’eux comme avant. Viens ! Je t’embrasse ma Paula.
Alex
Samedi 25 mars 2000.
Ma Paula,
Voilà. Vite fait, mal fait, bien fait. Encore trois lettres et trois refus de maisons d’éditions pour mon roman renvoyé au pilon en même temps que mon moral. Cette fois encore, je n’avais pu m’empêcher d’espérer, je n’avais pu m’empêcher de guetter le facteur, pas pu m’empêcher de rêver. Non de gloire et d’argent mais d’un seul lecteur pour justifier ce terrible voyage en solitaire quand le marin désespère d’apercevoir la terre. Que de souffrances de galérien pour rien, ni personne. Je me trouve dans un état d’abattement post-partum. C’est cela, je fais une dépression d’après naissance d’un bouquin mort-né et c’est une douleur ! Sans tes encouragements, je bannirai toutes velléités d’écriture mais que serait ma vie sans elle ? Présentement, elle ne vaut pas grand-chose et je peux attester qu’elle n’a plus aucun jus à donner. Vidée et rincée à grande eau !
Pascal a accueilli ce nouvel échec avec le recul que donne l’indifférence, m’assurant du succès pour le prochain. Autant prévoir une averse de neige au 14 juillet. Je sais, je sais. Je suis injuste et je l’accuserai quoi qu’il dise ou fasse. Je n’ai encore rien dit à Rochebrune, de ce nouveau revers. Tout d’abord, il me faut le mâcher avant d’encaisser le sourire goguenard de Max au risque de m’écrouler comme la maison de paille des trois petits cochons au premier souffle du loup. En attendant, je voulais juste pleurer sur moi pour que tu me consoles.
Alex
Jeudi, 5 avril 2000.
Ma Paula,
Il m’est arrivé quelque chose de bien étrange hier ! J’ai reçu une grande enveloppe kraft contenant plusieurs feuillets jaunis, si minces qu’on eut dit des pelures couvertes d’une écriture pointue aux lettres resserrées que j’eus grand-peine à déchiffrer. As-tu déjà vu les carnets manuscrits qu’écrivait Soljenitsyne du fond son goulag ? Comme les morceaux de papier étaient un trésor vital, il utilisait le moindre espace, la plus petite interligne, la plus minuscule marge, pour noircir les infimes interstices en tous sens. Les lettres que j’ai reçues sont ainsi, sans respiration, presque sans ponctuation et pourtant il y souffle une force qui te fait vaciller comme une tempête d’hiver. On y sent une densité d’émotions tenues en laisse, on y devine l’irrationnel sans pouvoir le saisir et une déraison aussi fine qu’un trait d’encre traversant un buvard. Imperceptible, l’insensé s’échappe de chaque coin, revient, toujours là, te prend et laisse sur ta raison comme une sueur d’angoisse. L’encre violette a pâli aux pliures, rendant certains mots illisibles. À bien l’examiner, on dirait ce papier fabriqué dans l’ancienne papeterie de Marsac, fermée depuis plus de 30 ans. La lettre est signée d’un J. Juliette ? Jeanine ? Joséphine, peut-être ?
Ce courrier est adressé au maréchal Foch, en date du 29 septembre 1920. La jeune signataire cherche son mari Fernand, mort sur un champ de bataille, quelque part, du côté de Verdun, pendant la première guerre sans personne pour identifier son corps au milieu du carnage. Elle voudrait le retrouver pour le pleurer tout simplement. Plus étrange encore, ce Fernand serait le soldat inconnu qui repose sous l’arc de triomphe. Tu vois, ma Paula qu’on nage en pleine folie. D’abord, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une erreur de la poste. Mais non, j’ai beau lire et relire le nom et l’adresse du destinataire, il s’agit bien de moi. Aucun doute ! Puis j’ai cru un moment à ces histoires improbables de lettres perdues qui arrivent un demi-siècle plus tard pour bouleverser le destin. Mais non, les miennes ont été postées à la grande poste d’Angoulême, il y a trois jours, à 16 heures.
Voilà l’affaire absurde qui m’a réveillée plusieurs fois cette nuit. Dimanche, je les avais apportées à Rochebrune pour les faire lire aux autres. Les pages ont fait le tour de la table. Léa a trouvé cette histoire géniale et Max y a jeté un coup d’œil distrait avant de les reposer d’un air d’ennui. « C’est un fou ! » a-t-il conclu. J’ai insisté. « Pourquoi moi ? » Mais d’un haussement d’épaules, il a replongé le nez dans son journal. Il n’y a que Julien pour les avoir lues avec attention. Et encore, les a-t-il lues ou faisait-il mine de la concentration après les remarques cinglantes de Max en grande forme qui a enchainé les vexations comme d’autres effeuillent la marguerite. Je te donne un aperçu en vrac :
Julien sans talent « sinon, ça se saurait ! »,
Julien sans ambition « on ne sait pas de qui il tient ! »,
Julien sans lendemain « qu’est-ce qu’on va faire de lui ! »
Julien sans rien de rien « rien à dire. Rien à faire ! »
Cette sempiternelle ritournelle fait mouche à chaque fois et comme les mots n’étaient pas suffisamment assassins, il a sorti un chèque pour une aumône à l’ordre de son vaurien de fils. Il a pris son temps pour le remplir, le signer, le détacher, le plier avant de le lancer au-dessus de la table. Le papier s’est envolé, a tournoyé comme une cocotte avant d’atterrir de son bec sur la tarte tatin. Les conversations se sont suspendues pour suivre ce vol humiliant. J’en veux à mon père au paroxysme de sa méchanceté mais plus encore à Julien, de son silence et de notre lâcheté cautionnant ce mépris. Nous attendons, silencieux, fesses vissées, cou rentré que l’orage s’éloigne. Qu’attendons-nous ? Qu’est-ce qui nous cloue au sol ? Qu’est-ce qui nous empêche de nous lever et de jeter notre serviette monogrammée sur la table ? Dis-moi ce qui nous retient de coller ce vieux con contre le mur et ne plus revenir. Il faudrait courir, s’enfuir et ne plus revenir. Dis-moi, pendant combien de temps allons-nous supporter ? Explique-moi cette absence de courage et de fierté. Faudra-t-il des blessés ou faudra-t-il des morts ou faudra-t-il un mort ?
Comme un alligator, immobile, yeux plissés, il attend. On le croit assoupi entre deux eaux mais il observe. On ne connait pas l’instant de la détente précédant la morsure, on sait seulement qu’elle va venir. Fulgurante. Puissante. Inévitable. Puis après avoir croqué sa proie, il redevient placide avec un éclair fugace qui traverse son regard. Repu, il digère. Après l’attaque, le pire fut la rougeur marbrée recouvrant les joues de mon frère comme une honte étalée et le léger tremblement des doigts qui fit frémir les lettres. Je les ai reprises et rangées en évitant ses yeux de supplicié. Ne me demande pas d’où cette scène a surgi. Elle est arrivée de nulle part, sans raison, sans propos, sans tempo, comme un jet de bile. Pourquoi nous aimons-nous si mal ? Pourquoi faut-il que cet amour soit si douloureux à vivre ? Dis-moi Paula le sais-tu ? Là-bas, sous la douceur de nos arbres centenaires, nous devons être des soldats en alerte, prêts à tirer ou détaler. Cette fois, comme toutes les autres fois après cette escarmouche, tout redevint si paisible qu’on crut l’avoir rêvé.
Malinette appelle l’armistice de sa main menue. « Allons, allons, mes enfants d’amour, cessez donc vos chamailleries puériles. »
On se ressaisit, on reforme un ensemble familial, un instant explosé comme ces bancs de sardines au passage d’un requin. On nage de nouveau serein. On trouve le gigot fondant et la tarte divine. Exquise Malinette capable de l’impossible union. C’est traditionnellement Véro qui se charge de la remise en musique un moment interrompue.
« Et si nous prenions le café dans le jardin d’hiver », propose-t-elle. Malinette est descendue de sa chaise et mise à l’ombre de la lumière. Comme chaque fois qu’elle enlève ses lunettes, l’éclat de ses prunelles me bouleverse. Te souviens-tu de leur couleur ? Maintenant que les ans ont poli les émeraudes en deux pierres bleutées, on pourrait douter qu’elles fussent humaines. Étendue sur une chilienne, recouverte d’un plaid de dentelle, un coussin de fleurs glissé sous ses cheveux rosés, elle rit de ce petit rire mutin qu’on aime tant. Nous faisons cercle autour de ses joues pour la respirer. Elle sent bon la violette.
« Arrêtez, arrêtez, vous allez m’étouffer ! » s’amuse la coquine. Alors que l’on se demandait une heure plus tôt ce qui nous ramenait inexorablement vers Rochebrune, Malinette sourit et sent bon la violette. Voilà pourquoi, nous sommes là. Max étend ses longues jambes, discourt brillant, et passe sa main dans les cheveux de Paul. Voilà pourquoi, nous sommes là. Pour une photo de famille réussie, pour les fous rires de Léa qui a maintenant les cheveux bleus et un amant noir, pour Julien qui sort son carnet à dessin, notre si fragile et talentueux Julien. Nous sommes là. Ensemble. À l’heure du thé, Malinette s’est redressée sur sa canne et a fait tinter le cristal du bout de son couteau pour demander le silence. Elle veut faire une annonce solennelle.
« La semaine prochaine, quelqu’un viendra s’installer à Rochebrune ! »
« Ah bon ! »
« Mais qui ? »
« Dis-nous »
« Un fiancé ? »
La vieille dame pouffe. C’est un secret de Polichinelle et Malinette est la seule à croire à Polichinelle. Indulgents, nous l’écoutons religieusement, soulagés de la solution trouvée car Malinette pourra ainsi demeurer à Rochebrune en toute quiétude sans être seule. Dans le centre de convalescence où elle se remettait de sa chute, elle a fait la connaissance d’une douce personne du nom de Marido. Elles ont sympathisé, se sont trouvé des goûts communs et comme cette dame aux revenus modestes est sans famille, l’accommodement s’est imposé tout naturellement. Elle viendra s’installer à Rochebrune comme gouvernante et veillera ainsi sur Malinette. Quelle bonne nouvelle ! Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises alors que je rendais visite à ma grand-mère. Elle est discrète pour ne pas dire effacée mais sous la réserve, se devine une délicatesse touchante. Nous avons échangé à propos de sujets très variés car elle s’intéresse à tout, à la lecture, la musique, la nature et elle s’est avérée d’une compagnie fort agréable. Mise en confiance, j’ai même eu l’audace de lui avouer que j’écrivais, fière de pouvoir enfin parler de ma prose. Les occasions sont si rares. Elle m’a posé des tas questions et m’a demandé timidement si elle pourrait me lire. Tu te doutes que je ne me suis pas privée de ce bonheur inhabituel. Quel plaisir de pouvoir échanger avec elle quand elle sera au manoir. D’ailleurs tout le monde est ravi et tellement heureux de cet arrangement providentiel. Malinette aussi trépigne d’impatience. Espérons que la mutine se montrera bienveillante car sous ses airs qui nous ensorcellent, chacun connait ses entêtements.
Alors que nous étions sur le point de partir, Julien est venu nous demander ce que nous comptions acheter à Max pour son anniversaire. « Que dalle » a répondu Léa du tac au tac. Comme tu le sais, son anniversaire est toujours le 21 juin, et comme tu le sais, tous les 21 juin, nous fêtons l’anniversaire de Max. Le jour le plus long, le jour de la fête d’une drôle de musique. Les cadeaux, les bolducs et le soleil qui nous nargue dans le ciel sans vouloir se coucher. Satané soleil ! Satanée journée ! D’ordinaire, Véro organise une fête qu’elle appelle une surprise. Aujourd’hui, elle n’a parlé de rien et si pour une fois, nous échappions à l’épreuve ? Et si, et si, et si fa, do, ré, sol ? Comme d’habitude, nous nous sommes disputés avec Pascal, en rentrant à la maison. Comme d’ailleurs chaque fois que nous revenons de Rochebrune. On dirait que ces dimanches à la campagne nous rendent hargneux comme des mauvais vins qui nous déshabillent des pelures de la retenue, nous laissant nus, entortillés dans nos mesquineries. On se lance à la figure, les détritus de nos vies à pleins seaux. Il me reproche ma famille et moi le voyant à travers le jugement de Max, je lui reproche d’être lui. Prisonniers dans l’habitacle de la voiture, vitres fermées, l’air s’épaissit et nous nous détestons.
« Tu ressembles de plus en plus à ton père » m’a-t-il dit. Salaud. Touchée. Coulée.
Personne n’a reparlé de ces lettres. C’est peut-être en effet une erreur, après tout. Comme tu me manques. Je t’embrasse et te serre contre moi.
Alex
Samedi 8 avril 2000.
Ma Paula,
Encore un dimanche qui s’achève avec le plaisir de te retrouver. Tu les sauves.
À quelques détails près, celui-ci fut le jumeau des autres. Chaque fois, je crois en avoir atteint les sommets ou les fonds mais chaque fois, il y a plus haut ou plus profond. Heureusement qu’entre deux grandes messes dominicales, on peut être croyant ou mécréant. Quant à moi, j’ai le moral en abysse et je n’attends plus grand-chose de moi-même. Me voilà asséchée, sans idée et il me semble qu’il n’y a plus d’histoires à raconter, plus de destins à inventer, plus de mots à écrire. Les poètes et les conteurs d’ailleurs ou d’avant ont pris tout le talent ne m’en laissant aucun sauf une page aride. Je ne pouvais pas lutter et j’erre dans ce désert avec une vacuité qui m’accable. C’est une panne d’inspiration, dit-on autour de moi. Cherchant un réconfort, J’ai voulu en parler à Pascal l’autre soir, après diner mais il était assoupi sur le canapé, bouche ouverte et ronflant. Quel amour peut survivre à ces petits renoncements qui le détricotent férocement, surement ? Je crois que mon mari a une maîtresse. Tu me diras que ce n’est pas la première mais ce sera la première dont je ne serais pas jalouse. Je devine mon infortune à l’agitation de ces gestes. Il se cogne dans les meubles. Lui le nonchalant loué pour sa force tranquille, aimé pour son calme apaisant se montre soudainement pressé, impatient et parfois irrité d’un détail. Il ouvre les portes à la volée, ne quitte jamais sa montre des yeux comme si elle risquait de prendre la fuite et son portable taraude sa poche en permanence. Tout témoigne. Et alors. Non seulement, je m’en fiche mais l’idée me dédouane de l’aimer si mal. À vingt ans, j’aurais trépigné, à trente, j’aurais gémi, à quarante, j’aurais menacé mais à cinquante, je l’envie.
Si je l’aime ? Aujourd’hui, je ne sais plus. Tu sais combien de crises, nous avons traversées dans ce fracas qui fait vibrer l’amour. Que sommes-nous devenus reclus au fond de ce silence qui est venu éteindre le tonnerre, les éclairs ? Qu’est devenu celui capable de sortir une bouteille de champagne et deux coupes en cristal au milieu du Sinaï et trinquer à la joie, celui qui voulait creuser des puits au Sahel et sauver les grands singes de Tanzanie et les hommes aussi. Tous !
C’était avant et maintenant nous remâchons un sentiment plus moribond que vif qui se survit à lui-même et je crois que nous avons commencé l’âpre descente vers la désunion. Nous avons eu Paul, nous avons Paul, notre petit Paul, notre fils, notre justification à continuer ensemble. Mais tous les liens se détissent peu à peu pour nous libérer bientôt mais cette désalliance nous apeure plus qu’elle nous réjouit. Nous aimions encore nos barreaux. Du reste, à Rochebrune aujourd’hui, il fut question de lui, plus que je ne l’aurais souhaité.
La matinée fut délicieuse, enveloppée de ce temps léger qui rend heureux. Le ciel était Majorelle et Malinette avait fait dresser les tables sous les cerisiers en fleurs. Elle portait une robe lilas et des cheveux en nuage, comme si elle sortait de la palette de Marie Laurencin. Les apéritifs servis sous les noisetiers furent un moment exquis, presque suranné. Max était détendu et par un effet de balancier, nous l’étions aussi. Sauf Julien qui jouait à Julien mi-arrogant, mi-implorant.
Nous étions une famille. Je me pris à penser que Marido, la dame de compagnie, nouvellement installée au manoir, n’était pas étrangère à cette sérénité. Elle était assise, quelque peu en retrait, ni trop près, ni trop loin, ni trop bavarde, ni trop absente, une bonne distance trouvée intuitivement. Pour ce premier repas partagé, Max a levé son verre en guise de bienvenue. Marido a souri d’un beau sourire. Puis, déchirant l’instant, les graviers de l’allée ont crissé sous les roues d’un moteur lancé à vive allure avant de stopper net dans le parterre de tulipes. Max a levé un sourcil et Malinette a couiné comme un chaton. Nous les avons tous regardés, sortir l’un après l’autre et l’autre après l’un, plus encore un et un de cette voiture rouge et longue comme un jouet d’enfant. D’abord un grand noir tout de blanc vêtu puis Léa plus turquoise que jamais et enfin les jumeaux pliés en quatre, plus désabusés que jamais. Léa a fait les présentations. Son mec s’appelle Victor, quarante ans, trois enfants, deux divorces, sans emploi avec pour seul présent le lit de ma sœur.
« Et alors ? » a attaqué Léa.
Personne n’avait rien dit mais le pedigree fit tiquer le printemps. Au sourire du dénommé Victor, je compris les emballements de Léa qui m’a fait un clin d’œil signifiant « je les emmerde tous ». Julien hochait une tête qui prédisait : « Tant mieux, les mouches vont changer d’âne ! »
Malinette reprit ses esprits la première, fit trois tours sur elle-même avant de trottiner sans canne vers la maison.
« Maman, reviens ici tout de suite, tu vas encore tomber » jappait Max.
Mais sans l’entendre, elle piaillait d’un ton aigu : « Mon Dieu, mon Dieu, et voilà qu’il manque un couvert maintenant. »
Quand je l’eus rejointe, elle écroula sa belle robe lilas sur une chaise.
« Il ne va pas durer au moins ? »
Dans sa supplique passaient toutes les gammes de la perplexité.
« Parce que tu vois, il est trop, il est trop. Il est trop… »
« Trop quoi, Malinette ? Trop noir ou trop beau ? »
Son regard émeraude hésita avant de prendre un fou rire à pleurs qui laissa de fines rigoles dans sa poudre de riz. Quand nous eûmes repris notre souffle, j’ai recoiffé les beaux cheveux de Malinette et remis du rose sur ses joues lisses. Le temps passe sur elle comme une brise à la surface de l’eau, laissant seulement un frémissement sur sa peau. Je l’ai embrassée puis nous sommes redescendues main dans la main tandis que Marido rajoutait le couvert manquant.
Ce n’est qu’au dessert que l’incident éclata, après que la tatin fut découpée. Solennel, Max annonça qu’il souhaitait nous entretenir d’une affaire familiale importante dans la plus stricte intimité. Il insista sur le mot strict en fixant le seul étranger de la tablée qui venait d’enfourner une copieuse cuillerée de dessert. Victor repoussa sa chaise pour se lever mais Léa le retint d’un geste.
« Il reste. Il est avec moi et il peut entendre ! »
Mâchoire contractée, Max blêmit et jeta sa serviette au milieu de la table. Dans un désir de concorde, Véro posa une main sur le bras de son mari mais ce dernier la repoussa si brutalement que le poignet vint heurter le rebord de la table. On put entendre un claquement sourd mêlé des tintements des bracelets de perles et d’or. Le visage de Véro se crispa faisant jaillir des larmes de douleur. Déjà Max s’éloignait à grandes enjambées tandis que Malinette tentait de le retenir.
« Reviens, mon chéri, reviens, je t’en prie. Ce n’est rien ! »
J’ouvrais la bouche pour protester mais Véro, du regard, me supplia de me taire.
« Ce n’est rien. Ce n’est rien » répéta la malheureuse en serrant contre sa poitrine, son bras qui se tuméfiait salement.
« Putain » jura Léa.
Abasourdi, Victor s’était levé et on pouvait voir sa pomme d’Adam qui montait et descendait pour déglutir son morceau de gâteau.
« Ce n’est rien. Ce n’est rien » répétait Véro.
« Tu sais bien ma pauvre Véro qu’il ne faut pas l’asticoter quand il est furieux. Tu dois bien savoir qu’il finit par se calmer tout seul. Mais forcément, si on le titille, c’est normal que… Oh là là ! Et maintenant tout est gâché » se lamentait Malinette.
Véro baissa la tête. Nous avons pris sa défense à trois voix. Léa dressée comme une lionne, Julien tassé comme un vieillard, et moi entre les deux. Les jumeaux avaient dû monter le son de leur musique et se balançaient en rythme comme deux psychotiques fermés à ce ramdam. Quant aux autres figurants, silence on tourne. Malinette se mit à pleurer doucement, le visage entre ses mains et son dos oscillait en vagues. J’ai pensé en voyant les tavelures brunes de ses doigts aux fleurs de cimetière que nous n’avions plus le temps de la tristesse, alors d’un bond, nous fîmes cercle autour d’elle.
« Ce n’est rien, Malinette ! Ce n’est rien ! »
« Viens, Véro, nous allons mettre de la glace sur ton poignet et je te ferai un joli pansement. Si vous voulez venir nous aider, Marido, ce serait gentil ! » proposa Pascal.
C’est vrai que nous avions oublié Marido invisible dans son coin. Quelle image donnons-nous à cette dame ? Et si elle ne voulait plus rester à Rochebrune avec des fous furieux ! Il y eut ensuite une sorte d’interlude un peu mollasson et peu à peu, Malinette redevint Malinette.
« Paul, mon chéri, tu ne voudrais pas aller chercher ton grand-père, s’il te plait ? Toi, il t’écoutera. Dis-lui aussi que nous nous excusons. On peut lui dire ça, tout de même. N’est-ce pas les enfants ? Véro serait d’accord aussi, j’en suis certaine. Dis-lui et il reviendra » insista Malinette.
« Il ne faut pas exagérer, non plus. Ce serait plutôt à lui de faire des excuses » s’indigna Léa.
« Je suis si vieille maintenant, si fatiguée. »
À ces mots, Malinette replongea le nez dans son mouchoir qui sentait la violette et nous capitulâmes. Alors elle se redressa lumineuse.
« Allons, reprenons de la tarte et du champagne. Approchez votre coupe, Victor. C’est une si belle journée. Quel bonheur de vous avoir tous auprès de moi. »
Guillerette, la voici qui claque dans ses mains pour remettre la conversation en route, d’abord poussive comme une guimbarde, puis enhardie par les bulles de champagne et le soleil de printemps qui caresse les peaux. Victor s’avéra d’un humour subtil qui emporta nos derniers embarras et arracha quelques rires à notre ténébreux Julien.
Ce n’est que vers 4 heures que Max et Paul réapparurent au coin de la maison. Le grand-père entourait les épaules de son petit-fils et de nouveau, leur ressemblance me confondit. « Mon Dieu ! On dirait les deux frères ! » s’exclama Malinette rayonnante. Quant à moi qui aimais Paul avec certitude et Max avec incertitude, je me retrouvais prisonnière de cette double équation. Max s’approcha de sa femme, prit le poignet bandé entre ses belles mains pour l’embrasser mais Véro eut un imperceptible mouvement de retrait que Max dut ressentir car il lança un méprisant : « Ce que tu peux être empotée ma pauvre Véronique ! » Paula, comment peut faire ce salopard pour faire autant de mal, comment peut-il nous fracasser de la sorte sans la moindre riposte. Il a ce pouvoir-là car nous le lui laissons, nous pauvre armée fantoche et pétocharde. Sous l’insulte, Véro avait tourné les talons, remonta vers la maison et alors que je m’apprêtais à la suivre, le père tout-puissant m’enjoignit de me rasseoir à ma place.
« Reste ! Ce que j’ai à vous dire te concerne aussi, je veux vous parler tous les trois réunis ! Rendez-vous dans deux heures à la bibliothèque. En attendant, profitez de ce bel après-midi avec Malinette ! »
Il nous convoquait purement et simplement comme les subalternes de sa clinique.
De fait, Paula, tu n’as pas pu oublier les reflets de bronze sur le gris des étangs, ce souffle dans les cheveux des peupliers d’où s’envolent des milliers de duvets. Et l’odeur, Paula ! Personne ne peut oublier les senteurs de sous-bois, de mousse et de chanterelles ! Imprégnés, irrigués de cette terre, aucun de nous peut l’oublier. Nous sommes esclaves de sa grâce et il nous serait impossible de vivre ici sans pouvoir survivre ailleurs. Rochebrune est un endroit magique et maléfique qui nous attire, nous ensorcelle et nous étouffe de son emprise. C’est un gourou qui nous prend, qui nous jette et toujours nous ramène, un champignon vénéneux ou un chant de sirène. Après Malinette, que deviendrons-nous quand il faudra fermer ces volets et tourner le dos à cette vieille bâtisse ? Notre vie est ailleurs et non au milieu de ces marécages, il nous faut les néons et les fureurs des villes mais il nous faut aussi les silences de Rochebrune emmitouflée dans ses grands arbres et qui nous lie d’un impossible amour.
Au bout de notre promenade, quand nous fûmes parvenus au promontoire qui surplombe les lacs fumants, nous nous sommes arrêtés d’un même pas devant la majesté du vieux manoir. Il offrait ses pierres blanches au soleil rasant et ce lien indéfectible nous a tenus debout, unis et accablés. Pour finir, nous avons fait le tour par le plateau des carrières, traversé ses poussières venteuses, tourmenté de bourrasques qui prennent à revers pour nous empêcher de rentrer.
À notre retour, Max et Paul nous attendaient dans la bibliothèque. Je te passe le long monologue laminaire. Je te fais grâce aussi de l’ambiance lourde de cette pièce sombre étouffée de rideaux si épais qu’aucun soleil ne peut y pénétrer, sans parler de la mine contrite de Paul qui évite mon regard. Résumons seulement le propos. Max veut faire de Paul, son unique héritier. Il veut déshériter les autres, tous les autres, enfants, petits-enfants. Exit Julien, Léa, les jumeaux, au profit de mon fils.
Il veut tout lui léguer : La clinique, Rochebrune, les terres, les actions, les tableaux, la lignée. Il gomme ses enfants. Ils les enjambent comme des petits tas de poussières. Il nous dit le peu d’importance que nous avons à ses yeux. Il nous balaie. Une fois la chose dite, tous les yeux se sont tournés vers moi. La stupeur déjà résignée de Julien et la stupeur déjà révoltée de Léa et Max qui me nargue. « Tu devrais me remercier. » Le voici entièrement contenu dans cette destruction. Léa qui reproche à vif et Julien qui gratte son serpent jusqu’au sang. Le pire, ma Paula c’est qu’il fallait notre accord. Il fallait notre renoncement. Comme il est cruel de devoir signer la preuve d’un non-amour, parapher un rejet. Max sans doute a confondu sidération et refus ou hésitation et marchandage, toujours est-il qu’il nous a proposé l’aumône d’un pourboire comme à des domestiques, une sorte de dédommagement de ne pouvoir nous aimer davantage. « Combien ? » a demandé Léa. Max s’est mépris sur la question. Il la croit cupide mais il se trompe car la seule question qu’elle pose à son père est la suivante. « Combien est-ce que je vaux pour toi ? »
Max annonce une somme. Une forte somme. Une très grosse somme. Léa fait un geste pour faire monter l’enchère. Les prix s’envolent. Un autre geste. Un autre prix. Les colères, les ressentiments, les mémoires se rejouent dans cette foire de maquignons. Paula, comme j’ai honte d’être là. Le cobra de Julien saigne maintenant que Léa a perdu la partie en acceptant la dernière mise de ce poker menteur. Nous connaissons maintenant le prix du désamour. Je déteste le sourire de Max sur nos ruines. Son rictus qui m’impose l’impossible choix entre mon fils, mon frère, ma sœur, l’impossible choix entre la justice et l’amour. Égarée dans ce conflit de loyauté, je cherche le pardon de Léa qui me le refuse. J’en veux à Paul de n’avoir pas refusé, à Julien de n’avoir pas protesté, à moi de ne plus rien savoir. Nous sommes comme des papiers froissés dans le fond d’une corbeille, jetés, abimés mais encore là. Ensemble et séparés. On signe.