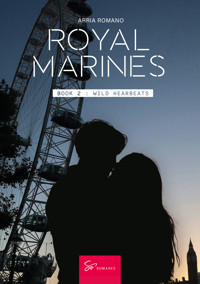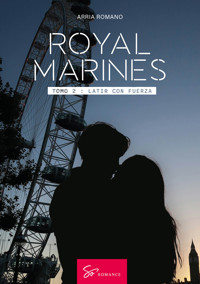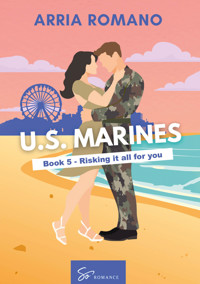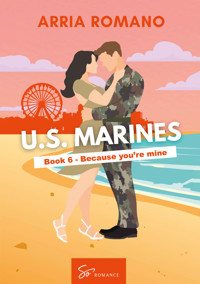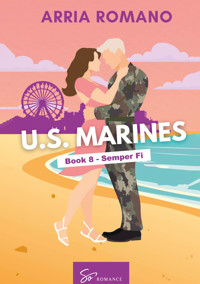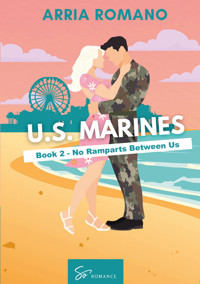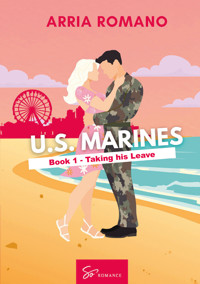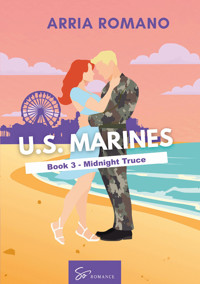Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: So Romance
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans l’ombre des palais de Vérone, l’amour est une arme… et la vengeance un devoir.
Vérone, 1454. Belle, riche et apparemment comblée, Beatrice cache sous son éclatante façade une vie de douleur. Mariée à Ludovico, un homme aussi cruel qu’ambitieux, elle découvre que son époux prévoit de la faire assassiner pour asseoir son pouvoir.
Mais Beatrice n’est pas prête à se laisser écraser. Avec l’aide de Baldassarre, l’homme ténébreux qu’elle a toujours aimé en secret et célèbre pour ses faits d’armes, elle prépare une contre-attaque implacable. Dans un monde où intrigues, trahisons et passions se côtoient, la jeune femme va jouer sa vie… et peut-être gagner son droit au bonheur.
- Une romance historique captivante dans l’Italie de la Renaissance
- Une héroïne forte, prête à défier son destin
- Alliances secrètes, complots et passions interdites
- Une fresque intense où l’amour est plus fort que la trahison
Redécouvrez la plume d’Arria Romano, autrice de la célèbre saga U.S. Marines, dans cette nouvelle romance historique.
À PROPOS DE L'AUTEUREArria Romano étudie l’histoire militaire à la Sorbonne et est passionnée de littérature et d’art. Elle écrit depuis quelques années des romans historiques et des romances, qu’elles se vivent au passé, au présent ou même nimbées d’un voile de magie… Tant que l’amour et la passion restent le fil rouge de l’intrigue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
Couverture
Page de titre
Citation
PROLOGUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ÉPILOGUE
Chapitre gratuit
Dans la même collection
Copyright
Landmarks
Cover
Dernière nuit à Vérone
« L’amour et un noble cœur ne font qu’un,et quand l’un ose aller sans l’autre,c’est comme quand l’âme abandonne la raison. »
Dante Alighieri
PROLOGUE
Printemps 1447
Vérone, Italie
Il existait en ce monde des personnes dont la beauté, le charme et la sensualité formaient une trinité indissoluble qui déchaînait les cœurs, suscitait l’admiration et, dans certains cas, rendait fou. Selon les hommes qui croisaient le chemin de Beatrice Bartolo, et en particulier selon Baldassarre Torelli, la jeune bourgeoise de dix-sept ans avait reçu à la naissance tous les dons qu’Aphrodite pouvait conférer à une femme.
Quand on la voyait pour la première fois, on se noyait tout d’abord dans son regard de velours aussi bleu et clair qu’un ciel ensoleillé au mois de mai. Puis, on s’attardait sur la symétrie de ses traits délicats et angéliques. Ses yeux dessinés en forme d’amande étaient un peu enfoncés dans leurs orbites et frangés de longs cils bruns, tandis qu’une paire d’arcs fins les coiffait dans un léger mouvement d’accent circonflexe. On suivait ensuite la ligne droite d’un nez aux ailes minces avant d’admirer longuement les lèvres vermeilles d’une bouche pulpeuse, qui s’ouvrait tel un bourgeon de rose en dévoilant une rangée de dents pareilles à des perles quand elle souriait. Son sourire était d’ailleurs célèbre dans la ville de Vérone, mais ce qui troublait davantage Baldassarre était ses pommettes hautes, posées tels des pétales de fleurs flottant sur le lait de sa peau délicieuse.
Enfin, on se perdait dans la contemplation de sa longue chevelure brune, bouclée, et brillant d’une teinte aussi chaude que l’écorce des marrons, avant d’étudier son allure altière, sa démarche déliée et son corps joliment fait, marqué par une poitrine généreuse, une taille de guêpe et des jambes longilignes.
— Pourquoi me regardes-tu comme ça, Baldo ?
Baldassarre, que tout le monde surnommait Baldo par rapport à son prénom, mais également pour sa vaillance proverbiale, étant donné que « baldo » signifiait « vaillant » dans la langue de Dante, sortit de sa contemplation pour rencontrer les yeux intrigués de Beatrice. Elle était au milieu des arènes de Vérone, joliment habillée d’une volumineuse robe de soie et de velours bleu pâle, une couleur très répandue chez les femmes aisées, et confectionnée avec un soin coûteux. Ses longues boucles brunes coulaient en cascade jusqu’à ses hanches, alors qu’une couronne tressée avec un motif tricoté croisé ornait l’arrière de son crâne.
— Pour graver ta beauté dans ma mémoire, Bea, avoua-t-il en se rapprochant d’elle, jusqu’à ne laisser qu’un mètre de distance entre eux.
Un frisson glissa sur l’échine de Beatrice à l’entente de ce ton grave, solennel, et le cœur battant plus vite dans sa poitrine, elle dévisagea son ami d’enfance. Baldassarre était un beau jeune homme de vingt et un ans, grand, lourdement charpenté, impressionnant dans ses vêtements noirs et sa cape de laine, qui claquait derrière lui à chaque fois qu’il marchait de son pas décidé, prêt à conquérir le monde qui s’ouvrait à lui. Il ne l’avait jamais laissée indifférente, même lorsqu’ils étaient plus jeunes, et ses yeux dessinés en pointes de lame, d’un noir de jais, lui donnaient toujours quelques roseurs. Peut-être était-ce à cause de sa façon intense, presque pénétrante, de la regarder ?
— Tu sais, lorsque je serai sur le champ de bataille, je n’aurai plus que ton souvenir pour seule consolation…
La respiration de Beatrice se suspendit.
Le champ de bataille. Voilà un sujet qui mettait sans cesse le feu à ses émotions, surtout lorsqu’il s’agissait de lui. Car, si Baldassarre l’avait invitée à se promener dans la ville ce matin, jusqu’aux arènes où ils aimaient autrefois se cacher par jeu, c’était justement pour lui faire ses adieux avant de rejoindre Federico da Montefeltro, le célèbre condottiere, auquel il venait de prêter allégeance.
Après une brève inspiration, elle lui répondit froidement :
— Tu n’es pas obligé de partir.
— Non, mais j’en ressens le besoin.
— Plus que de rester à mes côtés ?
Les étincelles qui éclatèrent dans le regard bleu de Beatrice lui imposèrent un petit silence réflexif, et après avoir passé une main nerveuse dans ses beaux cheveux noirs, ondulant jusqu’à ses larges épaules, il répondit d’une voix que la fatalité de leurs deux destins rendit ferme, voire sèche :
— Que je reste à tes côtés ? Mais dans quel monde vis-tu, Bea ? Aurais-tu oublié ton mariage prochain avec notre ancien ennemi héréditaire, Ludovico Foscari, ainsi que ma situation inconfortable au sein de ma propre famille ? Tu sais que je dois faire mes preuves en tant qu’homme, puisque les affaires de mon père sont désormais entre les mains de mes frères aînés et qu’il n’y a quasiment plus rien pour moi, qui ai eu le malheur de naître en dernier. Je ne peux pas me résoudre à entrer dans les ordres, alors, rien de mieux que la guerre pour me faire un nom et bâtir ma propre fortune… et surtout… rien de mieux que la guerre pour oublier le mariage prochain de la femme que j’aime. Pour t’oublier, Beatrice.
Pour t’oublier, Beatrice.
L’amertume teinta la fin de sa phrase et fit miroiter une lueur sombre dans ses yeux obscurs, lesquels dévoraient sans ambages le visage désormais rouge de Beatrice. Elle était bien trop intelligente pour ignorer l’amour qu’il lui vouait depuis longtemps, mais jamais encore il ne lui avait avoué ses sentiments et visiblement, même l’effondrement subit des ruines alentour ne l’aurait pas détournée de son trouble.
— Tu… tu m’aimes ? l’interrogea-t-elle après un silence pesant.
— Oui. Depuis que mon regard s’est posé sur toi, alors que tu n’étais qu’une fillette de six ans, et moi, un enfant de dix ans.
— À quel point m’aimes-tu ?
— À la folie.
Il vit les fins sourcils se froncer et crut assister à l’insurrection du printemps dans ses yeux.
— À la folie, dis-tu ? Alors, pourquoi n’as-tu pas fait ta demande à mon père avant qu’il n’ait eu l’idée ingénieuse de me promettre à Ludovico Foscari, hein ? lui retourna-t-elle d’une voix plus cuisante. Tu ne t’es pas dit, un seul instant, que je pouvais également être amoureuse de toi ? Que c’est entre tes bras que je veux connaître l’amour et que ce sont tes enfants que je rêve de porter ? Ou alors, tu es bien trop obnubilé par tes ambitions guerrières et ta folie des grandeurs pour te préoccuper de moi et de mes sentiments ?
En parlant, elle s’était rapprochée de lui pour pointer un index accusateur contre sa poitrine virile.
— Tu ne m’aimes pas à la folie, Baldassarre. Ce que tu aimes éperdument, c’est l’aventure, le risque et l’idée de devenir un jour aussi puissant que tous ces condottieri sanguinaires auxquels tu voues une admiration sans bornes !
Même si sa colère était légitime, le jeune homme fut très froissé par ses propos et d’une voix faussement calme, il répliqua :
— Mon propre père a fait savoir au tien qu’une union entre nous deux ne serait pas avantageuse pour ta famille et qu’il fallait te marier au fils des Foscari pour élargir vos horizons. J’ai entendu leur conversation il y a six mois et, crois-moi, même si j’avais fait ma demande, nos deux pères auraient refusé, juste pour une question de profits. Nous vivons dans un monde où les gains et les honneurs sont plus importants que l’amour, Bea.
— Je pensais que les héritiers des marchands, aussi riches soient-ils, avaient plus de chance d’être heureux en mariage que les aristocrates. Apparemment non, nous sommes dans le même panier, sauf pour la distinction…
Son ton s’était fait moins puissant, mais résonnait toujours d’écœurement. Car oui, elle ressentait du dégoût pour la société dans laquelle ils vivaient tous, régie par les apparences, les titres de noblesse, la violence et l’argent. Comme beaucoup d’autres avant elle, Beatrice allait devoir sacrifier ses rêves d’adolescente pour épouser un homme qu’elle n’aimait pas, pendant que son ami de toujours, son amour défendu, parcourrai les champs de bataille en quête de victoire et de gloire. Si jamais il ne mourrait pas prématurément…
— Je ne veux pas que nous nous quittions tristes et pleins de rancœur, Bea, dit-il, après un autre silence lourd de tension et de révélations étouffées. Je veux emporter ton sourire et ta bonne humeur avec moi.
Un petit reniflement échappa à la jeune femme, comme si elle réprimait un sanglot, et tout en tapant du pied, elle releva la tête vers la sienne pour nouer leurs regards.
— Je suis désolée, Baldo, mais je n’ai pas le cœur à sourire alors que tu vas te jeter dans les bras de la Mort en me laissant seule ici, bientôt prisonnière d’une famille que je connais à peine.
Il contint de justesse un soupir d’exaspération. Beatrice pouvait être une vraie tête de mule quand elle le voulait.
— Bien… quittons-nous tristes et fâchés alors, dit-il en se reculant de deux pas pour échapper à son index accusateur et mieux envelopper son visage des yeux.
Même assaillie par de sombres sentiments, la jeune femme gardait sa beauté époustouflante. D’ailleurs, la moue qu’elle arborait en l’observant était irrésistible et il dut mordre l’intérieur de sa joue pour ne pas sourire de tendresse et ainsi briser l’austérité de son faciès. Non, il fallait qu’il gardât son sérieux pour atteindre son objectif, celui de l’émouvoir et de lui faire adopter une autre attitude.
— Tu seras toujours dans mon cœur, Bea. J’espère que tu penseras à moi de temps en temps.
Elle esquissa un hochement de tête en guise de réponse. Puis, le cœur battant la chamade, Baldassarre tourna les talons pour s’éloigner d’elle et atteindre la sortie des arènes. Ils n’étaient pas venus seuls dans le site antique, car Gianni, le grand gaillard muet qui servait de chaperon à l’adolescente, les avait accompagnés dans leur promenade et les observait au loin, assis sur l’une des marches de l’amphithéâtre romain.
Le jeune homme entendait les bruits de ses pas se répercuter dans ses oreilles à mesure qu’il s’éloignait d’elle et n’osait plus se retourner pour la regarder. En règle générale, quand ils se disputaient et qu’elle s’opposait à lui dans un silence offusquant, il faisait mine de partir en attendant d’être rattrapé… mais là, ferait-elle ce dernier pas ? La gravité de la situation ne l’avait-elle pas figée dans sa colère ?
Mon Dieu, Bea, ne me laisse pas partir comme ça…
Il commençait à perdre espoir, les dents serrées et luttant contre l’envie folle de rebrousser chemin pour la supplier de lui pardonner quand, tout à coup, sa belle voix autoritaire heurta son dos :
— Arrête-toi !
Baldassarre n’attendait que cet ordre et tourna aussitôt sur ses talons pour la voir courir dans sa direction, ses boucles sombres voletant derrière elle comme un étendard glorieux. Là, le jeune homme sentit son cœur partir au galop et, bientôt, ce furent ses jambes qui l’entraînèrent à toute vitesse vers elle pour la réceptionner telle une comète brûlante entre ses bras vigoureux. Le contact de leurs deux corps chauds et frémissants les enflamma et, dans un élan passionné, il encadra son visage de ses grandes mains pour souder leurs deux bouches avides. Ce baiser d’amour désespéré, d’une intensité presque douloureuse, leur donna le vertige en faisant pousser dans leurs reins les graines d’un désir si ancien et neuf à la fois. Combien de temps avaient-ils résisté à cet appel sensuel, à cette étreinte amoureuse ? Une éternité…
Pourtant, si c’était bien la première fois qu’ils s’embrassaient, ce baiser avait une saveur familière, rassurante, qui leur donna l’impression d’être nés pour cela. Mais en même temps, il avait un goût d’inédit, comme s’ils avalaient dans leur gorge les éclats de la lune et du soleil à la fois.
— Ne me quitte pas, Baldo… je t’en supplie…, le pria-t-elle entre deux baisers langoureux et mouillés de ses larmes incoercibles.
Le jeune homme sentit son nez le piquer, alors qu’il luttait contre l’envie de pleurer en écrasant plus violemment sa bouche contre la sienne.
Sois fort. Pour elle, pour toi.
— Je suis désolé, Beatrice… mon amour… tu dois me laisser partir.
Il y eut un sanglot pendant qu’il s’obligeait à se détacher de ses lèvres et de son corps, le cœur écorché et les yeux embués de larmes brûlantes. Elle ne résista pas très longtemps, certainement résignée par leurs sorts.
— Promets-moi de ne pas mourir, lui dit-elle quand il s’éloigna enfin, ses grandes mains écrasant aussitôt les larmes qu’il n’avait su retenir.
Baldassarre prit une profonde inspiration, luttant vainement contre la tristesse qui le submergeait, puis parla :
— Je te le promets, Beatrice.
L’instant d’après, sur un dernier regard humide, il lui tourna le dos et s’éloigna à pas précipités en la laissant seule au milieu des arènes de Vérone.
1
Printemps 1454
Vérone, Italie
La curiosité de Beatrice était si forte qu’elle ne parvenait pas à dormir à fermer l’œil de la nuit. Depuis quelques heures déjà, son esprit était accaparé par le petit coffre richement décoré qu’un homme au visage peu engageant avait remis à son époux dans l’après-midi. Fine observatrice, elle avait remarqué le regard singulier que Ludovico portait sur ce coffre et, quand elle avait tenté de lui soutirer une quelconque information, par des questions détournées, elle s’était heurtée à un silence exaspérant.
C’était la raison pour laquelle la belle Véronaise s’était décidée à trouver la réponse toute seule. Dans un mouvement silencieux, elle se redressa sur sa couche, puis décocha un coup d’œil à la silhouette étendue à sa droite. Langée dans des draps de coton blanc, la douce et jeune Bianca dormait sur le dos, les bras parfaitement étendus le long de ses flancs, prompte à réagir en cas d’intrusion nocturne. Depuis que Beatrice avait perdu son garçon de trois ans d’une maladie incurable, il y avait de cela un an, sa belle-fille mettait un point d’honneur à monter la garde auprès d’elle, se contentant désormais d’un repos léger.
Discrètement, Beatrice quitta le lit, mit de l’ordre dans sa chemise de nuit blanche, puis saisit sur la table de chevet une chandelle, qu’elle alluma avec un bout de suif.
— Mère, où vas-tu ?
La voix encore enfantine de Bianca, qui n’avait que douze ans, s'éleva telle une brise jusqu'à Beatrice et celle-ci se tourna dans sa direction pour lui murmurer, rassurante :
— Pas très loin, ma chérie. Dors, je serai là à ton réveil.
Aussitôt, la jeune fille aux longs cheveux mordorés retomba dans les bras de Morphée et la maîtresse de maison put quitter la pièce sans attendre. En premier lieu, elle déboucha sur le cortile du palais, dans lequel elle vivait depuis sept ans, faiblement éclairé par les candélabres fixés aux murs et par la pluie de lumière opaline que déversait la lune dans le patio. À cette heure avancée de la nuit, les corridors abritaient plusieurs convives somnolents, trop ivres pour atteindre les chambres qui leur étaient destinées, tandis qu’au loin, dans la salle de réception, résonnaient encore la musique et les rires des noceurs endurcis.
Grand amateur d’agapes, Ludovico Foscari, le richissime marchand auquel elle était liée devant Dieu et les hommes depuis ses dix-sept ans, avait coutume de recevoir ses amis une fois par semaine. En tendant l’oreille, Beatrice subodora la présence de son époux parmi eux, ainsi que celle d’Alvise Petroia, un bellâtre ambitieux qui exerçait une forte emprise sur la raison, mais aussi sur les sens du maître des lieux. Si l’homosexualité, que l’on désignait de manière plus poétique par « amour grec », était proscrite dans la société catholique italienne du XVe siècle, conduisant souvent à la peine de mort, certains s’y adonnaient discrètement en parvenant à échapper aux autorités religieuses.
Beatrice avait compris que son époux nourrissait ce genre de penchant sexuel, même si elle ne l’avait encore jamais pris sur le fait. C’était seulement son instinct féminin qui le lui soufflait.
Comme la jeune femme avançait vers le studiolo de son époux, un cabinet d’études indispensable pour tout homme nanti, dans lequel il collectionnait des objets de curiosité, la voix d’Alvise résonna au loin et elle ne put réprimer une moue de dégoût en songeant à ce vaurien qui lui inspirait une haine viscérale. Dès l’instant où cet homme avait fait son irruption dans la famille Foscari, une épée de Damoclès s’était comme établie au-dessus de sa tête et de celle de Bianca. En seulement un an, il avait changé son époux. Ce dernier n’avait jamais été vraiment proche d’elle, mais s’était toujours montré respectueux par le passé, jusqu’à l’arrivée de cet ami étrange.
Il ne fallut guère de temps à Beatrice pour atteindre le fameux studiolo. Une fois assurée qu’il n’y avait personne à l’intérieur, elle commença son inspection du bout de sa chandelle, caressant de la faible lumière les endroits susceptibles de dissimuler le coffret recherché. Après une poignée de minutes, elle crut l’apercevoir entre plusieurs ouvrages de la bibliothèque, mais ne put s’en assurer, car des bruits de pas se firent soudain entendre dans le couloir en se rapprochant de son emplacement.
Oh non !
Elle souffla aussitôt sur sa bougie et courut se tapir derrière la lourde tenture bleue qui couvrait la totalité d’un mur. Si son époux la découvrait ici, il la battrait fiévreusement à l’aide de sa férule, comme il l’avait fait quelques mois plus tôt lorsqu’elle s’était interposée dans une altercation entre Bianca et lui.
La porte du cabinet s’ouvrit l’instant d’après sur deux hommes.
— Messer Ludovico a caché le coffret sous une dalle de la cheminée, renseigna l’un des domestiques, en l’occurrence Mario, le valet du maître des lieux.
— Donne-le-moi.
Beatrice frissonna derrière la lourde tenture en identifiant la voix vipérine d’Alvise et son esprit fut soudain en proie à de multiples questions. Pourquoi donc venait-il chercher le coffret ? Son mari y aurait-il caché de l’argent, des pierres précieuses, des documents de haute importance ?
Tout à coup, un crissement de pierre se répercuta tel un râle sinistre contre les murs du studiolo, et un mauvais pressentiment, une menace invisible, s’empara étrangement de la jeune femme, comme si l’objet que contenait ce coffret pouvait représenter un danger pour elle.
— Penses-tu que ce sera efficace ? demanda bientôt Alvise.
— C’est de la Cantarella, un poison infaillible, sous l’effet duquel le corps humain ne peut pas combattre. Personne n'y résiste.
Un silence de plomb s’installa dans la pièce durant quelques secondes.
— Si personne n’y résiste, cette putain de Beatrice succombera donc une fois qu’elle en aura bu.
Putain de Beatrice ? Quoi ?
— Tout à fait.
— Le festin au bal des Monteverdi, dans deux jours, sera l’occasion parfaite. Les Monteverdi ont toujours été les grands rivaux des Foscari, même s’ils cherchent un semblant de paix depuis quelques mois… Si nous empoisonnons Beatrice au cours de ce festin, nous pourrons ensuite les accuser de l’avoir tuée pour affaiblir notre famille, et ainsi mener une vendetta contre eux. La mort de cette femme serait le prétexte idéal pour éliminer les Monteverdi et faire des Foscari les seuls maîtres de Vérone… Sans oublier qu’elle laisserait la place à une autre épouse bien plus malléable et dotée d’un titre de noblesse qui soulignerait la puissance des Foscari. Car, il ne leur manque plus qu’un blason prestigieux.
Quel fils de catin !
Un cri d’effroi manqua de franchir les lèvres de Beatrice, mais son instinct de survie lui intima le silence. En réalité, elle était figée de stupeur et semblait s’être fondue dans la pierre contre laquelle son corps s’appuyait.
Cette scène était-elle réelle ou était-elle en proie à un cauchemar ?
— Garde la fiole de Cantarella sur toi, Mario. Il ne faudrait pas que la maîtresse de maison tombe dessus avant ce fameux repas. Si tu accomplis cette besogne en gardant le secret, crois-moi, tu seras généreusement récompensé. A contrario, ta femme et toi serez torturés jusqu'à ce que vous trépassiez. Suis-je bien clair ?
— Très clair.
L’instant d’après, la porte du studiolo se referma sur les deux hommes, désormais dans le corridor, et Beatrice se retrouva de nouveau seule dans l’obscurité, totalement pétrifiée par l’horreur et l’aversion qui l'enivraient. Elle ne respirait plus, mais haletait sous l’effet de la peur et la brutale montée de haine. Oui, elle tremblait d’un instinct meurtrier jusqu’ici insoupçonné. Son front était fiévreux, son cœur cognait dans sa poitrine tel un démon enchaîné aux flammes, tandis que les jointures de ses mains blanchissaient sous la force des crispations. Elle pensa s’évanouir de rage et d’anxiété mêlées, mais se ressaisit instantanément, dorénavant habitée par un sang-froid diabolique.
Si quelqu'un devait rejoindre le Royaume des Morts, le soir du bal, ce ne serait certainement pas elle.
Non, vous ne vous débarrasserez pas de moi ainsi…
* * *
Quelques heures plus tard, à l’aube
Baldassarre se réveilla brusquement en se redressant sur sa couche, embrumé par les traces encore vives d’un mauvais rêve. Son front était brûlant, sa chemise humide et ses yeux cernés de fatigue. Depuis combien de temps n’avait-il pas connu de nuit entière, reposante ? Des années, peut-être…
Le regard dans le vague, il chercha un quelconque réconfort dans la chambre immense qu’on lui avait attribuée depuis qu’il était revenu à Vérone, sa ville natale, mais n’en trouva aucun. De toute évidence, qu’est-ce qui pouvait bien le réconforter maintenant que l’angoisse et la solitude l’habitaient depuis qu’il avait appris le décès de ses parents ? Cela faisait trois mois qu’ils n’étaient plus de ce monde, et depuis qu’il avait appris cette triste nouvelle la veille, la culpabilité le rongeait tout entier. Pourquoi les avait-il tous abandonnés ? Pourquoi s’était-il volontairement égaré dans les tourments de la guerre alors qu’il avait une famille, une situation stable et un amour ici, dans cette ville qui l’avait vu naître ? Sa terrible ambition et son désir de reconnaissance lui étaient-ils montés à la tête, au point de négliger toutes les personnes qui comptaient vraiment pour lui ?
Malheureusement, oui.
Et le pire était qu’il n’avait pas vraiment donné de nouvelles ces dernières années, si bien que tout le monde avait fini par croire qu’il avait trouvé la mort sur un champ de bataille, au sud de la péninsule italienne. Un peu plus tôt dans la soirée, l’un de ses frères aînés lui avait avoué que ses parents n’avaient jamais cessé de prier pour lui durant ces sept longues années d’absence, pendant qu’il répandait la mort sur son chemin, s’encanaillait avec ses hommes et traînait de lupanar en lupanar.
Tu n’es qu’un bon à rien…, se dit-il mentalement, en se rallongeant sur le lit qui appartenait autrefois à ses parents.
En effet, depuis la rumeur de sa mort, les appartements qu’il occupait jadis dans le palais de son père avaient été attribués aux fils de son grand frère, et il n’avait récupéré la chambre parentale qu’à titre provisoire. Son retour n’avait pas été particulièrement bien accueilli par ses trois frères aînés, et il ne devrait pas tarder à repartir d’ici. La vieille rancœur qui écartelait sa fratrie était si profonde qu’il était désormais impossible de revenir à l’époque de leur enfance. Heureusement qu’il s’était forgé sa propre fortune au cours des dernières années de guerres.
Le plus âgé de ses frères, qui était désormais le propriétaire du palais et le maître absolu dans des affaires familiales, l’avait informé qu’il n’était pas cité dans le testament de leur père, étant donné qu’il le croyait mort. Néanmoins, leur mère l’avait mentionné par symbolisme et lui avait légué une grande propriété fermière près de Spolète, en Ombrie, d’où elle était originaire.
Grâce à la générosité de sa défunte mère, il avait désormais une propriété, même s’il ignorait l’état dans lequel il la trouverait. À vrai dire, cela lui importait peu. Il avait seulement besoin de se recueillir sur le sépulcre de ses parents, établi dans l’une des chapelles privées de la basilique San Zeno.