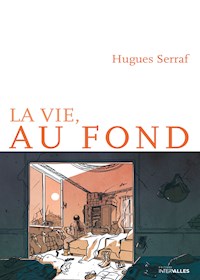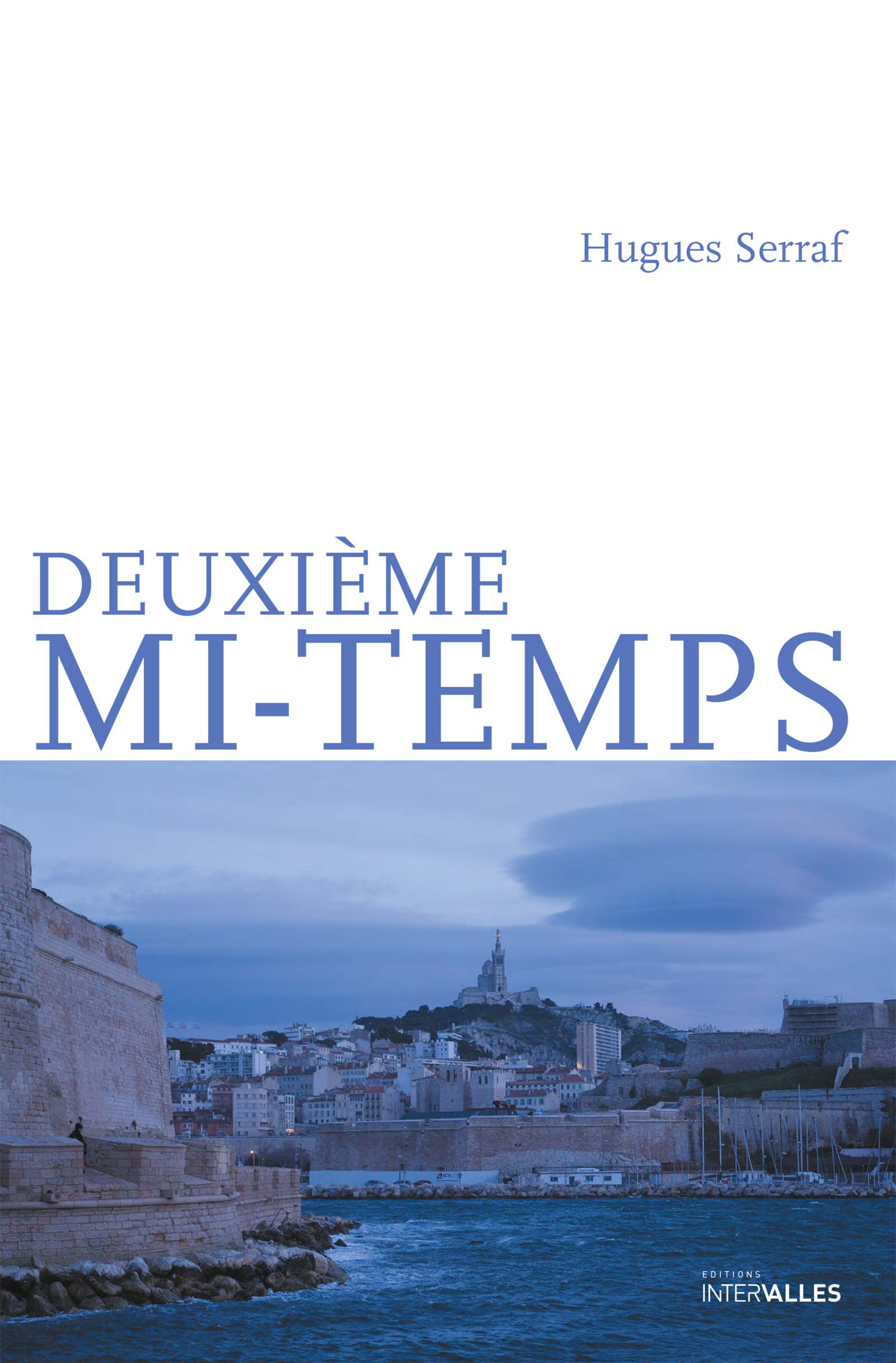
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comme le héros de
Deuxième mi-temps, Hugues Serraf a quitté Paris pour Marseille et un métier normal pour la littérature. Comme lui, il aimerait bien que sa nouvelle carrière décolle avant d’avoir mangé toutes ses économies.
Est-ce la raison pour laquelle son héros écrit des thrillers quand lui préfère s’adonner à la comédie sentimentale ?
Simultanément émouvant, désopilant, déprimant voire touristique et parfois même par inadvertance pédagogique,
Deuxième mi-temps est son troisième roman, mais ne parle surtout pas de foot.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
« Il croque son monde avec distance et bienveillance, et nous emmène avec lui visiter la cité phocéenne. »
Yaël Hirsch, Toute la Culture
« Porté par un langage vif et décontracté, c’est aussi la leçon de vie d’un homme qui se réinvente à une période que certains nomment l’automne de la vie. »
Daniel Fattore
« léger et enlevé »
Lyvres.fr
À PROPOS DE L'AUTEUR
Hugues Serraf est journaliste et écrivain. Après
Deuxième mi-temps, paru aux éditions Intervalles en 2018,
Le Dernier juif de France est son quatrième roman. Un roman qui parle d’une presse en déroute et de juifs ordinaires en proie au doute dans une France qui ne l’est pas moins. Un roman qui choisit le ton de la comédie pour traiter de sujets ô combien essentiels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Ce livre est un ouvrage d’imagination. Toute ressemblance ou similitude avec des personnes
À tous ceux qui font ce qu’ils peuvent, ce qui doit faire pas mal de monde.
Et pour Gilles aussi, bien sûr.
To love is to suffer. To avoid suffering one must not love. But then one suffers from not loving. Therefore, to love is to suffer ; not to love is to suffer ; to suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy, then, is to suffer, but suffering makes one unhappy. Therefore, to be happy one must love or love to suffer or suffer from too much happiness.
Woody Allen, « Love and Death »
« Aimer, c’est souffrir. Pour éviter de souffrir, on ne doit pas aimer. Mais on souffre alors de ne pas aimer. Donc, aimer c’est souffrir ; ne pas aimer, c’est souffrir ; souffrir, c’est souffrir. Être heureux, c’est aimer. Être heureux, donc, c’est souffrir, mais la souffrance rend malheureux. Donc, pour être heureux, il faut aimer, ou aimer souffrir, ou souffrir d’être trop heureux. »
Woody Allen, « Guerre et Amour »
I
Esther prétend que je me comporte comme un connard avec les femmes, précisément parce que je ne me comporte pas comme un connard. « Tu leur fais miroiter des trucs que tu n’as pas l’intention de leur donner pour de bon, elle explicite en harponnant ses petits pois un par un dans son assiette avec sa fourchette. Les mecs qui ne pensent qu’à tirer leur coup, c’est glauque, mais au moins ça a le mérite d’être clair. Toi, les nanas, tu les emmènes randonner dans les calanques, tu les invites à dîner ou au théâtre et tu dors toute la nuit avec elles au lieu de rentrer chez toi sur ton p’tit vélo à deux heures du matin après l’amour comme un connard honnête. Elles se mettent à y croire et, paf, en route pour de nouvelles aventures, comme Lucky Luke dans le soleil couchant à la fin d’un album… »
Esther, c’est ma sœur. Je lui raconte mes histoires et elle me raconte les siennes, qui sont généralement moins rock’n’roll parce qu’elle habite dans un petit patelin des contreforts du Luberon où il ne se passe pas grand-chose et qu’elle est moins portée sur le marivaudage de toute manière. Ça n’a pas toujours été comme ça. Enfants, et même ados, on ne pouvait pas se supporter. C’est mon divorce et la mort quasi-simultanée de son mari cinq ans plus tôt qui nous ont rapprochés. Et aussi mon débarquement dans le sud il y a dix-huit mois. De temps en temps, on se retrouve à Aix pour déjeuner parce que c’est à mi-chemin, que je peux y aller en bus et qu’elle ne veut pas descendre jusqu’à Marseille en voiture à cause de sa phobie des autoroutes. On parle de ceci et de cela, de nos gosses, de ses tableaux (elle est peintre), du nouveau roman que j’ai en chantier et, surtout, de la façon dont on gère nos deuxièmes mi-temps respectives.
L’arrangement me convient parce que j’aime bien venir à Aix. J’ai même failli m’y installer en quittant Paris : je trouvais que c’était plus civilisé que Marseille, avec de belles pierres chargées d’histoire, des boutiques chics tenues par des blondes en Louboutin, des autos bien rangées le long des pointillés et des papiers gras dans les poubelles plutôt qu’à côté. Mais ç’aurait été une sacrée erreur parce que c’est minuscule, qu’il y fait systématiquement cinq degrés de moins qu’en bord de mer et que, justement, il n’y a pas la mer…
Au dessert – Esther a pris la tarte aux fraises maison et moi le fondant industriel au chocolat qui a le même goût que celui de chez Picard surgelés –, je lui parle de la femme que je viens tout juste de rencontrer et elle lève les yeux au ciel : « Ah bon, une nouvelle ? Déjà ? Fais plutôt un break. Ça te fera du bien et aux nanas aussi… » Mais non, je ne peux pas. Je suis dans une quête : comme Perceval cherche le Graal, je cherche l’âme sœur. Oh, je croyais bien l’avoir trouvée, je me suis même marié avec, mais elle n’était manifestement pas l’authentique calice divin parce qu’elle m’a plaqué au bout de vingt ans pour un accordéoniste argentin. J’ai été très malheureux, j’ai même carrément voulu mourir comme dans une reprise d’Alanis Morissette sur la fin de l’amour dans The Voice, puis je m’en suis remis comme dans un article de Boris Cyrulnik sur la résilience dans Psychologie magazine. Et depuis, je cherche. C’est ma nouvelle mission dans la vie. Ça et devenir un écrivain célèbre, bien sûr.
« Tu pourrais aussi apprendre à être un peu seul », suggère Esther en enfilant sa veste pendant que je compose mon code de Carte Bleue sur le terminal que me tend le serveur des Deux Garçons, la grande brasserie locale à la parisienne, parce que c’est moi qui régale aujourd’hui. « Regarde, moi, pour le moment, ça me convient parfaitement. Ça me laisse du temps pour réfléchir…
— Je passe déjà ma vie à réfléchir. Mais j’ai besoin d’être à deux et d’être amoureux. Tout seul, je m’emmerde. Je trouve que la vie est moins intéressante.
— Avec les femmes aussi, apparemment, vu le temps que ça dure et la rapidité du turn-over…
— Bah, c’est parce que j’ai pas encore rencontré la bonne, voilà tout. Cent fois sur le métier… »
D’abord, ça n’est pas complètement vrai. Ça peut durer. Un peu. Après mon divorce, j’avais rencontré une femme dont j’étais tombé amoureux pour de vrai, mais elle était plus jeune, n’avait pas d’enfants, en voulait un, moi pas, et ça s’était terminé dans les cris et les larmes au bout d’une année particulièrement intense. Des enfants, j’en ai déjà deux. Deux filles. Deux grandes qui font leur vie. Je n’avais pas envie de recommencer. J’ai cinquante-deux ans, merde ! Je suis trop vieux pour repaterner.
« Et c’est qui, alors, la nouvelle ?
— Une Irlandaise. Elle s’appelle Siobhán…
— Drôle de nom. D’où tu la sors ?
— C’est un prénom gaélique. En Irlande, toutes les nanas s’appellent comme ça. C’est comme Fatoumata pour le Mali si tu veux. Je l’ai rencontrée dans un pub sur le Vieux-Port. Elle est de Galway mais elle vit en France depuis une dizaine d’années.
— Et c’est du sérieux ?
— … »
*
En sortant du restaurant, on descend le cours Mirabeau jusqu’à la petite rue où Esther avait laissé sa voiture et j’en profite pour jeter un coup d’œil aux affiches sur la devanture du Renoir. L’unique vrai point noir de ma nouvelle vie marseillaise, c’est le cinéma. Il n’y a pas beaucoup de salles, la programmation n’est pas terrible et Aix est nettement mieux lotie parce que c’est ici qu’habitent les intellos au pouvoir d’achat élevé et les expats qui exigent des films en VO.
« Ah tiens, regarde, il y a le nouveau Woody Allen ! Je vais aller le voir avant de reprendre le bus. Tu n’as pas envie de venir ?
— Ben non. Il faut que je retourne bosser. Je suis pas rentière, moi… »
Je ne suis pas exactement rentier non plus, mais je vis effectivement sur le fric de la vente de mon appartement à Paris, ce qui me permet de tester la vie d’écrivain à temps complet sans trop me poser de questions. Si je ne deviens pas Maupassant, Houellebecq ou même Guillaume Musso avant d’avoir tout mangé, je rentrerai probablement la queue basse dans la capitale pour y reprendre le cours de ma vie de journaliste, si on veut encore de moi, ou je m’inscrirai au RSA comme un Marseillais sur trois. On verra bien. Esther, elle, ne vit pas de sa peinture ; à la mort de Philippe, son mari, qui faisait bouillir la marmite car il était chef-cuisinier, elle s’est trouvé un job à la con dans une compagnie d’assurances qui paye les traites et les courses chez Leclerc, mais n’encourage pas spécialement à aller au cinoche pendant les heures de bureau. Elle ne peint plus que le week-end et pendant les vacances.
*
En sortant du Renoir après le film, je m’achète une petite bouteille d’eau minérale dans un kiosque à sandwiches et je marche jusqu’à la gare routière flambant neuve où je chope la navette in extremis. C’est l’heure de pointe et elle est remplie d’étudiants en socio trop pauvres pour habiter Aix qui rejoignent leurs studettes du cours Julien après les T.D. L’A7 est embouteillée comme d’habitude, mais ça ne me dérange pas parce que j’aurai largement le temps de repasser par chez moi, et de prendre une douche ou même de manger un morceau avant de retrouver Jérôme et son pote à l’Uppercut. J’écoute les concertos brandebourgeois au casque dans mon iPhone et je regarde le paysage défiler à travers la vitre, l’apparition des premiers murs anti-bruit tapissés d’affiches du Front national et de barres HLM miteuses aux balcons décorés de linge mis à sécher signalant l’entrée dans le périmètre phocéen. Derrière moi, deux Chinoises minuscules papotent à toute allure en mandarin et je me demande ce qu’elles se racontent.
Débarquant gare Saint-Charles, je choisis de rentrer à pied plutôt qu’en métro et je traverse le parvis crasseux jusqu’aux grands escaliers du Potemkine surplombant le boulevard d’Athènes et ses petits hôtels borgnes, quand un gringalet balafré en sweat à capuche m’interpelle : « Eh l’ancien, tu cherches du shit ? »
Je crois bien que c’est la première fois de ma vie qu’on m’appelle « l’ancien ». Je préfère quand la boulangère me gratifie d’un « jeune homme » en me rendant la monnaie, ce qui arrive encore à l’occasion malgré mon crâne chauve, et je me dis que le dealer manque de fibre commerciale tout en hochant la tête pour lui signifier que non, c’est gentil, mais l’ancien ne cherche pas de shit, merci. C’est marrant, d’ailleurs, parce que dans cette ville où des types roulent des pétards à chaque coin de rue et où d’autres s’entretuent à la Kalachnikov pour le contrôle d’une zone de chalandise cannabique, je n’ai toujours pas de fournisseur local et je continue de m’approvisionner à Paris. Non pas que je sois un si grand consommateur – ça serait même plutôt en train de me passer, à vrai dire, parce que ça me démotive et que ça m’empêche de me concentrer sur mon grand œuvre –, mais j’aime bien avoir une petite réserve à la maison pour les soirées entre amis.
*
Des poubelles débordent sur mon trajet et je me demande si une nouvelle grève-surprise des éboueurs ne vient pas d’être déclenchée, mais ça ne prouve rien parce que les poubelles débordent toujours un peu à Marseille. Et la différence entre un jour de grève et un jour normal n’est pas forcément flagrante. Sur la Canebière, entre la bouche de métro et le commissariat de Noailles, des punks à chiens s’embrouillent en polonais à propos d’un pack de 8.6 et je dois traverser la rue pour les contourner et récupérer le boulevard Garibaldi en direction de la Plaine.
C’est une belle fin d’après-midi d’octobre, il fait bon, chaud même, et je jette un coup d’œil à l’appli météo de mon téléphone pour vérifier le temps qu’il fait dans la capitale (7°C, averses fréquentes). Apercevant mon reflet en T-shirt dans la vitrine d’une agence immobilière, je souris stupidement en me figurant Ménilmontant sous le crachin froid et des gens en doudounes qui cavalent en faisant la gueule.
Dans ma rue, je décide même de m’arrêter quelques minutes à la terrasse du bar-tabac où j’ai désormais mes habitudes, histoire de profiter encore un peu du soleil et de la lumière avant de rentrer. C’est un vrai rade à l’ancienne comme on n’en voit presque plus à Paris, avec du mobilier en formica, un coin PMU, des toilettes médiévales dont on demande la grosse clé rouillée au comptoir et quelques tables alignées sur l’une de ces vraies-fausses pistes cyclables que la mairie fait tracer sur les trottoirs comme contribution sarcastique aux objectifs de la COP21. Dans ma vie d’avant, je n’avais pas vraiment de café attitré. Je papillonnais entre les bistrots branchés de la rue Oberkampf et les repaires de hipsters du canal Saint-Martin. Ici, je m’installe pratiquement tous les jours à la même terrasse pour lire les faits divers et l’horoscope dans La Provence et assister aux conférences politico-footballistiques de types qui ont l’air d’être là quelle que soit l’heure – ou du moins quelle que soit l’heure à laquelle je débarque, ce qui revient au même parce que je n’ai pas l’emploi du temps d’un ministre non plus.
Je paie mon express. 1,30 euro. La première fois, j’ai cru que le serveur s’était planté mais, depuis, j’ai même trouvé une terrasse près de l’église Notre-Dame-du-Mont où le café n’est qu’à 1,10. Je dis au revoir à la grosse dame à laquelle je demande toujours du feu (parce que je n’en ai jamais et que c’est devenu une sorte de petite routine entre nous), et je parcours les derniers mètres jusqu’à la porte de mon immeuble où je tombe sur monsieur Demirbag, mon voisin du dessus, en train de partir au boulot. Il est gentil, monsieur Demirbag, mais il commence à me gonfler un poil tout de même parce que sa baignoire a provoqué un dégât des eaux dans ma salle de bains et mes toilettes et qu’il n’a toujours pas rempli le formulaire de l’assurance que je lui ai pourtant donné huit jours plus tôt.
« Salut, ça va ? Et, hum, euh… On en est où pour ce fameux papier ?
— Bonsoir voisin ! Je m’occupe, je m’occupe… Là j’ai pas eu le temps à cause beaucoup beaucoup travail, mais je m’occupe. Demain matin, je le mets tout rempli dans ta boîte aux lettres. C’est sûr, là ! »
C’est un tout petit bonhomme qui a l’air assez dépassé par les événements ; un Kurde de Turquie avec une grosse moustache à la Saddam Hussein et un accent à couper au yatagan, qui tient un kebab quelque part du côté du stade Vélodrome où il n’arrête pas de m’inviter – mais je n’ai pas encore eu l’occasion d’y passer. Je ne veux d’ailleurs pas trop l’accabler parce qu’il a déjà suffisamment de problèmes dans cet immeuble semi-bourgeois où il n’est pas très apprécié à cause de sa femme qui porte le voile, de son môme super bruyant et des draps qu’il met à sécher à la fenêtre côté rue alors que c’est strictement interdit par le règlement de copropriété. Il paraît même que le syndic fait du lobbying auprès de son propriétaire pour qu’il ne lui renouvelle pas son bail lorsqu’il arrivera à échéance.
« Je compte sur vous pour le papier, hein, je ne peux pas faire repeindre tant que je ne l’ai pas renvoyé à mon assureur…
— Demain je m’occupe ! Promis, voisin ! Demain ! T’inquiète pas ! »
II
L’Uppercut, c’est le club de jazz du haut de la rue Sainte, dans le septième, d’où Jérôme démarre toutes ses soirées de goguette. Il ne le fréquente pas spécialement pour la musique, vu qu’il serait plutôt amateur de heavy metal, mais parce qu’il y a du bon whisky et qu’il a un faible pour la patronne, une grande brune au look de Pocahontas. Lorsque je débarque un peu après neuf heures, il en est d’ailleurs déjà à son deuxième Lagavulin seize ans d’âge et termine d’élaborer le programme des festivités du jour avec le gros Kader, son fidèle Sancho Pança.
« Eh ben tout de même ! On n’allait plus tarder à décoller, mais on a encore le temps de s’en jeter un dernier pour la route. Avec Kader, on se disait qu’on irait faire un tour aux Demoiselles du Cinq finalement. Il y a un concert.
— Désolé pour le retard, j’ai passé la journée à Aix et j’ai un peu traîné en rentrant, je réponds en attrapant un tabouret pour m’asseoir à côté d’eux au comptoir. C’est un concert de quoi ?
— Je sais pas. De musique. De toute manière, y a dégun ici ce soir. C’est pas la peine de rester plus longtemps.
— Ah bon. OK. »
Je commande un Coca Zero sous son regard narquois de maltophile et je jette un coup d’œil à la petite salle aux trois-quart vide : « Hum, effectivement, y a pas foule. Et au sous-sol, il n’y a pas un truc ? On est pourtant jeudi…
— Ouais, il devait y avoir un groupe mais ils ont annulé au dernier moment. C’est Marseille, quoi… »
Jérôme a un gros problème avec sa ville natale, qu’il trouve trop provinciale et manquant d’animation nocturne. Il se délocaliserait bien à Paris mais ne peut pas, du moins pas encore, rapport au rejeton de huit ans dont il partage la garde avec son ex-femme. Agrégé de maths au lycée Thiers, le Henri-IV de la région, il enseigne l’algèbre linéaire et les polynômes d’endomorphisme à des élèves de prépa qu’il juge également inférieurs à leurs homologues de la capitale et n’arrive pas à comprendre ce qui a pu me pousser à prendre le TGV en aller simple. Je lui réponds que c’est à cause des calanques, de la mer et du soleil, mais ça ne le convainc pas parce qu’il n’est pas spécialement porté sur la nature et ne fréquente la plage que par obligation paternelle. Été comme hiver, il trimbale sa silhouette d’échalas quadragénaire dans un costume de vampire – veste et chemise noires, jean anthracite et Doc Martens vernies – de bar de nuit en bar de nuit, pestant contre les chaussées défoncées qui niquent les suspensions de sa BMW Série I, la pauvreté de la vie culturelle et le manque de sophistication des Marseillaises qu’il tente d’emballer avec plus ou moins de succès au cours de ses tournées.
Kader, ex-moniteur d’auto-école en fin de droits (il a perdu son permis, et subséquemment son job, pour conduite en état d’ivresse et coups et blessures volontaires sur la personne du pandore qui le contrôlait), ayant un peu bourlingué lui même, est d’accord : « Ouais, Marseille, ça craint un max. Y a rien à y faire ! » Mais d’un autre côté, Kader est toujours d’accord avec Jérôme. D’autant plus que c’est lui qui a la voiture et les ronds pour le whisky.
Je suppose que les couche-tard sont effectivement plus à la fête à Paris qu’à l’ombre de la Bonne-Mère, même si l’idée que l’herbe soit plus verte dans le pré d’à côté est une constante, comme on doit dire dans les cours de maths sup de Jérôme. Mais je suis loin d’être un oiseau de nuit et l’offre locale suffit amplement à mes besoins. C’est sûr, en dehors d’une poignée de micro-secteurs relativement animés, Marseille a plutôt tendance à se coucher tôt avec ses rues désertes bordées d’immeubles aux lumières éteintes et aux volets clos dès onze heures du soir.
*
« Putain, on est la deuxième ville de France et il s’y passe moins de trucs qu’à Dijon ou à Clermont-Ferrand, peste Jérôme, décidément particulièrement remonté sur la question aujourd’hui, pendant que nous grimpons dans sa voiture, garée n’importe comment sur un trottoir derrière l’abbaye Saint-Victor. Vivement que je puisse demander ma mutation et me barrer !
— Euh, en fait, je rectifie juste pour le faire chier, c’est Lyon qui est la deuxième ville de France. Si on tient compte de l’agglomération, c’est beaucoup plus peuplé, il me semble. »
Mais ça, c’est un truc que j’ai vite remarqué : les Marseillais sont les seuls à avoir le droit de dénigrer leur ville en public. Et ils n’apprécient pas franchement qu’un Parigot se permette d’en rajouter une couche.
« Lyon ? Plus peuplé que Marseille ? Dans tes rêves !
— Ouais, n’importe quoi ! » renchérit Kader depuis la banquette arrière.
Une demi-heure plus tard – soit dix minutes d’un trajet que nous aurions pu faire à pied en autant de temps, plus vingt autres à chercher un passage piéton encore disponible sur lequel parquer la petite BM blanche –, nous faisons notre entrée aux Demoiselles du Cinq, un drôle d’endroit un peu défraîchi, mi-bar mi-boîte, planqué dans une ruelle pentue du quartier de Noailles. Là, pour le coup, il y a du monde, beaucoup de monde même. Ça boit, ça fume comme avant la loi Évin, ça danse au son de la musique électro produite par un trio d’ados en transe psychotropique et nous descendons au sous-sol où le deuxième bar est généralement plus facile d’accès. Ça n’est pas le même public qu’à l’Uppercut, qui est plus âgé et plus bourgeois, ambiance jazz oblige, mais il y a tout de même des vieux dans notre genre parce que les gens se mélangent davantage ici qu’à Paris – ce que je fais remarquer à Jérôme comme un atout.
« Tu parles, c’est juste parce qu’ils n’ont nulle part où aller !
— Bah, moi je préfère voir le verre à moitié plein… »
Kader nous a déniché une petite table et trois tabourets bancals dans un recoin pendant qu’on commandait au bar – j’ai repris un Coca Zero, les deux autres sont restés au whisky mais ont dû accepter de descendre en gamme en passant au JB – et on a pu se poser malgré l’affluence et le gang de Travolta sous ecstasy faisant leur show sur la piste.
« Alors, avec ton Irlandaise, comment ça évolue ? me demande Jérôme en sirotant son blend de grande distribution. Ti’aurais dû nous l’amener pour faire les présentations.
— Elle n’est pas à Marseille en ce moment. Elle est en voyage d’affaires. Elle ne rentrera que dans quelques jours.
— Ah bon, en voyage d’affaires ? Tu m’en diras tant… Et qu’est-ce qu’elle fait encore dans la vie ?
— Elle est consultante pour des multinationales d’agrochimie. Elle homologue des molécules d’engrais et de pesticides. Elle m’a expliqué tout ça en détail mais j’ai pas tout retenu. Là, elle est chez un client en Allemagne.
— Et donc, c’est le grand amour ?
— Disons que ça se passe pas trop mal…
— Bon mais c’est toujours pas The One, quoi…
— Je pense pas.
— Pourquoi tu prolonges alors ?
— On s’entend bien. Et puis on sait jamais… »
Jérôme, depuis son divorce, est un peu dans la même quête que moi, mais en plus cynique, en moins chevalier de la Table ronde. Trouver une nana « sans prise de tête », c’est son critère numéro un. Une qui puisse l’accompagner à l’occasion dans ses tournées des grands-ducs, mais ne pas trop lui briser les gonades lorsqu’il préfère les faire en solo. Je lui dis que ça sonne un peu adolescent, comme ambition, mais ça le fait rigoler parce qu’il pense que, bien au contraire, c’est moi qui n’ai pas encore assez de sagesse et d’expérience pour avoir vraiment déconstruit la vérité profonde de la relation homme-femme, qui est que ça ne peut tout simplement pas marcher. « Dans un monde idéal, tout le monde serait homosexuel, en fait. Les filles pourraient se concentrer entre elles sur leurs émotions subtiles et complexes et les mecs sur le whisky, le foot, le rock et la guerre, il plaisante à demi.
— Parfaitement ! beugle Kader en écho en levant son verre de JB.
— Bon et ton dernier bouquin, il marche comment ? demande Jérôme pour parler d’autre chose. Ti’as des retours ? Il se vend ou pas ? » Ça le préoccupe parce qu’il écrit, lui aussi. Enfin surtout des manuels d’enseignement des structures algébriques qui doivent l’aider à obtenir un détachement à la fac dans un premier temps, mais il a d’autres prétentions plus littéraires, lorgne du côté de Bukowski auquel il s’identifie notoirement, et observe mes efforts de reconversion du journalisme vers la littérature avec grand intérêt.
« Pas trop mal d’après mon éditrice, même si elle reste floue sur les chiffres pour ne pas me démoraliser. J’ai pas eu beaucoup de presse encore ce coup-ci, mais les libraires ont l’air de faire leur boulot et je me bouge le cul sur le service après-vente… Tiens, d’ailleurs, j’ai une signature dans un salon près de Paris le mois prochain. T’as qu’à monter avec moi, tu pourras te bourrer la gueule sur les grands boulevards pour changer !
— Ouais, ça serait sympa mais ça m’étonnerait que ce soit possible avec tous les trucs que j’ai à faire. Je bosse, moi. Je suis pas rentier…
— Celle-là, on me l’a déjà faite aujourd’hui. Faudrait songer à vous renouveler…
— Et le nouveau roman, ça avance ?
— Bof, ça suit son bonhomme de chemin. Je suis un peu bloqué ces jours-ci…
— Hé hé, c’est pas encore The One de ce côté-là non plus alors ?
— Non. De toute façon, je suis encore en phase d’apprentissage. Mon œuvre majeure, ça sera celle d’après. C’est prévu comme ça. Enfin, là aussi, on ne sait jamais… »
*
Vers minuit, l’électro et la cohue commencent à me taper sur le système et je me prépare à partir malgré la proposition de Jérôme de déménager au Trolleybus, une boîte du quai de Rive-Neuve configurée comme le dédale des couloirs du métro à Châtelet, mais où l’alcool serait de meilleure qualité et où on trouverait des meufs garanties sans prise de tête. « Bof, le Coca Zero aura le même goût là-bas, je réponds. Et je veux me lever tôt demain.
— Ti’es vraiment un vieux, toi, il ricane. Moi j’ai cours à huit heures mais je sens bien la nuit blanche.
— Ouais t’es vraiment un jeune, toi. Ça doit d’être encore au lycée à ton âge… »
J’enfile mon blouson, je prends congé et me fraye un chemin à travers la foule pour ressortir de la boîte. Devant le sas, parce qu’ils font trop de bruit et que les riverains vont encore appeler les flics, le gros vigile black engueule les fumeurs qui, incommodés par le tabagisme ambiant, sont venus en griller une dehors. Je remonte la rue de l’Arc vers le cours Lieutaud, prenant bien garde à marcher au milieu de la rue, histoire de ne pas me retrouver nez à nez sur le trottoir avec l’un des ces gros rats gris qui prennent le contrôle de la ville la nuit venue. J’imagine qu’ils ne sont pas vraiment plus nombreux ici qu’à Paris, – ou même à Lyon si on va par là et qu’on ne veut vexer personne –, mais certainement plus visibles, galopant d’un conteneur à ordures à l’autre sans souci de discrétion.
L’autre soir, un énorme spécimen bien flippant de rattus norvegicus que j’avais d’abord pris pour un chat de gouttière a tranquillement remonté un grand bout de la rue Consolat avec moi, lui côté impair, moi côté pair, avant de s’engouffrer dans le soupirail d’une pâtisserie.
C’est Marseille, dirait Jérôme.
III
J’émerge un peu après neuf heures, j’avais oublié de programmer mon radio-réveil. Je n’aime pas me lever trop tard à Marseille. J’ai toujours l’impression de louper quelque chose si je ne profite pas suffisamment de la lumière et que je n’ai pas l’occasion d’aller faire au moins une petite virée près de la mer dans la journée. Il arrive qu’il fasse froid l’hiver – on est dans les Bouches-du-Rhône, pas dans le sud de la Floride – mais la lumière est toujours là.
En quelques mois, je me suis d’ailleurs bricolé une vraie routine d’écrivain professionnel (pour les jours que je ne consacre pas à la glande pure et simple) : debout à sept heures ; quarante-cinq minutes de transpiration à la salle de gym du coin de la rue, France Culture dans les oreilles, pour tenir simultanément la dégradation de ma carcasse de demi-centenaire et l’inexorable nécrose de mes neurones en respect, d’autant plus que je ne cours pas en ce moment et que j’ai tendance à replonger dans l’addiction à la clope que je croyais avoir définitivement vaincue quinze ans plus tôt ; café-tartines au comptoir de ma cuisine américaine et douche express avant d’enfourcher mon vélo pour pédaler jusqu’au bureau. Enfin, jusqu’aux archives municipales, juste derrière la Friche de la Belle-de-Mai.
Ça ne vaut pas la bibliothèque Mazarine, quai de Conti, ou même Sainte-Geneviève au Panthéon, où j’allais régulièrement me poser avec mon ordi avant mon exil parce que le voisinage des académiciens me donnait l’impression de faire partie du club, mais il n’y a pas ce genre d’endroit à Marseille. Pas de temple classique avec fresques au plafond, moulures tarabiscotées et kilomètres de rayonnages garnis de vieux bouquins reliés cuir et dorés sur tranche. Les archives – une ancienne usine de la Seita plutôt pas mal réhabilitée dont je suis le seul visiteur régulier, même si je partage parfois la vaste salle de lecture avec un ou deux messieurs d’âge avancé prenant des notes pour la rédaction d’un précis d’histoire micro-locale – me conviennent pourtant parfaitement : je n’ai pas besoin de remballer mon laptop pour aller m’intoxiquer à la nicotine sur la terrasse ou descendre prendre un café au bistrot du bas de la rue Clovis-Hugues. Qui me le piquerait ? Les historiens amateurs ? Ils écrivent tous au stylo-plume.
J’ai bien déniché un autre lieu avec davantage de cachet, la minuscule bibliothèque de poésie de la Vieille Charité dans le quartier du Panier, mais elle n’ouvre que l’après-midi et encore pas tous les jours, et le Wifi y est aléatoire. De toute manière, j’étais bloqué à la maison ce matin parce que l’entrepreneur envoyé par la compagnie d’assurances doit se pointer entre dix heures et midi pour faire son devis : monsieur Demirbag a fini par me remplir le formulaire et les travaux devraient pouvoir commencer. Et en plus, j’ai promis à Siobhán d’aller la chercher à l’aéroport en fin d’après-midi, alors j’écrirai d’ici.
Ça ne me dérange d’ailleurs pas plus que ça, j’aime bien mon appartement. C’est juste que j’ai parfois du mal à m’y concentrer pour de bon et à aller au bout des quatre à cinq heures quotidiennes de boulot auxquelles je m’astreins sans distractions domestiques intempestives – ménage, vaisselle, lessive – et coups de téléphone de vendeurs de fenêtres à triple-vitrage ou de commerciaux de mutuelles qui remboursent les lunettes et les fausses dents mieux que toutes les autres. Il ressemble sans doute un peu trop à un showroom Ikea parce que je n’ai rien gardé de Paris à part mes livres et que je me suis intégralement rééquipé chez les Scandinaves, mais c’est un grand deux-pièces avec de hauts plafonds plutôt bien fichu que j’ai acheté pour le prix d’une chambre de bonne en petite couronne, histoire d’investir une partie de mon magot dans du concret en bon père de famille. Il y a même une cheminée qui fonctionne. Je m’en suis déjà servi l’hiver dernier. J’avais toujours rêvé d’avoir une cheminée. C’est sûrement un truc d’écrivain.
*
« Il va falloir attendre que les murs soient un peu plus secs avant de pouvoir repeindre, me dit le type après avoir promené son appareil de mesure de l’humidité un peu partout dans ma salle de bains et mes WC. Là, vous êtes toujours à 40 % par endroits. Ça va jamais tenir si on n’est pas redescendu en dessous des 15 %.
— Ah zut, combien de temps ça va prendre ?
— C’est difficile à dire, sans doute encore dix ou douze semaines. Peut-être un peu plus… On peut jamais savoir. »
Il inscrit au feutre la date et le niveau d’humidité sur la peinture écaillée, me propose de repasser le mois suivant pour voir où on en sera et repart avec son petit escabeau sous le bras, me recommandant de laisser les portes et les fenêtres ouvertes le plus souvent possible pour accélérer le processus.
Je me rassieds en face de mon PC en faisant un peu la gueule parce que j’imaginais qu’on pourrait démarrer tout ça rapidement, mais la muse doit être aussi contrariée que moi car je n’arrive pas à me réinvestir efficacement dans le tunnel de dialogues sur lequel je bossais avant l’arrivée du peintre. Je tape une réplique, elle sonne faux, je l’efface, je fais CTRL + Y pour la faire réapparaître, elle est toujours aussi nulle, je l’efface à nouveau et je décide de m’accorder une pause pour descendre les ordures, faire mon petit tour au bistrot et vérifier que l’inspiration n’est pas planquée dans La Provence du jour.
Dans la rue, je dépose délicatement mon sac-poubelle sur la pyramide qui s’est progressivement constituée près du conteneur de mon immeuble en cinq jours d’arrêt de travail des éboueurs qui protestent contre un truc ou un autre. J’essaie de l’installer proprement, bien au sommet, comme une nouvelle contribution à un cairn de randonneur, parce que le boulevard Chave est une artère bien tenue où les grèves des poubelles ne se vivent pas dans l’anarchie comme dans certains quartiers. Dans une petite rue transversale, deux types en bleu de travail sont pourtant en train d’enfourner des sacs dans un camion-benne miniature et s’étonnent que je m’en étonne.
« Tiens, la grève est déjà terminée ? Vous avez déjà repris le boulot ?
— Ah non monsieur, pas du tout. Elle continue. Mais on a deux services de ramassage différents : y a le privé, qui fait le boulevard avec les gros camions, et y a le public qui fait les perpendiculaires avec les petits. Et nous, on la fait pas cette grève-là. On n’a même pas le même syndicat.
— Et c’est quoi leur problème, à ceux qui la font ?
— Euh, en vrai, je sais pas… Je crois que c’est encore à cause de la suppression du fini-parti. Mais nous, les municipaux, on l’a pas, le fini-parti ! Vé, en vrai, on l’a jamais eu !
— Vous devriez vous mettre en grève pour l’obtenir, comme ça vous pourriez vous mettre en grève une deuxième fois pour protester contre sa suppression…
— Ho ho ho ! Té, on va le proposer au syndicat, ça va leur plaire comme idée ! »