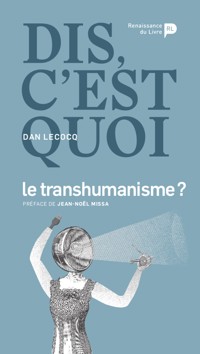
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Améliorer les potentialités de l’être humain, le rendre moins dépendant de la nature, du vieillissement, des accidents... Un projet qui remonte aux origines de l’humanité ! Qu’il s’agisse de médecine réparatrice, de performances sportives ou de génie militaire, l’Homme a toujours cherché à se dépasser. Les progrès constants et de plus en plus rapides de la science et de la technique repoussent sans cesse les limites du possible. Aujourd’hui émerge un projet de société qui ambitionne de bouleverser le monde en faisant de l’objectif de « devenir plus qu’humain » une priorité : le transhumanisme. Noble projet héritier de l’humanisme du Siècle des Lumières, ou dangereuse manifestation d’une volonté de toute puissance délétère ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dis,
c’est
quoi
le transhumanisme ?
Dan Lecocq
Dis, c’est quoi le transhumanisme ?
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
directrice de collection : nadia geerts
maquette de la couverture : aplanos
illustrations : © julie joseph
isbn : 978-2-507-05616-2
dépôt légal : D/2018.12.763/17
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
À mes enfants, Léna, Uriel et Malo, curieux et éveillés, petites lumières qui décideront avec leurs semblables de quoi l’avenir sera fait.
À ma femme, qui parfois me trouve un peu trop connecté avec les autres et pas assez avec elle.
Au professeur Jean-Noël Missa, qui m’a ouvert les yeux sur les enjeux des technosciences.
À Nadia, pour avoir cru en moi et m’avoir confié la rédaction de cet ouvrage.
Préface
Dis, c’est quoi le transhumanisme ? Dans ce bref ouvrage, Dan Lecocq répond merveilleusement bien à la question en évoquant tous les enjeux contemporains liés à l’augmentation de l’humain et à l’émergence des nouvelles formes d’intelligence artificielle.
L’effacement des frontières entre médecine thérapeutique classique et médecine d’amélioration constitue une des caractéristiques principales de la biomédecine du XXIe siècle. Dans la biomédecine contemporaine, les nouveaux médicaments et technologies thérapeutiques peuvent être utilisés non seulement pour soigner le malade, mais aussi pour améliorer ou transformer certaines capacités physiques et mentales de l’être humain. Cetteévolution représente un changement de paradigme dans la pratique médicale. Elle laisse entrevoir l’augmentation de l’humain, la modification en profondeur de la structure biologique de l’être humain.
En 2003, un document contribua à légitimer ce domaine nouveau de l’activité biomédicale, la médecine non thérapeutique ou médecine d’amélioration. Il s’agit d’un rapport du President’s Council on Bioethics entièrement consacré à la médecine non thérapeutique. La parution de ce rapport intitulé Beyond therapy : Biotechnology and the pursuit of happiness montre bien que ces questions liées à la médecine d’amélioration et à la transformation biologique de l’être humain ne relèvent plus seulement de la biologie-fiction, mais bien aussi de la réalité de la technoscience contemporaine (2003). Le rapport envisage quatre thèmes : la sélection et la modification génétique des embryons (« better children »), l’amélioration des performances athlétiques (« superior performance »), la prolongation de la vie (« ageless bodies ») et la modification de l’humeur et des fonctions cognitives (« happy souls »). Les technologies d’amélioration (enhancement technologies) concernent donc aujourd’hui presque tous les domaines de la biomédecine : design génétique, modification des fonctions cognitives et émotionnelles, amélioration des performances sportives, augmentation de la durée de vie…
Dan Lecocq donne plusieurs exemples de passage du thérapeutique au mélioratif. Il mentionne la Rilatine, une amphétamine souvent donnée à des enfants pour soigner des troubles attentionnels. La même molécule peut aussi améliorer les fonctions cognitives d’un adolescent qui ne souffre d’aucun trouble particulier mais qui décide seul ou à l’instigation de ses parents de se doper aux amphétamines pour maximiser ses chances de succès lors d’un examen scolaire. Apparaît ainsi souvent pour les nouveaux médicaments un usage « off label » qui devient parfois plus fréquent que l’indication thérapeutique classique. Il en va de même pour les technologies qui permettent aujourd’hui de modifier le génome humain. L’effacement des frontières entre médecine thérapeutique et médecine d’amélioration est bien illustré par l’exemple des usages potentiels de la thérapie génique dans le sport. La thérapie génique apporte les techniques permettant la modification génétique de fonctions physiologiques liées à la performance athlétique. Les technologies de recombinaison génétique pourraient permettre non seulement d’atténuer les symptômes de maladies, comme la dystrophie musculaire, mais aussi de renforcer la vigueur musculaire chez les personnes âgées ou d’améliorer les performances des sportifs. Des dizaines de gènes affectant les performances des sportifs et susceptibles d’être modifiés par recombinaison génétique ont été identifiés. Des scientifiques ont créé des souris transgéniques dotées de « capacités athlétiques » exceptionnelles. De nouvelles technologies de recombinaison de l’ADN, comme la « CRISPR-cas9 technology » mise au point par Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, pourraient conduire à la modification du génome d’embryons humains. On parle aujourd’hui d’édition du génome (gene editing). L’introduction de l’outil CRISPR, qui permet de recombiner l’ADN avec une grande précision, a suscité un vif débat au sein de la communauté des chercheurs relatif à la régulation d’une technologie qui permet d’envisager le design génétique d’embryons humains. Ainsi, un International Summit on Human Gene Editings’est déroulé en décembre 2015 à Washington pour discuter des aspects scientifiques et éthiques de l’édition du génome. Certains scientifiques ont même proposé un moratoire, un arrêt provisoire des recherches, pour permettre de mieux réfléchir aux conséquences de l’utilisation des technologies autorisant l’édition du génome. Les nouvelles biotechnologies laissent entrevoir la possibilité de changer durablement le corps et l’intellect, de transformer l’être humain. Même si les applications cliniques de certaines de ces technologies semblent encore incertaines ou éloignées dans le temps, il est important d’étudier dès aujourd’hui leurs conséquences potentielles sur la médecine, la société et l’avenir de l’être humain. L’eugénisme contemporain doit donc être analysé dans le cadre plus général d’une médecine de transformation qui pourrait modifier en profondeur la structure biologique de l’être humain.
Ce thème a bien sûr inspiré les philosophes et les bioéthiciens. Depuis une vingtaine d’années, aux États-Unis d’abord puis en Europe, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de l’eugénisme et de l’augmentation de l’humain. De façon schématique, il est possible de répartir les protagonistes du débat éthique et philosophique sur la question en trois groupes : les bioconservateurs, les penseurs libéraux et les transhumanistes.
Dan Lecocq décrit ces différents courants de pensée tout en insistant davantage sur le transhumanisme.
Les penseurs transhumanistes proposent l’adhésionà un programme de modification technoscientifique de l’être humain. L’objectif transhumaniste est que chaque personne puisse bénéficier d’un usage rationnel des biotechnologies d’amélioration. Leur programme, qui peut être résumé par le slogan « Living longer, healthier, smarter and happier », est de transcender les formes actuelles de l’être humain. Les défenses les plus argumentées du transhumanisme se trouvent dans les textes des philosophes Nick Bostrom, Julian Savulescu et James Hughes. Le transhumanisme est un mouvement qui s’est développé au cours des deux dernières décennies. Bostrom, qui reprend à Condorcet le concept de perfectibilité de l’être humain, affirme que le transhumanisme doit être considéré comme un prolongement de l’humanismedes Lumières. Le transhumanisme, c’est l’humanisme des Lumières plus les technologies. Pour améliorer l’être humain et le rendre plus heureux, toutes les technosciences sont convoquées : l’ingénierie génétique, les technologies d’intervention sur le cerveau, l’intelligence artificielle, les nanotechnologies ainsi qu’une technoscience prospective que le génie de l’homme ne manquera pas de mettre au point dans sa quête de perfection… Certains critiques ont assimilé le transhumanisme au Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Mais la comparaison ne tient pas. Le modèle que décrit Huxley correspond à une société totalitaire qui pratique une forme radicale d’eugénisme d’État. Le transhumanisme est une utopie technoscientifique et libérale qui repose sur le pari que les hommes choisiront librement d’avoir recours aux technologies d’amélioration.
Ainsi que le note Dan Lecocq, le transhumanisme peut ressembler à l’humanisme classique, mais les moyens qu’il entend mobiliser l’en distinguent. Du point de vue des technologies convoquées autant que de la relation à l’être humain, les spéculations posthumanistes oscillent entre deux orientations.
La première, nous en avons parlé, se situe davantage dans le prolongement de la transformation biophysique de l’être humain. Cette voie accentue soit les technosciences du vivant (biotechnologie, génétique, neuroscience) soit les technologies prothétiques et cybernétiques ; mais elle peut aussi les articuler entre elles et les combiner. La thématique cyborganique au sens le plus large est particulièrement porteuse dans la mesure où elle est ouverte à toutes les combinaisons. Cette première orientation demeure cependant d’une certaine façon « interne » puisqu’elle procède par transformation de l’être humain.
La seconde orientation est « externe » car elle ne passe pas par une telle transformation. Elle extrapole à partir des recherches et inventions dans les domaines de la robotique, de l’intelligence artificielle (IA), de la biologie de synthèse, des formes de vie artificielle… Des produits conçus ou non comme autant d’instruments au service de l’homme connaîtraient brusquement ou insensiblement une évolution autonome les conduisant à se rendre de plus en plus indépendants, étrangers à l’homme, voire à s’y substituer. C’est, entre autres, le thème de la singularité.
Dan Lecocq présente les différents enjeux liés au transhumansime de façon claire, vivante et accessible. C’est le grand mérite de son livre.
Aujourd’hui, je me suis senti
moins qu’humain
Nous sommes rassemblés autour du repas du soir.
« Comment s’est passée ta journée, Papa ? » me demande ma fille de treize ans.
« C’était une journée un peu compliquée, ma chérie… »
« Raconte-nous, Papa ! »
Ce matin, la journée a commencé comme la plupart des journées.
Après avoir dressé la table du petit déjeuner, guidé par l’habitude plus que par ma conscience, je me suis glissé sous une douche brûlante pour me réveiller enfin. Quel jour sommes-nous encore ?Ah oui, mardi ! Je dois confier mes clés de maison à ma fille, car elle rentre avant moi et nous avons prêté un trousseau à la femme de ménage.
Habillé, je sors de la salle de bains pour constater que, comme souvent, je vais devoir extirper ma fille adolescente de son lit. Quatre à quatre, je remonte les deux étages qui séparent le rez-de-chaussée des chambres des enfants. Je sonne le rappel en allumant, avec cruauté je l’avoue, le plafonnier de sa chambre, et j’en profite pour attraper le petit dernier, encore tout ensommeillé. Nous dévalons les escaliers et, de « Dépêche-toi ! » à « On t’attend, là ! », nous finissons enfin tous les cinq par nous retrouver sur le trottoir, les uns en route pour l’école, les autres pour le boulot.
Ma femme, ma fille et mon fils cadet s’éloignent en direction de la station de métro.
Mon fils puiné et moi prenons le chemin inverse pour retrouver la voiture : je dois le déposer chez mes parents. La voiture…
C’est à ce moment-là que les choses ont commencé tout doucement à déraper…
J’ai oublié. J’ai oublié où j’ai garé la voiture. Pas grave. Il va m’aider. Il est là, bien au chaud au fond de mon sac. Mais où est-il ? Pas dans mon sac… Dans ma poche peut-être ? Pas dans ma poche… Catastrophe !
Pas grave : je vais le retrouver. J’ai dû le laisser à l’intérieur, sur la table… Me voilà de retour devant la porte, sous la pluie battante. Mais sans clés. Et pas possible de contacter ma femme et ma fille, puisqu’il est à l’intérieur.
Bon. Je vais devoir faire appel à ma mémoire :





























