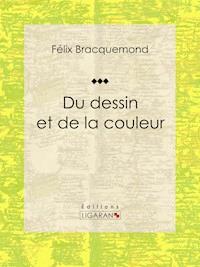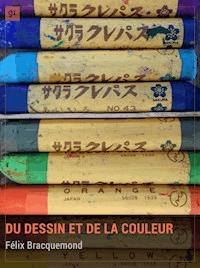
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: gravitons
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
La philosophie par un artiste.À la frontière entre le manuel, le dictionnaire et le traité d'esthétique, cet ouvrage de Félix Bracquemond fournit une série de définitions – trait, modelé, exécution, lumière, valeur, couleur… – pour comprendre l'oeuvre d'art. L'auteur prend également part dans le débat historique entre dessinateurs et coloristes. Défenseur du dessin et du modelé, il rejoint une tradition d'artistes philosophes qui ont mis la pensée théorique au coeur de leur pratique artistique.Cet ouvrage situé au croisement de plusieurs genres permet d'appréhender les théories d'un artiste indépendant du XIXe siècle.EXTRAITAinsi, une feuille de papier représente toute la somme de lumière imaginable, elle est le soleil même ; de son côté, le crayon est l’obscurité.À PROPOS DE L'AUTEURParis, 28 mai 1833 – Sèvres, 27 octobre 1914Auguste Joseph Bracquemond, dit « Félix Bracquemond » était un peintre, graveur et décorateur d’objets d’art français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du dessin et de la couleur
Félix Bracquemond
2e édition ISBN 979-10-95667-06-3 Copyright © gravitons 2015 Tous droits réservés
Félix Bracquemond, peintre-graveur, a été l'un des premiers artistes à s'intéresser à la gravure japonaise et a fait partie en 1863 des « Refusés » du Salon parisien. Son indépendance lui a permis de développer ses théories et lui a conféré la reconnaissance du grand public.
La présente édition est basée sur l'originale Félix Bracquemond, Du dessin et de la couleur, Paris : G. Charpentier et Ce, 1885.
Je dédie cet essai à la mémoire de Joseph Guichard, mon maître.
Du dessin et de la couleur
Préambule
L'essai présenté ici n'a aucune prétention littéraire. Deux mobiles d'ordres différents, mais provenant de la même idée, de la définition des termes du langage des arts, nous ont entraîné à cette tentative : tout d'abord, un simple mouvement de curiosité ; puis, par un sentiment plus grave, l'intérêt de l'instruction primaire du dessin.
Notre curiosité n'avait-elle pas en effet raison d'être éveillée, quand, à notre grand étonnement, nous voyions tout entretien sur les arts, entre un peintre, un physicien, un sculpteur, un littérateur, un architecte, un ingénieur, un homme du monde, se trouver incessamment retardé et entravé par les diverses attributions de sens données par chacun des interlocuteurs aux principaux termes employés dans les arts ?
Et lorsque, pour nous éclairer, nous eûmes recours aux dictionnaires, qu'avons-nous trouvé ? 1° absence d'indication significative ; 2° erreur de définition, l'attribution de sens étant appliquée à un autre terme qu'à celui auquel elle appartient ; 3° confusion des idées, par l'admission de deux sens, l'un bon, l'autre mauvais, pour le même terme.
Ainsi, les dictionnaires de l'Académie et de Littré, puis les autres, disent bien à quoi sert le dessin : « Représentation [...]. » Tous deux débutent de même, mais ils ne disent pas d'où provient cette représentation, quelle est l'essence même du dessin, ce qui le constitue. Ainsi, au mot valeur, l'Académie, qui, pour la première fois, en enregistre l'emploi par les arts dans sa septième édition (1878), en confond le sens dans la première partie de sa définition, où elle lui donne une acception qui ne touche que le contraste des couleurs entre elles, tout en lui rendant, dans sa seconde partie, son acception régulière. Chez Littré, l'erreur est complète, et sa définition doit être intégralement reportée au contraste simultané des couleurs.
Dans aucun dictionnaire, nulle indication de la simultanéité des qualités chaude et froide que la couleur possède, en outre de la qualité colorante. Tous, cependant, par de nombreuses citations, en constatent l'existence. Quant au dictionnaire que l'Académie des Beaux-Arts consacre au langage des arts, nulle mention de ces qualités ; et pourtant, dans les fascicules déjà parus, l'indication de cette façon d'agir de la lumière sur la couleur devrait s'y trouver représentée au moins par un des deux termes chaleur ou chaud.
À propos du mot coloriste, absence, confusion, indication incomplète, parmi tous les dictionnaires. Ceux d'entre eux qui l'admettent, celui de l'Académie française en tête, renient bien nous apprendre que le coloriste applique bien le coloris, mais c'est tout. Le dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, lui, ne l'insère pas dans sa nomenclature, tout en l'utilisant, pour le besoin de sa dissertation, dans son article sur le coloris.
Viollet-le-Duc, qui, lui aussi, se sert du mot, le répudie nettement : « Ce qu'on entend par un peuple de coloristes (pour me servir d'une expression consacrée, si mauvaise qu'elle soit) [...] », dit-il dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture française du onzième au seizième siècle, t. VII, p. 60. Ce qui ne l'empêche pas (t. IX, p. 396) d'être entraîné à cet élan d'admiration : « Avec quel art de coloriste cet effet est-il obtenu ! »
Que de choses étranges provoque cette incertitude générale ! On entend dire que Ingres dessine mal, que Delacroix ne dessine pas ! Affirmations magistrales, axiomes irréfutables devant lesquels la majeure partie du public s'incline comme devant la lumière du soleil, tandis que les artistes se contentent d'un haussement d'épaules. Et cette lettre si curieuse, où Decamps confesse que, s'il avait à recommencer sa vie d'artiste, il irait prendre des leçons de dessin chez Ingres, que pouvait-elle signifier, venant d'un tel homme ?
Et ces expressions art industriel, arts décoratifs, l'une délaissée après avoir été glorifiée un certain temps, l'autre aujourd'hui triomphante, que veulent-elles dire ?
En dehors des divisions naturelles des arts, qui, on peut le reconnaître, sont les métiers particuliers de ceux-ci, y a-t-il des arts parallèles à l'art ? Cette question nous intéressait vivement, nous qui avions vécu jusqu'alors avec cette croyance qu'il n'y a là que des applications d'un même principe.
Nous pensons que ces exemples suffiront pour constater le vague et l'indéfini où flotte la technique des arts. Nous pensons aussi qu'il serait nécessaire de fixer cette technique, afin de pouvoir au moins se comprendre, s'entendre sur une si glorieuse spéculation de l'esprit humain.
Dépourvus de définitions nettes, souvent même de principes un peu solides, la plupart des artistes, nous ne l'ignorons certes pas, pratiquent les arts avec un entraînement sentimental fortifié par quelques recettes et par l'habitude professionnelle qui paraissent suffire.
Reconnaissons tout de suite que de ce vague, de cette incertitude, émergent de loin en loin, comme par création spontanée, des choses qui méritent la qualification d'œuvre d'art. Mais ceci fait partie de la lingerie de famille, qu'il n'est pas, pour l'instant, utile d'étaler sous les yeux du public.
Un intérêt plus grave, avons-nous dit, que la marche plus ou moins heureuse de la conversation, est celui qu'excitent ces questions : N'est-ce pas de l'arbitraire inconsistance des mots et de la confusion qui en résulte qu'est née l'uniformité de l'enseignement des arts, imposé à tous, enfant, ouvrier, artisan d'art, physicien, élève de l'École polytechnique, homme du monde, artiste ? Uniformité réelle malgré l'apparente diversité des méthodes et des modèles adoptés pour chacune de ces divisions, qui toutes fatalement aboutissent soit à ébaucher des artistes, soit à débaucher des artisans. Et si cela est incontestable, quel est le dessin utile ? Peut-on distinguer, établir la quantité et la qualité de dessin nécessaire aux diverses situations où la vie jette chacun de nous ? Enfin, quelle est la délimitation entre le dessin d'usage général et le ou les dessins qui constituent la base professionnelle, la pratique incessante, de l'architecte, du peintre, du sculpteur ?
Pour répondre à ces questions, nous avons pensé qu'il fallait commencer par fixer le sens des termes et leurs rapports professionnels avec le mot dessin, et, pour cela, s'astreindre à les définir uniquement par le langage, sans le secours des choses qu'ils représentent, c'est-à-dire sans le concours de figures explicatives. Un terme bien défini ne peut-il être considéré comme un outil professionnel, comme un instrument de précision ?
La critique aurait pu nous fournir, par des exemples contradictoires, de vives clartés ; nous avons préféré nous confiner dans un vague qui, sans être obscur, exigera une attention persévérante
Nous avons tenté cette série d'ardues et indispensables définitions, certain que, si nous n'avons pas réussi, nous aurons du moins signalé un point faible et la nécessité de le fortifier.
L'Art La forme – les formules
L'art émanant du dessin est la nature formulée.
Par chacune de ses divisions il donne une formule spéciale de la nature.
Les arts ne pouvant percevoir la forme sans étendue, sans volume, ils lui ont attribué une sorte de membrure composée du contour, du modelé, de la couleur. Puis ils ont isolé ces membres théoriques, afin de les appliquer à leurs usages ; ils les ont réduits en formules, les rassemblant ou les divisant selon le service qu'ils en attendent.
À ce titre, la forme n'a rien d'abstrait : elle est carrée, ronde, triangulaire, ou composée de ces diverses figures ; elle est mesurable et comparable, étant grande, petite, épaisse, fluette, etc., etc. De plus, nous en tenant aux apparences d'expression, nous pouvons dire qu'elle est majestueuse, triste, joyeuse, noble, ridicule, etc., etc.
Quand Brid'oison parle de la forme, il emprunte aux arts plastiques leur manière de la considérer par des images applicables aux abstractions que ce terme évoque.
Pour nous, une forme polie est comparable à une surface qui a passé par le polissage du brunissoir ; pour Brid'oison, c'est de la politesse.
Mais nous n'avons pas à tenir compte de la complexité d'idées où entraîne le mot forme. Nous ne devons envisager ce mot que dans la signification qui le rapproche le plus de la technique du dessin. Pour cela, il nous faut examiner ce qui distingue l'un de l'autre les deux termes dessin et forme.
Tout d'abord, le mot forme suscite la comparaison entre la manière d'être de la nature et celle de l'art, ce que ne fait pas le mot dessin. Dans la nature, la forme est immuable, une, toujours semblable à elle-même ; dans l'art, elle est d'apparence mobile, variable et présente autant d'aspects qu'il y a d'arts, de systèmes. Et cependant la préoccupation constante de l'art est la représentation de la forme naturelle, car, alors même qu'il invente, il sait que son œuvre ne sera reconnue pour valeur acquise que si l'on peut dire de l'un ou de l'ensemble de ses éléments : « C'est vrai », ou « c'est juste ». On dit aussi : « C'est beau » ; mais cette expression échappant à la technique, nous n'avons pas à nous en préoccuper.
Il faut donc reconnaître la valeur d'expression propre à chacun des éléments naturels réduits par l'art en formule, pour apprécier la part apportée par chacun d'eux à l'unité de la forme, unité qui est absolue dans la nature par la confusion intime de ces éléments, qu'on peut bien distinguer, mais qu'il est impossible de disjoindre.
Le premier de ces éléments, celui qui est presque le représentant en titre de la forme, le contour, n'est cependant applicable qu'à une de ses localités. Il note la limite où, pour notre vue, un corps, un espace, semblent se terminer.
Les termes ligne, contour, trait, plan, élévation, coupe, gabarit, calibre, profil, silhouette, schéma servent à signifier forme lorsque la forme est effectivement limitée par un tracé quelconque.
Ingres disait à ses élèves : « Messieurs, tout a une forme, même la fumée ! » Cette chute dans une démonstration solennelle est peut-être un peu naïve, mais elle a, pour nous, l'avantage de placer la question de la forme, envisagée au point de vue des arts, sur son véritable terrain.
Il faut bien se garder de prendre le contour pour la forme. Il n'en est qu'un élément, figuré par le trait, qui lui-même n'est qu'une formule essentiellement conventionnelle et secondaire, donnant aux arts la plus grande liberté et qui leur appartient en propre. C'est par lui que la forme humaine, ainsi que toutes les autres formes, est modifiée à chaque fluctuation des arts ; c'est par lui que le principe ornemental joint et accouple des êtres, des choses, dissemblables et incompatibles. Il construit les combinaisons de la fantaisie la plus absolue, qui deviennent indiscutables comme vérité, comme justesse de forme, lorsque le contour respecte, par le modelé, la conformité indispensable entre la nature et l'art.
Un autre élément de la forme, la couleur, est également conventionnel. Dans la nature, la couleur est impondérable, c'est la lumière elle-même. Comment dès lors la disjoindre du modelé ? Dans l'art, elle est matérielle, mais elle se prête à tous les artifices. Pour simuler l'aspect coloré de nos yeux, le sculpteur ne fait-il pas des trous là où sont des surfaces lisses ? Le peintre ne supplée-t-il pas la couleur par des valeurs tirées de sa négation même, le blanc, le noir ?
Les formules du trait et de la couleur, laissant liberté entière aux conjectures, aux formes supposées par l'imagination, sont acceptées comme vraies et justes, et doivent l'être, lorsque, par le modelé, les lois de la lumière naturelle sont rigoureusement observées.
C'est de la clarté que dérive la stabilité d'effet, parce qu'elle ne varie jamais dans la logique de son expansion, qui permet la comparaison entre la nature et l'art. Et cela, avec ou malgré les formes conventionnelles du trait et de la couleur.
II nous est facile de démontrer cette vérité par le simple énoncé des époques d'art ou des noms de maîtres indiscutables, qui de la même forme, celle de l'humanité, ont tiré des expressions tellement différentes qu'elles semblent ne pas exprimer le même sujet : ce sont les Égyptiens, les Grecs, les Gothiques, la Renaissance, dont l'évolution se termine à la Révolution française ; ce sont Michel-Ange, Jean Goujon, Boulongne, Puget, Houdon, David d'Angers, Mantegna, Léonard de Vinci, Corrège, Albert Dürer, Holbein, Raphaël, Véronèse, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Watteau, Ingres, Delacroix.
Toutes les différences des formes que présentent ces dates et ces noms viennent sans doute des formules du trait et de la couleur ; mais chez toutes le modelé est conforme, c'est-à-dire que la lumière, l'ombre et leurs intermédiaires affectent la même action, confirmée par leur identité avec la nature.
C'est donc du modelé seul qu'on peut dire : « C'est vrai, c'est juste ; » c'est lui qu'on doit appeler « la forme « lorsque ce terme est un qualificatif. En un mot, si la science des formes est le dessin, c'est par le modelé qu'elle peut être vérifiée.
Le Dessin
Le dessin est le moyen artificiel d'inscrire et d'imiter la lumière naturelle.
Dans la nature, tout se montre par la lumière, et par ses compléments, le reflet, l'ombre. C'est ce que le dessin constate. Il est la lumière factice des arts.
Le mot dessin résume tous les termes de la langue des arts plastiques. Il est toujours sous-entendu, quel que soit le mot technique que l'on emploie. Les expressions : trait, modelé, couleur, ornement, forme, ligne, valeur, effet, etc., ne servent que pour aider par l'analyse à la signification du mot dessin, et pour en spécifier un des éléments.
Ces éléments divers sont tour à tour pris pour le dessin lui-même, selon que la pratique désignée par chacun d'eux prédomine dans l'application particulière qu'en fait l'une des trois grandes divisions des arts, l'Architecture, la Sculpture, la Peinture.
Le dessin sert à représenter les choses que nous voyons et à figurer celles que notre imagination conçoit et nous fait voir. Et il transmet son nom à ces représentations et figurations. Ainsi, la chose peinte ou tracée sur la toile, sur le papier, est un dessin ; une statue est un dessin ; un monument est un dessin ; une locomotive, une carte de géographie, les linéaments d'une idée, sont des dessins.
Le mot dessin désigne aussi les moyens employés à son exécution ; dessin au pinceau, à la craie, au crayon, à la plume, au pastel, au lavis, à l'aquarelle ; dessin linéaire ou dessin du trait.
De plus, il s'applique à la science qui sert à son émission : le dessin de Ingres, le dessin de Delacroix.
Il désigne encore la qualité du dessin de l'œuvre : ce monument, cette statue, ce tableau, cette gravure, est d'un bon ou d'un mauvais dessin.
En tenant compte des différentes valeurs de ce mot, on doit classer ainsi ses diverses propriétés : le dessin est à la fois une écriture, une science, un art.
Il est une écriture comme moyen d'expression, l'écriture des formes. II exprime, suivant une convention qu'il a créée, les combinaisons de l'ornement et toutes les formes de la nature, ainsi que toutes les figures dérivant de la géométrie, de l'architecture, de la géographie.
Il est une science comme étude, la science des formes. Il guide les industries dont il est le moteur, il donne un corps aux professions dont il est le moyen et le but, comme la peinture, la sculpture.
Il est un art comme conception et application, l'art des formes. Il modifie les formes selon sa convenance, en suivant uniquement les conventions qui lui sont propres.
Le dessin est particulièrement le but et le moyen de trois professions : l'architecture, la sculpture, la peinture. Ces trois divisions des beaux-arts ayant chacune une voie différente de celle des deux autres pour parvenir à son but, il est utile de mettre en lumière les moyens employés par chacune d'elles.
Si le peintre et le sculpteur recherchent exclusivement par le dessin l'imitation de la nature, il n'en est nullement de même de l'architecte, qui, affranchi de cette imitation, n'emploie le dessin que pour préparer et présenter ses plans. Pour lui, ce n'est là qu'un expédient, qui ne crée nul rapprochement avec le dessin du peintre ou du sculpteur ; son dessin est une simple indication destinée à servir de guide à la construction d'un édifice. On peut l'imaginer tracé sur le sable avec un bâton, sans que l'édifice à construire doive y perdre quoi que ce soit en beauté et en solidité. Mais cet édifice, qui n'a rien emprunté à l'imitation de la nature, n'en ajoute pas moins une nouvelle production aux choses naturelles ; et, à son tour, il devient pour le peintre et le sculpteur un élément de recherche, à l'égal des objets de la nature.
Plus que le crayon, que l'équerre et le compas, les corps de métiers sont les instruments de l'architecte. Aussi est-il dénommé le maître des œuvres. N'est-ce pas lui qui, dans son œuvre, distribue le lieu, le sujet et l'action, à chacun des corps de métiers, depuis le terrassier creusant la terre pour établir les fondations, jusqu'au sculpteur et au peintre chargés de terminer l'édifice en l'ornant et en le décorant ? Tous les métiers et tous les arts sont donc ses vrais instruments. L'épure n'est qu'un accessoire, que le signe matériel de son aptitude à diriger les artisans et les artistes dont il s'est entouré.
Le dessin de l'architecte est, à proprement parler, un mémoire, un guide. Son art est un art isolé, n'ayant d'autre rapport avec les arts du dessin que l'emploi qu'il fait d'eux, soit par lui-même, de sa propre main, soit par les peintres et les sculpteurs qui, sous son impulsion, lui apportent le complément de leur savoir, de leur talent.
Le mérite qu'il manifeste personnellement dans le tracé de ses plans n'est donc pas indispensable ; ce n'est qu'un agrément ajouté à la conception de son œuvre. À ce titre, son projet peut être examiné en dehors de ses qualités d'architecture.
Le goût et le talent de l'architecte, pour nous qui ne voulons considérer que l'effet produit par un édifice, s'exercent dans le choix et la distribution des matériaux, dans le choix et l'emploi du personnel qui les met en œuvre. L'édifice terminé est le véritable dessin de l'architecte, dessin qui doit découvrir son but à tous les yeux.
Le dessin fait à l'aide d'un trait rendant le contour des formes est la pratique de l'architecte. Il la tire non de la nature, en qui rien n'est déterminé par un trait, mais des conventions imaginées par la géométrie, dont il est obligé, de faire une étude spéciale.
Sa formule est bien une écriture, qui dit clairement ce qu'elle veut exprimer. Elle se retrouve dans la pratique de tous les arts ; et, au fur et à mesure que notre sujet nous y amènera, nous en examinerons la valeur dans ses diverses applications.
L'étude archéologique des styles, dont la connaissance doit être familière à l'architecte, n'offre ici aucune utilité. Elle n'entre pas dans notre sujet et ne pourrait rien changer à ce que nous venons de dire sur le dessin d'architecture. Mais elle peut faire d'un architecte un savant, et même un novateur, si cet architecte sait créer un style nouveau.
Pour préciser la qualité du terme dessin dans l'architecture et caractériser la différence avec d'autres applications d'art, il est nécessaire de faire une dernière remarque. Nous préviendrons ainsi, en même temps, toute objection tirée de la personnalité de quelques architectes.
Le dessin ornemental est une sorte de modelé effectif que l'architecte ajoute au monument qu'il édifie. Mais, ici encore, l'architecte ne fournit qu'un projet ; un plan ; et ce projet, quoique scrupuleusement suivi dans ses contours, n'offrira l'intérêt qui provient des choses d'art que s'il est exécuté par un artiste possédant la science spéciale du dessin, le modelé. C'est que, particulier à la peinture et à la sculpture, le modelé est étranger à l'architecture, et que l'architecte ne peut y marquer son savoir, s'il n'est peintre ou sculpteur, que par le choix du sculpteur ou du peintre qu'il s'adjoindra.
Si le dessin de l'architecte est à une si grande distance de celui du peintre et du sculpteur, à son tour le dessin du sculpteur diffère de celui du peintre, mais simplement par la différence du moyen employé pour analyser et fixer la lumière et l'ombre.
On dit bien du sculpteur qu'il modèle, et du peintre qu'il dessine ; mais comme, dans leur acception la plus haute, ces deux termes sont synonymes, nous les emploierons indifféremment.
Pour le peintre, il s'agit de faire voir sur une surface plane (papier, toile, muraille) les reliefs des objets naturels, en posant sur cette surface des matières claires ou sombres, c'est-à-dire plus ou moins blanches, plus ou moins noires, imitant les lumières et les ombres qui, dans la nature, font apparaître tous ces objets par leurs saillies et leurs dépressions.
En agissant ainsi, le peintre distingue les qualités diverses de la clarté contenues sur l'objet naturel ; il les inscrit dans la forme de cet objet ; ou, pour dire plus juste, ce sont elles qui déterminent cette forme.
Le relief ainsi obtenu par le peintre ou par le dessinateur à l'aide du dessin est illusoire. Il n'en est pas de même de celui que cherche le sculpteur. Le sculpteur obtient une identité absolue de relief et de volume avec la nature, grâce à la matière qu'il emploie : terre, cire, marbre, bronze, bois. Dans son imitation, il reproduit une saillie réelle là où le modèle présente une saillie, une dépression là où se creuse une dépression.
S'il ne semble pas se préoccuper de la lumière qui doit éclairer son œuvre, c'est qu'il sait que cette œuvre se montrera dans des lumières et des ombres identiques à celles du modèle. Il se borne donc à prendre toutes les mesures de volume du modèle et à les reproduire.
Il n'est pas inutile d'insister : l'analogie entre le peintre et le sculpteur est bien l'imitation de la lumière éclairant le modèle ; mais le premier montre sa préoccupation incessante de la qualité de la lumière, en constatant sur une surface plane les reliefs et les dépressions du modèle, pendant que l'autre laisse à la lumière elle-même le soin de faire voir les saillies et les creux de son œuvre, sans chercher à témoigner que son attention ait été dirigée sur la qualité et la quantité de la lumière, certain que celle-ci éclairera la copie de la même façon qu'elle éclaire le modèle.
Cependant ce sont les valeurs produites par la lumière sur les objets de la nature et reproduites par le peintre ou le sculpteur, qui constituent la recherche que tous les deux poursuivent. Le peintre et le sculpteur ont en ce sens tant de points de contact que, grâce au modelé que chacun d'eux pratique dans sa profession, un sculpteur peut devenir peintre, un peintre se faire sculpteur, par la simple acquisition de quelques procédés matériels.
Nous n'avons pas à entrer dans l'analyse des moyens d'exécution qui font de ces deux arts deux métiers entièrement différents.
Le dessin étant la source unique qui alimente tous les métiers spéciaux rattachés à l'architecture, à la sculpture, à la peinture, son étude est pour eux tous l'étude de la langue qu'ils doivent parler et écrire. C'est une rhétorique dont la gradation est infinie et que ne supplée aucune aspiration, aucune organisation individuelle.
Le dessin, sous quelque forme qu'on l'envisage, ne peut exprimer que des réalités. Il est tout extérieur. Alors même que son œuvre émeut, excite chez le spectateur des sensations intimes que l'auteur a pu lui-même ressentir, cet effet n'est obtenu que par la représentation de l'extérieur des êtres et des choses.
Mais comment cette apparence visible a-t-elle été fixée dans une œuvre, la lumière étant fugitive, tant sur les corps inanimés que sur la physionomie des êtres vivants, où son incessante variabilité est encore accrue par les mouvements invisibles des sentiments ?
Nous n'avons pas à faire un traité d'expression, qui, du reste, serait contenu pour nous dans la science du dessin. C'est cette science seule qui donne à l'artiste une seconde vue, celle du discernement, par laquelle il saisit au passage les expressions naturelles, si lointaines qu'elles soient dans le temps, si rapides dans l'espace, si voilées dans la lumière, mais qu'il a fatalement vues de ses yeux avant de les cristalliser dans une œuvre.
Delacroix a vu l'entrée des Croisés à Constantinople, Ingres a vu Thétys et Jupiter, et de ces vues ils ont fait deux chefs-d'œuvre.
Qu'on ne s'étonne pas de l'absolu où nous nous plaçons !
Nous luttons contre un courant d'idées, contre une routine de pratiques qui placent l'expression des arts soit dans une conception préalable toute sentimentale, soit dans une constatation immédiate de ce que les artistes appellent la nature. Nous croyons, nous, que ces deux points opposés sont contenus et confondus dans une science qui est le dessin, hors de laquelle aucune expression d'art ne peut être acceptée, sinon comme tendance, comme aspiration.
Dans cette situation, toutes les distinctions qu'il faudrait faire, nous les écartons.
La Couleur (dans le sens général)
Dans un sens général, le mot couleur désigne une apparence physionomique superficielle qui distingue les unes des autres toutes les choses que nous percevons. Ainsi, un objet est rond, de plus il est rose ; il est encore ou clair ou sombre.
Il faut noter que la couleur de toute chose est mobile, changeante, suivant les mille variations que la lumière lui impose en la rendant visible.
Couleur désigne aussi les matières employées par la peinture, l'aquarelle, la détrempe, le pastel, etc., etc.
Dans ces deux sens, le blanc, le noir, le gris, qui, selon les diverses manières d'envisager la couleur par la physique et par les arts, sont la négation ou plutôt l'absence de la couleur, sont des couleurs.
Le terme nuance