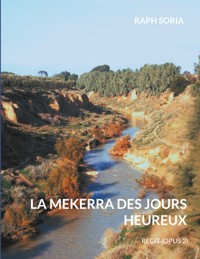Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Douze nouvelles courtes, vivantes, tirées de faits réels et emmêlant réalité et fiction, fragments de vie qui se dévoilent au hasard comme les images aléatoires que forme un kaléidoscope à partir d'une multitude de minuscules fragments de verre coloré...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A ma femme Joëlle
ma lectrice avisée
ma « critique littéraire »
aux appréciations toujours pertinentes
A mon fils Frédéric
A mes petites-filles Anelise et Cloé
avec une infinie tendresse
Et
pour notre amitié fidèle qui dure depuis tant d’années
A Chantal et Michel
affectueusement
La nouvelle est au roman ce que le court métrage est au film.
C’est une fraction de vie, un infime instant arraché à l’infinie cendre du temps et emprisonné à jamais comme un paon-du-jour1 dans une bulle de cristal, comme un scarabée doré dans un écrin d’ambre translucide.
Un instantané.
Que nous les ayons vécus ou que nous en ayons été les témoins directs, des aventures ou des mésaventures, des événements tristes, insolites, joyeux ou parfois dramatiques ont émaillé nos vies.
Entre des milliers de péripéties, notre mémoire capricieuse en choisit quelques-unes comme faits marquants, les enregistre, les retient et nous les restitue considérablement enjolivées.
Toutes les anecdotes qui sont ici proposées à votre lecture sont tirées de faits réels.
Qu’importe de savoir si le narrateur en a été l’acteur, le témoin ou un simple spectateur. Qu’importe qu’elles s’éloignent de la réalité ou qu’elles la transposent.
L’essentiel c’est que, toujours attentif à la façon de les raconter, l’auteur choisit toujours l’angle de vue qui lui paraît le plus propice à vous toucher au cœur.
1 Nom d’un papillon
Table des matières
Les désagréments du train de nuit
Gospel
Bons baisers d’Istanbul
Un homme prévoyant
La fugueuse
Un naïf exceptionnel
Dans un nid de curés
Le petit théâtre de la Cigale Rouge
Un cadeau tombé du ciel
Ça n’arrive pas qu’aux autres
Rencontre du quatrième type
Un oiseau, juste un tout petit oiseau
Les désagréments du train de nuit
Au moment où se situe cette anecdote, il m’arrivait de prendre fréquemment le train.
Il faut te dire qu’à cette époque, Délégué Départemental d’une entreprise nationale de Travaux Publics, je devais me rendre au moins une fois par mois à Paris.
A force d’allers-retours, il s’était instauré une sorte de rituel assez minuté et quasi immuable dont la description pourrait te paraître fastidieuse du fait de son banal prosaïsme.
La plupart du temps, je prenais ma voiture de Châteaurenard à Avignon. Je la laissais au parking de la gare. A 20 h 40 je montais dans le train, après avoir préalablement repéré mon wagon. Je cherchais mon compartiment, vérifiais à son numéro sur la porte l’emplacement de ma couchette, installais mon maigre bagage sur le porte-bagages - une petite mallette contenant mon nécessaire de toilette, mon pyjama, des sous-vêtements de rechange, de la lecture et, dans une chemise en carton, les documents indispensables à ma réunion de travail -. Je sortais dans le couloir après avoir pris soin de fermer la porte de mon compartiment. J’abaissais une vitre du couloir2 pour respirer l’air embaumé de thym sauvage. J’allumais une cigarette en attendant le redémarrage du train. Et je restais là pendant quelques instants, regardant défiler les lumières étincelantes de la ville, scrutant dans la semi-obscurité le scintillement fugitif des éclairages tremblotants des fermes et des hameaux, essayant de deviner les contours de plus en plus imprécis d’un paysage se diluant dans les lambeaux effilochés d’ors, de cuivres, de pourpres et de grenats d’un ciel peu à peu avalé par l’obscurité.
Puis, lassé de ce spectacle, ma cigarette finie depuis longtemps, je refermais la fenêtre, entrais dans mon compartiment, prenais dans ma petite mallette mon nécessaire, allais, à l’extrémité du wagon, aux W-C les plus proches pour un dernier petit pipi et une brève toilette. Puis, retourné dans mon compartiment, j’entrouvrais la vitre en dépit de quelques grognements mécontents pour laisser entrer un filet d’air afin de nous éviter l’étouffement, je grimpais sur ma couchette - toujours une de celles du haut, réservée longtemps à l’avance -, m’y allongeais et, le plus confortablement installé, reprenais avec délectation le dernier roman en cours de lecture.
Quand toutes les lampes étaient éteintes et que je voyais, à quelque ronflement persistant, à des borborygmes confus et des vocalises nerveuses faites d’onomatopées incompréhensibles ou à quelque pet non retenu, que mes compagnons de route étaient endormis, j’éteignais ma veilleuse et, dans le noir, avec force contorsions, je me dévêtais et enfilais - mais oui ! - mon pyjama.
Mettre son pyjama dans un train de nuit est chose fort courante lorsque l’on dispose pour soi tout seul d’une cabine de wagon-lit. Mais c’est pour le moins inhabituel lorsque l’on voyage dans un train couchettes. La plupart des voyageurs avec lesquels j’ai partagé un compartiment, n’ôtant que leur veste, ont toujours dormi tout habillés, quand ce n’était chaussés. Quant aux femmes, elles ont presque toujours préféré à tout autre vêtement le jogginginforme, de peur sans doute que, dévoilant par inadvertance la moindre parcelle de leur anatomie, elles ne risquassent de transformer en lubriques voyeurs leurs imprévisibles voisins. Il faut dire aussi que les trains de nuit ont entretenu tant de fantasmes !
Une fois revêtu de mon pyjama, je m’enfonçais peu à peu comme une murène erratique dans les eaux profondes du sommeil pendant que le train fonçait dans la nuit opaque comme un bison furieux.
Au petit matin, quand, à l’approche de la gare de Lyon, le contrôleur venait toquer de son poinçon nonchalant à la porte vitrée, mes compagnons, déjà fin prêts, bagage au pied, étaient entassés dans le couloir. Je pouvais donc me rhabiller dans un compartiment vide… mais empuanti. Car, mettant à profit notre sommeil, l’inévitable voyageur frileux avait fini par fermer hermétiquement la fenêtre au risque de nous entraîner à la mort par asphyxie. Je ne traînais pas. J’avais hâte de quitter ces effluves malsains de la nuit où dominaient ces relents indéfinissables de slip négligé et de vieille chaussette si particuliers à l’homme mal lavé. J’étais impatient de laisser au plus vite derrière moi cet espace clos, plus restreint et plus insalubre qu’un cachot. En m’habillant, je me faisais toujours cette réflexion qu’à part voguer dans la cale d’un bateau pleine à craquer de voyageurs serrés sur des transats comme des harengs ou confiné à bord d’un sous-marin pareil à une boîte de sardines en fer blanc, il faut que l’homme civilisé soit sacrément masochiste pour voyager de nuit, en seconde, de son plein gré, dans un compartiment à six couchettes, avec cinq inconnus tous porteurs de microbes, de bacilles et de virus et qui, par l’exhalaison de leur haleine chargée, l’odeur âcre de leurs aisselles ou de leur entrejambe, le fumet insinuant de leurs pieds et l’insidieuse pestilence des gaz produits par la malodorante tuyauterie humaine, sont générateurs d’effluences abominables. Mais je me rassurais aussitôt en me disant qu’après tout ce n’était que l’affaire d’une nuit.
Paris. Ah, Paris !
Arrivée à 6 h 23. Début du marathon.
Cavaler comme un dératé dans le métro du petit matin, perdu dans une foule déjà compacte, en étant attentif à ne pas me tromper de station ; puis, les copains retrouvés au bistrot habituel, toilette rapide, entre deux expresso, dans les sous-sols dudit bistrot ; dernières nouvelles échangées entre deux bouchées vite englouties de croissants chauds ; petit déjeuner rapidement expédié ; course-vitesse pour arriver à l’heure au lieu du rendez-vous ; retrouvailles dans le hall du siège social ; rassemblement dans la salle de réunion ; chassé-croisé des groupes de travail ; repas de midi avalé à la va-vite dans le bruit confus des conversations croisées ; reprise des travaux - commissions, plénière, élaboration de la synthèse finale et tutti quanti - ; puis, la rencontre de la journée terminée sur une liste de résolutions, reprise du parcours du combattant, à l’heure de pointe, dans le métro plein à craquer comme une outre de son ahurissante cargaison humaine et course contre la montre pour ne pas rater le train couchettes de 20 h 12 du retour.
Quand, à l’issue de cette journée épuisante je m’en revenais dans ma chère Provence exténué mais conscient du devoir accompli et heureux d’avoir revu, même brièvement, quelques-uns de mes collègues, j’avais droit à force ricanements et allusions :
- Alors, dis-moi, Jean-Phi, c’était comment, Paris ?
- Eh, Jean-Philippe ! Tu t’es bien amusé, au moins ?
- Dis donc ! Tu le prends à l’aise, toi ! Tu files à Paris pendant que nous, ici, on s’tape tout l’boulot !
- Eh ! Eh ! Je trouve que tu y vas un peu trop souvent, à Paris ! T’y’aurais pas une copine là-bas, par hasard ?
Ou bien il me fallait subir, sifflotée ou chantonnée, la sempiternelle ritournelle :
« Ah ! Les p’tites femmes
Les p’tites femmes de Paris !
Ah ! Les p’tites femmes
Les p’tites femmes de Paris ! »
Mais baste ! Tout ceci passait au-dessus de ma tête.
En plusieurs années, exception faite des prévisibles inconvénients dus aux vicissitudes du voyage collectif, je n’eus que quelques légers incidents à déplorer.
Une fois, je perdis mon slip que, pourtant, j’avais soigneusement placé sous mon oreiller et que je ne retrouvai jamais. Heureusement, j’avais un slip de rechange ! Une autre fois, dans ma hâte, j’abandonnai sur ma couchette mon pyjama. Une fois, j’égarai mes lunettes que j’avais pourtant rangées dans le vide-poches en filet situé au-dessus de ma tête. Je finis par les retrouver sur la couchette du dessous où elles avaient atterri je ne sais comment. Une autre fois encore, je perdis mes chaussures qu’un autre voyageur avait, les prenant sans doute pour les siennes, failli emporter. Par chance, je les aperçus au bout du couloir sans jamais comprendre comment elles y étaient parvenues. Vous me voyez en chaussettes, dans Paris, si je ne les eusse récupérées ? Une fois encore, le contrôleur ayant oublié de me réveiller, je me retrouvai seul dans une gare bruissante3, seul dans mon compartiment, seul dans le wagon, seul dans le train entièrement vidé de ses voyageurs, profondément endormi, jusqu’à ce que les agents du service de nettoiement de la SNCF, éberlués, ne me trouvassent presque nu sur ma couchette. Heureusement que ce jour-là le train n’allait pas à Bruxelles !
Bref, des vétilles ! Rien de bien palpitant !
Une fois, cependant...
Cette fois-là, ayant un peu de retard, je montai précipitamment dans mon wagon où, instantanément, une odeur nauséabonde assaillit violemment mon odorat.
Ma couchette se trouvant à l’autre bout du wagon, je devais traverser le couloir déjà désert.
A mesure que j’avançais vers mon compartiment, l’odeur se faisait plus puissante, plus insoutenable. Je suffoquai lorsque j’ouvris la porte et reculai brusquement comme si un dragon, m’attendant pour me sauter à la gorge, m’eût soufflé de plein fouet au visage son haleine pestilentielle. A demi asphyxié, je refermai hâtivement la porte, ayant à peine eu le temps de vaguement distinguer dans la pénombre trois dormeurs que l’affreuse puanteur ne semblait pas le moins du monde incommoder. Je me précipitai à l’autre bout du wagon et, après avoir ouvert une vitre pour faire entrer un peu d’air frais dans le couloir, je me réfugiai dans le sas de sortie, attendant le contrôleur qui, normalement, ne devrait pas tarder à venir composter mon billet.
« Pas question, me disais-je, de passer toute une nuit dans cette bauge infecte ! »
Lorsque, peu de temps après, arriva le contrôleur, il fut à son tour frappé de plein fouet par l’odeur irrespirable que le filet d’air n’avait pas atténuée et s’étonna du fait qu’aucun des dormeurs du wagon, et plus précisément ceux du compartiment d’où semblait provenir cette insupportable puanteur, ne se fût éveillé et ne fût venu l’alerter.
Bizarre !
Nous ouvrîmes grand toutes les vitres du couloir. Apportant avec lui dans son sillage comme une vague libératrice le sifflement strident du train, l’air vif de la nuit s’engouffra précipitamment dans le wagon, estompant pour un instant ces miasmes asphyxiants à l’origine inconnue.
Le contrôleur toqua de son poinçon à la porte vitrée du compartiment dont le rideau avait été baissé, ouvrit, recula brusquement, frappé lui aussi par l’odeur épouvantable, toussa, suffoquant à son tour, prit sur lui, avança avec courage et fit la lumière, arrachant brutalement les dormeurs hébétés - ils étaient bien trois - à leur rêve.
Plus de doute possible. Ce compartiment était bien l’épicentre de ces émanations infectes.
Alors, les recherches commencèrent, et avec elles les suppositions.
S’agissait-il d’un rat mort qui se fût décomposé ? Impossible. Les agents d’entretien sont d’une méticulosité extrême. Ils passent chaque compartiment au peigne fin. Ils changent de fond en comble la literie, expédiant impitoyablement à la blanchisserie même celle qui n’a pas servi.
S’agissait-il d’une boule puante lancée par quelque mauvais plaisant ? C’était peu probable. Car qui eût pu le faire et pourquoi ? Chacun des voyageurs était monté seul, l’un à Vintimille, l’autre à Nice, le troisième à Marseille et aucun ne se connaissait d’ennemi.
Voilà le contrôleur inspectant à l’aide de sa lampe de poche les porte-bagages, les couchettes, défaisant oreillers, draps et couvertures, examinant le moindre interstice, le moindre repli. Le voilà à quatre pattes, toute dignité bue, dans une posture peu conforme à son rang, explorant sous les banquettes.
Pas de boule puante. Pas de rat mort. Mais toujours cette infection puissante, persistante, atroce odeur de matière organique en état de putréfaction avancée ne s’apparentant cependant à rien de connu.
L’agitation et le bruit réveillent l’un après l’autre tous les compartiments du wagon. L’on prend conscience de l’odieuse puanteur. L’on s’inquiète. L’on s’interroge. Bref, un vrai branle-bas de combat. Et l’inspection continue sans autre résultat.
Et voilà que le contrôleur aperçoit quelque chose - il ne sait quoi - au fond, sous la banquette de droite, contre la paroi. Mais il ne peut l’atteindre. Alors, il demande un objet. On lui tend un stylo à bille. Mais le stylo est trop court. Alors quelqu’un lui apporte une canne. Et le contrôleur, avec des gestes méticuleux de chirurgien sortant du ventre d’un patient un tronçon d’intestin, ramène une petite chose informe, abjecte, une sorte de morceau de tissu trempé d’un épais et écœurant purin qui, par vagues successives, réveille et amplifie l’infernale pestilence.
Nouveau branle-bas de combat. Reflux des voyageurs. C’est : « Tous à vos mouchoirs ! »
Le contrôleur suffoque, mais il tient bon. Entre deux hoquets désespérés de nageur qui se noie, il balbutie :
- Là ! Il y en a un autre !
Et il extirpe précautionneusement un deuxième innommable lambeau de ce tissu putride qui soulève une nouvelle onde de remugles nauséabonds.
Sous les yeux médusés des voyageurs, ces deux choses sont balancées dans le couloir et - horreur ! - se révèlent être... une paire de chaussettes imbibées d’un infâme suint.
Comment diantre ces chaussettes ont-elles pu parvenir jusqu’ici et se glisser sous cette banquette et à quel être repoussant ont-elles bien pu appartenir ?
Soudain, le passager de Vintimille se souvient d’avoir remarqué sur le quai, à l’écart d’un groupe clairsemé de voyageurs ensommeillés, un type un peu douteux, une sorte de demi-clodo. Ce type aurait pu monter sans se faire remarquer dans le même wagon que lui. Mais rien ne dit que ceci puisse avoir le moindre rapport avec ces immondes chaussettes et l’insoutenable infection qu’elles dégagent.
On se perd en conjectures. Et puis on finit par imaginer un scénario. Le demi-clodo, probablement un voyageur sans billet, cherchant un lieu tranquille, a cru, à tort, que le compartiment était vide. Alors, il a pu entrer en catimini, s’apercevoir de la présence d’un occupant et, profitant de l’endormissement de ce dernier, se glisser sans bruit sur la couchette du bas. Descendu sans doute à Nice, il a abandonné sciemment ou non sous la couchette, pour rétribution de son passage, ses chaussettes répugnantes.
Le train arrêté à la première gare venue, le wagon fut évacué en toute hâte. Heureusement, comme celui-ci, loin s’en faut, n’était pas bondé, chaque voyageur put trouver une couchette dans un autre wagon.
Mais le plus extravagant de cette histoire c’est, vois-tu, qu’aucun des voyageurs de ce compartiment n’ait été alerté ou dérangé par cette odeur méphitique et que nul n’en avertît le contrôleur !...
Bizarre !...
2 A ce moment-là les normes de sécurité n’imposaient pas encore le verrouillage des portières et des fenêtres
3 Néologisme à partir de bruisser
Gospel
Je ne sais ce qui le dispute le plus en moi de la candeur, de l’absence de curiosité, du manque de discernement ou de la stupidité.
Il faut te dire que l’affiche était bigrement alléchante.
Imagine ! The Bostonian Gospel Singers ici, à Gardanne, à « La Briqueterie » !
De plus, le spectacle était offert par la ville dans cette toute nouvelle salle communale inaugurée depuis peu.
Par ici, l’été, dans nos terres de festival, un tel fait n’est pas rare. Mais au printemps pareille prodigalité est plutôt inattendue, voire insolite.
Bien sûr, à la lecture du programme, deux interrogations ont traversé mon esprit :
« Tiens ! Du gospel à La Briqueterie, ce temple du Rock ! Bizarre, mais, après tout, pourquoi pas ? » et « Un spectacle de cette envergure gratis ! Que nous vaut cette aubaine ? ».
Mais j’ai vite repoussé ces deux questions importunes et je me suis empressé d’en parler à Mathilde, toujours partante dès qu’il s’agît de « spectacle vivant » et j’ai réservé à l’Office de Tourisme deux entrées.
S’il m’arrive d’écouter du negro spiritual et même d’en fredonner à l’occasion, je ne suis pas particulièrement amateur de gospel. Cela tient au fait que je suis totalement irréligieux et que non seulement je ne me sens pas du tout concerné par la dimension chrétienne qu’il véhicule et encore moins par son caractère sciemment prosélyte, mais que je n’apprécie pas du tout le martellement ad libitum de ses chorus lancinants destinés à vous conduire à la transe.
Mais comment diable manquer pareille opportunité ? Pourquoi se priver d’un spectacle aussi rare ? Devrais-je récuser la beauté des cathédrales françaises ou des mosquées stambouliotes ou plus généralement l’art religieux au prétexte de mon incroyance ? Devrais-je rejeter la musique sacrée ou telle forme d’expression du chant profond de l’âme humaine au motif qu’elle puisse servir de vecteur à l’endoctrinement ?
Je me faisais donc un plaisir de me rendre avec Mathilde à un spectacle de qualité.
Pourtant, j’eusse dû lire plus attentivement le prospectus qui annonçait clairement que cette tournée gratuite, tournant dans toute la région et organisée par une église évangéliste, adventiste, anabaptiste ou je ne sais quoi ne se produisait que dans des temples protestants ou dans des salles privées anonymes, et trouver suspect que la prestation de ce groupe de renommée mondiale se fît ici, exceptionnellement, dans un lieu public… Etrange ! La municipalité aurait-elle été abusée, manœuvrée, par un puissant lobby protestant ?
C’est à croire !
A ce moment-là je me suis dit qu’on ne saurait se méfier de tout…
Vient le jour du spectacle.
Lorsque Mathilde et moi arrivons à proximité de la salle, nous sommes impressionnés par les énormes camions arborant fièrement l’enseigne « Bostonian Gospel Singers ». Ils sont placés cul contre l’arrière du bâtiment dont le rideau métallique extérieur a été hissé. Leur plateforme relevée à hauteur de scène laisse imaginer les tonnes de matériel que les régisseurs ont dû transbahuter. C’est aussi impressionnant que s’il se fût agi du Cirque Amar ou Bouglione. Prodigieux ! Cette débauche de moyens nous laisse augurer d’emblée de l’exceptionnelle qualité de ce groupe talentueux et célébrissime - le meilleur groupe de Gospel au monde ! - qui, traversant l’Atlantique, est venu se perdre ici, dans cette petite ville provençale, on se demande bien pourquoi.
Comme Mathilde et moi avons pris les devants, il y a encore peu de monde à l’intérieur lorsque nous arrivons. Mais le public afflue à jet continu, par grappes serrées.
En peu de temps la salle remuante, bruyante, électrique est pleine à craquer. Dans un indescriptible tohu-bohu, on se bouscule, on se regroupe, on se salue, on s’interpelle, on s’embrasse. On dérange même ses voisins et on se décale, quand c’est possible, pour faire de la place à ses amis.
Avant que ne commence le spectacle, de nombreux spectateurs, qui n’ont pu trouver de place assise, se tiennent debout au fond et sur les côtés, entassés comme une assemblée de manchots au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires.
Comme nous avons été prévoyants, Mathilde et moi sommes arrivés assez tôt pour occuper deux sièges au troisième rang, en bordure d’une allée latérale. Nous sommes aux premières loges ! Nous jouissons d’une vue imprenable sur la scène illuminée a giorno et, à l’exception d’une forêt de micros et de retours4, absolument déserte pour l’instant. Nous allons pouvoir profiter d’un spectacle qui s’annonce extraordinaire sans avoir à nous tordre le cou !
Arrivent les prestigieux choristes, accueillis par une énorme ovation. Ils entrent en file indienne dans le feu des projecteurs et prennent tranquillement la place qui leur a été assignée, remplissant immédiatement tout l’espace et rendant d’un coup la scène exigüe. Beaucoup de femmes. Peu d’hommes. Tous sont noirs. Tous. Etonnant ! Tous sont vêtus d’un long boubou jaune imprimé de motifs africains vert olive. Certaines femmes, les plus âgées, arborent un turban assorti au boubou. Les plus jeunes sont nu-tête.
Suivent trois hommes.
Le premier, jeune, plutôt petit, maigrichon, étriqué dans une veste trop serrée en dépit de sa petite corpulence, porte des lunettes rondes, des cheveux mi-longs et, prolongeant un menton aigu, un semblant de barbichette assez ridicule. Il s’avance devant un micro, le tapote du doigt pour vérifier s’il fonctionne et prend la parole. Il se présente brièvement. C’est un pasteur aixois inconnu ici, chargé de la tournée. Sous les applaudissements de la foule, il y va du petit laïus habituel dans ces circonstances : remerciements appuyés aux conseillers municipaux qui trônent au premier rang et qui ne boudent pas leur plaisir de se montrer, remerciements au public « d’être venu si nombreux ! ». Puis il présente ses deux comparses : d’abord, l’accompagnateur du groupe, un pasteur noir bostonien, un type ascétique vêtu d’un costume sombre, le Révérend Moses - un nom pareil ne s’oublie pas ! - ; ensuite, le chef de chœur, un long type décontracté, sympathique et souriant, vêtu sobrement d’un pantalon noir et d’une chemise blanche, tenue qui contraste singulièrement avec les boubous bariolés. Enfin, dans un tonnerre d’applaudissements, il présente le « Bostonian Gospel Singers ».
A ce moment précis, je me fais cette réflexion somme toute assez incongrue :
« Bon sang ! Quelle manie ont les spectateurs d’applaudir avant le spectacle ! D’accord ! Il faut bien encourager ces pauvres artistes qui sont en général morts de trac lorsqu’ils entrent en scène ! Mais tout de même !... »
Cette cérémonie achevée, les deux pasteurs cèdent la place au chef de chœur et aux chanteurs. La salle est alors plongée dans une pénombre ponctuée par les lampes faiblardes des issues de secours semblables à des lucioles moribondes. La scène sur laquelle vont converger et se concentrer des centaines de regards scrutateurs forme une petite flaque de lumière. Encore quelques murmures, quelques chuchotements, quelques toussotements, quelques raclements de gorge et le silence se fait, dense, minéral. Le spectacle peut commencer !
V