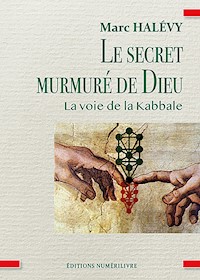Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
La philosophie n’est pas une matière abstraite et rébarbative !
C’est un art de penser au service d’un art de vivre. Conçu par un esprit libre, qui pense librement. Au delà du conditionnement du passé et de l’ADN idéologique. Penser librement, c’est le cas de ces deux philosophes, Lao-Tseu et Nietzsche. Pour Lao-Tseu, il s’agit d’assumer la loi du Tao : construire sa propre vie, en harmonie avec la grande vie du Cosmos. Pour Nietzsche, le but ultime est d’accepter son propre destin. Afin d’accomplir librement tous les possibles qu’il recèle. Unis au-delà des siècles par la même volonté de substituer à la possession des choses la richesse de l’être et l’espérance de devenir, peut-être, des « flèches vers le surhumain », ces deux esprits libres déchirent le décor du banal quotidien et nous ouvrent la voie.
Un ouvrage de référence sur deux des plus grands philosophes .
EXTRAIT
Qu’est-ce qu’un « esprit libre » ?
Tous les philosophes, sans doute, diront qu’ils incarnent, chacun à sa manière, une forme de liberté de pensée. Et, à quelques exceptions près, ils auront probablement raison. Mais faut-il confondre liberté de pensée et esprit libre ? Penser librement et être un esprit libre sont deux choses bien différentes. On pense librement lorsque l’on ne pense pas sous la contrainte, semble-t-il. Mais cela est toujours le cas : même en prison, l’acte de pensée, parce qu’intérieur, est toujours libre. C’est la parole qui ne l’est pas toujours.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Né à Bruxelles en 1953,
Marc Halévy, physicien et philosophe français, a travaillé durant deux décennies dans l’équipe du Prix Nobel llya Prigogine. L’ouvrage de ce passionné de philosophie et d’histoire des religions réussit une éblouissante synthèse de cette double formation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je dédie ce livre au buffle de Lao-Tseu, au Zarathoustra de Nietzsche
Prologue
Qu’est-ce qu’un « esprit libre » ?
Tous les philosophes, sans doute, diront qu’ils incarnent, chacun à sa manière, une forme de liberté de pensée. Et, à quelques exceptions près, ils auront probablement raison.
Mais faut-il confondre liberté de pensée et esprit libre ? Penser librement et être un esprit libre sont deux choses bien différentes. On pense librement lorsque l’on ne pense pas sous la contrainte, semble-t-il. Mais cela est toujours le cas : même en prison, l’acte de pensée, parce qu’intérieur, est toujours libre. C’est la parole qui ne l’est pas toujours.
Mais la pensée libre est une chose, un esprit libre en est une autre. Toute la nuance se joue sur les déterminations de la pensée. Comment pense-t-on ? Bien évidemment, selon une langue, selon une éducation, selon des savoirs accumulés, selon un lieu et une époque, selon un milieu, selon un tissu de relations intellectuelles ou relationnelles qui relie notre pensée à celles de beaucoup d’autres. Nous pensons tous librement, mais nous pensons rarement de façon originale. Oh, je ne parle pas de cette originalité philosophique qui relève d’une acrobatie de foire ou du syndrome de l’art pour l’art (je pense à un Lacan) : ce type de pensée absconse, abstruse, artificielle, vide mais brillante, qui étonne et étourdit ou éblouit sans enseigner, sans nourrir, sans s’offrir, n’a aucun intérêt, hors des salons parisiens. Les poubelles de l’histoire de la philosophie en sont pleines.
Non, l’originalité de pensée dont je veux parler relève de l’ascèse la plus extrême, d’un acte lent, progressif, difficile, de libération de soi hors des déterminations qui téléguident toute pensée imprudemment docile. Il s’agit d’extraire l’esprit et la pensée qu’il secrète du paradigme qui en est le terreau. L’affaire est plus aisée à écrire qu’à réaliser !
Car, nous voici arrivé à l’essentiel : un esprit libre est un esprit qui s’est libéré de ses conditionnements. Un esprit qui pense aussi librement que l’Esprit absolu dont tous les conditionnements sont issus sans qu’ils aient la moindre prise sur lui. Un esprit libre est un esprit libéré.
Libérer son esprit. Libérer l’Esprit en soi. Savoir que ce que nous croyons penser est, en fait, pensé à travers nous. René Descartes affirma jadis : Cogito ergo sum, « Je pense donc je suis ». Non, mon bon René, la vérité est ailleurs, la vérité est ceci : Cogitandum ergo exsistandum, « Il y a du pensant donc il y a du surgissant », ou encore, comme « il y a pensée », donc « il y a ».
Ce n’est donc pas notre pensée qu’il faut libérer de ses conditionnements et déterminations, mais c’est l’Esprit qu’il faut libérer en nous !
Et l’Esprit dont je parle n’est pas le Dieu personnel des théologies théistes. Il est immanent. Il est la source ultime et profonde de tout ce qui existe. Il n’est pas un produit de la Matière comme le voudraient les matérialismes démocritéens ou scientistes. Il n’est pas le Dieu extérieur et parfait, créateur et maître du monde, comme le voudraient les idéalismes platoniciens ou chrétiens. Il est tout ce qui est, et tout ce qui est émane de lui : matière, espace, temps, lois de la physique. Il est la source unique de tout. Il fonde un spiritualisme radical aussi étranger aux matérialismes hasardistes qu’aux idéalismes théistes.
Il est la Volonté de Puissance nietzschéenne.
Il est le Tao de Lao-Tseu.
Lao-Tseu. Nietzsche.
L’Univers éternellement naissant, le Dieu éternellement naissant, l’Homme éternellement naissant.
La Connaissance, la Joie, le Surhumain.
Trois fois la Liberté. Celle de la pensée. Celle de l’esprit. Celle de l’âme.
Trois oppositions radicales et irréductibles à tous les théismes. Le Divin ? Oui ! Évidemment. Mais le Dieu personnel ? Non ! Définitivement non.
Tout ce qui existe est Un, radicalement et indissociablement Un. Monisme donc. Contre tous les dualismes idéalistes. Contre Platon. Contre tous les rabbinismes (mais avec la Kabbale), contre les christianismes (mais avec Maître Eckhart et Pierre Teilhard de Chardin) et contre les islamismes (mais avec les Soufis). Contre Confucius, aussi.
Que dit maître Lao ? Que la vie est impermanence (Héraclite d’Éphèse le dira aussi, à la même époque). Que tout se transforme perpétuellement. Que l’Être n’est pas et que seul le Devenir advient.
Que dit Friedrich Nietzsche ? Que l’homme est un pont tendu, au-dessus de l’abîme, entre animal et surhumain. Que l’homme n’est pas la fin de l’homme (antihumanisme, donc). Que chaque homme a pour destin (Amor fati) de se dépasser et de tendre vers ce qui le dépasse, vers ce qui est au-delà de l’homme, par-delà le bien et le mal.
Lao-Tseu : la Liberté de l’Eau qui coule.
Nietzsche : la Liberté de l’Esprit qui pense.
Ces deux immenses philosophes ont en effet des traits communs majeurs et, surtout, entrent en profonde résonance avec les ruptures et mutations de notre époque.
L’époque qui est la nôtre signe la fin de la Modernité dont le cycle passa, successivement, par l’Humanisme du XVIe siècle (Montaigne, La Boétie), le Rationalisme du XVIIe siècle (Descartes, Leibniz), le Criticisme du XVIIIe siècle (Kant, les « Lumières »), le Positivisme du XIXe siècle (Comte, Marx) et le Nihilisme du XXe siècle (Heidegger, Sartre).
Cette Modernité qui se construisit contre la Féodalité à la Renaissance est aujourd’hui arrivée au bout de sa logique : ses modèles économiques (capitalisme, socialisme), politiques (démocratie, égalitarisme) et noétiques (mécanicisme, réductionnisme) sont à bout de souffle.
Nous vivons une grande bifurcation, nous remodelons tous nos référentiels, toutes nos valeurs, toute notre Weltanschauung, notre vision du monde. Nietzsche l’avait parfaitement prédit, il y a plus d’un siècle ; il avait pressenti cette fin de la Modernité et la montée, subséquente, d’un nihilisme banalisé, généralisé, celui qui a mené à Auschwitz, au Goulag, à Hiroshima, à Guantanamo et en tant d’autres lieux d’infamie…
Nous sommes, de fait, nous les hommes et femmes libres qui pensons notre vie et qui vivons notre pensée, dans la même situation que Lao-Tseu, que Nietzsche qui, leur vie durant, furent en butte au système ambiant.
Nous-mêmes, nous ne survivrons (au sens physique comme psychique) que contre ce grand cadavre pourrissant qu’est devenue la Modernité finissante.
Lao-Tseu eut affaire à une bureaucratie écrasante, imbécile, rigide ; il finit par quitter la cour où il était haut fonctionnaire et résolut de quitter ce monde-là pour se retirer dans les montagnes, y méditer et y mourir en paix, en pleine sérénité.
Nietzsche eut affaire au système académique prussien, mais surtout, à la maladie : nausées, céphalées, troubles oculaires et auditifs, troubles digestifs sans fin (les suites, dit-on, d’une syphilis contractée dans un bordel allemand, lorsqu’il était étudiant).
Comme notre avenir et notre monde doivent se construire, aujourd’hui, contre la Modernité, Lao-Tseu et Nietzsche ont construit leur philosophie contre l’État, la Religion, la Folie.
Car c’est éclairant : notre monde d’aujourd’hui est bien étatique, religieux (les fanatismes laïques, athées, islamistes, intégristes, idéologiques) et fou (au nom de la richesse, nous appauvrissons tout !).
Au fond, ce qui lie les philosophes auxquels ce livre rend hommage, c’est un immense plaidoyer pour changer d’étalon de richesse.
À notre richesse matérielle, enfermée dans l’Avoir et le Paraître, prisonnière de la possession des choses et des êtres, empêtrée et enlisée dans le modèle du bourgeois moderne, il est impérieux de substituer une « autre » richesse, une richesse qui permette, nourrisse et renforce l’émergence d’une philosophie de l’Être et, surtout, du Devenir, ce processus en Devenir que Lao-Tseu appelle le Tao et que Nietzsche appelle le Surhumain.
La liberté avec Lao-Tseu
Il y avait quelque chose d’indéterminé avant la naissance de l’univers.
Ce quelque chose est muet et vide.
Il est indépendant et inaltérable.
Il circule partout sans se lasser jamais.
Il doit être la Mère de l’univers. […]
Ne connaissant pas son nom, je le dénomme Tao.
LAO-TSEU, Tao-tö-king
UN, IMPERMANENCE, LOGOS
L’Humanité est une espèce animale sans beaucoup d’intérêt particulier d’un point de vue zoologique ou biologique. Un animal peureux et faible, mal adapté à la Nature sauvage, sans carapace ni fourrure, sans griffes ni crocs, malhabile à la course et à l’escalade, incapable de vol ou d’apnée. Bref : un raté de l’évolution, voire ! Ce ratage zoologique allait ouvrir le chemin vers une nouvelle aventure de la Vie : un saut vers l’inconnu !
Pour pallier ses déficiences corporelles et tenter, malgré tout, de survivre, l’humain comprit que son seul atout était sa pensée, sa capacité à comprendre le monde, sa capacité à anticiper les catastrophes ou les dangers, sa capacité à ruser en jouant des manies, des faiblesses ou des aveuglements de ses prédateurs, sa capacité à structurer ses expériences.
La Culture était née face aux défis de la Nature.
À ses origines, la Culture des hommes prit assez vite des allures abstraites, voire religieuses : il fallut inventer des concepts concis, compacts, drus, pratiques, partageables et échangeables pour parler de l’essentiel : la vie et la mort, l’amour et la haine, de désir et la terreur, l’espoir et le désespoir.
Du marais animiste et chamanique des débuts devaient émerger et germer trois arborescences culturelles très différentes, entées sur des terreaux bien distincts : le long des vastes rives du Yangzi Jiang en Chine, autour du Gange en Inde et sur les bords de notre Méditerranée, où fleurent le romarin et le thym, la sarriette et la farigoule, où s’osent, effrontément, l’olivier et la vigne.
Trois concepts fondateurs sont nés là. Tous à la même époque : celle du VIe siècle avant notre ère.
Ces trois concepts ont fondé trois aires de civilisation qui, de là, ont essaimé jusqu’aux confins de leurs bassins naturels.
L’Inde forgea le concept de l’Un.
Tout ce qui existe est Un. La multiplicité des êtres et des choses, des événements et des phénomènes ne doit leurrer personne car tous, ils reflètent et manifestent une Unité essentielle qui est l’océan du Réel dont ils ne sont que les vagues de surface. L’Un, en tant que concept central de la pensée et de la spiritualité indiennes, appelle l’unification, le dépassement de toutes les dualités dont celle, immense, qui scinde l’existence entre ces deux illusions que sont le moi et le non-moi. Toutes les écoles indiennes de pensée et de pratique visent ce même but unique : unifier ce qui semble multiple et retrouver l’Un pur pour s’y fondre. Tout le védantisme, tous les yoguismes, tout le shivaïsme, tous les bhaktismes, toutes les facettes (si nombreuses) de ce que l’Occident nomma l’hindouisme, ainsi que ses surgeons bouddhistes et jaïnistes, procèdent de cette seule et unique racine : la recherche de l’Un.
La Chine forgea un autre concept clé : l’Impermanence.
Tout est mouvement, transformation, changement, mutation et transmutation. Tout naît, grandit, mûrit, décline et meurt : les cinq phases de toute existence, les cinq « éléments » qui s’engendrent et se détruisent mutuellement dans l’immense cycle du Ciel et de la Terre, du yin et du yang. Tout est Devenir. Rien n’est permanent. Tout est énergie fluide et volatile, subtile et fluente. Tout est flux et reflux.
Vivre, c’est respirer : succession d’inspirs et d’expirs. Tout est respiration. Tout est harmonie, aussi. Car l’impermanence n’exclut nullement la complémentarité, la résonance, la complicité, la reliance. Ce qui se meut ne se meut jamais seul : tout mouvement subit et induit d’autres mouvements dans le jeu infini des résistances et des connivences. Faciliter l’écoulement des énergies, agir sans agir, couler avec ce qui coule comme la goutte d’eau au sein du torrent. L’eau coule et va de l’avant sans se préoccuper du caillou qui lui résiste et qu’elle use, inexorablement, au passage.
La Méditerranée engendra le troisième concept clé : le Logos.
Le monde tel qu’il existe, malgré ses aspects erratiques et aléatoires, n’est pas le fruit du pur hasard : il y existe un ordre, une loi, une cohérence. Le grec ancien appela cette raison commune, cette loi générale, le Logos qui est à la fois la Loi qui ordonne (qui met de l’ordre) et la Parole qui ordonne (qui donne un ordre).
Le Logos méditerranéen s’identifie pleinement à ce principe de consistance de l’univers qui, entre tout ce que celui-ci contient, assure la cohésion dans l’espace et la cohérence dans le temps. Cette découverte fondamentale du VIe siècle avant l’ère vulgaire (et sous ses deux formes, physique ionienne – les lois du cosmos – et prophétique hébraïque – les lois de Dieu) a ouvert, d’un même coup, toutes les voies du sens et des sciences qui, chacune de son côté, cherchent à percer le mystère (les modalités, les raisons et les règles) de ce principe de consistance universel.
Un. Impermanence. Logos.
Ces trois concepts sont complémentaires et se renvoient, sans cesse, l’un à l’autre.
Le Cosmos est Unité, Devenir, Cohérence. Sans Unité, point de Cohérence mais au mieux quelques hasards ou fortuités. Sans Cohérence, point de Devenir mais au mieux quelques aventures ou caprices. Sans Devenir, point d’Unité mais au mieux quelques impasses ou inerties.
Pour que l’univers soit – puisse être – un Cosmos au sens grec ancien d’Ordre, il doit impérativement pouvoir s’appuyer sur ce ternaire essentiel.
Ternaire, triangle, Force, Beauté, Sagesse. La Force de l’Unité, la Beauté de la Cohérence et la Sagesse du Devenir.
Que serait Israël sans ses trois patriarches : Abraham le fidèle de la foi, Isaac le mystique de la gnose et Jacob le religieux de la loi ?
Que serait l’héritage du tranquille Noé, à quoi auraient servi l’Arche et l’Alliance, sans ses trois fils : Sem, Cham et Japhet, sans le Nom (Chem) qui nomme et désigne par le Logos de la Parole, sans l’Énergie-chaleur (Ham) qui anime et nourrit le Devenir, et sans l’Ouverture (Yèphèt) qui sort l’Un du néant et le déploie en myriades d’êtres ?
Ce Logos, à la fois hébreu et grec, est fondateur de l’identité méditerranéenne qui, par l’empire romain, devint européenne.
Face au Logos méditerranéen, l’Inde inventa le concept de l’Un dans la non-dualité et la Chine, celui du Devenir dans l’impermanence.
Notre époque verra-t-elle l’émergence de la synthèse des trois : l’Un, le Devenir et le Logos, c’est-à-dire l’unité, l’évolutivité et la cohérence du Tout ?
Le Logos méditerranéen (dans ses deux versions ionienne physique et hébraïque prophétique) le Tao chinois et le Brahman indien sont liés. Mais ces trois branches de l’arbre n’ont pas donné les mêmes fruits : là-bas l’essence de son impermanence et l’essence de son unité, ici, l’essence de sa consistance.
L’Humanité, donc, doit à la Chine ancienne d’avoir dégagé ce concept immense de l’Impermanence et du Devenir.
Tout le Tao et tout le taoïsme philosophique qui le cherche naissent au cœur de ce concept qui fonde toute la culture et toute la civilisation chinoise et toutes les cultures du vaste bassin sapientiel où les catégories chinoises se sont implantées jusqu’à forger, au plus profond, l’âme des peuples de tout le Sud-Est asiatique depuis le sud du Vietnam jusqu’au nord du Japon.
Le Tao, c’est cela : cette Impermanence universelle, de Devenir permanent.
La sagesse méditerranéenne a été subjuguée par l’Ordre miraculeux et harmonieux qui règne dans le Cosmos et par les Lois (physiques ou éthiques) qui en découlent.
La mystique indienne, elle, a été fascinée par l’Unité absolue, radicale, compacte du Tout, et par l’interdépendance foncière de tout avec tout au sein de cette unité.
La pratique chinoise a regardé le monde réel, sans illusion ni idéal, lucidement ; elle n’a pas recherché le fixe derrière le fluent ; elle a pris ce fluent tel quel et a œuvré à l’assumer pleinement.
Le Réel, objet final de toute la tension intellectuelle et spirituelle des hommes, a donc été visité selon ses trois axes : son territoire, qui fonde le « Tout est Un » de l’Inde, ses structures, qui fondent le « Tout est Loi » de la Méditerranée, et son activité, qui fonde le « Tout est Mutation » de la Chine.
Contrairement à la pensée européenne, obsédée d’espace, de conquêtes, de dominances, et à la pensée indienne, acharnée de libération, de désillusionnements, de désincar-nations, la pensée chinoise est fondée sur le temps !
Le temps.
Le peuple chinois est casanier. Il n’a jamais rêvé de conquêtes guerrières. Il ne connaît pas la notion d’impérialisme même s’il fut – et est encore, d’une certaine manière – un immense empire : celui du Milieu. Le symbole du peu d’intérêt chinois pour l’espace se cache dans la grande muraille : 6 700 kilomètres d’ouvrages d’art qui en font la plus importante structure architecturale jamais construite par l’homme tant en longueur, qu’en surface et en masse.
L’espace est clos et se clôt.
Le temps, lui, s’ouvre, interminablement. Plus qu’un territoire, la Chine est une tradition. Elle est la tradition de la tradition. Elle cultive les généalogies et le culte des ancêtres, les linéaments phylétiques et les idiosyncrasies.
En Chine, l’individu ne compte pas et l’individualisme est la pire des grossièretés. Chacun n’est que le maillon d’une longue chaîne de transmission des patrimoines de la famille : patrimoines matériels et de commerce autant que patrimoines immatériels et de renommée. Perdre la face, c’est ternir mille générations. La mission de chaque homme est de transmettre, vers la génération suivante, les patrimoines reçus de la génération précédente. Ils doivent être transmis au moins intacts et, si possible, enrichis, ennoblis, enluminés.
Cette inscription dans le temps est, bien sûr, le pendant de cet ancrage dans les principes mêmes de l’impermanence et du Devenir, dans ce regard sur l’écoulement des êtres et des choses, des saisons et des existences, sur ce flux universel qui se nomme Tao.
Au fond, le taoïsme philosophique n’est qu’une longue et fertile méditation sur le temps qui passe. Mais une méditation sans nostalgie ni désespoir, sans fatalisme ni finalisme.
Le temps n’est que le lieu de la création continue, du projet éternel, de l’éternellement inaccompli qui s’accomplit. Et voilà bien l’essence même du Tao d’être cet « éternellement inaccompli qui s’accomplit ».
L’esprit chinois est pragmatique. Toute philosophie y est bien plus une praxéologie (du grec praxis : « action », et logos, « discours » : « règles d’action ») qu’une métaphysique.
Les Chinois ont tout inventé, disaient leurs découvreurs européens de la Renaissance et d’après, mais ils n’en ont tiré aucune science. Et cela est curieusement vrai : le papier, la soie, l’encre, la poudre à canon, la boussole, l’étambot, les pâtes alimentaires, les machines à calculer, les thés verts ou fermentés ou fumés, sans parler du canard laqué et des raviolis à la vapeur, sont autant d’inventions chinoises comme l’acuponcture et les arts martiaux. Et pourtant, de tout cela, l’esprit chinois ne tira nulle science conceptuelle et axiomatique. La science abstraite n’intéresse pas l’esprit chinois, qui n’est habité par aucun goût pour les systèmes, par aucun attrait pour ces cathédrales abstraites et logiques qu’affectionne l’Occident.
Ce paradoxe curieux n’est qu’apparent et n’insulte en rien la suprême et subtile intelligence de l’Empire du Milieu ; il souligne seulement son dédain pour le figé et le fixe, pour le rigide et le dogme. Nous rêvons, ici, de tout couler dans l’airain et de tout graver dans le marbre ; Tchouang-Tseu en pleurerait de rire. L’impermanence s’applique aussi aux prétentieux savoirs qui croient tout accaparer et maîtriser. En Chine, le savoir aussi est un héritage qui se transmet en s’enrichissant, en s’ennoblissant. Rien, jamais, n’y est ni coulé dans l’airain, ni gravé dans le marbre.
Au fond, le penseur chinois ne s’intéresse qu’à une question pragmatique : comment harmoniser l’impermanence intérieure et l’impermanence extérieure ? Comment harmoniser le Tao du « dedans » et le Tao du « dehors » au sein du Tao absolu ?
Car dans la sémantique chinoise, impermanence et harmonie se répondent profondément. L’une appelle l’autre, évidemment. Tout se mouvant, tout pourrait être déchirure, écarts et divorce, mais tout peut aussi, si on le veut vraiment, converger, s’allier, s’unir, s’enrichir mutuellement.
J’écrivais ailleurs ceci : « L’objectif de toute communication occidentale est de transférer, telle quelle, sans déformation, une vérité depuis une tête pensante vers une autre tête pensante. En Chine, rien de tel. Le but du jeu, surtout entre lettrés, est tout autre : il s’agit de nourrir l’autre, de lui proposer un champ interprétatif et herméneutique riche et fécond où il puisse planter sa propre pensée. Il ne s’agit pas tant de transmettre que d’ensemencer. »
Écrire n’a pas pour intention de convaincre, de persuader, d’embrigader le lecteur, mais bien de semer, dans son esprit, des graines fécondes qui y germeront peut-être et qui y donneront un fruit que le lecteur seul connaîtra.
Là réside l’immense différence entre transmettre et enseigner : on transmet la graine et l’on enseigne le fruit.
Le texte est un pont entre deux esprits autonomes : celui de l’auteur et celui du lecteur. Et ce pont a pour mission de véhiculer des messages qui devront être accueillis et transmués par l’esprit du lecteur : il ne vise pas la vérité, mais la fécondité. La nuance est énorme !
Un bon livre nourrit, un mauvais livre tranche. Un bon livre unit ; un mauvais livre sépare.
Dans le même esprit, un Chinois ne dit jamais : « non ». Un Chinois n’agresse jamais verbalement celui qu’il a en face de lui. Il cherche toujours à laisser ouvert un maximum de portes afin, à tout moment, d’avoir devant soi la plus grande panoplie possible de scenarii pour construire – patiemment – une solution harmonieuse qui permette, aux deux parties, de s’en sortir avec élégance et panache, sans perdre la face.
Cette courtoisie lancinante (« le misérable ver de terre que je suis, espère que votre très honorable personne acceptera de me faire l’honneur de »), cette tolérance active (« je vous écoute avec la plus grande attention et le plus grand dévouement »), cette ouverture (« je vous prie humblement de penser à votre intérêt en tenant compte de ») ont longtemps été interprétées par les Occidentaux comme de l’hypocrisie (ce qui est faux), de la ruse (ce qui est vrai car la ruse est positive si elle veut mener à un accord harmonieux), de la compromission (ce qui est faux car incompatible avec la renommée et l’honneur d’une famille), de la duplicité (ce qui est en dessous de la vérité puisque ce n’est pas de duplicité mais de multiplicité qu’il faut parler).
La littérature taoïste est vaste et ancienne, mais si simple et si actuelle.
Le voyage auquel je vous convie n’est qu’une excursion limitée, on s’en doute. Quelques millénaires de culture, de pensée, de philosophie et de poésie ne se résument jamais à trois ou quatre livres, quelque représentatifs soient-ils.
Mon travail, présenté ici, ne parle que du Tao dans la vision de la philosophie taoïste fondée par Lao-Tseu au VIe siècle avant l’ère vulgaire. Il fait donc l’impasse sur toutes les écoles confucianistes qui, longtemps et maintenant encore, furent et sont largement dominantes quant aux normes, règles, standards et comportements sociétaux de la Chine et des Chinois.
Un Chinois est confucéen en public et en famille ; il est taoïste dans son for intérieur, face à lui-même et à l’univers. Et s’il est juif, chrétien ou musulman (ce qui arrive !), cela ne l’empêchera nullement d’être toujours taoïste dans son âme et dans son cœur, et confucéen dans ses gestes et paroles. Et il n’y voit aucun problème, aucune malice. Pour lui, tous ces registres se complètent et se nourrissent mutuellement. Là où nous, Occidentaux, hérissons l’existence de OU exclusifs, le Chinois sème des ET inclusifs.
LAO-TSEU OU LE VRAI
Le Tao est un concept philosophique, métaphysique même, qu’un grand sage, Lao-Tseu, a fondé au vie siècle avant l’ère vulgaire. Un livre, donc : le Tao-tö-king, le « Classique du flux et de sa puissance » pourrait-on traduire. Un livre dense, compact, immense. Quatre-vingt-un chapitres courts, minimalistes, obscurs mais d’une fécondité qui nourrit les esprits d’aujourd’hui, malgré les presque trois millénaires qui nous séparent de sa rédaction. Le Tao-tö-king est un texte abrupt, rêche, économe, aride même. Il faut y pénétrer avec patience, avec persévérance, avec délicatesse. Un monument conceptuel d’un très haut niveau d’abstraction. Lie-Tseu, deux siècles plus tard, reprendra ce travail.
Lire Lao-Tseu ou, plutôt, lire ce texte ancien attribué au sage Lao-Tseu, n’est pas une sinécure. Dans les parties qui suivent, nous parcourrons les thèmes centraux de la pensée de Lao-Tseu : le cosmos (Lao-Tseu est d’abord un métaphysicien qui a fait du Tao le fondement absolu et ultime du Tout), l’engendrement (le Tao est, avant tout, une dynamique, un processus universel dont tout émane), la vertu (le potentiel comme on parle de vertu médicinale d’une plante), le non-agir (toute l’éthique de Lao-Tseu tient dans ces deux petits mots), le prince (Lao-Tseu est un conseiller des princes, une sorte de Machiavel d’avant la lettre) et le peuple (envers lequel Lao-Tseu prêche un antihumanisme politiquement très incorrect mais interpellant).
Mais plaçons tout ceci dans son contexte.
De l’homme Lao-Tseu (le Vieux Maître, en traduction littérale), on ne sait rien ou presque. Il aurait été fonctionnaire de haut rang – archiviste, dit-on – à la cour des Zhou quelque part au VIe ou au Ve siècle avant l’ère vulgaire. Poétiquement, les historiographes chinois nomment son époque : « la période des Printemps et des Automnes ». Pour une raison obscure – lassitude, intrigue, exil ? –, il aurait décidé d’aller au-delà des montagnes, loin vers l’ouest, pour terminer sa vie en ermite.
Les légendes à son sujet sont heureusement plus prolixes.
Sa mère aurait été fécondée sous un prunier, symbole de vie et de beauté, par la vue d’un Dragon, symbole du Tao et de la plus haute sagesse.
Il serait né à 81 ans, avec des cheveux et une barbe très longs, très blancs. Avec des oreilles aux lobes très longs, signe de sagesse.
La légende continue : « archiviste à la cour des Zhou et contemporain de Confucius qui le reconnaît comme un maître et un être extraordinaire, il finit par quitter le pays âgé d’au moins 160 ans, lassé des dissensions politiques. Il part vers l’ouest monté sur un buffle ; arrivé à la passe qui marque la frontière, il rédige le Livre de la Voie et de la Vertu à la demande du gardien Yin Xi puis continue son voyage. Personne ne sait alors ce qu’il devient, mais certains pensent qu’il ne meurt pas ou qu’il se réincarne, reparaissant sous différentes formes pour transmettre le Tao ».
La religion taoïste ultérieure a fait de Lao-Tseu un immortel et un dieu. Il y est vénéré comme tel.
Le lettré et alchimiste Ge Hong (283-343) décrit l’image de ce Lao-Tseu divinisé au centre du panthéon taoïste religieux : « Peau jaune clair, oreilles longues, grands yeux, dents écartées, bouche carrée aux lèvres épaisses, quinze rides sur un front large qui porte aux coins la forme de la Lune et du Soleil. Il a deux arêtes de nez et trois orifices à chaque oreille, et les dix lignes des êtres d’élite marquent ses paumes. »
Il est aussi souvent représenté âgé, chevauchant un buffle, symbole de force et de sérénité.
Voilà pour le personnage. Quant à son livre, aussi fameux qu’unique, les historiens et exégètes nous disent qu’il eut plusieurs auteurs et que sa rédaction s’étale entre le VIe et le IIIe siècle avant l’ère vulgaire.
La vérité est un leurre. De Kant (1724-1804) à Hegel jeune (1770-1831), en passant par Fichte (1762-1814), Schelling (1775-1854) et Schopenhauer (1788-1860 ; ou Jacobi, Reinhold et Maïmon), le problème qui tracasse la métaphysique allemande, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, est celui du rapport du sujet connaissant et de l’objet à connaître, celui de la possibilité même de toute connaissance, celui de la fondation certaine d’une connaissance réelle, bref, celui de la vérité.
Ce qui exaspère chez les philosophes modernes (surtout après Kant et dans sa veine), c’est ce besoin obsessionnel de mécaniser leur système de pensée en inventant une kyrielle de concepts artificiels qu’ils s’ingénient, ensuite, à articuler entre eux selon des règles fines de logique aristotélicienne ou de sémantique analytique.
On s’y perd très vite. C’est lourd, c’est ennuyeux, c’est pesant, c’est vide.
C’est une réponse compliquée (donc ontologiquement inadéquate et pratiquement fausse) à la complexité réelle du Réel.
La philosophie doit réapprendre à penser le Réel avec simplicité (ce qui est bien plus difficile que de construire des « usines à gaz » logico-conceptuelles aussi abstruses qu’inutiles).
La philosophie doit revenir à sa source profonde : l’amour de la sagesse, c’est-à-dire de la mise en harmonie et en joie de cette interface fluent et évanescent entre la vie du « dedans » et la Vie au « dehors ».
La conscience se place à l’interface entre le « dedans » de ma vie organique et le « dehors » de la Vie cosmique (deux faces du même processus d’accomplissement). Cette idée est fondamentale. Elle définit la pensée comme processus de convergence au sein de cette interface, dont participent l’ego et toutes les activités mentales.
D’un côté, un estomac criant famine, de l’autre, un monde regorgeant de nourritures.
D’un côté, une angoisse face à la mort. De l’autre, un monde de vie incessante, éternellement recommencée.
Tout le travail de la pensée est d’établir un pont entre ces deux faces de la même réalité.
La vérité, c’est ce qui fait grandir l’homme dans la joie de vivre !
La vérité ne se démontre pas ; elle se vit. Elle proclame, par la joie vécue, que le chemin de vie que l’on suit est bien en harmonie avec le Réel tel qu’il est. La connaissance ne se dit pas, elle se vit : elle est cette adéquation même entre ma vie et la Vie.
La vérité, c’est le Réel. Il n’y en a pas d’autre, il n’y a rien d’autre. Chercher la vérité, c’est prendre toute la réalité telle quelle et telle qu’elle est.
LE COSMOS
Il y a deux millénaires et demi, Lao-Tseu – du moins c’est ainsi que le veut la légende – écrivit quatre-vingt-un chapitres courts et denses qui disent tout sur tout. Ayant achevé ce qui sera son épitaphe et l’ayant remis au gardien de la passe, le philosophe aux longues oreilles remonta sur son buffle. On ne le revit jamais. Depuis, il vit parmi les Immortels, là-bas, de l’autre côté, léger comme la brume. Mais qu’est devenu le buffle ?
Premier chapitre (la tradition ou l’habitude font que l’on numérote les chapitres de Lao-Tseu en chiffres romains) :
Le Tao nommé Tao n’est pas l’éternel Tao.
Le Nom nommé Nom n’est pas l’éternel Nom.
Sans Nom : origine de Ciel et Terre.
Avec Nom : mère des dix mille choses.
Alors que, partout ailleurs, j’utiliserai les traductions françaises des sinologues les plus autorisés, ici je fais une exception et traduis le texte moi-même. Le texte est concis.
Ces quatre vers entament le Tao-tö-king – le livre unique attribué à Lao-Tseu. Vingt-quatre sinogrammes1qui bouclent les vingt-quatre heures du temps éternel, de l’éternel retour au même.
Que dit ce texte ? Tout ! Le Tao est éternel ; le Tao est l’origine du Ciel et de la Terre. Mais tout nom, même Tao, lui est inadéquat, impropre, impertinent (dans les deux sens de ce mot).
Lao-Tseu se place donc, d’emblée, dans une posture apophatique2 : sur le Tao, rien ne peut être dit, même pas son nom. Il est le Réel ineffable, indicible. Le Réel ne se dit pas, mais il se vit. Aucun mot, aucun concept ne lui conviennent, mais il est l’évidence de l’évident, il est le plus proche des proches, il est ce qui advient.
Moïse, en exil auprès de son beau-père Yitro dont il garde les troupeaux, rencontre un buisson-ardent qui brûle sans se consumer. Et une voix tonne : « Je serai ce que je serai3 » (Exode 3:14). C’est le Tao.
Lao-Tseu suggère – plus qu’il ne proclame – deux points philosophiques essentiels : la réalité du Réel et l’inadéquation de tout langage humain. Le premier de ces deux points sera repris plus loin. Quant au second, voyons : les mots et les concepts découpent le Réel afin d’y identifier ce que l’homme croit être des parties, des constituants, des éléments. Mais le Réel est le Tout Un, indissociable, indécoupable, indiscernable. Le Tao est un Tout organique en devenir, sans parties ni composants. Tout mot humain lui arrache un morceau qui, aussitôt, perd tout sens. Et si l’humain persiste à nommer, alors surgissent les dix mille choses comme autant de mirages qui manifestent le Tao sans être autre chose que des reflets partiaux et partiels qui siéent au mental humain et à ses besoins de conceptualisation, d’idéalisation (au sens propre et premier de ce terme).
Le débat est d’importance. Il a nourri la discussion philosophique en Occident depuis les présocratiques. Que peut-on dire, en langage humain, du Réel ? Rien, répond calmement Lao-Tseu. Tout ce que l’on peut dire de lui est inadéquat. Les apophatiques prenaient la même posture dès qu’il s’agissait de parler de Dieu.
Derrière cette posture se dresse tout un discours sur la réalité et la valeur de la connaissance. Toute connaissance exprimée en mots est une méconnaissance. Mais la connaissance vraie, véridique est cependant possible, immédiate, mais inexprimable, indicible, incommunicable. Cette connaissance-là – qu’il faudrait plutôt appeler de son nom grec : gnose – est une connaissance qui se vit, mais qui ne peut se dire d’aucune manière.
Sans nom, le Tao est tout ce qui advient là – y compris ce que je nomme « je » ; il est le Réel pris comme un tout vivant, pris comme devenir universel, pris comme origine de tout ce qui existe et le manifeste dans le visible et l’invisible.
Les savoirs se disent, mais ne disent rien, la connaissance se vit, mais ne se dit pas.
Le taoïsme philosophique est une gnose. La tradition zen en a gardé et préservé l’essentiel : vivre le Réel ici et maintenant et n’en rien dire. Laisser s’épuiser la pensée conceptuelle comme une vague qui meurt sur la grève. Laisser la conscience silencieuse et tranquille se laisser pénétrer par le Réel sous-jacent et, surtout, ne pas penser ou, plutôt, ne pas accrocher les pensées qui passent et les laisser filer pour ne plus y prêter aucune attention.
Vivre le Réel sans le penser. Vivre le Tao sans le penser. Sans le nommer, donc. Car ce que nous susurre Lao-Tseu, c’est que penser et nommer sont synonymes. On ne pense jamais les choses ; on pense seulement le nom des choses. La pensée est un jeu de mots. Rien d’autre.
Lao-Tseu nous indique que le Tao ne se nomme pas. Il est. Il advient sans cesse. Et de lui, naissent le Ciel et la Terre. Ciel et Terre symboliques, évidemment.
Le Ciel : cercle. La Terre : carré. Le trou carré au centre du cercle de métal : c’est la vieille pièce de monnaie chinoise. Cela n’est ici dit, mais l’on sait bien que le Ciel est yang et la Terre, yin. Le Tao est l’origine du yin yang4.
Pense à ne pas penser, et tu penseras
Le regardant, on ne le voit pas, on le nomme l’invisible. L’écoutant, on ne l’entend pas, on le nomme l’inaudible. Le touchant, on ne le sent pas, on le nomme l’impalpable. Ces trois états dont l’essence est indéchiffrable se confondent finalement en Un.
Sa face supérieure n’est pas illuminée, sa face inférieure n’est pas obscure.Perpétuel, il ne peut être nommé, ainsi il appartient au royaume des sans-choses.Il est la forme sans forme et l’image sans image.Il est fuyant et insaisissable.
L’accueillant, on ne voit pas sa tête, le suivant, on ne voit pas son dos.
Qui prend les rênes du Tao antique dominera les contingences actuelles.Connaître ce qui est à l’origine, c’est saisir le point nodal du Tao5.
Laissons, pour l’instant, ces quatre derniers vers. Le reste du texte, comme souvent, se présente comme une litanie de paradoxes, d’oxymores même. La pensée taoïste est une antipensée. « Pense à ne pas penser et tu penseras », « Ne pense pas, mais laisse-le se penser par toi ».
Dire l’indicible. Voilà le nœud oxymorique de toute gnose authentique.
L’image classique la plus adéquate, me semble-t-il, est celle de l’océan et de ses vagues. Nos sens perçoivent les vagues. Nos mots nomment les vagues. Nos pensées idéalisent les vagues. Mais les vagues ne sont rien. Elles n’existent pas. Elles ne sont pas des objets. Elles ne sont que les manifestations superficielles du Réel sous-jacent, de cet océan immense dont on ne perçoit rien, dont on ne peut rien dire ni penser.
Voir, entendre, sentir. Percevoir, dire, penser. Les trois ne font qu’un et forgent le royaume de l’illusion où l’homme se pavane et se repaît de ses propres mensonges, de ses propres fantasmes.
Nous voilà en plein centre du débat classique entre noumène (la chose en soi) et phénomène (la chose pour moi), entre le Tao et ses manifestations à mes yeux, entre le Réel et ce que j’en perçois et conçois.
Et Lao-Tseu ne tranche pas. Il ne prend pas parti. Il suggère seulement et simplement que chacun doit bien clairement savoir où il en est et d’où il parle, diraient nos philosophes d’aujourd’hui. Lao-Tseu n’interdit nullement de dire, ni ne raille ceux qui disent (lui-même a écrit ses quatre-vingt-un chapitres). Il veut seulement et simplement que chacun sache que ce qu’il dit ne dit rien du Tao en soi, mais ne parle que du Tao pour lui. La parole et la pensée qui la nourrit ne sont pas bannies mais elles sont diablement relativisées. Si elles sont utiles aux hommes en chemin vers le silence, soit. Mais si elles ne le sont pas, le silence est infiniment plus vrai.
Au cœur de la doctrine du taoïsme se trouve cette distance, voire cette incompatibilité, entre le « dire » et le « vivre ». Vis plus et dis moins : tel pourrait être tout le résumé de la voie taoïste qui deviendra, plus tard et ailleurs, la voie zen.
Mais reprenons le dernier quatrain :
Qui prend les rênes du Tao antique dominera les contingences actuelles. Connaître ce qui est à l’origine, c’est saisir le point nodal du Tao.
Dominer les contingences actuelles : maîtriser ce qui advient mais qui pourrait bien ne pas advenir (c’est le sens du mot « contingence »). Ici, Lao-Tseu invite l’inquiétude humaine à se vider. Tout est incertain. C’est l’évidence même. Rien n’est écrit dans l’airain. Rien n’est gravé dans le marbre. Tout est impermanent. « Tout coule », dirait Héraclite d’Éphèse, ta panta rhéi.
Et alors ?
Souvent, le Tao est symbolisé dans l’iconographie chinoise par le dragon. Là-bas, le dragon est signe bénéfique et non maléfique tel que l’en fit la tradition chrétienne pour diaboliser les symboles du paganisme antérieur. Prendre les rênes du Tao, c’est chevaucher ce dragon, c’est vivre le Tao, c’est devenir le Tao, c’est passer du « dedans » de l’inquiétude humaine au « dehors » de la sérénité cosmique.
En écho, François Rabelais renchérirait probablement : « Fais ce que tu dois, advienne que pourra. » Sauf que l’idée de devoir est bien plus confucéenne que taoïste.