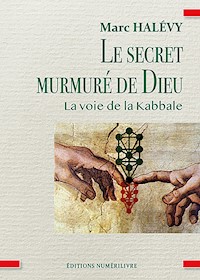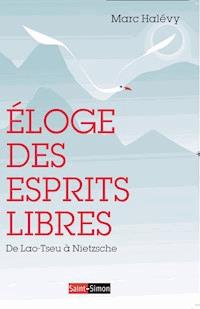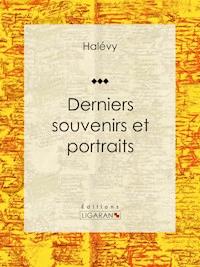
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le nom de Mozart est si illustre, sa renommée, que le temps accroît encore chaque jour, est si légitime et si grande, qu'on regrette de devoir restreindre aux limites d'une notice biographique l'histoire de sa vie et une appréciation de son œuvre. — Au reste, beaucoup de travaux ont été publiés sur ce musicien célèbre. Nous citerons, parmi les biographes allemands, Schlichtegroll, Niemtschek, Nissen...."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050691
©Ligaran 2015
La France vient de perdre un de ses deux grands compositeurs, un maître illustre, un théoricien savant, un écrivain d’un rare mérite, enfin, l’un des hommes les plus considérables de notre temps, M. F. Halévy. Rien ne pouvait faire prévoir l’imminence de ce malheur ; on savait que l’auteur de la Juive s’était ressenti, l’été dernier, d’un peu de fatigue et de malaise, suite naturelle des travaux de toute sorte qu’il s’était imposés. Son médecin, moins par nécessité que par précaution, lui avait conseillé de passer l’hiver sous un climat plus doux, et de s’éloigner, pour quelques mois, de ce tourbillon de la vie parisienne, où il était mêlé forcément par tant de côtés. Il partit donc pour Nice, avec sa femme et ses enfants, serrant la main à ses amis sans leur dire adieu, comme on part pour la campagne. Au bout de quelques jours, il se portait déjà mieux ; les nouvelles étaient excellentes ; dans quelques semaines, il aurait entièrement recouvré ses forces. Il se prodiguait peu, il travaillait modérément ; il était entouré des plus douces affections ; il était heureux ! Il allait revenir, et ce retour, hélas ! eût été pour lui une joie et un triomphe.
Son Excellence le ministre d’État, qui s’était informé sans cesse de la santé de l’éminent compositeur, de ses projets, de ses vœux, avait donné l’ordre de jouer le plus tôt possible, à l’Opéra, un ouvrage en trois actes d’Halévy, presque entièrement achevé et destiné à une autre scène. Cependant la direction de l’Opéra-Comique revenait aux mains d’un homme qui a commencé sa fortune par le succès du Val d’Andorre, qui s’est montré, en toute occasion, l’ami le plus reconnaissant, le plus dévoué de l’auteur des Mousquetaires, de la Fée aux Roses, de l’Éclair, de tant d’autres partitions populaires et charmantes, et qui aurait sans doute remis en honneur un répertoire trop négligé par une déplorable incurie. Ainsi tout souriait à ce pauvre Halévy ; tout lui était propice ; on le désirait, on l’attendait, on pressait son retour ; jamais peut-être l’avenir ne lui était apparu sous des couleurs plus brillantes ; lorsque, soudain, le bruit se répand qu’il est à la dernière extrémité ; et presque en même temps on apprend qu’il est mort.
Il n’était âgé que de soixante-trois ans, et peu de carrières ont été mieux remplies, plus laborieuses et plus fécondes que la sienne. Je donnerai tout à l’heure le catalogue de ses ouvrages à peu près complet. Ceux qui savent ce qu’il faut de temps et de peine pour écrire un si grand nombre de partitions, – je ne parle que du travail matériel, – seront déjà étonnés qu’il ait pu y suffire. Mais on est effrayé quand on songe que c’est la moindre partie de ses veilles qu’il donnait à la composition ; que sa vie a été toujours partagée entre des occupations multiples et diverses, dont chacune eût exigé la somme totale des facultés d’un homme ordinaire ; qu’il a été tour à tour ou simultanément directeur de la partie musicale à l’Opéra, professeur au Conservatoire, où il a formé d’excellents élèves (tout ce qui s’est fait remarquer depuis, soit dans l’enseignement, soit au théâtre) ; académicien des plus actifs et des plus autorisés ; écrivain didactique d’un profond savoir, d’une lucidité, d’une précision merveilleuses, et sachant se mettre à la portée de tous ; enfin, secrétaire perpétuel de l’Institut, fonctions très élevées, très littéraires et très absorbantes, auxquelles je ne crois pas qu’avant lui aucun musicien ait été porté par le libre suffrage de ses collègues.
On sait comment il a rempli cette place, dont il était si digne. Outré une correspondance très vaste, des rapports continuels, une assiduité constante aux séances de l’Institut, une bienveillance et une affabilité inaltérables pour tout ce qui venait à lui, un accueil empressé, une patience à toute épreuve, il excellait dans ses notices, qu’il lisait tous les ans à l’Académie des beaux-arts. C’étaient des modèles, de goût, d’observation, de finesse. Il relevait par d’ingénieuses allusions, par des anecdotes piquantes, par les agréments d’un récit très vif, mais toujours naturel, l’aridité, la simplicité et souvent l’extrême indigence des faits dont il était forcé d’entretenir son auditoire.
Ajoutez à tout cela les soins, les soucis d’une famille qu’il chérissait et dont il était adoré ; les relations du monde qui le tenait par tant d’attaches, et qui le saisissait au moment même où il croyait lui échapper ; les devoirs de position, de société, de convenance auxquels aucun homme bien élevé ne saurait se soustraire, et, moins qu’un autre, F. Halévy, recherché partout, assiégé et forcé pour ainsi dire dans ses derniers retranchements. Il avait l’esprit le plus distingué et le plus cultivé, le commerce le plus aimable et le plus sûr ; une conversation charmante, une bonté rare, jamais de haine ni de fiel contre ses détracteurs les plus acharnés. Sa physionomie était toujours franche et ouverte ; son regard affectueux, son sourire engageant et sympathique, et cependant, malgré sa grande égalité d’humeur, à travers sa gaieté même et son courage, on voyait qu’il fléchissait sous le fardeau d’un travail énorme ou de secrètes et profondes amertumes.
Il produisait sans trêve et sans relâche, et plus il produisait, plus le public se montrait difficile et exigeant. C’est le sort de tous ceux qui s’élèvent et règnent par l’intelligence. Il faut aussi tenir son rang, marcher de pair avec ses égaux, faire face aux besoins croissants d’une société qui juge sur les apparences, et qui estime le talent moins d’après ce qu’il vaut que d’après ce qu’il rapporte. Souvent la mode, le caprice, le parti pris s’en mêlent. Plus l’injustice est grande, plus on s’en indigne, et on la repousse par un redoublement d’efforts et d’énergie. L’homme de mérite n’a qu’un moyen de lutter, c’est de payer hardiment de sa personne. Autrefois, les compositeurs et les gens de lettres ne s’appartenaient guère ; ils vivaient de pensions, de libéralités, souvent du fruit de leurs flatteries et de leurs bassesses. Ils étaient les hôtes et les commensaux d’un prince ou d’un grand seigneur qui les logeait dans un coin de son palais, les nourrissait, les cajolait comme des levrettes et des épagneuls. À l’abri des besoins matériels, ils ne s’occupaient que de leur art, et ils ne livraient leur chef-d’œuvre que lorsqu’ils l’avaient poli et repoli, selon les préceptes d’Horace et de Boileau.
Aujourd’hui, grâce à Dieu, le génie et le talent sont émancipés ; ils ont leurs lettres de noblesse ; les musiciens, les savants, les artistes jouissent d’un des plus grands biens de ce monde : l’indépendance. Ils sont reçus sur le pied d’une égalité parfaite chez leurs anciens protecteurs, qui, tout en les admirant et en les caressant, les traitaient un peu en obligés et en subalternes. La dignité y gagne ; mais il faut payer chèrement les frais – dirai-je la rançon ? – de cette émancipation intellectuelle. Tous les ressorts de la machine humaine sont tendus jusqu’à se briser. De là ce labeur écrasant, cette production démesurée, hâtive, incessante ; cet ouragan qui nous enveloppe tous et nous froisse et nous roule comme des grains de sable emportés par le vent. Le siècle a la fièvre ; pourquoi voulez-vous que les compositeurs, les artistes et les écrivains ne l’aient pas ?
Halévy (Jacques-Fromental) était né à Paris le 27 mai 1799. À l’âge de dix ans, il entrait au Conservatoire comme élève de solfège. Il se fit bientôt remarquer par son esprit pénétrant et par son ardeur à l’étude. Il eut Berton pour maître d’harmonie ; Chérubini lui donna pendant cinq années des leçons de contre-point. On sait quelles étaient l’aménité et la douceur de Chérubini : ce maître rigide et bourru, qui ne passait pas pour gâter ses élèves, avait une affection véritable pour le jeune Halévy. Il le rudoyait sans doute, il lui faisait des sorties étranges ; mais une sorte d’indulgence, de partialité pour cet élève favori, perçait au milieu des reproches les plus durs et de ses plus violentes algarades. Aussi Halévy avait-il gardé un souvenir plein de reconnaissance et de sincère estime pour son terrible professeur. Il ne tarissait point lorsqu’on le mettait sur le chapitre de Chérubini ; il le savait bien par cœur ; il en racontait les anecdotes les plus amusantes ; les mots les plus curieux, les traits qui peignaient le mieux son caractère, en rendant toutefois justice à son grand talent et à son vaste savoir. On riait des bizarreries et des travers de ce vieillard original et quinteux ; mais, au plus fort de l’hilarité générale excitée par le récit de quelque boutade du maître, l’élève ne pouvait cacher un certain air d’attendrissement.
Halévy eut son premier prix de composition en 1819. Il paraît que le sujet du concours était une cantate intitulée Herminie.
L’heureux lauréat partit pour Rome l’année suivante, et il passa deux années en Italie ; il fit un assez long séjour à Naples, dont il paraissait enchanté ; il s’y était lié avec la jeunesse la plus distinguée du royaume, et, il y a à peine quelques mois, M. le marquis de Gargallo, dînant à l’Institut, rappelait à M. le secrétaire perpétuel plusieurs circonstances qui se rapportaient à cette époque, et qui semblaient faire aux deux interlocuteurs le plus sensible plaisir. Halévy parlait fort couramment l’italien ; il avait eu un instant l’idée de se fixer à Naples et de n’écrire que pour les théâtres d’Italie ; il me semble même que ce projet eut un commencement d’exécution. Si je ne me trompe, Halévy composa un ouvrage en deux actes pour le Fondo ou le Teatro-Nuovo. Ou j’ai rêvé ce détail, ou je le tiens d’Halévy lui-même, qui me dit quelque chose d’approchant lors de son voyage à Londres, où il se rendit avec Scribe pour y assister aux répétitions de la Tempesta.
Ce qui est certain, c’est qu’en partant pour l’Italie il avait dans sa malle un opéra qui n’a jamais été joué : les Bohémiennes. De retour à Paris en 1822, il commença ces pérégrinations de théâtre en théâtre, ces stations douloureuses à la porte des directeurs invisibles, qui sont la Via crucis de tous les jeunes compositeurs, surtout des prix de Rome. Ce privilège singulier est consacré par la tradition. Il semble que les directeurs les mieux disposés pour ces lauréats en peine, les évitent comme des créanciers importuns dont la présence est toujours désagréable, même quand on a la ferme intention de payer ses dettes.
Chaque fois que Halévy présentait à l’Opéra son Pygmalion, et ses Deux Pavillons à l’Opéra-Comique, on le priait de repasser l’année suivante. Et il repassait ! il ne se rebutait pas, il ne perdait point courage. L’un des traits les plus saillants de son caractère a été la persévérance. Le bonheur ne lui est jamais venu en dormant. Après cinq ans d’épreuves, de sollicitations vaines, de refus persistants, il fit représenter enfin l’Artisan au théâtre Feydeau. La première pièce et le dernier poème que Halévy a mis en musique sont de M. de Saint-Georges. Il y a peu d’exemples d’une collaboration plus suivie et d’une plus inaltérable fidélité.
L’Artisan n’eut qu’un succès d’estime. Il fallait vivre cependant. Halévy, qui était déjà professeur de solfège, fut nommé, dans cette même année 1827, professeur d’harmonie et d’accompagnement. Il accepta aussi la place de maître accompagnateur (maestro al cembalo) au Théâtre-Italien ; ce qui lui fit connaître et approcher madame Malibran. Le projet de se vouer exclusivement à la musique italienne lui revint à l’esprit avec plus de force, car il voyait sans cesse grandir les obstacles qui lui fermaient les scènes françaises, Madame Malibran lui conseillait de prendre, un parti décisif, avec l’ardeur qu’elle portait en toutes choses. Elle n’admettait ni hésitation ni réflexion ; il fallait changer sur-le-champ de genre et de nationalité. M. Halévy composa pour cette grande artiste un opéra italien en trois actes, intitulé Clari ; mais là se bornèrent, pour le moment, ses excursions dans le répertoire étranger ; il resta Français, et il fit bien.
Je passe rapidement sur une pièce de circonstance, le Roi et le Batelier, de la même année, et je m’arrête au Dilettante d’Avignon, le premier opéra-comique d’Halévy qui ait eu un vrai et franc succès. L’œuvre demeura longtemps au répertoire ; elle était pleine d’esprit, de gaieté, de verve ; il y avait des morceaux d’un comique excellent ; ce qui m’a toujours fait penser que, si Halévy avait écrit plus souvent de la musique bouffe, il n’y aurait pas moins réussi que dans le genre dramatique et élevé.
En 1829, il fut nommé chef de chant à l’Opéra, et il remplit cette place avec un zèle, une conscience, un succès qui lui valurent les remerciements de tous les grands compositeurs dont il faisait interpréter les ouvrages. En 1830, on donna de lui un ballet en trois actes, intitulé Manon Lescaut. Le programme était de Scribe et Aumer. La Tentation, opéra-ballet en cinq actes, fut représentée le 20 juin 1832. C’était un enfant de plusieurs pères : M. Cavé pour les paroles, M. Coralli pour la danse, MM. Halévy et Gide pour la musique. Il y a de fort beaux chœurs dans la Tentation ; mais, par son origine même et par le trop grand nombre de collaborateurs qui y avaient mis la main, l’ouvrage n’était pas destiné à un succès durable.
L’année précédente, Halévy était tombé sur un mauvais livret, la Langue musicale, et les auteurs des paroles l’avaient entraîné dans leur chute. Il fut plus heureux avec M. Carmouche. Les Souvenirs de Lafleur, écrits pour la rentrée de Martin à l’Opéra-Comique, renfermaient de charmants morceaux, et seraient encore au répertoire ; mais quelle est aujourd’hui la basse qui pourrait chanter un rôle de Martin ?
Le Shérif, opéra-comique en trois actes, est de la même époque et de la même manière. Sur ces entrefaites, l’auteur de Marie, de Zampa, du Pré aux Clercs, mourut, fort jeune encore, d’une maladie de poitrine, et des fatigues extrêmes qui l’avaient accablé pendant les répétitions de son dernier ouvrage. Il laissait une partition en deux actes, intitulée Ludovic, dont il n’avait écrit que quelques morceaux ; Halévy l’acheva pour rendre un pieux hommage à la mémoire d’un confrère et d’un ami. Ludovic fut joué avec succès en 1834, un an après la mort d’Hérold.
Nous voici arrivés à la Juive, le chef-d’œuvre du maître. À partir de ce moment, Halévy se place au premier rang des compositeurs dramatiques ; son œuvre capitale, représentée pour la première fois le 23 février 1835, a fait le tour du monde ; elle a eu autant de représentations que Guillaume Tell, Robert le Diable, les Huguenots ; car, à l’exemple de Rossini et de Meyerbeer, Halévy possédait au plus haut degré le sentiment du drame et l’entente scénique, qualités indispensables pour qu’un opéra réussisse et se maintienne au théâtre. Il ne se laissait point séduire par le côté extérieur d’un sujet, par la couleur locale, par l’effet des masses ; il cherchait le côté humain, la passion, la vie. Il savait que les œuvres d’art qui ne frappent que l’imagination sans aller au cœur sont des œuvres mort-nées. Là était sa force, et c’est par là qu’il survivra à bien des musiciens qui se croient peut-être ses égaux et qui ne lui viennent pas à la cheville. Halévy rend toujours la situation dramatique avec une rare énergie, et si tous les ouvrages sérieux et les ouvrages de genre qu’il a livrés successivement au public n’ont pas la même valeur et n’ont pas eu le même succès, ils n’en contiennent pas moins des beautés de premier ordre, et cette qualité essentielle d’intéresser constamment le spectateur.
Maintenant, je n’ai plus qu’à citer les titres et les dates des compositions nombreuses qu’il a fait représenter depuis 1835 (année où il a été décoré en même temps que Bellini) jusqu’à la dernière reprise de Jaguarita au Théâtre-Lyrique. La plupart de ses opéras se jouent encore, et se joueront longtemps, je l’espère ; les autres seront bientôt repris, car, pour Halévy comme pour tous les hommes supérieurs, il n’y a de justice complète que lorsque la postérité commence.
Voici, dans leur ordre chronologique, les différents ouvrages de ce grand compositeur :
OPÉRA : Guido et Ginevra, ou la Peste de Florence, opéra en cinq actes, de Scribe, 5 mars 1838 ; le Drapier, opéra en trois actes, de Scribe, 6 janvier 1840 ; la Reine de Chypre, opéra en cinq actes, de M. de Saint-Georges, 22 décembre 1841 ; Charles VI, opéra en cinq actes, de Casimir et Germain Delavigne, 15 mars 1843 ; le Lazzarone, opéra de genre en deux actes, de M. de Saint-Georges, 1846 ; le Juif errant, opéra en cinq actes, de Scribe et de M. de Saint-Georges, 23 avril 1852 ; la Magicienne, opéra en cinq actes, de M. de Saint-Georges, 1858. Œuvres posthumes : Valentine d’Ornano, opéra en trois actes, poème de M. Léon Halévy ; Noé, ou le Déluge, opéra en trois actes, poème de M. de Saint-Georges.
OPÉRA-COMIQUE : l’Éclair, trois actes, paroles de Planard et de M. de Saint-Georges, 1835 ; les Treize, trois actes, paroles de Scribe, 1839 ; le Guitarrero, trois actes, paroles de Scribe, 1841 ; les Mousquetaires de la Reine, trois actes, paroles de M. de Saint-Georges, 1846 ; le Val d’Andorre, trois actes, paroles de M. de Saint-Georges, 1848 ; la Fée aux Roses, trois actes, paroles de Scribe et de M. de Saint-Georges, 1849 ; la Dame de pique, trois actes, paroles de Scribe, 1850 ; le Nabab, trois actes, paroles de Scribe et de M. de Saint-Georges, 1853 ; Valentine d’Aubigny, trois actes, paroles de MM. Jules Barbier et Michel Carré, 1856.
THÉÂTRE-ITALIEN : la Tempesta, trois actes, paroles de Scribe, 1851.
THÉÂTRE-LYRIQUE : Jaguarita, trois actes, paroles de MM. de Saint-Georges et de Leuven, 1855.
Comme écrivain, Halévy nous laisse ses discours, ses souvenirs, de charmants articles dont il enrichissait les journaux et les revues, et des traités sur la musique, adoptés par le comité des études du Conservatoire ; traités qui, entre autres mérites, se recommandent par une clarté de style admirable et par une grande force de persuasion.
Un des bonheurs de ma destinée a été de vivre, depuis mon adolescence, dans l’intimité des plus grands artistes et des plus grands maîtres de ce siècle. J’ai eu, pendant dix-huit ans, avec Halévy, des relations très dévouées de ma part, très bienveillantes et très amicales de la sienne, et j’affirme, sans crainte d’être démenti par tous ceux qui l’ont connu, que c’était la bonté même que ce cœur-là. Je ne l’ai jamais entendu se plaindre de personne. Non seulement il pardonnait les offenses, mais il semblait les ignorer. Et pourtant il a beaucoup souffert ! Je l’ai vu peu de jours avant son départ ; le soir même où il quittait Paris pour se rendre à Nice, il m’a écrit un billet fort touchant, le dernier que j’aie reçu de lui. Il est un point sur lequel je ne voudrais pas insister, mais que je dois indiquer néanmoins avec une extrême réserve. Halévy était calme, résigné, mais un peu triste. Dans ces derniers temps, il s’était vu en butte à des agressions qu’il n’avait ni provoquées ni méritées. Il n’a pas été plus épargné que Scribe.
J’admets, je reconnais les droits de la critique la plus vive et la plus sévère ; mais il n’est question ici de critique à aucun degré ; je veux parler de ces attaques gratuites, personnelles, sanglantes jusqu’à l’insulte, qui ne sauraient trouver d’excuse ni dans la vivacité des polémiques, ni dans l’ardeur des discussions. Je sais bien qu’on devrait dédaigner ces excès, qui retombent sur leurs auteurs ; mais il vient un moment dans la vie où l’on y est plus sensible que l’on ne voudrait se l’avouer, où l’injustice nous est plus amère parce qu’il s’y mêle aussi l’ingratitude. Après de longues années de travaux et de succès, quand on a des titres incontestables à l’estime et à la reconnaissance des contemporains, et que l’on se croit oublié, méconnu par les générations nouvelles, l’âme la mieux trempée ne peut se défendre d’un sentiment de tristesse. Prenons garde, nous tous qui tenons une plume, de ne loucher qu’avec les plus grands ménagements à ceux qui nous ont précédés dans la carrière où nous entrons et que nous parcourons après eux ; même s’ils venaient à faiblir, ils n’en mériteraient pas moins nos égards et nos respects. Gardons-nous surtout des cruautés inutiles et disons-nous : Le trait que j’aiguise et que je lancerai d’une main légère et distraite, ira frapper peut-être un cercueil !
P.-A. FIORENTINO.
Le nom de Mozart est si illustre, sa renommée, que le temps accroît encore chaque jour, est si légitime et si grande, qu’on regrette de devoir restreindre aux limites d’une notice biographique l’histoire de sa vie et une appréciation de son œuvre. – Au reste, beaucoup de travaux ont été publiés sur ce musicien célèbre. Nous citerons, parmi les biographes allemands, Schlichtegroll, Niemtschek, Nissen, qui, par sa position particulière, s’est trouvé à même de disposer de documents authentiques, et M. Otto Jahn, qui, dans ces derniers temps, a publié sur Mozart un ouvrage considérable ; parmi les écrivains français, Beyle (si connu sous le nom de Stendhal), qui n’a guère fait que traduire Schlichtegroll, et Fétis. M. Alexandre Oulibicheff a publié à Moscou en 1843 une Nouvelle Biographie de Mozart, écrite en français. M. Edward Holmes a fait paraître à Londres en 1845 the Life of Mozart. M. L. Goschler a traduit et fait connaître en France, il y a quelques années, des lettres de Mozart et de son père, recueillies par M. de Nissen et contenues dans son ouvrage. M. Holmes en a donné aussi de nombreux fragments. Cette correspondance nous fait assister pour ainsi dire à la vie de Mozart ; on le suit dans ses voyages et ses travaux, depuis son enfance jusqu’aux dernières années de sa vie ; nous aurons plus d’une fois occasion de la citer.
Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756 ; il reçut les noms de Jean-Chrysostome-Wolfgang-Gottlieb. On a souvent traduit ce dernier prénom par Théophile, Amédée, Amadeus, Amadeo, et Mozart a presque toujours signé Wolfgang-Amadeus. Il n’eut jamais d’autre maître que son père, Léopold Mozart, ou plutôt, à vrai dire, celui-ci n’eut qu’à laisser se développer librement les rares facultés dont était doué le jeune Wolfgang ou Woferl, comme il le nomme souvent dans ses lettres. – Léopold Mozart était fils d’un relieur d’Augsbourg : il s’adonna à la musique et apprit à jouer de plusieurs instruments. Il commença sa carrière musicale en entrant chez un certain comte de Thurn en qualité de valet de chambre musicien. Cette double qualification, qui paraît si singulière aujourd’hui, ne semblait pas étrange alors et ne choquait personne. Les grands seigneurs faisaient apprendre la musique à leurs paysans, choisissaient les plus habiles et les attachaient ainsi à leur personne. Dans beaucoup de maisons, les officiers et les serviteurs même devaient jouer de quelque instrument, afin d’être prêts à chaque instant pour l’exécution d’un quatuor, d’une symphonie. « Dans la maison du comte Joseph Kinski, à Prague, dit le docteur Pierre Lichtenthal, quatuor était encore, il y a quelques années, composé du valet de chambre, qui faisait le premier violon, du cocher, qui jouait du violoncelle, et de deux autres domestiques, dont l’un jouait le second violon et l’autre la viole, et tous les quatre exécutaient leur partie avec un talent et une précision remarquables. »
Léopold quitta la maison du comte de Thurn pour aller s’établir à Salzbourg. Il s’y maria. Il ne gagnait pas grand argent à être tout à la fois compositeur d’oratorios, de symphonies et de concertos, habile exécutant sur l’orgue, le violon, le clavecin, professeur de ces divers instruments. Il était en outre auteur d’une très bonne méthode de violon, encore estimée aujourd’hui. Le prince-archevêque de Salzbourg l’admit parmi ses musiciens, et le nomma plus tard maître de chapelle en second et chef d’orchestre de ses concerts. Ces dignités ne l’enrichirent pas beaucoup. Il songea à donner à ses enfants un talent d’exécution qui pût les rendre célèbres, leur permettre de se faire entendre dans les grandes capitales, et leur assurer par la suite une fortune indépendante. Deux enfants lui restaient de sept qu’il avait eus ; c’étaient les plus jeunes, Marie-Anne, née en 1751, et Wolfgang. Il commença par s’occuper de Marie-Anne. Elle avait huit ans lorsqu’il lui fit mettre les doigts sur le clavecin. – Marie-Anne fit des progrès rapides ; mais le jeune garçon, qui n’avait que trois ans et auquel on ne faisait nulle attention, donna bientôt des preuves d’une aptitude singulière ; assidu et toujours attentif, il prit de sa seule volonté une part de cet enseignement qui ne lui était pas destiné. Dès ce moment, la musique s’empara de cette jeune intelligence, si merveilleusement disposée à la recevoir, la pénétra, grandit et se fortifia avec elle, jusqu’au jour suprême où tout s’éteignit dans le tombeau. – La vie musicale de Mozart commence donc dès cet âge si tendre, et c’est le devoir du biographe de retracer l’histoire de cet enfant. À peine Marie-Anne avait-elle quitté le clavecin, que Wolfgang en prenait possession. Il répétait de mémoire les gammes et les exercices qu’il lui avait entendu faire. Mais il allait plus loin ; obéissant à l’instinct secret qui le dominait, il interrogeait le clavier et y cherchait d’harmonieuses consonances. Les tierces et les sixtes le ravissaient de joie. M. de Nissen a publié dans son ouvrage vingt-deux petits morceaux composés par Mozart, de 1760 à 1762, c’est-à-dire depuis l’âge de quatre ans jusqu’à six ans, et qu’il dictait à son père. Il ne savait pas encore tenir une plume ; la musique précédait en lui le développement des autres facultés. On n’a aucune raison de douter de l’authenticité de ces petites compositions, qui sont au reste très simples et très naturelles, lorsqu’on songe à la précocité de génie dont Mozart a donné tant d’autres preuves.
En 1762 (Wolfgang avait un peu plus de six ans), le père résolut de commencer l’exécution de son projet. Marie-Anne ou Nanerl avait onze ans, et elle était de première force sur le clavecin. Quant à Wolfgang, il était si étonnant, il jouait les pièces les plus brillantes avec tant de charme et d’éclat, les andante avec tant de grâce, les fugues les plus difficiles de Hændel et de Bach avec tant de netteté, de précision et d’intelligence ; il improvisait si facilement sur quelque thème qu’on pût lui proposer ; il était, en un mot, capable de tant de merveilles, que le père était fondé à penser que le moment était venu, et qu’il pouvait essayer de jeter les fondements de cette fortune, de cette indépendance qu’il rêvait pour ses enfants. – Léopold Mozart avait toujours été laborieux et économe, et cependant il avait toute sa vie souffert de la gêne. Il voulait voir ses chers enfants plus heureux que lui. C’était un homme au cœur droit, d’une vie très régulière et d’une piété qu’on doit croire sincère, à en juger par ses lettres. On est donc autorisé à croire qu’il n’avait pas l’idée d’exploiter pour son propre compte les jeunes talents qu’il allait produire dans le monde. Tous les bénéfices qu’il espérait devaient appartenir à ses bien-aimés Wolfgang et Nanerl. Malheureusement, ses calculs furent plus d’une fois trompés, et les dépenses des voyages égalaient souvent, quand elles ne les dépassaient pas, les recettes qu’il prenait grand souci de recueillir. – Une autre raison guidait encore Léopold. Les surprenantes facultés de Wolfgang le remplissaient d’admiration et parfois d’une sorte de respect. Ses yeux se mouillaient de larmes lorsqu’une circonstance imprévue lui révélait un nouveau progrès de son fils. De même que Pascal avait deviné Euclide, Wolfgang devinait ce que les leçons du maître et une longue pratique de l’art avaient enseigné aux plus habiles. Léopold croyait qu’il avait mission de montrer au monde cet enfant miraculeux, à qui Dieu avait donné tant d’intelligence et de génie.
Il fit d’abord une sorte de voyage d’essai. Au mois de juin 1762, il se rendit à Munich avec sa femme et ses deux enfants ; on n’a aucun détail sur ce voyage : on sait seulement qu’ils restèrent environ trois semaines à Munich, que Wolfgang joua un concerto devant l’électeur et qu’il excita une véritable admiration. Puis la famille revint à Salzbourg pour se préparer à une expédition nouvelle.
Le 19 septembre de la même année, toute la famille se mit de nouveau en route, mais cette fois pour aller à Vienne, la grande capitale de l’Allemagne. C’est alors que commence la correspondance dont nous avons parlé et qu’a recueillie M. de Nissen. La première lettre de Léopold Mozart est datée de Linz, le 3 octobre 1762 ; elle fait connaître que ce voyage commença par un mécompte et une déception. « Vous nous croyez peut-être arrivés à Vienne ? écrit-il à M. Hagenauer ; nous ne sommes encore qu’à Linz. » Et il raconte qu’ils ont dû s’arrêter à Passau, parce que le prince-évêque de cette ville a voulu entendre Wolfgang et l’a retenu cinq jours entiers. Ils ont, il est vrai, donné un concert à Passau ; mais, tous frais faits, il ne leur reste qu’une quarantaine de florins, et ils n’ont plus maintenant le temps de donner un concert à Linz, qui aurait certainement produit plus du double. « Et savez-vous ce que le prince-évêque a donné à Wolfgang ?… Un ducat ! » – Mais il se console par la vue de ses enfants et l’espoir du succès. « Mes enfants sont gais et partout à leur aise comme chez eux. Le petit est familier avec tout le monde, et surtout avec les officiers, qu’il traite à première vue comme s’il les avait toujours connus. Ces chers enfants sont l’objet d’un étonnement général, surtout le garçon. Tout présage que nos affaires marcheront bien. Que Dieu daigne seulement nous maintenir en bonne santé ! Faites, je vous prie, aussitôt que possible, dire quatre messes à notre intention à Maria-Plaïn. » – Enfin on arrive à Vienne le 8 octobre. « Nous avons été dispensés de tous les ennuis de la douane, écrit le père, grâce à monseigneur Woferl, qui en un clin d’œil est devenu l’ami intime du receveur, lui a enseigné le clavecin, lui a joué un menuet sur son petit violon, et lui a fait ses invitations pour l’avenir. » – Wolfgang, on le voit, était plein de grâce, de gentillesse, de gaieté et d’entrain. L’artiste précoce et déjà savant était resté un charmant enfant et on l’aimait avant de l’avoir entendu.
Son succès à Vienne fut immense. Sa réputation l’y avait devancé. « Il vient d’arriver ici un petit bonhomme qui, dit-on, joue admirablement du clavecin. » Voilà ce que le père Mozart eut la satisfaction d’entendre dire à l’archiduc Léopold à l’Opéra, le jour même de son arrivée, et son cœur tressaillit d’orgueil et de joie.
Non seulement Wolfgang soutint vaillamment le fardeau de cette bonne renommée, qui n’était pas sans danger, mais il surpassa encore tout ce qu’on avait pu dire ou imaginer de lui. Appelé à la cour, la vue de si grands personnages ne le troubla pas, la splendeur de la cour impériale n’enleva rien de sa liberté à ce jeune esprit. Il se mit gaiement au piano. L’empereur s’était placé près de lui. « Monsieur, lui dit Wolfgang, je vais jouer un concerto très difficile de M. Wagenseil, votre maître de chapelle : je voudrais bien l’avoir à côté de moi, il me tournerait les feuillets. Voulez-vous le faire appeler ? » Et l’empereur fit appeler M. Wagenseil. – M. Oulibicheff, en racontant avec une légère variante cette petite anecdote, que nous citons seulement comme un trait de naïveté enfantine, prête à Mozart une intention pleine de finesse et de malice, et qu’on se refuserait à admettre s’il ne s’agissait d’un enfant tout exceptionnel, d’un Mozart. Il dit que les plus hauts suffrages lui étaient et lui furent toujours complètement indifférents, s’ils n’étaient raisonnés et sentis. Lorsqu’on le faisait jouer devant des personnes qui n’entendaient rien à la musique, on n’obtenait de lui que des contredanses, des menuets, des bagatelles sans importance. Il paraît qu’il avait jugé sévèrement l’auditoire et qu’il craignait de n’y pas trouver les garanties qu’il désirait. C’est pourquoi il aurait dit à l’empereur : « Faites venir M. Wagenseil, celui-là s’y connaît. » Et, lorsque M. Wagenseil arriva : « Ah ! lui dit-il, je suis charmé de vous voir ; je vais jouer un concerto de votre composition. Vous me tournerez les feuillets, s’il vous plaît. » – Quoi qu’il en soit, que Mozart ait parlé avec la naïveté d’un enfant ou la rouerie d’un diplomate (et, s’il fallait choisir entre les deux appréciations, nous pencherions vers la dernière), il joua le difficile concerto de manière à enlever tous les suffrages. Il satisfit M. Wagenseil, qui s’y connaissait, et ceux qui auraient pu ne pas s’y connaître.
Voici ce qu’écrit le père après cette séance mémorable : « Je n’ai que le temps de vous dire que Leurs Majestés nous ont reçus avec une faveur si extraordinaire, qu’un récit détaillé vous paraîtrait fabuleux. Woferl a sauté sur les genoux de l’impératrice, lui a jeté les bras autour du cou et l’a embrassée avec effusion. Hier, jour de Sainte-Thérèse (fête de l’impératrice), elle nous a envoyé deux habillements complets pour les deux enfants et le trésorier nous a remis cent ducats. Voulez-vous savoir quel est le costume apporté à Woferl ? Il est du drap le plus fin, couleur lilas ; la veste en moire de la même couleur ; habit et veste garnis d’une double bordure en or. On l’avait commandé pour le petit archiduc Maximilien. Le costume de Nanerl était fait pour une archiduchesse. C’est du taffetas blanc broché, avec toute sorte de garnitures. »
Une vive inquiétude vint, peu de temps après, assaillir le cœur du père. Wolfgang fut atteint d’une maladie sérieuse. « Fragilité ! fragilité ! s’écrie le père à cette occasion. Mais Dieu a permis que tout se soit passé sans trop de mal, et nous rendons grâce à sa miséricorde infinie. La maladie touche à sa fin. Elle nous coûte cher ; elle nous fait perdre au moins cinquante ducats. Faites dire, je vous prie, trois messes à Lorette, à l’autel de l’Enfant Jésus, et trois à Bergl, à l’autel de saint François de Paule. » – On trouve à chaque instant dans les lettres de Léopold Mozart ce mélange bizarre de pratiques religieuses et d’observations financières. Il aligne ses élans de piété et son petit budget. Mais la tendresse paternelle préside toujours à ses préoccupations. Les messes qui seront dites, les économies qui seront faites, tout sera pour les chers enfants. – La famille quitta Vienne au mois de novembre, après avoir épuisé tout ce que cette capitale avait pu offrir de succès, de gracieusetés, de cadeaux et de ducats, mais non sans que le père regrettât amèrement ce qu’avait coûté la maladie de Wolfgang. En réalité, cette maladie ne fit perdre que ce qu’elle avait empêché de gagner. Le père Mozart dit qu’il paya l’excellent docteur Bernhard par une sérénade.
Après plusieurs mois de repos et d’études à Salzbourg, le père conçut le projet d’un nouveau voyage, plus considérable et qui devait être plus décisif pour la fortune et pour la gloire des jeunes artistes. On se mit en route le 9 juin 1763 pour visiter la France, l’Angleterre et la Hollande, et l’on commença par Munich, qu’on connaissait déjà et où Wolfgang et Nanerl avaient laissé d’excellents souvenirs. On y resta une dizaine de jours, qui suffirent aux enfants pour se faire entendre plusieurs fois et au père pour faire une assez bonne recette.
Je n’ai pas à me plaindre de l’électeur, écrit-il, il est pauvre. Il m’a dit hier : Nous sommes de vieilles connaissances : il y a près de dix-neuf ans que nous nous sommes vus pour la première fois ; mais, que voulez-vous ! chacun a ses affaires ! Il m’a donné cent florins.
Ils vont dans le Wurtemberg ; mais là rien ne leur réussit. D’abord le duc n’est pas à Stuttgart, il est à sa résidence de Louisbourg. Ils vont à Louisbourg ; ils ne peuvent parvenir jusqu’au duc. Le père, très mécontent, s’en prend à Jomelli, qu’il traite sévèrement dans une de ses lettres : « Je considère tout cela comme l’œuvre de Jomelli, maître de chapelle du duc. Il se donne toutes les peines du monde pour éloigner les Allemands de cette cour, et il y parvient. Il est en grande faveur auprès du duc. Outre ses appointements de quatre mille florins, il a une maison à Stuttgart, une autre ici, l’éclairage, le chauffage, une voiture, un cheval. Les Italiens, qui lui font la cour, et dont sa maison est toujours pleine, ont dit et répété au duc qu’il est impossible qu’un enfant de sang allemand ait le génie musical, le feu et l’intelligence qu’on attribue à Woferl. » Il quitte Louisbourg le cœur plein d’amertume, accusant Jomelli, reconnaissant toutefois que la musique qu’il dirige est bonne, « Cela vient, dit-il, de ce qu’il a tout pouvoir sur ses musiciens. »
Il se dirige vers Bruxelles, où il doit donner un concert. En passant à Aix la Chapelle, il trouve la princesse Amélie, sœur du grand Frédéric. « Malheureusement, dit-il, elle n’a pas le sou. Nous aurions de quoi nous réjouir si je pouvais convertir en bons louis d’or tous les baisers qu’elle a donnés à mes enfants, à maître Wolfgang surtout ; mais ni les maîtres de poste ni les aubergistes ne veulent être payés de cette monnaie. Elle veut que j’aille à Berlin, et le prince Charles est tout à fait de cet avis. Comme sa sœur, il est plein de parfaites intentions, mais, comme elle aussi, il n’a pas le sou vaillant. » Il va donc à Bruxelles, et donne son concert, auquel assiste le prince Charles ; puis, avant de partir pour Paris, il demande qu’on lui envoie une nouvelle lettre de crédit ; « car, dit-il, j’ai de quoi monter une vraie boutique de cadeaux de toute sorte, montres, chaînes, tabatières, épées, bijoux, dentelles, etc. Quant à l’argent, il est rare, et je suis positivement pauvre. Le voyage va me coûter au moins deux cents florins, et je ne veux pas être pris au dépourvu. »
Le 18 novembre 1763, ils arrivent à Paris, chargés de lettres qui doivent leur ouvrir toutes les portes. De grands seigneurs étrangers les recommandent à de hauts personnages de la cour de France. Ces lettres, remises aussitôt, ne produisent rien. On ne croit pas au petit prodige. Un négociant de Francfort leur avait donné une lettre pour M. Grimm. On a recours à cette lettre, sur laquelle on ne fondait pas grand espoir. Grimm accueille les voyageurs, les protège, devient leur patron, met à leur service son activité, ses relations, son influence, toute la chaleur d’une amitié intelligente, et introduit dans le monde le jeune artiste dont les talents extraordinaires l’avaient charmé. On lit dans sa correspondance : « Les vrais prodiges sont si rares, qu’on en parle volontiers lorsqu’on a le bonheur d’en voir un. Un maître de chapelle de Salzbourg, nommé Mozart, est arrivé ici avec deux enfants charmants. Sa fille, âgée de onze ans, joue du clavecin à ravir et exécute les morceaux les plus difficiles avec une rare précision. Quant à son frère, qui n’a pas encore accompli sa septième année, c’est un phénomène si extraordinaire, qu’on a peine à croire ce qu’on voit de ses yeux et ce qu’on entend de ses oreilles. Non seulement il exécute aisément et avec une parfaite netteté les pièces les plus difficiles, quoique ses petites mains atteignent à peine la sixte ; mais encore (et c’est là l’incroyable) je l’ai entendu improviser une heure entière et se livrer aux inspirations de son génie, qui lui amenait une foule d’idées ravissantes, se suivant avec goût et sans la moindre confusion. Un maître de chapelle consommé ne pourrait avoir une connaissance plus profonde de l’harmonie et des modulations que l’enfant sait opérer dans les voies les moins connues, mais toujours conformément aux règles. » – Grimm continue sur ce ton ; il parle de la facilité avec laquelle Mozart déchiffre tout ce qu’on lui présente, écrit, compose sans consulter le clavecin, trouve à l’instant même sans préparation divers accompagnements pour les airs qu’on lui chante, et il finit par dire : « Je crains que la tête ne me tourne pour peu que je l’entende encore, et je conçois à présent combien il est difficile de se préserver de la démence quand on voit des miracles. » Grimm était très bon connaisseur en musique et sincère dans ses admirations. C’est pourquoi nous avons rapporté ces fragments, qui donnent une juste idée de la surprise que levait exciter le jeune prodige.
La famille resta environ cinq mois à Paris. Pendant ce temps, les deux enfants, invités plusieurs fois à Versailles, jouèrent devant le roi et toute la cour. Nanerl réussit beaucoup ; quant à Wolfgang, il fut apprécié comme il méritait de l’être. Il ne se montra pas seulement exécutant audacieux, profond harmoniste, improvisateur heureux ; il fut gai, spirituel, aimable, charmant. Au grand couvert qui eut lieu la veille du nouvel an (1764), toute la famille fut appelée près de la table royale. La reine retint Wolfgang près d’elle. Il lui baisait les mains et lui disait en allemand mille gracieusetés dont elle était ravie. Wolfgang fut moins satisfait de madame de Pompadour. « Qui donc est-elle ? dit-il à son père. Elle a refusé de m’embrasser, moi qui ai embrassé l’impératrice ! »
Le père était enchanté, il recevait beaucoup de cadeaux et beaucoup d’argent. Quand vint la semaine sainte, il obtint la permission de donner à Paris deux concerts. C’était à cette époque une grande faveur, très rarement accordée, parce qu’elle contrevenait aux privilèges de l’Opéra, des Concerts spirituels, de la Comédie-Française et de la Comédie-Italienne. On ne put enlever cette permission, que M. de Sartines donna à la fin et de guerre lasse, que par la protection de quelques grandes dames et surtout par l’intervention de Grimm. Aussi, comme le père chante ses louanges ! « Ce Grimm, mon plus grand ami, qui a tout fait pour moi, est vraiment un homme du plus haut mérite. C’est à lui que je dois l’autorisation pour mes concerts. Pour le premier, il m’a placé trois cent vingt billets, c’est-à-dire pour quatre-vingts louis ! Il m’a obtenu de ne pas payer l’éclairage, et il y avait plus de soixante bougies ; et, pour le second concert que nous allons donner, cent billets sont placés ! Quel homme ! quel esprit et quel cœur ! Il sait tout mettre en train et fait réussir les choses comme il l’entend. »
Le séjour de Paris se signale dans la vie de Mozart par une circonstance importante : jusqu’alors il s’était montré exécutant de premier ordre ; à Paris, l’enfant de sept ans se révèle compositeur : il y publie ses deux premières œuvres, deux recueils de sonates, dédiés, l’un à madame Victoire de France, sœur de Louis XV ; l’autre à la comtesse de Tessé, dame de madame la Dauphine. « Ces sonates, qu’on trouve dans la collection de ses œuvres, sont charmantes, dit M. Fétis, et auraient fait honneur aux artistes les plus renommés de cette époque ; cependant leur auteur était à peine parvenu à sa huitième année. »
Wolfgang excita à Paris un enthousiasme qui eut un grand retentissement dans toute l’Europe. Le père n’eut donc qu’à se féliciter d’avoir entrepris ce voyage. Avant de partir, il envoya à Salzbourg deux cents louis, gardant par devers lui la somme nécessaire « pour ne pas être pris au dépourvu. » Et cependant, malgré tout ce profit, auquel il se trouve très sensible, il est très sévère pour Paris. Quand il parle des femmes, de leurs toilettes, de leur dévotion, de madame de Pompadour, le pieux Allemand se voile la face. « Chacun vit à sa guise, et sans une miséricorde toute Spéciale de Dieu, je ne sais ce qu’il arrivera du royaume de France. » Le bonhomme ne se trompait pas trop. Il ne traite pas mieux la musique. « La musique française ne vaut pas le diable, dit-il avec une rudesse toute germanique ; mais il s’opère de grands changements. Les Français commencent à tourner, et, dans dix ou quinze ans, je l’espère pour eux, le goût français aura complètement fait volte-face. » Et il n’était pas non plus mauvais prophète en cela. Gluck, qui devait arriver à Paris dix ans plus tard, travaillait déjà à lui donner raison. Il n’a quelque indulgence en cela que pour la chapelle royale : « J’y ai entendu de bonne et de mauvaise musique. Tout ce qui se chantait par une voix seule et devait ressembler à un air était vide, froid, misérable, par conséquent français ; mais les chœurs sont bons, et très bons. Aussi ai-je été tous les jours à la messe de la chapelle royale avec mon petit homme, très content des chœurs qu’on y exécutait. » On ne donnait guère à cette époque que ce qu’on appelait des fragments, c’est-à-dire des actes séparés d’opéras-ballets, et quelques opéras de Dauvergne, compositeur oublié aujourd’hui et qui mérite de l’être. Si Léopold Mozart avait pu entendre quelque bon ouvrage de Rameau, il eût certes modifié son jugement, reçu d’autres impressions, et reconnu ce qu’il y avait de riche dans cet orchestre, de force, dans cette harmonie, d’effet et d’énergie dans les chœurs, de bonnes qualités enfin dans cette musique française.
La famille Mozart quitta Paris dans les premiers jours d’avril 1763, s’embarqua à Calais et arriva le 10 à Londres. Wolfgang, devenu tout à fait célèbre, n’eut aucune peine à se produire. Son succès fut éclatant : il joua de l’orgue et du clavecin devant le roi Georges III, qui aimait la musique, et devant la reine, qui passait pour bonne musicienne ; donna des concerts publics qui furent très suivis, et composa six sonates, avec accompagnement de violon ou de flûte, qu’il dédia à la reine. C’est son œuvre 3. – Un savant magistrat, amateur passionné de musique, M. Daines Barrington, fut vivement frappé de la précocité extraordinaire du jeune artiste. Wolfgang chantait très bien, avec une voix de soprano fine et pure, avec la grâce et le charme qui faisaient de lui un petit être plein de séduction. En l’entendant chanter, M. Barrington vint à se persuader que le public était dupe d’une comédie parfaitement jouée et que le prétendu petit garçon était une charmante jeune fille de quinze à seize ans. Il fit partager ses soupçons à plusieurs personnes du monde et à des artistes. Ces gens-là ne réfléchissaient pas qu’une jeune fille accomplissant tout ce qu’on entendait faire à Mozart, jouant dans la perfection de l’orgue et du clavecin, habile harmoniste, composant et improvisant à merveille, jouant au besoin du violon, n’aurait eu besoin d’aucun subterfuge pour exciter la curiosité, un vif intérêt, l’admiration. On raconte que de nos jours un gentleman suivait dans tous ses exercices un célèbre dompteur de bêtes féroces, espérant qu’un jour il le verrait dévorer ; M. Barrington suivit Mozart dans tous ses concerts, se fit introduire dans la famille, non dans des vues aussi cruelles, mais dans l’intérêt de la vérité et dans l’espoir qu’un jour un incident fortuit l’éclairerait. N’apprenant rien par cette poursuite obstinée, il employa la voie diplomatique et fit écrire au ministre anglais près la cour de Bavière de prendre secrètement les informations nécessaires. Celui-ci envoya simplement l’extrait baptistaire de Wolfgang-Gottlieb Mozart. M. Barrington, tranquille désormais, écrivit alors sur le jeune prodige un mémoire qui produisit une grande sensation, et qui fut inséré dans les Transactions philosophiques.
Après un séjour de quinze mois à Londres, la famille alla passer quelques jours dans la résidence d’un lord, près de Canterbury. Avant de quitter la capitale, Wolfgang, à la prière des conservateurs du Musée britannique, laissa à cet établissement son portrait et quelques manuscrits, entre autres celui d’un chœur à quatre voix, qu’il avait composé sur un texte anglais. Ils visitèrent alors le nord de la France et la Belgique, Wolfgang improvisant partout sur l’orgue de la cathédrale et attirant toujours un auditoire immense. Ils allèrent à la Haye, où Wolfgang et sa sœur se firent entendre à la princesse d’Orange.
Là, une maladie grave mit en danger la vie des deux enfants. Léopold Mozart se montre à cette occasion, dans plusieurs de ses lettres, plein de tendresse et de piété. Il ne perd jamais tout espoir, et sa confiance en Dieu lui donne un grand courage. Après quatre mois d’inquiétude et d’angoisse, les chers enfants furent enfin sauvés, et ils purent se rendre à Amsterdam. C’était dans le temps du carême ; tout divertissement public était sévèrement interdit. Ils obtinrent cependant la permission de donner deux concerts, « parce que, dit l’autorisation, qui fut rendue publique, les facultés miraculeuses de ces deux enfants ne peuvent tourner qu’à la gloire de Dieu. » Ils durent retourner à la Haye, où on les demandait pour une fête donnée en l’honneur du jeune prince d’Orangé, Guillaume de Nassau, qu’on installait en qualité de stathouder. Wolfgang écrivit à cette occasion six sonates pour la princesse de Nassau-Weilbourg, sœur du stathouder, et composa pour la fête des airs, des symphonies, des variations sur une mélodie « que chacun chante, souffle ou siffle en Hollande. » Ils quittent la Hollande au mois de mai 1766, retournent à Paris, sont appelés à Versailles, où ils restent quatre jours, et vont à Dijon. Le prince de Condé, qui tenait les états de Bourgogne, les y retient pendant deux semaines. Puis ils vont à Lyon, à Lausanne, à Berne, à Zurich, et enfin, avant de retourner à Salzbourg, ils font une nouvelle visite à Munich.
L’électeur de Bavière les reçut comme d’anciens amis. Il était à table lorsqu’on annonça les voyageurs : sur-le-champ il dicta à Wolfgang quelques mesures, et lui dit d’en faire le thème d’un morceau. Wolfgang s’installa sur un coin de la table, écrivit le morceau tout d’une haleine ; puis on passa dans le cabinet du prince, et, à la grande satisfaction de la société, le jeune improvisateur fit entendre sa composition. Ce fut le dernier exploit de Wolfgang pendant ce voyage, qui avait duré trois ans. – Toute la ville de Salzbourg vint fêter le retour des voyageurs ; mais Léopold Mozart avait pour ses enfants des idées de retraite et de travail. « Dieu a donné à mes enfants des talents qui m’entraînent à tout sacrifier pour leur éducation. Chaque moment que je perds est perdu pour toujours, et, si jamais j’ai compris combien le temps est précieux pour la jeunesse, c’est maintenant. »
C’est sous l’influence de ces idées qu’il avait ramené ses enfants à Salzbourg. Il avait rapporté de Londres les meilleurs ouvrages de Hændel. Wolfgang s’en pénétra. Il connaissait déjà Sébastien Bach, il étudia Emmanuel Bach, deuxième fils de Sébastien, dont le style, s’éloignant des formes scolastiques, formait une sorte de transition et semblait indiquer le chemin qu’il fallait suivre désormais. Il étudiait aussi les maîtres italiens, Scarlatti, Leo et Durante, et le maître allemand adopté par les Italiens, Hasse, que les Napolitains appelaient « le cher Saxon, le divin Saxon, » Hasse, qui, quelques années plus tard, s’écria : « Cet enfant nous fera tous oublier. » – Au mois de septembre 1767, après plus d’un an donné à l’étude, les jeunes gens, toujours sous la conduite du père, entreprirent une Nouvelle excursion ; car Salzbourg n’était pas un centre. C’était l’asile, le foyer ; on y laissait ses souvenirs, ses amis ; mais il fallait bien aller à la recherche de ressources nouvelles. On alla de nouveau à Vienne.
À peine y étaient-ils installés, qu’une terrible épidémie de petite vérole vient porter le deuil dans les familles. Une princesse du sang impérial, atteinte presque aussitôt, meurt la première. L’effroi se met dans la ville : sur dix enfants que le fléau touche, neuf périssent. Le fils de l’hôte des Mozart est frappé. « Priez Dieu qu’il veille sur nous, » écrit le père ; et il se réfugie à Ollmutz avec sa femme et ses enfants. Mais Wolfgang emportait le germe de la maladie, elle se déclara à Ollmutz. On craignit qu’il ne perdît la vue, et ses jours furent de nouveau menacés. Les soins qu’il reçut dans la maison d’un chanoine de Salzbourg, qui était doyen de la cathédrale d’Ollmutz, le sauvèrent. Te Deum laudamus ! c’est le cri qui s’échappe du cœur du père, et il se promet bien, lorsqu’il écrira l’histoire de son fils, de faire honneur au généreux doyen qui lui avait conservé une vie si précieuse.
Au commencement de janvier 1768, les craintes étant dissipées, le deuil impérial fini, les plaisirs reprirent leur cours. Wolfgang fut invité à jouer devant l’empereur : c’était Joseph II. François Ier était mort depuis cinq ans. Tout le monde jugea que le talent de Mozart comme exécutant, son génie comme improvisateur, s’étaient merveilleusement développés depuis son premier séjour à Vienne. Il entrait alors dans sa douzième année. L’empereur, qui l’avait entendu, lui dit : « Il faut faire un opéra. » Mozart croyait avoir mal compris. « Oui, répéta l’empereur, fais-moi un opéra-buffa, je n’aime pas l’opéra-séria. » Cela était vrai : il n’y avait à Vienne qu’une troupe d’opéra-buffa. Et même l’Alceste de Gluck avait été exécuté par ces artistes, qui, à ce qu’il paraît, excellaient dans les deux genres. Wolfgang était plein de joie. On lui donna un libretto intitulé la Finta semplice. Il se mit à l’œuvre, et en peu de semaines il en eut achevé la musique.
L’exploitation du Théâtre-Italien de Vienne a toujours été une entreprise particulière ; nous le croyons du moins, et cela était ainsi à cette époque. Le directeur-entrepreneur était un certain signor Affligio. Il ne voulut pas jouer l’opéra d’un enfant de douze ans, d’un Allemand ! Il chercha d’abord par toute sorte de délais et de subterfuges à éloigner l’époque de la représentation. Gluck, Hasse, Métastase avaient entendu l’œuvre du jeune maître et se rendaient garants du succès : pour détruire l’effet d’attestations si honorables, Affligio imagina de convoquer les chœurs, l’orchestre, les artistes chargés des rôles, et de faire ainsi, avant toute étude préalable, une répétition générale à première vue, dont le résultat fut déplorable. Léopold Mozart, exaspéré, alla trouver l’impresario, lui reprocha sa mauvaise foi et menaça de se plaindre à l’empereur. « Eh bien, répondit Affligio, puisqu’il en est ainsi, puisque vous voulez absolument perdre votre fils, je jouerai son opéra et je le ferai siffler. » Le père eut peur d’un pareil homme et se tint pour battu. Mais Wolfgang eut bientôt une éclatante consolation : il fut chargé de composer une messe solennelle pour l’inauguration d’une église. On dit que Joseph II, en demandant un opéra à Wolfgang, avait surtout voulu se donner le plaisir de voir un enfant conduire un grand orchestre. L’empereur eut cette satisfaction ; Mozart dirigea l’exécution de sa messe avec un aplomb qui charma l’empereur et toute l’assistance, et il reçut à cette occasion, avec les témoignages les plus honorables, un cadeau magnifique.
Mesmer, le fameux magnétiseur, était alors à Vienne. Il était fort riche, aimait le bruit et l’éclat, était grand ami des Mozart, et voulut venger aussi Wolfgang des dédains du signor Affligio. Il fit élever un théâtre dans son hôtel et donna une grande fête où l’on représenta un opéra-buffa, Bastian und Bastianna, dont Wolfgang avait composé la musique. Le jeune maître conduisit encore l’orchestre et obtint un nouveau triomphe. Après quoi, la famille alla faire une nouvelle station à Salzbourg et y passa toute l’année 1769. Wolfgang consacra ce temps à de nouveaux travaux et principalement à l’étude de la langue italienne. Il commençait à sortir de l’enfance ; il désirait voir l’Italie, et demanda à son père de l’y conduire. Cette fois, la mère et la sœur restèrent à Salzbourg ; le père et Wolfgang partirent seuls et se dirigèrent vers Vérone, où ils arrivèrent dans les premiers jours de 1770.
C’est de Vérone que sont datées les premières lettres de Wolfgang, recueillies dans la correspondance publiée par M. de Nissen. Elles sont pour la plupart adressées à sa sœur, sont gaies, très courtes et accusent bien l’âge de l’auteur. Elles respirent la plus aimable tendresse pour les chères personnes laissées au logis ; elles ne consistent quelquefois qu’en un post-scriptum de quelques lignes. La première de ces lettres, du 7 janvier, est un mélange d’allemand, de patois de Salzbourg, d’italien et de français, que nous retrouvons plus d’une fois dans sa correspondance, elle commence ainsi : « Sœur bien-aimée, après une longue attente, je reçois enfin de toi une lettre d’une aune de long !… Maintenant que le paillasse allemand a terminé son rôle, écoute le buffo italien. » Il lui raconte alors, en italien cérémonieux, entrecoupé de patois allemand, le sujet d’un opéra qu’il vient d’entendre. Chaque chanteur a son coup de patte, de griffe quelquefois. Il est ravi du carnaval, chacun va par la ville in maschera, lui comme les autres. On le salue, on lui dit : Servitor umilissimo, signora maschera ; il répond invariablement : Cospetto di Bacco. Il termine sa lettre en allemand, signe Wolfgang-Amadeus, puis il ajoute en français : « Portez-vous bien et aimez-moi toujours. » Cet enfant, qui, depuis l’âge de six ans, avait presque toujours voyagé, qui semblait livré entièrement au génie de la musique, avait trouvé le temps d’étudier sa langue maternelle, le latin, le français, l’italien, et savait très bien l’arithmétique, science pour laquelle il avait une aptitude qu’il n’eut jamais l’occasion de mettre en pratique.
Dans une seconde lettre datée de Milan le 26 janvier, il fait le portrait des chanteurs du théâtre de Mantoue, où il s’est arrêté, parce que l’académie philharmonique de cette ville lui a demandé un concert. Ces pauvres artistes le mettent en bonne humeur et excitent sa verve satirique. « La prima donna chante bien ; mais à quoi bon ? on ne l’entend pas. La seconda donna a l’air d’un grenadier, et elle en a la voix. » À Crémone, la première chanteuse « est vieille comme le diable. » Quelques expressions sont à remarquer, parce qu’elles sembleraient indiquer qu’il a déjà acquis ou qu’il désire acquérir une certaine expérience. On songe un peu au Chérubin du Mariage de Figaro, que Mozart devait faire si admirablement chanter : « Prima ballerina, bonne, et on dit qu’elle n’est pas sauvage du tout : quant à moi, je ne l’ai pas encore vue de près. Une autre danseuse ne gambade pas mal, bonne diablesse sur le théâtre et hors du théâtre ce qui n’est pas rare, dit-on. » L’ouvrage dans lequel il a entendu les chanteurs de Crémone, c’est la Clemenza di Tito, le même poème de Métastase qu’il mettra en musique vingt ans plus tard, trois mois avant sa mort ! Il ne dit pas le nom du compositeur. Il joint à cette lettre le programme du « concert public de l’académie philharmonique de Mantoue, donné à l’occasion du passage du très expert jeune homme le signor Amadeo Mozart. » On y lit les annonces suivantes : « Concerto sur le clavecin, exécuté, à première vue par le signor Amadeo Mozart. – Sonate pour le clavecin, exécutée à première vue par le jeune homme avec des variations de sa composition, et répétée ensuite dans un ton différent de celui dans lequel elle est écrite. – Air improvisé et immédiatement chanté par le signor Amadeo, avec accompagnement de clavecin, sur des paroles faites exprès et non vues d’avance par le compositeur. – Autre sonate sur un thème proposé à l’improviste par le premier violon. – Fugue sur un thème donné, entièrement conduite d’après les lois du contre-point. – Trio dans lequel le signor Amadeo jouera sur le violon une partie improvisée. » Il est triste de voir le nom de Mozart mêlé à une semblable exhibition.
En assistant à Milan à la répétition générale d’un nouvel opéra de Piccini, Cesare in Egitto, les deux voyageurs trouvent le maestro sur le théâtre « et causent avec lui. » Comme partout, Wolfgang fait fanatismo dans le monde et dans les concerts publics ; mais ce succès ne contente le père qu’à demi. Il écrit à sa femme : « Ma seule satisfaction, c’est qu’il y a ici, plus qu’ailleurs, passion et intelligence pour la musique, et que les Italiens reconnaissent et apprécient tout ce que sait Wolfgang. Mais il faut presque, toujours se contenter d’être payé en admiration et en bravos, je dois ajouter en courtoisie, car tu n’as pas d’idée de la manière dont on nous accueille, dont on nous attire, chez la plus haute noblesse ; pour le reste, il ne résultera pas grand-chose de ce voyage en Italie. »
Quant à Wolfgang, il est enchanté ; il est allô sept fois aux feste di ballo de l’Opéra ; il a vu les plus belles mascarades du monde, il les décrit à sa sœur. D’ailleurs, un évènement important vient de se passer : ses succès à Milan ont été tels, qu’il a dû signer un engagement, una scrittura, pour un opéra qui sera représenté à la fin de l’année. La joie de Wolfgang éclate dans ses lettres ou plutôt dans les quelques lignes qu’il ajoute aux lettres sérieuses du père : « Je suis accablé d’affaires à en être fou ; impossible d’écrire davantage. Addio, enfant ! je baise mille fois les mains de la maman, je t’envoie cent bonnes caresses sur ton drôle de petit visage ; et, per fare il fine, je me dis toujours le même. Lequel même ? Le même arlequin. Wolfgang en Allemagne, Amadeo en Italie. » Et il signe : de Morzantini. Toutes ces petites épîtres nous paraissent empreintes d’une charmante fantaisie. Il nous semble voir Wolfgang au piano ; le père l’appelle, il faut écrire à la mère, à la sœur ; il quitte le clavier, prend la plume, jette quelques mots au hasard et retourne achever sa joyeuse improvisation.
Après la signature de l’engagement, ils partent de Milan le 15 mars pour faire une tournée en Italie. En passant à Parme, ils vont rendre visite à une chanteuse extraordinaire : c’est la signora